TELLENNE Cédric, Introduction à la géopolitique, La Découverte, collection Repères Géopolitique, 2019, 127 p.
Cet ouvrage, qui ouvre une nouvelle collection « Géopolitique » auprès de cet éditeur, réunit des qualités – signalons-le d’emblée- fort utiles pour qui souhaite comprendre les grands champs de réflexion de cette discipline ainsi que les grandes dynamiques mondiales. Il rend d’abord accessible cette approche de la géographie au plus grand nombre dans un format destiné aux lycéens et aux étudiants. Dans un style fluide et clair, Cédric Tellenne, professeur d’histoire-géographie-géopolitique en classes préparatoires économiques au lycée Stanislas à Paris, propose une synthèse réussie sur la manière de penser la géopolitique, laquelle puise une grande partie des raisonnements à travers la géographie historique. Ensuite, l’ouvrage aborde toutes les grandes questions de géopolitique tout en préservant un certain recul sur les différents courants actuels. De surcroît, il ne néglige pas les différentes manières de penser la géopolitique en sciences politiques dont la dimension territoriale constitue un des leviers d’étude.
Qu’est-ce que la géopolitique aujourd’hui ? Pour l’auteur, la manière de la concevoir et de la pratiquer a radicalement changé : « le renouveau de la géopolitique s’explique par le fait que la discipline a été refondée, à partir des années 1970-1980, sur de nouvelles bases épistémologiques : elle ne prétend plus être une science établissant des lois géographiques intangibles, mais une démarche intellectuelle qui, avec la plus grande rigueur possible, tente d’éclairer une situation de rivalités de pouvoirs et de conflits, mais aussi parfois de coopération, sur un territoire donné, quelle qu’en soit l’échelle ».
Le plan de l’ouvrage traduit cette volonté d’expliquer les différentes thématiques fortes de la discipline. Dans une première partie, intitulée « De qui la géopolitique est-elle le nom ? », Cédric Tellenne nous présente les grandes phases d’essor de la géopolitique : « l’ancienne géopolitique » du XIXe siècle et du XXe siècle à travers les grandes écoles, le « renouveau de la géopolitique depuis les années 1970-1980 », les « nouveaux champs d’analyse géopolitique » (géoéconomie, géoculture). Dans une deuxième partie, l’approche centrale traite de la « géopolitique de la puissance et des puissances », effectivement prépondérante dans grand nombre d’études et d’ouvrages. Les principales théories, les concepts et les puissances étatiques sont analysés de manière concise et toujours avec le souci de clarté. Des encarts sous la forme de focus permettent d’étayer les grandes idées par des exemples bien choisis (sur l’OTAN, sur « la Corée du Nord : puissance ou nuisance », etc.). Enfin, la troisième partie insiste sur les « grands enjeux géopolitiques mondiaux » et offre des analyses sur les dynamiques concrètes en cours : les frontières internationales et leur territoire – avec une analyse du cyberespace bien menée-, les conflictualités dans la géopolitique mondiale (guerres, cyberpiraterie, etc.), les acteurs de ces dynamiques (des États aux acteurs non étatiques comme les migrants, les mafias, etc.).
Tous les sujets importants sont ainsi traités sous la forme d’une synthèse accessible et conçue pour un large public. L’expérience du pédagogue se révèle à travers le fond et la forme. Sans nul doute, l’ouvrage constitue une première entrée vers la géopolitique qui pose de bonnes bases et nous conduit à mieux comprendre la diversité des approches.
Philippe Boulanger
BAKER Alan R.H, BLACK Iain S. et BUTLIN Robin A., 130 Years of Historical Geography at Cambridge 1888-2018, Research Series, RGS with IBG, London 2019, 171 p.
Alan Baker, Iain Black et Robin Butlin proposent un ouvrage peu commun sur le développement de l’enseignement et de la recherche de la géographie historique à Cambridge. Certains de ces prestigieux collèges comme, Trinity College et Emmanuel College, ont été des lieux de rayonnement essentiel en Grande-Bretagne. Des générations de chercheurs et d’enseignants y ont été formés et ont diffusé, à leur tour, leurs savoirs dans bien d’autres universités britanniques. Faut-il rappeler que la géographie anglaise se partageait traditionnellement en géographie physique, géographie humaine et géographie historique. Autant dire que celle-ci constitue une approche importante de la géographie anglaise qui fut notamment soutenue par la Royal Geographical Societyà la fin du XIXesiècle et renforcée lors du 6econgrès international de géographie de Londres en 1895.
L’année 1888 marque véritablement le début de cet enseignement à Cambridge par la création du premier poste de maître assistant en géographie financé par la Royal Geographical Society. La géographie historique du sacré et celle des grandes civilisations, nous apprennent les auteurs, constituent les premières thématiques fortes qui se sont diversifiées par la suite. La géographie des explorations, de l’expansion coloniale, des Etats et des subdivisions administratives, des populations et de l’économie, des paysages et de la démographie, politique et sociale à différentes périodes, ont été des approches centrales au XXesiècle. L’ouvrage nous propose d’en suivre les mutations selon une démarche chronologique en 8 chapitres : les débuts 1888-1919, les premières années 1919-1928, la réforme 1928-1945, maturité et spécialisation 1945-1966, la renaissance 1966-1976, les améliorations 1976-2003, les nouvelles directions 2003-2018.
Des grands noms mondiaux de la géographie historique y ont développé des connaissances fondamentales tel H. C. Darby qui y enseigne de 1931-1945 et de 1966 à 1976 et publie la célèbre étude Domesday Englanden 7 volumes (1954-1977)et A New Historical Geography of England(1973. Sa méthodologie et ses conclusions sont toujours des références en histoire médiévale. Il est à noter que la géographie historique de la France y a été enseignée pendant plusieurs décennies, notamment par Alan Baker qui a aussi encadré des générations de jeunes chercheurs dans les archives départementales en France entre 1976 et 2003. Les paysages ruraux et urbains, les sociétés sportives et militaires entre 1871 et 1914, et biens d’autres thématiques sur la France, ont fait l’objet de thèses de doctorats et de multiples publications. Une revue de référence, Journal of Historical Geography, y est publiée, aujourd’hui en format numérique. Si la géographie historique dans certains collèges à Cambridge continue d’être enseignée, notamment par Philip Howell et Alice Reid en démographie, David Nally et Matthew Gandy en culture urbaine et environnementale, Bill Adams en écologie politique, la discipline a toutefois perdu en rayonnement comme dans toutes les universités européennes où elle s’était installée. En 2018-2019, seulement huit professeurs sur quarante (20%) du département de géographie à Cambridge, adoptent une perspective historique dans leurs recherches, six d’entre eux développent une approche en géographie historique. Mais, comme l’écrivent les auteurs, la géographie historique est bien vivante avec des approches renouvelées qui caractérisent l’évolution de la géographie académique.
En citant tous les professeurs, leurs publications et les manifestations organisées en géographie historique, cet ouvrage se veut une mise en perspective rigoureuse et passionnante, sans équivalent outre-Manche. Ses auteurs restituent aussi ce rayonnement intellectuel à l’échelle du pays en guise de conclusion. Les appendices donnent à comprendre la profusion des réflexions et des manifestations à différentes périodes. Des cartes et des tableaux illustrent de manière précise toutes ces informations, notamment les principaux lieux des manifestations de géographie historique en Grande-Bretagne. Sans nul doute, 130 Years of Historical Geography at Cambridge 1888-2018constitue une somme de connaissances à découvrir sur les tenants et sur les axes forts de développement de cette branche de la géographie à Cambridge.
Philippe Boulanger
VADILLO Floran et PAPAEMMANUEL Alexandre, Les espions de l’Élysée, Le Président et les services de renseignement, Paris, Tallandier, 2019, 328 p.
Le domaine de l’espionnage et du renseignement continue de susciter une certaine curiosité du grand public sinon un certain mystère entretenu par la règle du secret. L’ouvrage de Floran Vadillo (Science Po Paris) et Alexandre Papaemmanuel (Ihedn), tous deux experts de ce domaine, nous apporte quantités d’informations actuelles sur le sujet bien qu’il ne soit pas géographique à proprement parler. Le regard du géographe se trouve dans l’appréhension des lieux de pouvoirs et de crises que les auteurs mentionnent (Syrie, Ukraine, etc.). Il se veut encore plus géopolitique lorsque la question porte sur les relations entre le Président de la République et les directeurs des agences dédiées à cette activité.
Car l’ouvrage ne constitue pas une synthèse de plus sur le sujet. Il est un recueil d’entretiens -parfaitement mis en forme dans un style fluide- auprès des grands acteurs du renseignement français (Bernard Barjolet, Claude Guéant, Christophe Gomart, Alain Zabulon entre autres) et étranger depuis la fin des années 2000. Il attire notamment notre attention sur le Conseil national du renseignement qui coordonne les cinq agences en France et dont la création est fixée en 2008. Qui sont les acteurs qui renseignent le Président sur les zones de crise ? Comment les agences de renseignement françaises se sont adaptées à une géopolitique mondiale toujours complexe ? Quel rouage administratif est mis en place pour donner le tempo à ces organismes qui bénéficient d’une politique de développement depuis 2008 ? Les deux auteurs nous livrent à la fois des analyses bien menées et des entretiens inédits. Il est à noter un chapitre entier consacré à François Hollande (2012-2017) qui nous apporte l’avis de l’ancien Président sur ces grandes questions.
L’ouvrage s’articule en trois parties (Naissance d’une institution, l’inconstance de Nicolas Sarkozy (2008-2011) ; Le temps des mutations (2011-2015) ; La recherche d’un supplément d’âme (2015-2017), suivies d’un appendice sur le Director of National Intelligence aux Etats-Unis en comparaison avec la situation française. Il se veut accessible pour le grand public et permet de mieux saisir la manière dont certaines crises sont appréhendées par les décideurs : les attentats sur le territoire national, les organisations criminelles internationales au Moyen-Orient et en Afrique, la crise ukrainienne depuis 2013, l’affaire Snowden en 2013 et bien d’autres.
Philippe Boulanger
BROC Numa, 2019, La géographie de la Renaissance (1420-1620), Paris éditions du CTHS, format 82, 436 p.
Le temps de la Renaissance incarne les balbutiements de la naissance de la géographie comme science actant et accompagnant l’ouverture sur les océans, la découverte du monde, sa configuration confirmée en sphère. Ce constat est un temps fort de l’humanisme traversé par des phases d’euphorie, de doutes, avec de mémorables joutes scientifiques à propos de la rotondité de la terre. Guerres de religions et solutions apportées par le concile de Trente évoquent un contexte de graves crises qui vont crescendo, avec par exemple la récupération de la cartographie au service de l’art de la guerre et de la poliorcétique. En rééditant dans un format pratique (12X 18,5 cm) l’ouvrage de Numa broc paru en 1986, les éditions du CTHS font preuve d’une heureuse initiative. Cette lecture sera utile à tous ceux qui aiment la géographie, souhaitent connaître sa genèse et encore les façons d’élaborer les cartes anciennes. Numa Broc est à la fois historien et géographe. Il accorde autant d’importance aux échelles croisées des temporalités et des espaces. Il fut un des rares géographes à prendre pour posture de travailler dans le labyrinthe du passé sans vouloir obligatoirement raccorder ce dernier à l’actuel. Pour lui, le temps la Renaissance fut un objet d’étude en soi. Il suit le père François de Dainville, entre dans la catégorie des géographes humanistes, savants, érudits. Il rapproche les territoires, les échelles, les récits de voyages et sait souligner la poésie des lieux. N. Broc s’est passionné pour la trilogie associant la cosmographie, la chorographie (ou topographie) et la cartographie. Son inventaire des cartes et portulans traduit une impression heureuse et colorée des productions faites pendant la Renaissance. Sa plongée dans les XVeet XVIesiècles. Montre des temps de tâtonnements, d’hésitations malgré les découvertes et voyages. Ces derniers sont un volet primordial de la Renaissance. La période des grandes découvertes s’entoure d’un halo d’imaginaire pour accompagner les récits des voyageurs. La géographie reste cependant sous l’ombre tutélaire de Ptolémée. Textes, lettres et récits de voyages sont repris, mis en forme par les géographes de cabinets. Marins, mécènes et cartographes ont placé leurs différents talents au service d’une œuvre commune ; la découverte progressive des terres émergées, des océans paisibles ou rugissants et encore des solitudes englacées. Une perception inquiète de la part respective de l’écoumène et des zones arides, hostiles est redéfinie.
Organisé dans la succession de quinze chapitres, ce livre retient une trame chronologique qui s’impose. Il s’agit de voyager dans deux siècles de profonds changements provoquant l’élargissement des territoires progressivement identifiés, reconnus, appropriés. L’ouvrage intègre les temps d’assimilation des découvertes, tient compte des silences et des rétentions d’informations liées au secret qui pèse sur les conquêtes et l’établissement des routes commerciales où sont espérés des profits considérables. Derrière la géographie de la Renaissance se profilent des stratégies à la fois portées par la course à la construction des premiers empires et l’égrenage des comptoirs portuaires où transitent des marchandises précieuses (épices, soie, porcelaine, or et argent, etc.).
Si l’écriture est limpide, le contenu du volume est savant, dense, très érudit. Sa lecture ne peut être envisagée comme une découverte initiale du sujet. Les chapitres sont distribués entre quatre grandes orientations thématiques. Celles-ci sont établies dans des approches croisées entre les découvertes, la construction des empires et la confection de cartes manuelles ou/et dupliquées grâce à l’essor récent de l’imprimerie. Ces beaux objets sont à la fois œuvre d’art et de sciences. Les cartes se répartissent en trois familles de produits : les cosmographies, les chorographies et les cartes. Ajoutons les portulans progressivement resautés de quotités angulaires (les rhums), enfin les atlas des routes maritimes.
D’abord, quatre chapitres pour replacer la Renaissance dans la continuité et les ruptures par rapport à l’héritage antique de Ptolémée questionné par l’élargissement progressif de l’écoumène. Ce sujet pose la confrontation entre la tradition et la nouvelle réalité actée par les grandes découvertes. L’Imago Mundi traditionnelle est ébranlée. Ptolémée est redécouvert tardivement par sa traduction latine de 1409. L’ouvrage fait sensation, bouleverse les idées géographiques de la fin du Moyen Age (p. 12). Il génère du bouillonnement intellectuel et invite à énoncer moult questions à propos de la configuration de la terre. Un atlas initial constitué de 27 cartes est rapidement enrichi, complété par de nouvelles cartes. Dès 1500, il a profité de sept éditions successives. Ptolémée est le socle stimulant sur lequel progresse la géographie de la Renaissance, jusqu’à Ortelius (1570) puis Mercator (1578). Entre temps se sont amoncelés itinéraires, journaux de voyages, enquêtes, observations astronomiques et encore quantité de compilations pouvant diffuser des erreurs, voire des images fantastiques et déformées du monde. Les données produites méritent d’être vérifiées, comparées, digérées, triées, classées. Cette tâche prend plus d’un siècle pour atteindre un stade de maturité. D’où le paradoxe suivant : « Les Renaissants ont fait progresser le savoir en regardant en arrière » (p. 28). La diffusion des connaissances est lente, parfois freinée par les rétentions d’informations qui affectent les expéditions. Le progrès nait aussi du travail des géographes de cabinet qui ont parfois de géniales intuitions. Dès 1507, et grâce au soutien du duc René II de lorraine, Waldseemüller fait paraître saCosmographia Introductio. Audacieusement, il écrit de Saint-Dié : « Une quatrième partie du monde a été découverte par Amerigo Vespucio ». Pour quelques créateurs de génie, déplorons cependant beaucoup d’épigones. Dans la saga des découvreurs se profilent Colomb, Magellan, Pinzón, Cabral et encore Henri le navigateur pour le rôle d’impulsion qu’il sut donner. Ils sont soutenus par les grandes puissances maritimes seules capables de financer des projets aussi risqués. C’est le Portugal réuni à l’Espagne en 1580, l’Espagne, puis Rome, Florence, Venise, etc. S’ensuit un glissement opéré en direction des pays septentrionaux. Ces derniers voient dans les cartes des œuvres utilitaires, des instruments de conquête (outil politique, diplomatique et militaire). La carte offre du pouvoir de persuasion et dessine un nouvel espace mental. La production est réalisée à Anvers, Nuremberg, Bâle, Venise, Amsterdam, Londres, etc. Elle évolue en établissant une grammaire des représentations, des symboles, des figurés. Avec la rose des vents et la direction de l’orientation naissent des conventions. Au XVIe siècle, sous l’influence de l’usage de la boussole, le Nord s’impose en haut. Un laborieux travail de corrections des tracés des continents s’opère. Des efforts de nomenclature s’affichent, avec en abondance, l’usage à des références religieuses pour donner des noms aux terres vierges, par exemple Santa-Cruz, Conception, etc.
En second, les chapitre V à IX dressent un état des lieux à propos du rythme irrégulier imprimé aux progrès de la cartographie. Au cours de la Renaissance, ce renouvèlement est à rapprocher du début de la maitrise de la trigonométrie. En résulte la Cosmographied’Apian (1524). Ce succès éditorial connut soixante éditions. L’évolution passe par la maitrise de la sphère qui est « univers des choses » (p. 107), sans commencement ni fin, mais avec la présence des antipodes. En publiant à Bâle saCosmographie (1544), Sébastien Münster (1489-1552) tente de donner un miroir du monde. Montaigne y vit surtout un beau guide de voyage pour organiser ses étapes de cures. Le travail de Munster est le point de départ d’une floraison de publications géographiques dressées dans différentes échelles complémentaires. Il met à la mode les portraits de ville ou vues en perspectives cavalières. Elu parmi les pères de la géographie, S. Munster en établit ses lois, créé un modèle descriptif. Ses héritiers intègrent l’héliocentrisme suite aux découvertes de Galilée, Copernic, Tycho-Brahé qui inaugurent la révolution mécaniste. Ces acquis sont valorisés, par exemple chez les Français Belleforest et André Thevet. Ces auteurs commencent également à présenter les lois et coutumes des peuples. Ainsi, Thevet fait connaître le tabac popularisé par la suite par Nicot (p. 147).La géographie devient un outil de gouvernement. N. Broc étudie les cartes dans les échelles respectives de la cosmographie, de la géographie, de la chorographie. Son principal terrain d’études est l’Allemagne. Il est soutenu par de prestigieux mécènes : les Fugger, Welser, Peutinger. Débutent également des travaux cartographiques régionaux, par exemple avec la représentation de la Suisse dès 1538, la carte des Flandres de Mercator (1540), le Berry (1567), le Beaujolais (1573), la carte de Bavière d’Apian qui bénéficie d’une véritable triangulation (1554). Ajoutons les enquêtes diligentées par Philippe II d’Espagne pour connaitre le potentiel offert par le royaume de Castille (1575-1580). L’Europe des Humanistes s’arrête à l’Est de la Pologne et au Nord du Danemark. Au-delà, l’espace demeure flou, peu visité, craint.
Le XVIe siècle fut plein de controverses et contradictions, avec des balbutiement et des allers et retours dans la maitrise des connaissances. Les contemporains sont fréquemment écartelés entre l’héritage antique et l’ouverture au monde. Trois types de cartes créent des approches complémentaires pour percevoir le monde : les cartes cadastrales ou plans-terriers, les cartes-itinéraires utilisées par les marchands et pèlerins, les cartes « particulières » qui s’efforcent de remplir les espaces rétro-littoraux. S’ajoutent à ces documents des atlas. Le plus connu est leTheatrum d’Ortelius (1570).
Les chapitres IX et X osent la confrontation entre ancien et nouveau monde. Il en ressort que la pensée du géographe de la Renaissance emprunte des chemins capricieux. S’y intriquent le réel et l’imaginaire, le respect des textes anciens et l’audace de s’en servir pour aller plus de l’avant et créer de nouvelles hypothèses. Cette posture amène à constater des écarts de temps entre la conquête intellectuelle de la terre et les voyages réels qui servent in fineà valider des hypothèses. Les découvertes et l’euphorie qu’elles entrainent fonctionnent jusque vers 1540-1550.Les grands voyages modifient les regards sur l’ancien monde et ses marges : le Proche Orient, la Perse, et plus loin vers l’Afrique. A partir des comptoirs égrenés par la thalassocratie portugaise, on évoque l’empire du Prêtre Jean, le mythique Monomotapa, nouveau Pérou où l’on espère trouver l’or, l’ivoire, l’ambre, la gomme. Partiellement, la synthèse sur l’Afrique est établie par Jean-Léon qui fut intermédiaire entre Chrétienté et Islam (p. 238). Plus loin, les continents sont seulement effleurés. Les océans sont mieux connus que les terres, en particulier les marées, les courants, les vents étésiens liés aux alizées, les vents de mousson. Dans l’océan Indien et le Pacifique, les jonques chinoises, les praos malais et les caravelles commencent à se croiser (p. 245).Cette ouverture du monde passionne Rome qui eut un pape géographe (le futur Pie II avait compilé une Cosmographie avant d’accéder au trône de Saint-Pierre en 1458) (p. 26). Dans le cadre de la Contre-Réforme, Rome affiche sa suprématie en étant le centre de documentation géographique le plus actif du monde. Les papes Pie IV et Grégoire XIII font peindre des cartes en fresques sur les murs de leurs palais (p. 322). La ville éternelle dispose d’éminents savants avec les membres de la Compagnie de Jésus. Le concile de Trente amorce leur puissant mouvement missionnaire conservé dans les « Lettres indiennes », les rapports envoyés à Rome sur l’état des pays visités ou investis. Par exemple le père Ricci apprend le mandarin, débarque à Canton en 1582 puis réside à Pékin en 1600. L’Amérique reste très inégalement relatée. L’hispanique est bien recensée grâce aux inventaires géographiques, démographiques et économiques dressés par l’administration espagnole. Les terres d’Amérique du Nord sont peu investies si l’on excepte le travail de Samuel Champlain dans l’actuelle Belle Province. Le reste du monde est seulement entre-aperçu et l’imagination va bon train à propos des antipodes qui obéissent à des logiques de symétrie. Ortelius, « le Ptolémée du XVIe siècle », a même la prémonition d’une immense Terra Australis, ce qui attisera la curiosité des savants jusqu’aux découvertes des marins du XVIIIe siècle.
Les derniers chapitres (XII à XV) évoquent la consolidation de la géographie après avoir assimilé et rapproché l’héritage antique et les grandes découvertes. La fièvre des découvertes a précisé les contours du monde transcrit sur le papier. Cohabitent plusieurs types de projections : cordiformes, carrées, ovales, stéréographiques (p. 278). On aboutit à une représentation de la terre en une seule figure, exempte de discontinuités. La Renaissance correspond au temps des atlas. Celui de Mercator est l’aboutissement de toute sa carrière. Ce projet dure de 1569 à 1590. Des notices historico-géographiques sont placées au recto des cartes. Suivent des atlas nationaux, par exemple le Théâtre Françoisde Bourguereau qui a été étudié par le père de Dainville en 1960. Paraissent également des atlas nautiques, voire des recueils de cartes d’îles. Cette abondante production s’effectue principalement à partir d’Anvers où résidait l’imprimeur Plantin, puis à Amsterdam. A compter du début du XVIIe siècle, les villes de la mer du Nord supplantent Lisbonne, Séville et Venise. Dans le contexte de plus en plus troublé de la fin du siècle, les plans de ville établis en vue oblique ou les plans géométriques remplacent les portraits de ville. Ils montrent le passage des cartes heureuses affichant la prospérité des temps de paix aux cartes utilisées pour attaquer, conquérir. Il s’agit des levées établies par Tassin ou Chastillon pour engager un siège.
La typologie qui vient d’être énoncée souligne la diversité et la richesse de la géographie renaissante. Sur un pas de temps débuté dès le Quattrocento, elle lie son avenir aux mathématiques, à l’optique, l’anatomie, la géométrie (p. 299). Dès 1503, cette rencontre des disciplines fut institutionnalisée à Séville où laCasa de Contractacioncroisait les questions économiques, le rassemblement des documents, la fabrique des cartes et encore le fonctionnement d’une école navale (p. 311).
Pour terminer, le livre évoque les empreintes de la Renaissance géographique sur l’art pictural et la littérature. Le mot paysage nait avec la Renaissance, le terme artialisation qui fut initié par Montaigne est également contemporain. La présence de cartes est attestée dans les ateliers des peintres et les boutiques des marchands. Léonard de Vinci associa l’art et la géographie (p. 328). Les grandes découvertes renouvelèrent les thèmes d’inspiration, réveillèrent le sentiment de nature. Elles favorisèrent l’essor des cabinets de curiosités. Les continents furent présentés par des allégories, La perspective et les projections progressèrent. Laïcisation, humanisation et rationalisation gagnèrent les esprits. Enfin, la géographie investit la littérature, souvent via l’utopie (Thomas More) ou les fabuleux voyages (Rabelais dans Pantagruel-1532). Montaigne rédige un chapitre intitulé Des Cannibales.
Numa broc a produit une somme scientifique érudite et exhaustive pour traiter son sujet. La Géographie de la Renaissance méritait l’effort de réédition engagé par les éditions du CTHS. Elles se mettent au service d’une redécouverte d’un travail éclairant un temps fort de notre civilisation judéo-chrétienne. Sur un pas de temps de deux siècles s’impose une nouvelle vision de l’espace. Les contemporains sont bénéficiaires d’horizons considérablement agrandis. La planète s’y révèle, parfois par des chemins capricieux. La progression de la géographie s’accommode de rythmes lents ou accélérés. Numa Broc nous fait vivre la conquête intellectuelle et matérielle de la terre. Il a démontré que la Renaissance fut un temps d’éducation à la géographie des élites.
Jean-Pierre Husson, U. de Lorraine
SAPIN Guy (sous la dir.), Les villes atlantiques européennes, une comparaison entre l’Espagne et la France (1650-1850), Presses universitaires de Rennes, 2019, 285 p.
Cet ouvrage collectif, dirigé par Guy Sapin (université de Nantes), s’inscrit dans la continuité de plusieurs travaux publiés sur ce thème par le même éditeur. Il vient compléter une somme de connaissances sur le concept de « ville atlantique européenne ». Il apporte aussi une nouvelle dimension scientifique au sujet tant par l’originalité de son approche géohistorique en comparant les situations française et espagnole que par la publication de nouvelles recherches et réflexions. Le concept de ville atlantique européenne renvoie à l’intégration des villes dans les échanges de l’espace atlantique, reliant les continents européen, africain et américain. Entre 1650 et 1850, l’Espagne et la France sont deux grandes puissances de l’Europe grâce à la mise en œuvre d’un vaste système d’accumulation des richesses. La période est marquée, somme toute, par l’apogée du premier système colonial de modèle mercantiliste, le développement des révoltes revendiquant les premières formes de décolonisation, la concurrence croissante du commerce anglo-saxon (Angleterre/Etats-Unis), les transformations sociales des sociétés urbaines liées à cette dynamique économique et géopolitique. Les dix-sept contributions abordent cette orientation scientifique par le biais de l’espace urbain et de l’urbanisme valorisant ainsi une approche en géographie historique.
Pour Guy Sapin, « la ville est analysée comme un point nodal de toutes les circulations qui structurent le monde atlantique, en tant que produit de la symbiose entre ce qui lui vient de son hinterland, de son appartenance nationale et de la somme de ses relations atlantiques à toutes les échelles identifiables ». Le raisonnement est fondé sur la spatialisation des processus tout en conservant une dimension historique pour aborder cette évolution de redistribution des dynamiques urbaines et sociales. Après une introduction présentant les enjeux historiques et géopolitiques des deux Royaumes, l’ouvrage s’articule en trois grandes parties de manière équilibrée : dynamiques atlantiques et évolution des villes portuaires, dynamiques atlantiques et transformations des sociétés urbaines portuaires, dynamiques atlantiques et morphologie urbaine des villes portuaires.
Ces trois parties contribuent à comprendre la dynamique de transformation de la hiérarchie portuaire en valorisant une approche comparative entre les villes. Les auteurs analysent les spécificités des villes atlantiques européennes qui se distinguent des villes de l’intérieur et de celles des Amériques. Celles-ci se caractérisent par leur développement comme centres attractifs commerciaux ou comme bases navales comme Donastia-San Sébastian, Ferrol, Nantes, Bordeaux, Avilés, Gijón, Santander, La Rochelle, Cadix ou les arsenaux entre autres exemples. Elles révèlent aussi leur connexion à un vaste réseau d’échanges où l’activité entrepreneuriale privée prend le pas sur le système du monopole de plus en plus contesté. Enfin, cet essor d’activités économiques et militaires participe à remodeler l’espace urbain, à créer des villes nouvelles et à les embellir grâce à une nouvelle élite de négociants au siècle des Lumières. Tous ces éléments conduisent à faire émerger une nouvelle forme d’attractivité spatiale que renforcent les mobilités socio-culturelles et leur cosmopolitisme. Malgré un appareil cartographique parcimonieux, force est de constater la qualité scientfique des analyses sur l’essor des villes atlantiques européennes entre 1650 et 1850 qui en fait un ouvrage incontournable sur le sujet.
Philippe Boulanger
ANCEAU Eric et TEMPLE Henri, Qu’est-ce qu’une nation en Europe ?, Presses universitaires de la Sorbonne, collection Sorbonne essais, 2018, 332 p.
Dans la nouvelle collection Sorbonne essais dirigée par Olivier Forcade et Danielle Seilhan, vient de paraître un ouvrage singulier qui nous aide à « décrypter les mondes de demain ». Qu’est-ce qu’une nation en Europe ? On peut penser, à tort, que la question a déjà été traitée par toutes les humanités depuis des décennies. Sous l’égide d’Eric Anceau et Henri Temple, la douzaine d’auteurs nous font découvrir une autre réalité. La question est, en fait, terriblement d’actualité à l’heure des contestations populaires dans toute l’Europe, des crises sécessionnistes et des fractures naissantes en Union européenne comme le montre la crise du Brexit au Royaume Uni depuis 2016. Cet ouvrage apporte de nouvelles réflexions et propose un renouvellement des approches en la matière. Il offre une diversité thématique liée à la pluralité des expertises d’une part, une mise en perspective territoriale d’autre part comme le montrent les contributions de Jean-Pierre Doumenge (« la dimension socio-spatiale de la nation et ses conséquences sur le gouvernement des hommes »), de Robert Tombs (« Le Royaume-Uni et ses nations au tournant de leur histoire ? »), d’Hélène Dewaele Valderrabano (« L’invertébration de l’Espagne »), de Françoise Thom (« La Russie post-communiste : le « grand espace » contre la nation »). Cette approche territoriale dans une dimension historique et politique n’est cependant pas exclusive. Les autres approches disciplinaires (droit, économie, sociologie, science politique) nous donnent une perspective inédite et riche sur un concept souvent difficile à appréhender. En effet, comme le rappelle Eric Anceau, deux conceptions de la nation se sont opposées dès le XIXe siècle : celle allemande qui prône une communauté organique indépendante et conforme à l’« esprit du peuple », dès le début du siècle (Discours à la nation allemande de Fichte, 1806), et celle française marquée par « le désir de vivre ensemble » comme le défend Ernest Renan dans sa conférence en Sorbonne prononcée le 11 mars 1882. La conception française s’est imposée au cours du XXe siècle et a « ouvert la voie au processus de construction des Etats-nations ». Parallèlement, toutes les contributions s’accordent sur trois éléments constitutifs de la nation : la cohésion territoriale, les héritages historiques, l’identité commune. Elles soulignent aussi les formes de concurrences qui se sont développées depuis la fin du XXe siècle et qui font de la nation un modèle remis en cause aujourd’hui. La nation est-elle encore pertinente à l’heure du retour des superpuissances nucléaires, de la mondialisation des échanges, de la recherche d’un modèle de société supranationale, de la construction de l’Union européenne qui « substitue son droit » à ceux des Etats nationaux, de la multiplication des revendications indépendantistes (Ecosse, Catalogne) ? Les auteurs concluent que la nation dispose, au contraire, d’un bel avenir et demeurent confiants en la force des Etats-nations : « Il y a fort à parier que les nations, moyennant les évolutions de la nature, resteront le cadre des démocraties et du concert international ». Tout l’intérêt de l’ouvrage est d’en comprendre les dynamiques, les orientations et les représentations. Celui-ci se révèle non seulement comme une synthèse habile et claire mais aussi comme un ouvrage de réflexion scientifique de référence réunissant des approches complémentaires.
Philippe Boulanger
DAINVILLE (père François de), Le langage des géographes. Termes, lignes, couleurs des cartes anciennes (1500-1800), préface de Hélène Richard, Cécile Souchon et Jean-Louis Tissier, Paris, éditions du CTHS, collection géographie, 2018, 301 p.
Publiée en 1964, cet outil indispensable pour qui s’aventure dans les riches problématiques portées par la géographie historique et l’étude des cartes anciennes, était devenu presque introuvable. Saluons l’heureuse initiative de cette réédition et en particulier l’action des préfaciers pour faire aboutir ce projet. François de Dainville était entré dans l’ordre des Jésuites, avait soutenu en 1940 une thèse intitulée « la géographie des humanistes », était directeur d’études de cartographie historique occidentale. Il nous avait éclairé sur la sémiologie graphique des cartes où lentement s’établissait une grammaire, des cadrages, des méthodes rigoureuses. Son pas de temps étudié débute avec la Renaissance (le mot géographe paraît en 1557 et remplace le mot cosmographe) et est stoppé par les décisions de la Commission de 1802. Celle-ci uniformise les conventions, impose l’échelle métrique. Contemporain de R. Barthes, P. Ricoeur, M. Foucault, F. de Dainville participe au renouvellement de la recherche en sollicitant la linguistique. Il préfère le mot langages utilisé au pluriel à langue décliné au singulier. Pour lui, la carte use en effet à la fois de mots, de graphismes, de signes et de couleurs afin de créer des représentations choisies, sélectionnées, orientées. Il avait bâti une sorte de dictionnaire des cartes et plans, avec en appui un abondant glossaire donnant l’étymologie latine du mot, des comparatifs avec l’allemand, l’anglais. Son livre est une œuvre de maturité. Il est nourri des nombreux travaux qui ont précédé ce texte, fruit d’une immense érudition. Chaque mot est positionné par rapport à Furetière (1690), à l’Encyclopédie (1751), au dictionnaire de l’Académie (1762) et encore à celui de Trévoux (1771). L’immense travail de fiches et récolement d’informations qui précède la publication de ce guide aboutit à une organisation en trois parties. D’abord les critères de la représentation de la planète. Ensuite, l’approche analytique des différents types de cartes produits : cartes terrestres, marines, civiles, stratégiques, avec un texte proposé sous le titre de Géographie naturelle (p. 71-141). Enfin un dernier chapitre nommé avec sobriété Géographie historique (p. 143-197). Succèdent encore une vingtaine de pages de conclusions et synthèses, une sélection de planches et enfin un gros index rendu indispensable par l’ordonnance de sa recherche. Comme le Père Lubin créateur du premier ouvrage sur le sujet « Mercure géographique ou le guide du curieux des cartes géographiques » (1678), F. de Dainville prit le parti d’aller des mentions et notions les plus générales pour descendre aux plus particulières. Ce choix proscrivait l’ordre alphabétique.
La géographie astronomique forme la première partie du volume. Successivement sont traitées la cosmographie puis les représentations de la terre, avec moult dessins et projections pour expliquer la lente évolution des progrès mis en œuvre. Le choix d’une succession de définitions érudites apporte une masse considérable de vocabulaire, en particulier sur la genèse de mots essentiels pour la discipline, par exemple le mot « carte » et ses diverses déclinaisons (militaire, chasse, marine, carte faite à la main, gravée), le « plan » (terrier, de forêt, cadastral), l’« échelle », l’« atlas ».
Le second livre est appelé Géographie naturelle, notion qui recouvre l’anémographie ou étude des vents, brises, moussons, tourbillons, bourrasques, etc., puis l’hydrographie. Il est rappelé que le bleu ne fut pas toujours la convention pour colorier les mers, quepontossignifie haute mer, que les Naudin ont mentionné l’« estrain » (estran) ou laisse de haute mer de vive eau ordinaire, que la cote dangereuse est réputée sale ou saine (p. 91). Potamographie réfère aux eaux continentales (p. 96-114). Succèdent à ces propos l’énoncé des formes de terrain, avec d’originales interprétations du relief pour arriver, à la fin du XVIIIe siècle, à la représentation de la topographie par des sections horizontales équidistantes ; la commission de 1802 arbitrant en faveur des lignes de plus grande pente (p. 117). Le traitement de la végétation et des cultures (p. 128-142) n’est pas à mon sens le plus réussi alors que bois et terres nourricières exercent sur toute l’époque concernée un rôle essentiel, avec en arrière-plan la récurrence des disettes et famines. Les dictionnaires de Paul Fénelon (1970) et Pierre Morlon, François Sigault (2008) renseignent abondamment sur le sujet et méritent une lecture croisée avec Le langage des géographes.
La dernière partie intitulée Géographie historique est essentielle, probablement la plus riche mais aurait mérité un chapeau introductif. Elle traite des villes mises en plan ou en élévation, partageant l’idée de civitas, de réunion de citoyens formant un corps. Elle énonce les lieux militaires, religieux puis les formes d’habitats agricoles (jas, bergeries, bordes, mas, censes, etc.), enfin les espaces proto industriels, et au premier chef d‘entre eux les moulins, machines à moudre, à scier, concasser, battre le fer, etc. Les grands chemins qui précédent les routes (en particulier celles des Lumières qui firent l’admiration d’Arthur Young et de bien d’autres), les chemins ferrés, de traverse, forains montrent la richesse de la trame viaire déclinée en itinéraires, relais de poste, étapes de foires pour des divisions territoriales administratives et religieuses complexes, parfois confuses, mal superposées.
Les vues de synthèse qui ferment le livre sont essentielles, nécessaires à la compréhension de la coordination du travail engagé, probablement précurseur d’une approche systémique articulant échelles spatiales, temporelles et, fruit de leur rapprochement la compréhension matricielle des territoires. En douze pages denses, elles traduisent l’objectif ambitieux conduit par l’auteur soucieux de coordonner, d’établir du lien entre les mots, les signes, l’usage et la signification des couleurs. Les mots des géographes évoluent avec la richesse de la langue jugée ronde au XVIe siècle, précisée et ordonnée au siècle suivant sous la férule des ingénieurs géographes du Roi, enrichie au temps des Lumières par les emprunts faits à la fois aux spécificités locales et à la technicité qui gagne la discipline, avec également l’éjection de mots anciens et l’accueil de beaucoup d’autres. Les signes référant à l’objet ou à la qualité se traduisent en lignes, lieux et surfaces (p. 206). Les conventions d’écriture participent à la compréhension des signes qui sont à la fois le reflet de l’œil et de l’esprit occidental. Enfin, les couleurs constituent un langage partagé entre ceux qui conçoivent et ceux qui lisent les cartes.
La conclusion de l’auteur mérite d’être rappelée. A hanter le langage des géographes des siècles passés, nous avons à trier entre ce qui est encore aujourd’hui familier et ce qui est tombé en désuétude. Cinquante-quatre ans après la sortie de la première édition de ce volume, ces remarques résonnent encore bien à nos esprits, et sont renouvelées, problématisées autrement. Les possibilités offertes par les récentes analyses des cartes anciennes révolutionnent nos approches et surtout démocratisent à tous l’usage des cartes, plans et cadastres anciens de plus en plus mis en ligne. Croisés avec des traitements en SIG ou des balayages LIDaR, ces documents sont infiniment plus bavards qu’ils ne l’étaient à l’époque où F. de Dainville effectuait ses travaux.
Jean-Pierre Husson
SINGARAVELOU Pierre et ARGOUNES Fabrice, Le monde vu d’Asie, une histoire cartographique, Mnaag Seuil, 2018, 190 p.
Cet ouvrage est le catalogue de la remarquable exposition Le monde vu d’Asieorganisée au musée national des Arts asiatiques-Guimet, du 16 mai au 3 septembre 2018, par l’historien Pierre Singaravélou et le géographe Fabrice Argounès. L’exposition comme l’ouvrage résultent du mariage de l’histoire et de la géographie, ce dont il faut se féliciter tant la qualité d’ensemble donne du plaisir à apprendre et à découvrir un sujet méconnu en France.
Comment les cosmographes, les souverains, les savants, les pèlerins, les commerçants et les géographes asiatiques donnent à comprendre le monde depuis les premières représentations cartographiques ? Telle est la problématique de l’ouvrage qui vient remettre en cause notre européocentrisme. Les auteurs ont souhaité présenter une évolution de la cartographie du continent asiatique non pas du point de vue occidental mais à partir du regard asiatique. Ils montrent la façon dont les cartes réalisées depuis plusieurs millénaires traduisent une modernité inégalée en Europe avant le XIXesiècle ainsi que les échanges entre les royaumes d’Asie et avec les autres régions du monde. Il faut saluer ainsi une posture scientifique audacieuse qui se révèle très instructive pour le grand public comme pour les chercheurs. Parallèlement, contrairement à l’histoire de la cartographie européenne, il est intéressant de noter que les militaires, contrairement aux services géographiques militaires qui se sont développés à partir de la fin du XVIIesiècle en France ou dans les pays germaniques comme latins, n’occupent pas un rôle spécifique. Ce constat révèle ainsi bien une différence importante dans la manière de concevoir l’espace et de le représenter par les cartes au profit du souverain.
L’ouvrage s’articule en six chapitres, précédés d’une riche introduction, qui révèlent les grandes évolutions de la réalisation cartographique en suivant les principales dynamiques d’échanges régionaux et mondiaux : « L’Himalaya, au centre du monde », « de la cour palatine aux marges barbares », « le décentrement du monde », « occidentalismes ? », « les cartes asiatiques en Europe ». Pierre Singaravélou et Fabrice Argounès mettent en évidence, avec une grande précision dans le propos et la synthèse scientifique, une histoire de la cartographie qui diffère bien de celle connue en Occident depuis l’Antiquité. Ils montrent que les premières conceptions cartographiques sont liées aux croyances religieuses et aux représentations cosmographiques hindou, jaïn, bouddhiste et taoïste. L’Himalaya et le mont Meru sont ainsi au centre des premières représentations dans la cosmologie bouddhique où il est à la fois exposé les offrandes au dieu protecteur et les montagnes. Parallèlement, la première mention d’une carte du monde dans la littérature chinoise se découvre dans le traité de géographie et de mythologies (le Livre des monts et des mers) rédigé entre le Vesiècle av. JC et le IIIeap. JC. Toutefois, beaucoup de cartes sur bambous, papier, bois ou soie ont été perdues à travers les siècles à l’exception des cartes gravées dans la pierre, telle « la carte de Yu » (XIIesiècle), figurant sur une stèle d’un mètre de haut au 1/3 500 000 à partir d’un quadrillage probablement inventé un millénaire auparavant. A partir du XIesiècle, le monde vu d’Asie s’enrichit de nouveaux apports avec le temps long des explorations conduites par les pèlerins, les commerçants et les explorateurs en suivant la route de la Soie. Les échanges mongols aux XIIIeet XIVesiècles dans un vaste espace s’étendant de la mer Noire à la Corée, les « grandes découvertes » de Shang Qian et de Zheng He, entre autres expéditions à cette période, ont construit une représentation de l’Asie-Monde qui se rencontre encore en Corée, au Japon et en Asie du Sud-Est jusqu’à la fin du XIXesiècle. Il apparaît une sorte de métissage des savoirs et des techniques cartographiques pendant des siècles. En témoigne le prototype de la carte coréenne Kangnido(1402), « première carte de « l’Ancien monde », (qui)incarne ce métissage très ancien des traditions est-asiatiques. Sa partie japonaise s’inspire d’une carte nippone rapportée en Corée à la fin du XIVesiècle » (p. 24). Ce regard sur le monde évolue encore lors de l’arrivée des premiers Jésuites, dont le prêtre et savant Matteo Ricci à la cour impériale de Pékin auprès de l’empereur Wanli (1601-1610) ou des jésuites français Dominique Parrenin et Jean-Baptiste Régis (mathématiciens et géographes), entre autres, envoyés à Pékin en 1685 par Louis XIV. Ceux-ci partagent leurs techniques cartographiques avec les savants de la cour impériale et s’enrichissent des méthodes de calculs chinoises du mouvement des planètes permettant une localisation plus précise sur un plan cartographique. La mappemonde d’Ishikawa Ryusen (1688), qui place le Japon au centre (Europe et Afrique en bas, par pivotement de l’Ouest en bas et de l’Est en haut) est, par exemple, une adaptation à un autre format de la mappemonde de Ricci. La carte nipponne de l’Asie centrale (« Panorama illustré des trois royaumes »), extraite de Hayashi Shihei et produite en 1785, combine une vision traditionnelle du monde sinisé (avec la Corée dans sa sphère d’influence) et une conception européenne avec les latitudes, les longitudes et les frontières du Japon avec ses voisins. Cette nouvelle rencontre entre les cultures, qu’elles soient religieuses, politiques, commerciales et techniques, produit un « décentrement » de l’Asie qui demeure toutefois au centre du monde mais considère l’existence d’autres continents. Les échanges mondiaux au cours de cette nouvelle ère de contacts provoquent des transformations dans la manière de concevoir l’espace et de le représenter. Celles-ci s’accentuent avec l’accroissement des échanges à partir du XIXesiècle. Une nouvelle ère d’« hybridation des savoirs » se distingue à partir de la colonisation occidentale en Asie où les modes de projection comme les messages transmis par la carte tendent à se préciser au profit de l’idée de puissance régionale. « La Chine du mouvement d’auto-renforcement (1861-1895) et le Japon de l’ère Meiji (1868-1912) s’ouvrent aux traductions et adaptations des cartes européennes tout en conservant souvent des techniques qui leur sont propres » (p. 132). La projection Mercator et la plupart des conventions européennes sont ainsi introduites par le cartographe japonais Satô Masayasu, dans la seconde moitié du XIXesiècle, dans la réalisation des mappemondes japonaises centrées sur le Japon ou sur l’Europe nous apprennent les auteurs. Il apparaît aussi un accroissement du nombre de cartes urbaines, notamment pour localiser les concessions européennes en Chine (Shanghai par exemple) ou les ports japonais (Yokohama par exemple) où les commerçants européens ont des intérêts.
L’ouvrage montre que l’évolution de la représentation cartographique de l’Asie par les savants asiatiques est faite d’enrichissements par les échanges et résulte de procédés techniques souvent très avancés pour leur époque. La qualité des illustrations (photographies anciennes, dessins) et, surtout, celle des cartes publiées en couleurs en témoignent. L’ouvrage les restitue avec une grande clarté. Les commentaires comme les analyses, les cartes originales judicieuses choisies, accompagnées de croquis de synthèse pour en simplifier la lecture en double page, nous invitent à voyager dans ce temps long de la réalisation cartographique à l’échelle d’un vaste continent qu’est l’Asie.
Cet ouvrage d’histoire de la cartographie l’est aussi en géographie historique sous l’angle de la représentation d’une vision du monde asiatique dans ses rapports avec les autres cultures cartographiques. Il nous offre une ouverture culturelle sur un sujet souvent méconnu du public français. En s’inscrivant de manière complémentaire à l’exposition, organisée par les auteurs au musée nationale des arts asiatiques à Paris en 2018, cet ouvrage s’impose comme une référence incontournable.
Philippe Boulanger
TRANCHANT Mathias, Les ports maritimes de la France atlantique (XIe-XVe siècle), volume 1 : tableau géohistorique, Presses universitaires de Rennes, 2017, 261 p.
Mathias Tranchant (maître de conférences en histoire médiévale à l’université de La Rochelle), nous fait découvrir une synthèse inédite et jamais vraiment traitée autant par les historiens que par les géographes de l’essor maritime français. Il montre que le dispositif portuaire de la France atlantique s’est mis en place surtout entre le XIeet le XIIIe siècles, avec de rares créations entre le XIVe et le XVe siècles, parallèlement aux grandes mutations agricoles et proto-industrielles qui sont enclenchées en Europe occidentale à la même période. Toutefois, ces ports médiévaux ne sont que de modestes sites pour la plupart, souvent peu aménagés à l’exception de quelques emplacements comme dans les estuaires de la Garonne, de la Loire et de la Seine. Ils sont parfois des rivages où les marchandises sont habituellement débarquées ou embarquées. Dans d’autres cas, ces activités de transbordement suscitent quelques aménagements et un regroupement de populations. Toujours est-il que ce processus de développement est enclenché durant cette période.
L’originalité de cet ouvrage consiste à étudier les territoires portuaires trop souvent délaissés au profit d’autres thématiques dans un esprit de synthèse. « Nos connaissances à leur endroit sont restées pour le moins lacunaires et hétérogènes. Les ports stricto sensu, considérés en tant que territoires à part entière et non pas comme de vagues appendices urbains ou de simples outillages du commerce, n’ont que très peu attiré l’attention » (p. 7). Qui plus est, ce sont surtout les ingénieurs à la fin du XIXesiècle, puis les travaux de l’économiste Marcel-Adolphe Hérubel dans les années 1920-1930, qui s’y sont surtout intéressés. L’unique étude de synthèse couvrant les ports de la France du Nord à l’Algérie avait été produite par le ministère des Travaux publics consacrée aux Ports maritimes de la France(13 volumes) publiée entre 1878 et 1899.
L’ouvrage de Mathias Tranchant vient donc apporter une somme de connaissances sur une période précise (la seconde moitié du Moyen-Age) malgré les nombreuses difficultés qui caractérisent la recherche scientifique en la matière. Commencée en 2011, cette étude est produite à partir de l’analyse des archives nationales et départementales (quand elles existent), des nombreuses monographies régionales réalisées depuis le XIXesiècle. Elle a conduit à la réalisation d’une base de données consacrée au fait maritime et aux 623 sites portuaires identifiés en s’appuyant, notamment, sur les séries du Trésor des Chartes et du Parlement. Elle s’inscrit également dans un renouvellement des études des sociétés et des espaces littoraux. Alors que les historiens plus spécialisés dans la seconde moitié du Moyen-Age ont étudié les sociétés littorales, les trafics, les types de marchandises ou les navires, l’auteur adopte une approche à mi-chemin entre l’histoire et la géographie à une période donnée - ce qui est le propre de la géographie historique – en s’intéressant à l’évolution des espaces que ce soient les berges aménagées, les quais, les villages ou les villes portuaires. Le plan de l’ouvrage en dix chapitres adopte d’ailleurs une approche régionale consacrée aux ports de Gascogne, de la Gironde et des basses vallées de la Garonne et de la Dordogne, du Saintonge, Aunis et Bas-Poitou, de la Basse vallée de la Loire, de Bretagne, de la Normandie occidentale, de la Basse vallée de la Seine, de la Normandie orientale, de Picardie et du Boulonnais, de Flandre.
Nous apprenons ainsi beaucoup sur les populations qui occupent ces espaces, mais aussi sur quantité d’autres thématiques : les risques environnementaux comme l’envasement de certains sites et le processus d’érosion contre lesquels les hommes tentent de lutter (endiguement, écluses, jetées voire déplacement du site portuaire), les politiques locales d’aménagement des territoires, la vie littorale des populations qui préfèrent s’installer à distance des rivages en raison des risques naturels, les mutations spatiales des ports de toute taille qui se développent pour répondre à la croissance économique, la disparition de certains qui ne pouvaient plus accueillir de nouveaux navires d’envergure, les enjeux maritimes et les rivalités de pouvoirs entre les seigneuries ou entre les négociants, les pêcheurs et les agriculteurs liées à l’exploitation des espaces littoraux, les problématiques juridiques de développement territorial entre autres aspects. Enfin, il est à noter la qualité de la représentation cartographique des sites portuaires (83 cartes) dont l’utilité sera exploitée par les aménageurs du territoire, les autorités publiques comme par la communauté universitaire. Au final, force est de remarquer la qualité de cette étude de géographie historique qui vient combler un vide de connaissances sur le sujet et qui ouvre une œuvre collective scientifique plus large avec d’autres ouvrages d’histoire maritime en préparation.
Philippe Boulanger
KAZEROUNI Alexandre, Le miroir des cheikhs, musée et politique dans les principautés du golfe Persique, Paris, PUF, coll. Proche Orient, 2017, 274 p.
Cet ouvrage est issu d’une thèse de doctorat soutenue à l’Institut d’études politiques de Paris en 2013 et remise à jour jusqu’à l’année 2016. Il résulte d’un travail de recherche de grande qualité, mené entre 2007 et 2013, qui traite d’un sujet original et pluridisciplinaire, à la charnière de la géographie historique, politique et culturelle, des sciences politiques et de l’histoire de l’art. En effet, la représentation que nous avons des Etats arabes du Golfe laisse penser que les questions de patrimoine et de muséographie ne les concernent pas. Alexandre Kazerouni démontre le contraire à partir d’informations inédites et d’une argumentation minutieuse. Il met en évidence la multiplication de projets de musées ambitieux inscrits dans une nouvelle dynamique géopolitique de mise en valeur des patrimoines depuis les années 2000 et de rayonnement international qui modifie les rapports de forces entre les Etats. En outre, l’intérêt de l’étude dépasse le cadre même de l’approche muséographique. Celle-ci est restituée et analysée à travers le prisme des mutations politiques, culturelles et sociales de ces sociétés qui connaissent des bouleversements majeurs ancrés dans la mondialisation des échanges de tout type.
L’ouvrage s’articule en deux parties. La première, intitulée « La guerre du Golfe et les limites du musée classique » rappelle les origines des premiers musées dans la région. Si le premier est fondé à Aden en 1931, la plupart sont créés dans les années 1970 au moment des indépendances. Tel est le cas du musée national du Bahreïn fondé en 1970, du Musée national du Qatar en 1975 ou celui de Dubai en 1971. L’auteur les appelle les « musées-racine » parce qu’ils incarnent les nouveaux Etats modernes. Ils ont vocation à exposer une seule identité dans une pluralité de cultures entretenue par des migrations régionales anciennes. Ces musées s’appuient sur une architecture traditionnelle, des collections locales, un récit muséal (en arabe) justifiant la tribu au pouvoir et établi par une bureaucratie locale, des cibles essentiellement nationales, avec une médiatisation très faible. Le musée vient justifier ainsi des racines originelles arabes de la péninsule que ce soit aux Emirats arabes unis, au Qatar, au Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Koweït.
La seconde partie (« Musées et dédoublement de l’Etat au Qatar et aux Emirats arabes unis ») expose une nouvelle génération de musées dont les premiers projets apparaissent dans les années 1990 mais se développent avec une forte médiatisation à partir des années 2000. Ces projets présentent des orientations nouvelles et plus ambitieuses : une architecture nouvelle (par exemple celle de Jean Nouvel pour le Louvre Abou Dhabi en 2017), des collections internationales, un récit muséal s’appuyant sur une construction occidentale (en anglais), une médiatisation occidentale active et forte. Les Emirats arabes unis et le Qatar mènent ainsi des politiques de rente culturelle inédite pour préparer l’après-pétrole mais aussi mener une politique d’influence internationale. Pour l’auteur, deux facteurs prépondérants expliquent l’émergence de cette dynamique inédite : l’émergence d’un marché de l’art moderne et contemporain à Dubai à partir de 2005, la multiplication des projets de musées « dont les Occidentaux sont le public prioritaire et les maître d’œuvre à la fois ». Sont ainsi ouverts le Musée d’art islamique de Doha en 2008, puis le Louvre AD sur l’île de Saadiyyat au Nord-Est de l’île d’Abou Dhabi en 2017 tandis que bien d’autres projets sont toujours en cours (le Guggenheim à Abou Dhabi par exemple).
Cette évolution majeure est à replacer dans un contexte plus complexe de la géopolitique régionale et mondiale. Elle s’appuie également sur des bases structurelles. L’auteur montre que les dynasties au pouvoir modifient un ordre social établi entre elles et les élites. Les différents projets de musées, d’universités (Sorbonne, New York University à Abou Dhabi, la cité éducative à Doha) et de rencontres sportives de niveau international sont gérés non plus par une élite marchande dominante ou par une classe de fonctionnaires qui s’est imposée depuis les indépendances, mais par des agences et des organisations non gouvernementales autonomes comme Qatar Museums Authority au Qatar et Tourism Development and Investment Authority à Abu Dhabi. Ces organisations, composées de nouvelles élites internationales, venant d’Europe et des Etats-Unis, supplantent les élites traditionnelles dans la mise en œuvre de ces projets. Leur obéissance aux autorités locales et leurs compétences en matière d’expertise en font des acteurs clefs qui forment un Etat dans l’Etat. Ces nouvelles élites constituent aussi de nouvelles formes de pouvoir qui légitiment le discours sur l’art universel développé par les Etats occidentaux comme elles confortent l’assise politique des Etats du Golfe. Elles inventent une autre mise en scène des dynasties régnantes au sein de l’islam et dans les affaires du monde. L’auteur désigne d’ailleurs ces nouveaux projets les « musées-miroir » au sens où il donne à comprendre une représentation du pouvoir ancré dans la mondialisation vers les populations résidentes du Golfe et vers les Etats du monde entier. Ils deviennent ainsi de véritables outils de soft power au sens américain du terme.
L’ouvrage d’Alexandre Kazerouni apparaît comme une référence sur le sujet tant sont nombreuses ses qualités. L’argumentation est précieuse sur quantités de sujets, de dynamiques structurelles ou conjoncturelles qui concourent à transformer la géographie historique et politique des Etats du Golfe. A travers l’évolution des musées des Etats du Golfe, l’auteur nous aide à comprendre la complexité culturelle de ses populations mais aussi la diversité des stratégies étatiques et non étatiques inscrites dans des rapports de forces permanents.
Philippe Boulanger
ROSTAIN Stéphen, Amazonie, Les 12 travaux des civilisations précolombiennes, Paris, Belin, 2016, 334 p.
Depuis une quarantaine d’années, l’idée d’une Amazonie précolombienne « vierge » est mise en cause par des chercheurs de disciplines différentes, mais surtout des archéologues, non sans provoquer des débats, parfois extrêmement passionnés. Loin d’être « vide » d’hommes, cette forêt aurait été beaucoup plus peuplée qu’on ne le pensait et surtout aménagé de manières très variées et donc modifiée par les populations que les conquérants européens ont appelées indiennes.
Avec ce livre, Stéphen Rostain, le premier archéologue français à s’être spécialisé dans la période précolombienne de l’Amazonie, nous fournit une synthèse de plusieurs décennies de travaux archéologiques. Soucieux de mettre en valeur les achèvements des civilisations amazoniennes avant 1492, l’auteur dresse un parallèle avec ceux de la civilisation grecque telle qu’elle apparaît à la lecture du mythe d’Hercule et de ses 12 travaux. L’ouvrage a par conséquent 12 chapitres donc chacun établit une comparaison entre un aspect des sociétés précolombiennes et le monde grecque (archaïque) selon la mythologie. Le combat contre le taureau de Minos, symbolisant la domestication, est ainsi comparé à la domestication, notamment des plantes, en Amazonie ; le nettoyage des écuries d’Augias, que Hercule accomplit en dérivant les fleuves Alphée et Pénée vers ces écuries sales, qu’il laissa sécher ensuite, est mis en parallèle avec l’assèchement des terres basses par la technique des champs surélevés, étudiée par l’auteur, notamment sur la côte des Guyanes.
Les échanges à longue distance entre les populations précolombiennes d’Amazonie supporteraient facilement la comparaison avec le périple qu’impliquait la tâche d’Hercule de ramener le troupeau de Géryon d'Erythie. Dans l’ensemble, l’auteur défend les thèses d’une Amazonie beaucoup plus densément peuplée avant la conquête par les Européens, telles qu’elles sont mises en avant par un certain nombre de chercheurs, comme Michael Heckenberger ou William Denevan et appuyées entre autres sur l’étendue des « terres noires » d’origine anthropique les terras pretas.
La majeure partie du continent, croyait-on, n’avait qu’un peuplement claire-semé, fait de tribus de chasseurs et de cueilleurs. Une explication étrange, du point de vue d’un géographe, se serait maintenue parmi les archéologues jusqu’aux années 1960 pour rendre compte de ce contraste entre les terres basses amazoniennes et les civilisations andines: le milieu amazonien aurait été tellement contraignant que de grandes sociétés structurées avec un Etat n’auraient pas pu s’y constituer. L’auteur critique ce « déterminisme écologique », débattu, rejeté, revisité, par les géographes depuis longtemps. Selon Stéphen Rostain, le milieu amazonien a vu se développer des sociétés complexes, ayant fait preuve d’une grande inventivité pour modifier l’environnement. La forêt vierge serait un mythe né de la perception d’une sylve qui se serait développée à la suite de l’effondrement démographique, provoqué par le choc microbien.
Ne passons pas sous silence que ces conclusions sont contestées par un certain nombre d’écologues et paléo-environnementalistes. Un certain nombre d’idées et de concepts proposés par la géohistoire mériteraient aussi d’être appliqués et testés au regard de la validité de cette théorie d’une Amazonie profondément anthropisée avant le premier contact avec l’Ancien Monde. Comment se fait-il qu’à l’échelle du continent, les grands foyers de peuplement amérindiens précolombiens, celui des Andes (Incas) et du haut plateau du Mexique (Aztèques), concentrent toujours l’essentiel des populations amérindiennes aujourd’hui et ont donc pu se reconstituer, après le déclin démographique indéniable consécutif à la conquête, alors que le bassin de l’Amazone si densément peuplé au début du XVIe siècle, comme le postulent certains, n’a pas pu se régénérer ? Même si l’Amazonie était moins densément peuplée que les foyers de civilisations de montagne, mais davantage qu’on ne le pensait, pourquoi cet écart entre leurs poids démographique relatifs aujourd’hui ? L’étude de la géographie historique du peuplement et son évolution différenciée après 1492 serait ici certainement riche d’enseignements.
L’ouvrage est richement illustré avec de nombreuses photographies prises par l’auteur, mais aussi avec une iconographie produite par les Européens conquérants, et témoigne de la grande érudition de l’auteur et de l’étendue de ses travaux de terrain.
Nicola Todorov
BROERS Michael, The Napoleonic Mediterranean. Enlightenment, Revolution and Empire, New York, I. B. Tauris, 2017, 368 p.
Spécialiste de renom du Premier Empire, Michael Broers est certainement l’un des historiens qui ont contribué le plus à renouveler l’historiographie de cette période, largement labourée par la recherche depuis deux siècles, mais abandonnée pendant un moment par les universitaires français, par son approche spatiale de cet « épisode » de l’histoire européenne et mondiale. On lui doit notamment la conceptualisation de la réception différenciée des réformes napoléoniennes des différentes parties de l’Europe napoléonienne par sa distinction entre un « inner » et un « outer » Empire, dont les limites ne recouvraient pas le découpage politique traditionnel.
Il nous livre là un ouvrage qui repose sur ces travaux historiques entamés depuis un quart de siècle au moins, ayant débuté avec ses recherches sur l’Italie napoléonienne. Comme le titre, le laisse deviner, Michael Broers reconnaît dans ce livre sa dette envers Fernand Braudel. Ainsi, il écrit dans l’introduction : « L’association braudélienne de l’histoire et de la géographie est toujours restée fondamentale pour moi ». Selon Michael Broers, l’environnement et la géographie humaine méditerranéens joueraient un rôle aussi considérable dans la compréhension du résultat de l’entreprise napoléonienne qu’ils ne le firent dans la compréhension de la Méditerranée de Philippe II plus de deux siècles avant.
L’ouvrage reprend une partie des articles que l’auteur a publié auparavant dans des revues de renom, mais comporte aussi des chapitres neufs, fondés sur de la recherche archivistique récente, notamment sur la Catalogne napoléonienne. Les huit chapitres de l’ouvrage sont répartis sur trois parties.
La première partie du livre est intitulée « La géographie historique de la Méditerranée napoléonienne » (The Historical Geography of Napoleonic Mediterranean). Le chapitre 2 « The Myth and reality of Italian regionalism. A historical geography of Napoleonic Italy 1801-1814 » montre qu’au-delà d’une apparente diversité régionale, la structure compartimentée de l’espace méditerranéen faisait apparaître un même modèle. Alors que des monographies historiques régionales traitent généralement le royaume d’Italie au Nord et celui de Naples comme deux entités, en dépit de leurs fortes disparités internes, Michael Broers leur reconnaît, de même qu’à la partie de l’Italie directement annexée à l’Empire français, une unité spatiale de microrégions toutes constituées d’une plaine côtière, urbaine et centrale, et une périphérie montagnarde. Les sociétés de ces types d’espaces réagirent différemment à l’impulsion extérieure, venue de France.
Si l’on comprend bien l’auteur, les administrateurs français ne s’appuyèrent guère sur les élites urbaines traditionnelles pour gouverner ces périphéries et poussèrent leur intégration plus loin que tous les Etats précédents. Ce sont ces espaces périphériques, considérés comme « sauvages » et les moins « civilisés » par les administrateurs napoléoniens qui ont posé le plus de problèmes à l’intégration dans l’Empire napoléonien. Le chapitre 4 s’intéresse à la confrontation des visions différentes des Lumières françaises et italiennes dans la mise en place du système judiciaire en Catalogne, où l’auteur oppose deux types d’espaces différents. Dans son chapitre consacré à l’administration judiciaire des provinces illyriennes, sur la côte orientale de l’Adriatique, une véritable « guerre à la géographie » aurait dû être menée tant l’implantation du système hiérarchique français s’est heurté à la géographie humaine. Par ailleurs, la géographie politique de l’ordre ancien a fait preuve d’une inertie particulièrement prononcée dans cette partie balkanique de la Méditerranée napoléonienne. Mais alors que le système féodal y apparaissait aux Français le plus archaïque, leur volonté de supprimer le régime seigneurial y a été la plus déterminée. C’est dans ces provinces que le régime napoléonien aurait le plus nettement renoué avec ses origines révolutionnaires.
La dernière partie « Pride and prejudice » traite la question de la culture politique, de question de l’impérialisme culturel et des perceptions. A l’aide d’exemple de personnages-clé, l’auteur étudie la transformation des élites et l’application des réformes judiciaires dans les différents territoires annexés de l’Italie, du Piémont aux départements romains. Ainsi, le dernier chapitre analyse les effets de la « conscription » sur les élites aristocratiques romaines.
Il s’agit d’une œuvre stimulante qui reflète la profonde pensée et l’impressionnante érudition de l’auteur ainsi que la vaste étendue géographique de ses recherches historiques.
Nicola Todorov
LAZZAROTTI Olivier, Une place sur Terre ? Franz Schubert, de l’homme mort à l’habitant libre, HDiffusion, 2017, 177 p.
Olivier Lazzarotti (Université de Picardie-Jules Verne) fait preuve d’une grande originalité en s’intéressant à l’approche géographique de la musique classique à travers l’œuvre et la vie d’un compositeur du début XIXesiècle, celles de Franz Schubert connu pour sa musique de chambre, vocale (ses lieder notamment), sacrée, chorale et ses opéras. Malgré un titre qui traduit difficilement la dimension novatrice de son contenu, l’ouvrage apparaît singulier à plus d’un titre. Il pose, tout d’abord, la question de la portée géographique d’une telle étude. La démonstration est concluante tant l’argumentation exposée est inédite et riche d’informations.
Dans une première partie (« L’étranger par les marges »), l’auteur aborde les parcours géographiques de Franz Schubert, tel un jeu de piste, qui le conduisent, de sa naissance en janvier 1797 à Lichtenthal, maintenant l'un des quartiers du neuvième arrondissement de Vienne, à sa mort (liée au typhus) à Vienne en novembre 1828. La vie du compositeur est parsemée de séjours dans diversesmaisons bourgeoises et aristocratiques. Si Schubert demeure principalement dans la région de Vienne, à l’exception de sept voyages d’études à moins de 300 km de la capitale impériale (comme à Steyr en 1825), il manifeste une certaine mobilité, dans un monde caractérisé par sa sédentarité, pour non seulement satisfaire ses sources d’inspiration et son exigence de création mais aussi répondre aux codes de sociabilité liée à son ascension sociale.
Les trois parties suivantes abordent une approche attendue, celle de la dimension musicologique et géographique du compositeur. Dans « l’étranger par nostalgie » (2epartie), « Franz Schubert l’affranchi : coûte que coûte » (3epartie) et « Toi, homme heureux » (4epartie), Olivier Lazzorotti traite des thèmes géographiques dans ses compositions musicales, y compris en nous faisant découvrir la spatialité de certains airs et de certaines émotions romantiques. La double dimension (musicologique et géographique) est traitée avec nuances et finesse. La nature et la Terre-mère y sont des éléments structurant dans l’imaginaire et la production musicale de Schubert qui se décline à travers plusieurs thèmes, tels la dimension sacrée de la nature, le mouvement de l’eau, le temps immuable des saisons, la faune (les abeilles, la Truite), les paysages ruraux, le compagnon-errant (le Wanderer) dont la symbolique poétique se retrouve dans la culture du monde germanique et à laquelle Schubert se serait identifié.
Cette « analyse géographique combinée des pratiques et des sons » de Franz Schubert appelle à poser de nombreuses questions nous apprend Olivier Lazzarotti : « le rapprochement entre les deux langages, deux expériences du monde, deux écritures géographiques, s’il devait avoir lieu, si la géographie schubertienne, dans toutes ses manifestations, devait être prise au sérieux, elle devrait l’être de manière plus structurelle, plus fondamentale.(…) S’y rencontre un habitant, s’y retrouve un homme. Tout comme la science géographique » (p. 103). Ainsi l’auteur nous invite à comprendre le rapport d’un créateur à son environnement habité et à en saisir la traduction poétique et musicale liée à ses représentations « géographiques ». S’appuyant sur une réelle érudition et une connaissance musicale de l’œuvre schubertienne, Olivier Lazzarotti nous offre un ouvrage peu commun et ouvert à une dimension géographique trop rarement explorée.
Philippe Boulanger
Année 2017
VALLAUX Camille, Le sol et l’Etat 1911, nouvelle édition présentée par Jean-Pierre Villard, Paris, L’Hamarttan, 2017, 302 p.
Disciple de Vidal de la Blache et auteur d’une thèse de doctorat sur la Basse Bretagne, étude de géographie humaine, Camille Vallaux (1870-1945) est plus connu pour ses nombreux travaux sur les régions océaniques de l’Europe du Nord-Ouest, l’océanographie et l’hydrologie marine. Les récents travaux de Marc Levatois (2013) ont montré son important apport dans la géographie maritime française dont La Mer(1908) constitue une œuvre centrale.
Il est aussi considéré comme l’un des pionniers de la géographie politique française (notamment en rapport avec la géographie maritime) qui manque toutefois de s’imposer dans le milieu universitaire dans la première moitié du XXesiècle. Comme le souligne l’avant-propos présenté par Jean-Pierre Villard, riche et analytique (34 pages), « on ne peut être surpris de l’oubli dans lequel est tombé Camille Vallaux aujourd’hui ». A l’exception d’une notice publiée par François Carré en 1973, nous savons peu de ce géographe qui s’est intéressé à la manière de penser le territoire en politique. Dans Géographie sociale : le sol et l’Etat, qui n’avait pas été réédité depuis 1911, nous redécouvrons un « texte fondateur de la géographie politique » qui s’inscrit dans un contexte intellectuel spécifique. Face à la théorisation de l’espace du géographe allemand Friedrich Ratzel, présentée dans Politische Geographie en 1897, Camille Vallaux propose une autre manière de considérer la géographie politique. Il s’oppose au déterminisme naturel promu par son prédécesseur allemand, critique vivement la notion d’espace (Raum) et de position (Lage). Il propose une géographie politique plus ouverte sur les dynamiques économiques et sociales, sur les conditions les plus favorables à la formation des Etats (notion de la différenciation), sur la place des frontières dans la croissance des activités humaines (dont l’originalité est rarement citée). Cette réédition du Sol et de l’Etat, introuvable dans les librairies spécialisées, ne manquera pas d’intéresser historiens et géographes férus de pensée géographique.
Philippe Boulanger
PS : Ce compte rendu a fait l'objet d'une première publication dans la revue La Géographie, n°1567, nov-dec. 2017.
TERTRAIS Bruno, L’Atlas des frontières, Murs, conflits, migrations, Les Arènes, 2016, 129 p.
« Des bonnes barrières font de bons voisins » écrivait Robert Frost. Il n’est pas de sujet plus géopolitique et géographique que celui des frontières pour nous faire comprendre certaines mutations mondiales ou régionales. Il n’en fut pas forcément ainsi dans l’histoire de la géographie à l’université tant la géopolitique, et donc l’étude des frontières, paraissait une discipline mal perçue et sujette à des orientations idéologiques. Aujourd’hui, aborder la géopolitique des frontières n’est plus autant mal aimée du monde académique, surtout quand la démonstration apporte tant à la connaissance du monde et nous aide à mieux le comprendre. Tel est le cas de ce bel ouvrage réalisé par Bruno Tertrais et Delphine Papin qui s’impose comme une référence dans ce champ de la géographie.
L’ouvrage se compose de 5 parties et de 40 cartes. Tous présentent une approche originale à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, les sujets essentiels, mais aussi bien connus des géographes, sont traités avec clarté et précision. « Les frontières en héritage », « les frontières invisibles », « murs et migrations », « curiosités frontalières » et « frontières en feu » nous conduisent à comprendre les origines, leur essor et leurs spécificités dans un monde en permanente mutation géopolitique. « Quel rôle précis joue la frontière dans l’existence de l’Etat ? ». Les auteurs soulignent le « bel avenir des frontières » tant celles-ci constituent un objet central pour l’Etat depuis la mise en œuvre de l’ordre de Westphalie en 1648. Celui-ci les reconnaît comme l’un des attributs fondamentaux de l’équilibre des relations entre les Etats.
A la lecture de l’ouvrage, nous comprenons que la frontière est un objet mouvant. Les frontières internationales terrestres, au nombre de 250 000 km dans le monde, sont en augmentation croissante depuis la fin de la Guerre froide. Les auteurs nous prédisent une nouvelle augmentation pour les années 2020 avec la délimitation de nouvelles frontières maritimes. Ceci vient ainsi nuancer l’idée d’un monde qui évoluera sans frontières internationales avec le libéralisme dominateur, idée qui avait tant séduit l’opinion occidentale et les médias à la chute du communisme au début des années 1990. Nous savons que les Etats attachent une plus grande importance à la délimitation, la fixation et la matérialisation de leurs limites sur un territoire. A la suite de sécession, d’une indépendance obtenue par référendum, de guerre ou de diplomatie, les frontières sont ainsi plus nombreuses.
Qui plus est, le monde se barriérise. Pour faire face aux effets d’une mondialisation des échanges, certains Etats clôturent et construisent davantage de murs. Afin de freiner les vagues de migrations, limiter les trafics de drogues, séparer des communautés, renforcer la défense d’un territoire, les murs se multiplient depuis 1991. Ils représenteraient 3% (7 500 km) à 17% (41 000 km) des frontières terrestres internationales, selon les modes de calculs, en Europe, en Asie, en Afrique ou dans les Amériques. Les exemples sont nombreux et attestent de ces dynamiques géopolitiques qui interpellent le géographe. Outre les frontières terrestres, les frontières maritimes font également l’objet de négociation, de délimitation et de tensions entre les Etats. Les auteurs reviennent sur ces sujets traités par d’autres mais apportent également des éclairages rarement évoqués sur les cas particuliers de frontières (les condominiums, les micronations, les Etats enclavés, les corridors, les tripoints).
« Nous vivons dans un monde fini. Il n’y a quasiment plus de « zones blanches » sur les cartes, c’est-à-dire de Terra nullius ». Les « terres qui n’appartiennent à personne » n’existent plus. Ce qui peut donner lieu à des situations insolites héritées de contexte politique ancien. Tel est le cas de la région de Cooch Behar, relativement méconnue. Composée de 192 petites enclaves de part et d’autre de la frontière entre l’Inde et le Bangladesh (3 200 km) dont les origines remontent à l’époque mongole (traité de 1713), ces situatoins présentent parfois des contre-enclaves et des contre-contre enclaves. Peuplées de 50 000 habitants, leur superficie varie de 20 km2à moins d’un hectare. Celle de Dahala-Khagraban (0,69 ha) est un morceau d’Inde dans une enclave du Bangladesh en territoire indien. De ces situations souvent complexes, que nous retrouvons aussi sur d’autres continents, le texte accessible et concis nous donne à comprendre des analyses démonstratives.
La gestion des frontières apparaît souvent source de tensions et, parfois, de conflits. Le dernier chapitre nous en expose toutes les dimensions. De la frontière entre les Palestiniens et Israël en Cisjordanie à celle entre les deux Corées, en passant par les nombreuses frontières maritimes devenues sources des tensions entre Etats (comme celles revendiquées par la Chine et les Etats riverains en mer de Chine méridionale), les exemples de conflictualités sont légion. La frontière divise aussi les milieux politiques et les opinions, entre les souverainistes et les nationalistes qui appellent à leur fermeture et à plus de contrôle, et les altermondialistes et les libéraux qui plaident pour leur atténuation, voire leur disparition pour favoriser le commerce international. Mais il serait incomplet de ne voir dans les frontières que des sujets de guerre et de tensions. D’abord parce qu’il est rare que la frontière soit au cœur d’un conflit. Celle-ci servirait plutôt de prétexte au déclenchement des conflits tant les raisons les plus importantes sont ailleurs, dans l’appropriation des territoires et de leurs ressources par exemple. Cet aspect est l’une des idées fortes de l’ouvrage. « La frontière signifie aussi qu’on a fait la paix » écrit le géographe Michel Foucher à qui cet ouvrage est dédié. Dans la plupart des cas, la frontière permet d’entretenir des relations pacifiques et de clarifier des héritages historiques. L’Etat n’est d’ailleurs plus le seul acteur de sa gestion. Des entreprises privées participent au développement d’un marché de la frontière, estimé à 20 milliards de dollars par an, pour assurer la sécurité et la surveillance de la frontière.
Parallèlement à la démonstration qui nous apprend beaucoup, la qualité de l’ouvrage repose aussi sur une infographie (élaborée par Xemartin Laborde) et une conception cartographique non seulement originale et claire mais aussi novatrice par le jeu de couleurs et les modes de projection adoptée. Chaque situation géopolitique est représentée à différentes échelles avec des messages parfaitement lisibles. L’enjeu géopolitique des murs se comprend ainsi à l’échelle mondiale, continentale, régionale et locale selon le cas abordé. Les schémas sur la localisation de la frontière sur le fleuve montrent, entre autres exemples, des qualités de vulgarisation et de précision scientifique.
Au final, nous apprenons beaucoup sur un sujet qui a fait l’objet déjà de plusieurs publications de grande qualité. Ce qui le distingue est à la fois la diversité des thèmes abordés et la qualité visuelle des cartes. Sans nul doute, voici un ouvrage à lire pour mieux comprendre les mutations rapides de notre monde actuel.
Philippe Boulanger
BAKER R.H Alan, Amateur Musical Societies and Sports Clubs in Provincial France 1848-1914, Harmony and Hostilities, Palgrave macmillan, 2017, 350 p.
Alan R. H. Baker (professeur émérite au Emmanuel College de l’Université de Cambridge) est déjà connu pour quantité de travaux de géographie historique de la France dont il est l’un des spécialistes en Grande-Bretagne. Ceux-ci concernent, de manière générale, la société française au XIXe siècle et au début du XXe siècle, plus spécifiquement les associations dans la vallée de la Loire. Associant les raisonnements géographiques à la rigueur des méthodes historiques, ses travaux sont des références dans la recherche académique. Son dernier ouvrage portant sur les sociétés musicales amateurs et les clubs de sports en France entre 1848 et 1914 s’inscrit dans cette continuité et apporte de nouvelles connaissances sur le sujet.
L’ouvrage s’articule en quatre parties : sociabilité et fraternité, les sociétés musicales, les clubs de sports, conclusions et comparaisons avec d’autres pays. L’ensemble, illustré de nombreuses cartes, aborde l’importance de la vie associative entre 1848 et 1914 dont la loi sur les associations adoptée en 1901 crée un cadre spécifique d’organisation. Comme le rappelle Alan Baker, il existe déjà près de 45 000 associations volontaires en 1900. A partir de 1901, leur nombre n’a cessé de croître comme en témoigne leur nombre en 2012 (près de 1,3 million). L’un des aspects novateurs de l’ouvrage est d’étudier le concept de fraternité sur un plan géographique, lié à la vie des associations portées principalement par les professeurs et les curés de paroisses. Il en définit les caractères et les grandes dynamiques montrant la vitalité de leurs activités sous des formes très diverses comme les fanfares de commerce ou les musiques municipales, les sociétés de gymnastique ou celles de tirs. Il démontre, par exemple, que la richesse et la diversité des associations de sports et de sociétés musicales dans les provinces sont directement liées à l’idée de construction nationale, à des valeurs sociales et humanistes, parfois en contradiction avec le rôle centralisateur et le modèle des élites parisiennes.
L’auteur souligne aussi que ce foisonnement d’activités associatives favorise une forme d’encadrement des Français dans l’esprit de la Revanche à la fin du XIXe siècle et dans le sentiment plus large d’appartenance à la nation française. Il prépare les mentalités à l’effort ultérieur de la mobilisation générale de 1914. L’adoption de la loi de 1905, créant le service militaire universel, s’inscrit dans ce contexte social où les liens de solidarité et de fraternité, de sociabilité et de compétition, sont très forts et en développement. Cette période est donc celle d’un âge d’or des associations, toutefois marquées par des inégalités régionales assez fortes. Par exemple, la cartographie des clubs de gymnastique en 1914 montre une concentration d’associations (entre 22 et 132 entités) dans l’ensemble des départements du Nord et du Nord-Est ainsi que dans certains départements du Sud comme les Bouches-du-Rhône, et du Sud-Ouest comme la Gironde et la Haute-Garonne. Alan Baker rejoint les conclusions de Xavier de Planhol dans sa Géographie historique de la France (1995). Il rappelle la permanence durant cette période de cette séparation régionale marquée par la ligne Saint-Malo/Genève. Celle-ci s’explique pour des raisons très diverses, étudiées dans le dernier chapitre, notamment la diffusion de modèle associatif et de sociabilité porté par le chemin de fer et l’existence d’une gare mais aussi par l’importance des échanges régionaux liés au réseau routier. L’auteur analyse par des exemples précis et localisés tout un éventail de facteurs qui donnent à comprendre la diversité des situations.
A partir de la consultation des archives départementales et nationales, Alan Baker réalise un travail très original et richement argumenté de nombreux exemples. Il permet de redécouvrir tous les enjeux de la vie associative française tant sur le plan social et culturel que politique. La somme des connaissances rassemblées conduit à des conclusions passionnantes et rarement traitées aujourd’hui en géographie historique française.
Philippe Boulanger
DEUTSCH Mathias, REEH Tobias, PÖRTGE Karl-Heinz, Hochwasser in Thüringen – Texte, Karten und Bilddokumente (1500-2013), Jena, Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG), 2016, 174p.
S'inscrivant dans une collection visant à informer le spécialiste aussi bien que le grand public, directement concerné par des risques actuels, l’ouvrage rassemble des documents sur plus d’une trentaine d’événements de crue et d’inondation choisis pendant plus de cinq siècles, survenus en Thuringe. L’objectif de cette publication est de rendre accessible des documents historiques illustrant des catastrophes ou en tout cas un risque naturel à un grand public afin de sensibiliser les citoyens de ce Land au risque d’inondation. L’ensemble des documents textuels, cartographiques et iconographiques est ordonné systématiquement et commenté. Dans ce but, les auteurs insistent sur l’efficacité limitée des systèmes techniques de protection des inondations à travers les siècles. Si les habitants ont les inondations récentes encore présentes à l’esprit, les auteurs se proposent de renforcer la conscience de la population de ce risque dans le sens d’une prévention durable. L’ouvrage est divisé en sept parties ou chapitres. Après avoir présenté très brièvement les objectifs du livre, les auteurs, des géographes et historiens, donnent un aperçu des sources disponibles et justifient leurs choix. Le chapitre consacré aux événements de crue historiques occupe l’essentiel de l’ouvrage (p. 11-158) dans lequel les auteurs présentent un catalogue des événements de crue connus depuis celle touchant la ville de Tonna en 1558 jusqu’aux inondations de 2013. A la fin de l’ouvrage les auteurs présentent une liste des sources inédites et publiées.
Les auteurs ont exploré 29 dépôts d’archives communales et du Land de Thuringe, mobilisant pour leur démonstration des témoignages historiques officiels et privés, des extraits de chroniques et de presse, ainsi que des photographies. Par exemple, ils reproduisent des représentations des catastrophes d’inondation de 1815 et 1890 et des écrits officiels et des informations de presse de 1909 et 1981. Ecrit dans un style clair et facile à comprendre même pour le non-spécialiste, l'ouvrage devrait atteindre son objectif d'éveiller un large public, tout en faisant une contribution pour l'étude scientifique des risques naturels dans cette partie de l'Allemagne.
Nicola Todorov
KÖDEL Sven, Die Enquête Coquebert de Montbret (1806-1812) . Die Sprachen und Dialekte Frankreichs und die Wahrnehmung der französischen Sprachlandschaft während des Ersten Kaiserreichs, Bamberger Beiträge zur Linguistik, vol. 8, Bamberg, University of Bamberg Press , 2014, ISBN: 978-3-86309-292-4, 628 p.
Spécialiste de langues romanes et historien, l’auteur nous livre une présentation d’ensemble et détaillée de l’enquête linguistique des Coqueberts de Montbret entreprise sous Napoléon, destinée à faire connaître la géographie des langues et dialectes d’un empire en expansion. Cette enquête était certes connue, mais n’avait pas encore fait l’objet d’une étude d’ensemble. L’ouvrage, issu d’une thèse de doctorat, est divisé en trois grandes parties, rédigées dans un style clair, mais respectant rigoureusement la terminologie linguistique. La première partie est consacrée aux acteurs principaux et au cadre institutionnel de l’enquête, dont les intentions sont replacées dans le contexte des théories et idéologies linguistiques de l’époque. La deuxième grande partie examine minutieusement la réalisation de l’enquête, ses acteurs nombreux, sa mise en œuvre avec ses différences géographiques et les outils des enquêteurs. L’auteur souligne que l’enquête dépassait le stade de l’inventaire statistique pour aboutir à une véritable cartographie des langues et dialectes. La troisième partie analyse les résultats de l’enquête et sa réception ultérieure ainsi son rôle dans l’histoire à la fois de la linguistique et de la géographie.
L’auteur affirme que cette enquête menée par les savants Charles-Étienne et Eugène-Barthélémy Coquebert de Montbret devait sa conception et sa réalisation en grande partie à l’entreprise d’envergure des statistiques napoléoniennes. A côté des données économiques et démographiques, ces statistiques incluaient la description des caractéristiques culturelles et ethnographiques des populations. Cette entreprise de description statistique de l’Empire, de courte durée, mais menée vigoureusement, fixait les objectifs et méthodes de l’enquête. Elle n’était donc rendue possible que grâce au cadre administratif et institutionnel de l’Empire napoléonien. Selon l’auteur, cette enquête linguistique par ses finalités et les moyens mobilisés se distingue nettement de l’enquête de l’abbé Grégoire. Le but principal consistait à identifier et classifier tous les idiomes parlés au sein de l’Empire, de les localiser et délimiter spatialement, ainsi que d’en déterminer le nombre de locuteurs. L’administration napoléonienne visait à collecter des données géographiques linguistiques utiles pour son action. S’il s’agissait à long terme d’intégrer les différentes populations très hétérogènes, dans un Empire voulu homogène, la préoccupation immédiate des administrateurs était de déterminer dans quelle langue les textes officiels des territoires annexés devaient être publiés. Car, comme on l’avait déjà affirmé auparavant, l’Etat napoléonien cherchait à donner aux administrés les moyens de comprendre les lois et décrets pour leur permettre de s’y conformer et, le cas échéant de les utiliser.
Les Coqueberts pouvaient ainsi s’appuyer sur l’administration napoléonienne : les préfets, sous-préfets, juges de paix, maires, les curés,les élites locales. Afin de prendre la mesure de la mise en œuvre concrète de l’enquête sur les langues, Sven Ködel a exploré, au-delà des archives centrales (Archives Nationales de Paris, la BNF, le musée d’histoire naturelle), les fonds de presqu’une quinzaine d’archives départementales ainsi que les archives du grand-duché de Luxembourg. Il a également pu tirer des informations précieuses du fond Coquebert de Montbret de la Bibliothèque municipale de Rouen, en plus, bien entendu, des nombreuses publications contemporaines.
Grâce à la cartographie des frontières linguistiques, cette enquête a dépassé le niveau de la collecte d’informations statistiques et a ainsi à la fois contribué au et bénéficié du développement de la cartographie thématique. Elle a également stimulé l’intérêt pour l’étude de la dimension spatiale de phénomènes descriptibles statistiquement, dont les langues et dialectes, même si l’auteur doit constater que les termes langue, dialecte, patois etc. n’étaient pas toujours rigoureusement employés dans l’ensemble du corpus de l’enquête par les nombreux acteurs. Le travail et les conclusions de Sven Ködel illustrent à notre avis la contribution importante de l’époque napoléonienne au développement de la géographie, car le cadre des circonscriptions révolutionnaires et napoléoniennes était bien un prérequis au développement de la cartographie thématique statistique, faisant apparaître des structures spatiales, qui, autrement échappaient au regard de l’observateur et ne pouvaient guère être analysé par la géographie en voie de constitution comme champ scientifique. La Société de Géographie de Paris portait un grand intérêt à ce travail. Il n’est donc peut-être pas étonnant qu’en Allemagne, comme l’affirme l’auteur, les géographes s’intéressent moins aux langues qu’en France ou dans le monde anglo-saxon. De ce point de vue, la découverte de la division linguistique de la France n’est qu’un exemple et l’apport de la période révolutionnaire et napoléonienne pourrait être illustré par des exemples dans d’autres domaines, de la géographie forestière à la géographie économique. On doit bien sûr émettre des réserves sur l’usage du terme « Sprachlandschaften » dans le titre de l’ouvrage, qui aurait pu être utilement remplacé par Sprach(en)geografie.
Nicola Todorov
TODOROV Nicola, La Grande Armée à la conquête de l’Angleterre, le plan secret de Napoléon, Paris, Vendémiaire, 2016, 295 p.
Nicola Todorov, l’un des spécialistes français de la période napoléonienne, s’intéresse dans ce nouvel ouvrage à un grand projet stratégique bien mal connu du grand public : la préparation de l’invasion de l’Angleterre après la défaite française de Trafalgar en octobre 1805. Dans un style toujours précis et une argumentation fouillée grâce à la consultation des archives et de la correspondance de Napoléon, l’ouvrage s’articule en 11 chapitres abordant tous les aspects d’un tel plan stratégique. Nous apprenons donc beaucoup à la fois sur l’histoire et la géographie d’un empire qui s’apprête à reconstruire sa flotte de guerre en puisant dans toutes ses ressources à partir de 1810. Car Napoléon, contrairement à une idée reçue, n’a jamais cessé de « venger vingt siècles d’insultes » et de mettre au pas son adversaire héréditaire. Des aspects politiques (l’échec du blocus continental) et économiques (l’aménagement des ports ou la concentration des moyens comme le bois de construction des navires) à ceux plus stratégiques et militaires (l’armement des navires, la formation des équipages de la flotte, la stratégie de l’Empereur entre autres faits), cette nouvelle étude nous ouvre les yeux sur un sujet méconnu, largement cantonné traditionnellement à la concentration des forces françaises (120 000 hommes) à Boulogne sur mer en 1804.
La thèse de Nicola Todorov est bien plus profonde. Elle vient renouveler une conception de la pensée stratégique et de la politique de Napoléon Bonaparte quant à la conquête de l’Angleterre. L’historiographie académique ne retient qu’une vision chronologique de celles-ci après-Trafalgar en sous-estimant la stratégie de l’Empereur sur la reprise de la guerre sur mer. Elle retient surtout l’idée que le blocus est la clef de voûte de la politique française. Or celle-ci doit être reconsidérée. Pour cela, l’auteur nous expose la vision et la politique de construction d’une véritable flotte dans un contexte difficile (échecs d’Aboukir d’août 1798 et de Trafalgar, pertes essuyées en ravitaillant les colonies, domination des mers par la Royal Navy). Un plan « secret », décidé en 1810, doit permettre d’obtenir une force de 109 navires pour 1812. Cette marine d’après Trafalgar parviendra justement à son apogée en 1812 qui est une période de paix sur le continent. Napoléon envisage alors deux piliers dans sa stratégie maritime : la reconstruction d’unités lourdement armées permettant de reprendre possession de la mer avant de débarquer sur les côtes anglaises, le concept « d’opération générale ». Ce dernier consiste à « appliquer la stratégie de guerre continentale à la lutte maritime, en immobilisant les forces anglaises sous la menace exercée simultanément par de nombreuses expéditions d’escadres, de flottes de transports et de flottilles, afin de permettre à l’une des escadres substantielles de l’Empire de prendre l’initiative lorsqu’elle se trouverait en situation de supériorité locale face à la marine britannique » (p. 223). La stratégie maritime de napoléon consistait ainsi à concentrer les forces de l’océan dans la Manche, notamment à Brest malgré les contraintes de l’environnement pour sortir la flotte de la rade. Toute la thèse de l’ouvrage consiste ainsi à nous en expliquer la mise en œuvre jusqu’à l’été 1813.
Philippe Boulanger
ANNEE 2016
HUSSON Jean-Pierre, La Lorraine des Lumières, voyages dans les temporalités, les paysages et les territoires, Ed. Vent d’Est, 2016, 308 p.
La région Lorraine, qui fête les 250 ans de son rattachement à la France cette année, est une terre de richesses et de transitions multiples. Alors qu’elle vient d’être intégrée au Grand Est (avec l’Alsace et Champagne-Ardenne), elle porte aujourd’hui les germes d’une nouvelle forme de développement après avoir souffert profondément de la désindustrialisation à la fin du XXe siècle. Aujourd’hui, une nouvelle génération inscrit ce territoire dans une dynamique tournée vers l’Europe. Il faut dire que la Lorraine, longtemps terre de richesses économiques et de prospérité, a profité de convergences des grands progrès du continent européen. Cet ouvrage en montre un des aspects de manière particulièrement remarquable et éclairante.
Jean-Pierre Husson, Professeur de géographie à l’Université de Lorraine et membre de l’Académie Stanislas, est spécialiste de géographie historique des aménagements ruraux, de l’histoire des paysages, des forêts et de la cartographie ancienne. A travers le prisme de la géographie historique, il nous livre une étude inédite sur les paysages et les territoires lorrains au XVIIIe siècle. Ce siècle n’est pas choisi au hasard par l’auteur qui est autant historien que géographe. Il s’inscrit dans une période de progrès dans tous les domaines qu’ils soient agraires, proto-industriels ou socio-culturels dont témoigne l’éclosion de mouvements artistiques sans précédent. Trois « temps stratégiques successifs », comme le précise Jean-Pierre Husson, marquent ce long siècle de progrès : le règne de Léopold (1697-1729) qui sort le Duché de Lorraine de la terrible guerre de Trente ans et de ses prolongements au XVIIe siècle, celui de Stanislas (1736-1766) qui ouvre la Lorraine aux échanges européens, la période du rattachement à la France qui poursuit les progrès de la précédente et achève la réunion des deux duchés lorrains (Barrois et Lorraine) et des Trois-Evêchés (Toul, Metz, Verdun) sous l’égide du roi de France.
Après une introduction de presque 70 pages, où les grandes questions sont approchées ainsi que la conception de la géographie historique et les outils de la recherche, l’ouvrage se compose de six chapitres traitant des principaux aspects liés à l’évolution des territoires et des sociétés : les villages et les terres nourricières, les forêts aménagées et déréglées, les villes repensées et mises en scènes, l’essor exceptionnel de la proto-industrie, l’aménagement des routes et des rivières, la géopolitique historique des territoires, les crises des écosystèmes. Cette diversité thématique est l’une des grandes qualités de l’ouvrage, mais elle n’est pas la seule. Le style est aéré et agréable à lire, les cartes anciennes et les reproductions d’illustrations d’époque sont abondantes et donnent à mieux comprendre cette période si importante pour le rayonnement de la Lorraine.
Le souci de la clarté et de la pédagogie de l’auteur, grâce à de nombreux schémas et cartes de synthèses, en font un ouvrage à la fois très accessible pour le grand public et un véritable manuel pour les érudits. Parallèlement, nous apprenons beaucoup sur quantité de sujets méconnus : les évolutions agraires ou l’alignement des maisons dans les villages lorrains le long des routes royales, l’aménagement des villes selon les principes des Lumières et du style Louis XV (Commercy, Nancy, Metz entre autres) en faisant appel aux plus grands architectes comme Jules Hardouin-Mansart, la pression sur l’exploitation forestière selon les régimes seigneuriaux et la croissance démographique, la reconstruction grâce à l’éclosion de multiples foyers de forges et usines à feu grâce à un esprit d’entreprise libéral en avance sur son temps, l’apparition de véritables fronts pionniers (le long de la Meurthe avec les cristalleries et la faïencerie et dans le pays de Bitche), la croissance des échanges s’appuyant sur un nouveau réseau de routes en ligne droite et de ponts (196 ponts en pierre et 115 en bois en 1778), l’essor des sociétés de la connaissance et des savoirs comme en témoignent les presque deux cents académies, créées entre 1750 et 1789, ouvertes sur les mouvements de pensée européens. Ce siècle semble être celui d’une construction et d’un développement durable sur tous les plans. « En moins de deux générations, la Lorraine est sortie du groupe des provinces à industrie humble et pauvre pour se ranger dans la catégorie des provinces qui préparent l’avenir » comme l’écrit l’auteur dans son chapitre sur l’essor proto-industriel (p. 194).
L’ouvrage de Jean-Pierre Husson est une étude brillante de géographie historique régionale et une synthèse de connaissances érudites, comme le révèlent les nombreuses références d’études récentes et de recherches archivistiques. Il donne à comprendre et à apprécier la position stratégique et originale de la Lorraine d’une part « inspirée, voire aspirée par le modèle français avec l’imbrication des Trois Evêchés et des Duchés », d’autre part regardant « toujours vers l’Europe centrale, avec en son sein des enclaves ». La Lorraine entre dans le siècle des Lumières comme une région prospère et annonciatrice des grands progrès économiques et socio-culturels du siècle suivant.
Philippe Boulanger
REGNIER Paul-David, Dictionnaire de géographie militaire, Paris, CNRS-édition Biblis, 2015, 348 p.
La production scientifique en géographie militaire en est encore à ses débuts en France. Elle apparaît limitée à quelques articles, études du Ministère de la défense et ouvrages de synthèse ou régional. Il en est tout autrement dans les pays anglo-saxons, pour l’essentiel aux Etats-Unis, Canada et Grande-Bretagne. Il suffit de rappeler certaines études, souvent en géographie historique militaire, pour souligner l’assise solide de cette approche de la géographie aussi bien dans le domaine militaire qu’à l’Université : Geography military de Johns Collins (1998), Battling the elements, weather and terrain in the conduct of war dirigé par Harold Winters (1998), The Geography of war and peace coordonné par Colin Flint (2005), Military geography from peace to war de Eugene Palka et Francis Galgano (2005), Military geographies de Rachel Woodward (2005). Le Congrès bi-annuel de l’association des géographes militaires, réunissant plusieurs centaines de membres et rattaché à l’Union géographique internationale, est l’un des rassemblements les mieux connus des chercheurs et des officiers géographes dans le monde. Le Dictionnaire de géographie militaire, coordonné par Paul-David Régnier, vient donc pallier la méconnaissance de cette forme de géographie qui doit être reconnue pleinement dans toute sa dimension. Quoi qu’il en soit, l’auteur fait preuve d’innovation et d’audace dans cet ouvrage publié chez CNRS-éditions dans une seconde édition (la première date de 2008). Tout d’abord, il est bien le premier dictionnaire de géographie militaire que l’on ait pu publier depuis la naissance officielle de cette forme de géographie au XVIIIe siècle en France. Ensuite, produire un dictionnaire qui se veut grand public tout en étant un outil de travail pour les militaires d’Etat-major ou en opération est un véritable défi. Paul-David Régnier le relève et s’inscrit dans la lignée des géographes militaires français qui ont donné à la géographie une dimension vivante, dynamique, concrète et utile depuis le XIXe siècle.
Ce dictionnaire est riche d’enseignements comme nous pouvons l’attendre d’un tel ouvrage. Pourquoi les terroristes préfèrent-ils les aéroports aux ports ? Pourquoi le milieu urbain est-il aussi prépondérant pour le militaire aujourd’hui ? Comment la forêt tropicale est-elle un terrain contraignant en opérations ? Comment les hautes technologies dont celle du géospatial ont révolutionné la pratique de la géographie par le militaire ? Cet ouvrage pose des questions intéressantes auxquelles les auteurs donnent des réponses claires et synthétiques. Une centaine d’entrées permettent de comprendre les aspects essentiels de la géographie pratiquée par le militaire aux niveaux tactique (terrain), opérationnel (théâtre d’opérations) et stratégique (grands espaces).
Les entrées sont donc présentées en fonction de leur thème et de leur intérêt : Milieux, concepts, doctrine militaire, cartographie et lieux. Prenons quelques exemples parmi d’autres. L’insurrection ou la contre-insurrection appartiennent à la rubrique des concepts où l’auteur montre la place qu’occupe cette forme d’action militaire dans la pensée géographique militaire, la définition de la lutte anti-insurrectionnelle, l’influence du milieu rural et urbain dans le champ d’action. Avec la rubrique doctrine, on découvre avec grand intérêt la définition de l’IPB (Intelligence Preparation of the Battlefield ou préparation renseignement du champ de bataille) qui naît dans la doctrine américaine dans les années 1970, adoptée ensuite dans la doctrine des armées occidentales, et qui a pour objectif d’identifier les principales clés du terrain (avantages, contraintes) pour le militaire avant, pendant et après l’opération. La diversité des différents types de milieux et leur influence sur l’activité militaire est aussi traitée avec une grande clarté sur le plan de l’utilisation des systèmes d’armes, des pratiques tactiques et opérationnelles et de la gestion des hommes : milieu désertique chaud, milieux intertropicaux, milieu montagnard, etc. On reconnaît également l’importance de la cartographie de nos jours pour le renseignement militaire. Un nombre d’entrée important permet de mieux comprendre l’importance des nouvelles technologies dans la pratique militaire : géoréférencement, intervisibilité, modèle numérique de terrain, modèle numérique d’élévation, ordre graphique, systèmes d’informations géographiques entre autres exemples. En somme, le choix des entrées révèle une grande diversité de concepts et de pratiques qui témoignent de la spécificité de la géographie pour le militaire.
L’ouvrage de Paul-David Régnier se veut donc un outil de travail pratique aussi bien pour les militaires et les géographes civils des questions militaires que pour un grand public dont on sait qu’il s’intéresse plus que par le passé à un monde militaire en pleine mutation. Il participe à répondre au besoin de clarifier les notions fondamentales de la géographie militaire en France tout en s’inscrivant dans un mouvement international de pensée. Il donne à penser que la géographie comme mode de pensée et d’action n’a rien perdu de son importance pour le militaire dont les missions ont évolué vers la gestion de crises et le maintien de la paix. En somme, cet ouvrage rigoureux et instructif devrait répondre aux questions des uns et des autres dans ce domaine, à enrichir la connaissance scientifique pour les plus avertis et informer de manière didactique les plus curieux.
Philippe Boulanger
SUBRA Philippe, Zones à Défendre, de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, L’Aube, 2016, 120 p.
Le référendum du 26 juin 2016 pour le Grand Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, où le oui l’emporte à 55,17% des voix, donne à comprendre une situation complexe. Qu’est-ce qu’une ZAD ? Il est devenu difficile de définir ce phénomène présenté dans les médias sous le nom de ZAD (Zone A Défendre), mais aussi de zone grise ou de zone de non droit, expressions réservées en géopolitique pour désigner des territoires devenus incontrôlables, voire de guerre civile comme en Somalie dans les années 2000 ou en Afghanistan avant 2001. Philippe Subra, spécialiste de la géopolitique locale et de l’aménagement du territoire à l’Institut français de géopolitique (Université Paris VIII), auteur de plusieurs ouvrages de référence en la matière, nous livre un essai de réflexion très éclairant sur ce phénomène de société protéiforme à partir des principaux projets actuels (comme Sivens, Bure, Notre-Dame-des-Landes, Roybon, les ZAD 2.0) en France, tout en le mettant en perspective avec des mouvements de contestations passés (comme le projet d’extension du camp militaire du Larzac dans les années 1970). Si l’ouvrage est éclairant, c’est que l’auteur offre des comparaisons avec les nombreux mouvements d’opposition contre des projets d’aménagement locaux en France depuis les années 1960 à travers le prisme du géographe, c’est-à-dire de l’analyse réfléchie et concrète des rivalités de pouvoirs entre des acteurs différents sur un territoire donné. Il montre de manière démonstrative la spécificité du zadisme qui s’est développé par la « convergence entre un altermondialisme qui se territorialise et une concertation environnementale qui se radicalise » remettant en cause le processus de concertation établi entre les acteurs depuis plusieurs décennies.
Le plan de l’ouvrage pose d’ailleurs des questions essentielles auxquelles Philippe Subra répond de manière précise et synthétique : 1) Qu’est-ce qu’une ZAD, 2) d’où viennent les ZAD ?, 3) Demain, les ZAD partout ? 4) Pour les aménageurs et pour l’Etat, le referendum est-il le moyen de sortir du piège ? L’ouvrage est très instructif pour y trouver des repères, comprendre les évolutions du mouvement zadiste, évaluer ses enjeux et ses évolutions sociétales, mesurer la place du territoire dans ses affrontements devenus plus violents. Il montre, en particulier, que le développement et la pérennité d’une ZAD reposent sur trois conditions majeures : un projet contre lequel la population locale est unie dans l’opposition mais dont les formes classiques de lutte ont été vaines, un terrain favorable par sa topographie et son milieu naturel (le bocage par exemple) favorisant sa défense, la proximité d’une grande ville, généralement estudiantine, qui apporte son soutien au mouvement de contestation, la capacité d’alliance entre les zadistes et les opposants locaux. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, selon Philippe Subra, est exemplaire : « Les objectifs stratégiques des zadistes et des opposants classiques (…) ne coïncident que partiellement. Les modes d’action des opposants classiques et zadistes diffèrent également, mais cette diversité est perçue comme une complémentarité (…). Les intérêts qu’ont en commun les opposants à la création de l’aéroport, zadistes et opposants classiques, ont permis jusqu’ici de dépasser ces différences (…) ».
L’ouvrage nous apprend beaucoup sur l’évolution du mouvement altermondialiste qui connaît une mutation majeure en donnant lieu au Zadisme. Il montre, d’abord, que celui-ci devient « une mutation stratégique d’un mouvement à la recherche de combats concrets » dont la territorialisation prend un sens nouveau. Le territoire n’est plus urbain mais rural, plus structuré en réseau et enraciné qu’éphémère à l’occasion d’un grand sommet du G7. Il apparaît aussi réticulaire à différentes échelles géographiques : au niveau local (la ZAD), au niveau régional (l’espace rural hors ZAD, la relation avec les villes voisines), au niveau national voire européen (avec l’ensemble des ZAD). Au-delà des territoires, le mouvement évolue pour durer, définir des objectifs stratégiques en lien avec les opposants anciens, conduire des actions diluées mais aussi plus violentes par rapport aux mouvements antérieurs (Larzac par exemple).
Philippe Subra analyse également par quels moyens le zadisme devient un mouvement de luttes environnementales aux formes radicalisées. La seule issue du mouvement est la victoire contre des projets perçus comme néfastes pour la démocratie et la Planète dans un contexte de constat d’impuissance du parti écologiste. « La violence est redevenue une option, alors qu’elle était absente des mouvements de contestation des projets d’aménagement depuis le début des années 1980 ». Enfin, les modes de concertation entre les différents acteurs sont bousculés par la nouvelle culture d’opposition du zadisme et par la radicalisation de ses modes d’actions. Tout en rappelant le succès de plus de 80 débats publics en France entre 1997 et 2016, les progrès de l’information auprès des populations dans le cadre des projets d’aménagements, permettant de réduire les conflits locaux, l’auteur souligne la difficulté de mener des opérations de dialogue et de négociation avec un mouvement qui se radicalise. Ce dernier point demeure un enjeu fondamental dans les prochains mois et les prochaines années pour la société et l’Etat.
Aux termes de la lecture de cet essai, force est de constater la qualité d’analyse et de démonstration. Il s’agit d’un livre sans nul doute à découvrir et à relire pour mesurer la dimension nouvelle et protéiforme d’un mouvement inscrit dans la durée.
Philippe Boulanger
PAGNEY Pierre, L’incertitude climatique et la guerre, Paris, L’Harmattan, 2016, 229 p.
Pierre Pagney, professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne et climatologue internationalement reconnu, nous livre des réflexions originales et peu communes dans la géographie académique. Dans Le climat, la bataille et la guerre (2008), il nous avait déjà exposé l’importance de la connaissance des phénomènes climatologiques pour le stratège militaire dans les guerres passées. En s’appuyant sur des exemples issus de cet ouvrage, il développe une nouvelle démonstration tout autant essentielle pour les Etats-majors : l’incertitude climatique. Quel impact peut provoquer l’incertitude climatique sur la décision militaire ? Pour répondre à cette question, Pierre Pagney met en évidence deux aspects tout au long de l’ouvrage : le climat et sa variabilité dans le temps pour le militaire qui conduit à s’interroger sur son incertitude et sa prévisibilité.
L’ouvrage s’articule en trois grandes parties qui exposent les caractéristiques les plus importantes en s’appuyant systématiquement sur des exemples passés. Dans « L’Ordre et le désordre climatiques », l’auteur expose « l’aspect climatique » à l’échelle du globe. Si « l’ordre climatique » aborde la zonation climatique, l’azonalité climatique et la mosaïque climatique du globe, le « désordre climatique » renvoie au caractère climatique de l’atmosphère, la permanence de la variabilité du temps et du climat, aux catastrophes climatiques. Il montre à quel point le niveau stratégique tend à réduire cette incertitude climatique par les nouvelles technologies depuis plusieurs décennies, afin d’anticiper l’organisation des manœuvres militaires. Mais c’est surtout dans la deuxième partie que l’approche militaire est la plus détaillée. Dans « les décisions militaires et l’incertitude climatique » sont traités, dans un ordre qui peut paraître original, les opérations continentales, les situations subies comme l’échec du Chemin des Dames (1917), les situations contrôlées comme le débarquement allié en Normandie en juin 1944, les théâtres d’opérations continentaux dans leur rapport à l’incertitude climatique. Dans les exemples exposés, extraits de faits de la Première ou Seconde Guerre mondiales, l’auteur montre que les conditions météorologiques sont toujours fondamentales et exercent une tension sur la prise de décision compte tenu de la variabilité climatique toujours de règle. Enfin, la troisième partie tente de prendre un certain recul en traitant des perspectives géostratégiques et du réchauffement climatique. En s’intéressant aux « conflits potentiels », et en adoptant une démarche régionale, l’auteur tente d’embrasser tous les facteurs de tensions liés à ce phénomène climatique majeur. Autant dire qu’une grande partie des problèmes géopolitiques mondiaux sont cités sans atteindre toutefois un développement approfondi. L’approche se veut donc large, au risque peut-être de perdre le fil directeur de la démonstration qui reste centrée sur la décision militaire. Il n’en demeure pas moins que nous apprenons beaucoup sur le rapport entre incertitude climatique et décision stratégique. L’ouvrage constitue l’un des rares à traiter de cette problématique et à nous la rendre compréhensible.
Philippe Boulanger
AUBOUT Mickael, Les bases de la puissance aérienne 1909-2012, Paris, La Documentation française, collection Stratégie aérospatiale, 2015, 452 p.
Mickael Aubout, docteur en géographie de l’Université Paris-Sorbonne et officier au Centre d’études stratégiques aérospatiales, nous présente un ouvrage issu de sa thèse portant sur la Géographie politique et militaire du réseau des bases aériennes françaises (1909-2012). Le sujet est méconnu en France en dehors d’un cercle restreint de spécialistes alors qu’il concerne la politique militaire actuelle de la France dans les opérations militaires en cours, en Afrique ou au Moyen-Orient, comme la société française durement touchée localement lors d’une fermeture de base depuis la fin de la Guerre froide.
L’ouvrage s’intéresse au développement du réseau des bases aériennes françaises. L’auteur adopte une démarche originale en géographie historique en combinant analyse spatiale et étude des rythmes de développement, en France et dans les territoires outre-mer, des bases aériennes. Dès l’introduction, il prend soin de définir l’état de la recherche en matière de géographie militaire aérienne. Il nous aide à mieux comprendre tous les enjeux de l’étude. « L’analyse géographique d’un élément comme la base aérienne, de part sa surface d’implantation et les interactions politiques, économiques, culturelles ou encore sociologiques qu’elle entretient avec son environnement, est plus que fondée » (p.12). Il souligne la rareté des travaux de recherche en la matière depuis la naissance de la géographie française. Il nous apprend que les sites d’implantation des forces aériennes prennent le nom de « bases aériennes » dès la naissance de l’armée de l’air au début des années 1930. La notion de réseau de bases aériennes se développe dès lors dans l’objectif de défendre les territoires de la France. Son maillage répond à une stratégie globale précise afin de s’approprier et de contrôler un espace.
L’ouvrage se compose de trois parties thématiques. La première, intitulée « Tenir l’air par la terre : le réseau des bases aériennes en tant que concept géostratégique » apparaît la plus ambitieuse. Elle tend à « faire comprendre que les bases aériennes, organisées en réseaux, peuvent être considérées comme un élément de la géostratégie de par leur caractère spatial et leur position duale, d’objet et d’instrument, de la stratégie générale » (p. 15). Elle constitue un axe central de la réflexion en caractérisant la géographie militaire aérienne, celle des bases aériennes, des facteurs physiques et humains ainsi que l’évolution de la pensée stratégiste. Elle met en évidence la richesse de la pensée stratégiste en la matière, notamment à travers les œuvres de plusieurs auteurs reconnus (Raoul Castex, Giulo Douhet, John III Warden entre autres). Il en résulte une réflexion tout à fait inédite ainsi qu’une typologie des bases aériennes examinée sous un angle structurel et spatial à partir de nombreux exemples. L’auteur démontre clairement que le réseau de bases aériennes mis en place par la France, entre 1909 et 2012, est un pilier fondamental de la puissance aérienne, incontournable dans les opérations de projection de forces et de puissance.
La deuxième partie traite du développement du réseau des bases aériennes en France métropolitaine depuis 1909. Elle montre qu’il existe un modèle spécifique au territoire national de construction d’un réseau de bases qui connaît son apogée avant la fin de la Guerre froide et qui tend à se recentrer sur quelques centres de gravité depuis. Elle interroge les conditions et les modalités de développement du réseau en métropole ainsi que les inégalités de répartition géographique. La construction d’un maillage de bases est établie en fonction de la menace, des capacités économiques et de l’organisation administrative militaire. Son essor traduit les priorités doctrinales et géostratégiques, par une densification des infrastructures dans l’Est de la France, avant de connaître une réorganisation fonctionnelle profonde depuis les années 1990. L’ensemble suit ainsi une analyse thématique. Après avoir examiné l’évolution spatiale du réseau depuis 1909, l’analyse porte sur la dimension socio-économique des bases et sur l’environnement industriel puisque leur implantation géographique a influencé la mise en place des entreprises liées à l’aéronautique.
La troisième partie, « La France dans le monde, le réseau des bases aériennes extra-métropolitaines », porte sur l’espace outre-mer et aux différentes formes de discontinuités spatiales des infrastructures. Elle démontre que le dispositif des bases aériennes a été essentiel dans l’appropriation politique de ces territoires et à la projection de puissance à l’ensemble du domaine colonial français. Malgré l’éloignement de la Métropole et des moyens relatifs, le réseau de bases forme un outil de cohérence territorial en permanente adaptation à partir de l’Entre-deux-guerres. Le dernier chapitre aborde les phases de restructuration du réseau de bases depuis l’indépendance des colonies et de la fin de la menace du Pacte de Varsovie en 1989. Ce réseau est nécessairement réadapté aujourd’hui en fonction des impératifs stratégiques en Afrique et dans le Golfe Arabo-Persique. Cette dernière partie vient ainsi parfaitement illustrer l’approche conceptuelle de la première par la diversité des exemples étudiés depuis le début du XXe siècle.
Cet ouvrage, issu d’un travail de recherche reconnu et inédit, est sans nul doute une œuvre pionnière en géographie militaire et historique. Par la nature du sujet, mais aussi par la réflexion apportée, la qualité des nombreuses cartes, la profondeur temporelle traitée et la diversité des espaces, il permet de mieux comprendre un sujet méconnu et si important à l’heure où l’armée française s’engage dans des opérations extérieures plus nombreuses en Afrique et au Moyen-Orient.
Philippe Boulanger
ANNEE 2015
GRATALOUP Christian, Introduction à la géohistoire. Paris, Armand Colin, collection Cursus, 2015, 224 p.
Christian Grataloup est professeur à Paris 7 et à Sciences Po Paris. C’est un des meilleurs connaisseurs des rouages de la géohistoire, une discipline encore peu pratiquée dans la géographie francophone malgré les nombreux questionnements puis apports qu’elle peut mobiliser afin de produire un diagnostic complet des territoires. Son ouvrage est à la fois court, condensé et didactique. Il entre dans une collection de manuels destinés aux étudiants du cycle de la licence. La complexité du sujet et les préalables requis pour le lire, en comprendre et en assimiler les démarches relèvent du registre du livre érudit.
Ce volume est essentiel pour aborder le couple espace-chronologie. La posture de la géohistoire restitue sa place à l’épaisseur du temps, qu’il soit linéaire, continu, rompu ou bifurqué. Ainsi est comprise la lente sécrétion des territoires et de leur partie la plus lisible : les paysages compris dans leur filiation avec le pays et le paysan. Cette démarche est également à associer à la fiabilité de la mémoire des sols et de la topographie, un axe de recherche aujourd’hui largement révolutionné par l’usage du LIDAR. La réflexion menée n’est pas seulement académique. Elle sert encore à se projeter sur les devenirs et scénarios possibles pouvant concerner un territoire soucieux de valoriser son patrimoine et de soigner son image.
L’auteur familiarise le lecteur avec la prise en compte du temps long dans la construction des lieux à partir des empilements successifs nés des aménagements. Ce sujet souligne l’originalité du rapprochement de l’histoire et de la géographie, deux disciplines enseignées conjointement chez nous ou encore au Japon ; ce qui fait figure d’exception. Né sous la plume de Fernand Braudel, le néologisme géohistoire sert à lire, comprendre et interpréter l’espace dans ses interactions avec le temps, qu’il soit cyclique, accéléré dans ses rythmes ou infléchi par les choix retenus ou subis par les hommes. L’auteur confirmer la filiation associant géohistoire et métissage pour souligner la fécondité de cette démarche. A l’origine, le sillon de ces recherches a été tracé dès les années Vingt dans les publications des Annales. Ce thème de recherche se retrouve ensuite chez Fernand Braudel, Xavier de Planhol, Jean-Robert Pitte, etc. Le croisement des perspectives temporelles et des échelles spatiales emboîtées est essentiel pour comprendre notre temps et les legs reçus. Les Anglo-Saxons ont mieux compris que nous tout l’intérêt porté par cette démarche. Elle questionne et éclaire les sujets d’actualité, par exemple les modifications climatiques, l’érosion de la biodiversité, la morphologie des villes, les effets de la mondialisation des échanges, etc. Grâce à ces questionnements, les territoires sont éclairés par le supplément de sens amené avec la patine apportée par la durée. Cette rencontre relève également du besoin social. C’est un moyen de préciser la montée en puissance de la patrimonialisation à inventorier, à faire respecter, à réguler pour ne pas tomber dans l’excès et enfin à transmettre.
Dans sa première partie, l’auteur est guidé par un souci didactique qui l’honore. Il explique et accorde une grande place aux définitions et mises au point. Il développe des commentaires étoffés à propos des mots Territoire, Milieu, Espace. Le croisement de ces termes nous éclaire sur l’historicité, un processus abordant à la fois la reproduction et la transformation d’une société pollenisée par les apports de ses voisins, voire ses envahisseurs. Pour illustrer cela, C. Grataloup souligne par exemple les liens étroits qui unissent la répartition des vents et les directions prises par les flux migratoires dans le Pacifique. Une idée force est qu’espace et lieu amènent la retrouvaille de l’horizontal et du vertical (p. 66).
Echelles, situations et moments structurent le second volet du livre (p.79-154). Ces paramètres sont abordés en partant de l’exemple de Madagascar. L’illustration de ce cas montre que les distances ont une histoire nuancée par la rugosité des lieux, la configuration des puzzles et des réseaux. La géohistoire donne des auréoles au temps avec la diffusion des sphères. L’espace et le temps convergent dans le progrès, un principe mis en avant par les hommes des Lumières. La périphérie est souvent l’élément qui est force de proposition pour tisser l’évolution. Le couple temporalité/spatialité a cru en importance avec les grandes découvertes et leur corollaire : certes l’afflux des métaux précieux, surtout la confrontation des sociétés à racines et à pattes (p. 116). La première favorise l’accumulation des biens alors que la société caravanière vit avec le strict nécessaire. Pour aller plus loin, C. Grataloup souligne qu’il n’y aurait pas de richesse dans le fait géographique sans l’élargissement du système binaire vers le multiscalaire. C’est un avertissement pour se défier de l’Etat-nation monoscalaire, faisant à coup sûr progresser la frontière vers l’affrontement. Les échelles réveillent à la fois l’empire et le poly territoire. Les chapitres ayant traité de l’impossible déterminisme environnemental concluent sur une géographie des historicités résumée dans la formule suivante : Densité+connexité= historicité.
Dans la dernière partie intitulée « Principes géohistoriques », C. Grataloup insiste sur la relativité des faits sociaux, les récurrences constatées et les efforts entrepris pour caser ces données dans des modèles comparatifs, des scénarios possibles. Pour établir cette démonstration, il mobilise des exemples variés : la chine, nos réseaux urbains actuels et antiques, Constantinople. L’auteur termine sa réflexion sur le couple fertile formé par l’échelle et l’identité, avec des logiques spatiales et des résistances territoriales.
Mettre en avant la géohistoire, c’est avant tout replacer l’espace dans un processus historique, un duo espace-temps. Ce dernier sert de trait d’union pour expliquer les espaces dont nous sommes usufruitiers. En terminant sur la fécondité de ce lien, C. Grataloup livre un message très optimiste sur la vitalité de ce secteur de recherche plein de promesses.
Jean-Pierre Husson
Université de Lorraine
TODOROV Nicola-Peter, L’administration du royaume de Westphalie de 1807 à 1813, le département de l’Elbe, Sarrebruck, éditions universitaires européennes, 2011, 632 p.
Nicola-Peter Todorov nous livre une remarquable étude sur un sujet à la fois historique et de géographie historique. Dans le contexte actuel de commémoration de la fin de l’Empire napoléonien (la bataille de Waterloo de 1815), son ouvrage participe à mieux connaître l’apport des réformes napoléoniennes, issues du Consulat et de l’Empire, dans la nouvelle structure territoriale et politique en Europe du Nord qu’est le royaume de Westphalie. Il faut dire que l’auteur, docteur en histoire de l’université Panthéon-Sorbonne, aussi enseignant à l’Université de Rouen et au lycée Gustave Flaubert (académie de Normandie), dispose de nombreuses qualités pour nous exposer une étude scientifique de grande qualité qui donne à voir une autre manière de considérer l’administration de l’Empire napoléonien. Son étude est le fruit de quinze années de travail dans les centres d’archives de Berlin et de Magdebourg, de Paris et de Saint-Pétersbourg que la maîtrise du français, du russe, de l’allemand et de l’anglais a rendu possible. Le résultat donne lieu à un ouvrage précis, démonstratif, illustré de nombreuses cartes inédites (58 au total), lui conférant ainsi une approche en géographie historique originale, dans un style clair et compréhensible. Il apparaît surtout innovant par le résultat produit qui va à contre-courant de la thèse retenue par l’historiographie nationaliste ancienne et, en partie, plus récente.
Après la paix de Tilsit de 1807, qui conduit au contrôle des anciennes provinces prussiennes par les armées de Napoléon et à leur rattachement au nouveau royaume de Westphalie, sous la direction de Jérôme Bonaparte, une série de réformes administratives et sociales est menée. L’historiographie donne une vision assez pessimiste de l’application de ces réformes. Celles-ci auraient été mal acceptées, mal appliquées et, surtout, rejetées aussi bien par les populations que par les élites. Nicola-Peter Todorov nous livre une autre vision beaucoup moins négative et relativise beaucoup les thèses précédentes. En réunissant des territoires très différents (appartenant au roi de Prusse, à l’électeur de Hesse-Cassel, à l’électeur de Hanovre et au duc de Brunswick), les serviteurs de Napoléon parviennent à créer un royaume de Westphalie qui est sensé devenir un Etat modèle selon les principes politiques et sociaux français en Europe du Nord. Les réformes mises en œuvre sont profondes : application d’une constitution, adaptée de celle de la France impériale, réalisation des huit départements supposant une nouvelle répartition territoriale, adoption du code civil, disparition de l’ordre seigneurial et création de la citoyenneté (impliquant la liberté individuelle et religieuse, l’égalité et la disparition du statut de serf), nouvelle organisation économique. A partir de l’étude du département de l’Elbe en particulier, l’auteur nous donne à comprendre leur mise en œuvre à différentes échelles spatiales (la commune, le district, le département, le royaume) par la consultation d’un corpus de sources diversifiées, reposant aussi bien sur les rapports de l’inspection forestière et les correspondances des préfets que sur les pétitions paysannes. La richesse de cet ouvrage est liée ainsi à son angle d’approche, valorisant le lien entre les hommes et leurs territoires, l’enracinement social des serviteurs de l’Etat et leurs relations avec la société globale.
Quel est le résultat de la politique napoléonienne menée dans le royaume de Westphalie ? Pour répondre à cette question, l’auteur articule sa démonstration en dix chapitres. Le premier porte sur les relations franco-prussiennes de 1803 à la création du royaume de Westphalie dont la création constitue un enjeu géopolitique en Europe du Nord. Le deuxième aborde l’organisation du nouvel Etat à différentes échelles géographiques, notamment en insistant sur les spécificités locales, tandis que le troisième analyse les pratiques administratives des fonctionnaires français et westphaliens à l’échelle préfectorale et sous-préfectorale. Dans les trois chapitres suivants, ce sont différents secteurs d’activités du Royaume qui permettent de saisir les nuances de l’application des réformes en matière de justice, de finances et progrès social, de la gestion des biens de l’Etat et des forêts, de l’administration des postes et de l’armée. Enfin, dans le dixième et dernier chapitre, l’auteur s’intéresse à la participation de la population dans les ambitions réformatrices françaises et à leur représentation au sein de l’opinion, dont les aspects négatifs (exactions des soldats français, rixes entre civils et soldats ivres par exemple) ont été entretenus dans les manuels scolaires allemands dans les décennies suivantes.
Finalement, Nicola-Peter Todorov nous amène à comprendre toutes les nuances de l’ensemble des réformes qui sont appliquées en tenant compte des contraintes locales, parfois à des rythmes différents selon les secteurs d’activités, tout en ayant pour objectif de briser les résistances des élites anciennes. « La division territoriale, surtout cantonale, illustre cette idée à merveille » écrit l’auteur, car les nouvelles entités créées permettent de détruire les anciens territoires seigneuriaux, brasser les populations, construire une nouvelle hiérarchie et réaliser de nouvelles dynamiques économiques. L’auteur met ainsi en évidence que la réforme napoléonienne et les agents au service du nouveau royaume, enclins à une « profonde compréhension des hommes » et évitant une rationalité formelle, ont réussi là où les anciens administrateurs prussiens avaient échoué. Les réformes françaises sont ainsi adaptées en fonction de ceux qui les mettent en œuvre et selon les conditions locales. La structure communale continue ainsi d’exister bien après la chute de l’Empire (jusqu’en 1833). Les structures créées par l’Etat français, notamment dans le domaine de la justice, disparaissent ensuite mais ont servi de modèle à la réorganisation ultérieure demandée par le roi de Prusse. En revanche, les réformes sociales ont profité durablement à toute la société au détriment des élites anciennes qui perdent leur emprise sur l’appareil d’Etat. Finalement, l’apport de la période napoléonienne, surtout rendu négatif par l’historiographie nationaliste ancienne, se révèle bien plus profond et à nuancer selon les couches sociales et les secteurs d’activités. Toute la démonstration de l’ouvrage, constituant une somme de connaissances inédites, tend à en révéler toutes les spécificités.
Philippe Boulanger
PITTE Jean-Robert, Dictionnaire amoureux de la Bourgogne, Paris, Plon, 2014, 682 p.
Le dernier ouvrage de Jean-Robert Pitte, professeur de géographie, ancien président de l’Université Paris-Sorbonne et membre de l’Institut, est l’un des plus remarquables et surprenants. Chacun de ses livres pouvait déjà nous étonner. Celui-ci ne manque pas de nous enchanter à chaque page. Nous y apprenons beaucoup sur la Bourgogne que l’auteur connaît à la fois par sa propre expérience personnelle, qu’il nous fait partager de manière intime comme un guide nous conte les plus belles histoires, et par son immense savoir scientifique de géographe. « Je suis fier d’être bourguignon de cœur, d’une province où je ne suis pas né et où n’est sans doute né aucun des mes ancêtres » nous écrit l’auteur, lui-même ayant dirigé quelques années, et habité partiellement, une propriété viticole d’un hectare, à Villars-Fontaine, produisant un vin délectable de Chardonnay. Nous y apprenons beaucoup sur des sujets variés : la romanité antique et les grandes abbayes (Cluny et Cîteaux) du Moyen Age occidental, le rayonnement du grand duché de l’Occident, les reliefs ondulés et la richesse de des paysages de Bourgogne (Chablis, Charolais, Mâconnais, le Morvan, etc.), les sites les plus significatifs (Fontenay, Dijon, Beaune, Joigny, le Creusot, etc.), les Bourguignons dont la personnalité est « faite de franchise, de truculence, de distance vis-à-vis d’eux-mêmes », la richesse gastronomique et les divers vignobles qui produisent les plus grands vins du monde, les personnalités les plus illustres (Bernard de Clairvaux, Jacques-Bénigne Bossuet, Alphonse de Lamartine, Colette, etc.) ou moins connues (le chanoine Kir, Charles de Brosses, Gaston Gérard, etc.).
Jean-Robert Pitte donne des clefs de lecture qu’aucun ouvrage ne pouvait nous livrer ainsi. Il faut dire qu’il a parcouru, dans toutes les dimensions, cette région si riche par son histoire, sa culture et sa géographie. « Des années après l’éblouissement de Chorey, mon addiction à la Bourgogne s’est ensuite ancrée dans la Côte de Nuits, entre le Clos de Vougeot, Vosne-Romanée et Nuits-Saint-Georges, et dans la montagne qui la domine, les Hautes-Côtes de Nuits, au pied de la colline inspirée de Vergy, sur le coteau ensoleillé de Villars-Fontaine. Dionysos est né deux fois ; moi aussi, et ma cuisse de Zeus s’appelle la Bourgogne ». Le Dictionnaire amoureux de la Bourgogne est donc un ouvrage à la fois personnel, autobiographique pour certains passages, et savant dans un style propre à l’auteur, vif et alerte, un mélange d’histoires personnelles et vécues, de sensations ressenties depuis ses premières escapades de géographe, une sensibilité d’homme du terroir et du monde urbain, un regard épanoui et réellement amoureux pour les hommes qui la composent.
L’ouvrage est donc savoureux parce qu’il n’est pas académique et ne ressemble nullement à ce que nous prenons l’habitude de découvrir sur une région. Nous ne nous lassons pas d’apprendre à chaque page. Il se compose d’une centaine d’entrées, toutes différentes par leur nature. La diversité des thèmes et des approches, menés avec un corps vibrant et un cœur battant, aborde aussi bien le site d’Alésia que les villes de Dijon et de Beaune, les paysages, les vignobles et les villages de Meursault, Chambertin, Nuits-Saint-Georges ou de Vosne-Romanée, que les escargots, le cassis, la cocotte, le cornichon et la bouteille de Bourgogne, l’accent bourguignon (le « r ») et les climats que la vie de Jean-Philippe Rameau et de Vauban, ses rivières (Saône, Seine, Yonne) que son jambon persillé et sa moutarde. Jean-Robert Pitte nous conduit dans une autre sphère avec passion et le plaisir de la partager. Il est plus qu’un ouvrage qui vous donne envie de visiter ou revisiter la région. Il vous la fait découvrir et aimer de manière inattendue, par ses richesses matérielles et immatérielles.
Philippe Boulanger
LAURENT Sébastien-Yves, Atlas du renseignement, géopolitique du pouvoir, Paris, Les Presses de Sciences-Po, 2014, 191 p.
La question du renseignement est globalement peu connue en France quand elle n’est pas méprisée. S’il existe une littérature abondante sur les réseaux ou les scandales liés au renseignement, qui vient répondre à une demande du public, les études sérieuses et approfondies sur ces aspects restent encore marginales. L’ouvrage de Sébastien-Yves Laurent, professeur à l’Université de Bordeaux et spécialiste des questions de renseignement, nous apporte un éclairage à la fois original, en valorisant la représentation cartographique, et inédit sous la forme d’une synthèse claire par le style et instructive par la diversité des exemples.
L’ouvrage s’articule en cinq parties qui abordent les principales questions liées au renseignement à l’échelle planétaire depuis le XXe siècle. Dans la première (« Observer, influencer, agir »), ce sont les concepts fondamentaux et les pratiques, à travers des exemples illustrés de plusieurs cartes (les « coverts actions » de la CIA pendant la guerre froide, l’influence du KGB en Afrique et en Amérique latine, etc.), qui sont abordés. La deuxième partie présente « le renseignement face aux crises » en mettant en évidence les déficiences ou les qualités des services de renseignement qui ont informé le pouvoir politique, ou au contraire manqué, de l’imminence d’une crise majeure. Sont ainsi traités l’audace stratégique japonaise et les erreurs américaines avant l’attaque de Pearl Harbor du décembre 1941, les opérations de désinformation alliées pour préparer le débarquement de Normandie de juin 1944, l’échec du renseignement américain face à Al Qaeda, la politique du renseignement Blair à l’entrée en guerre en Irak en mars 2003. Enfin, les trois dernières parties abordent les effets du renseignement sur les politiques publiques (« Quand les Etats coopèrent »), le contrôle du renseignement dans les sociétés ouvertes (partie 4) et les mutations de la conception du renseignement à l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Dans cette dernière partie, une géopolitique inédite du renseignement est particulièrement instructive. Elle aborde les principales questions qui conduisent les agences de renseignement à se restructurer et à repenser leurs finalités : le défi des sources ouvertes, l’affaire Wikileaks, le renseignement dans le cyberespace, la fin du monopole de la sécurité et la remise en question de l’Etat.
Sébastien-Yves Laurent apporte une nouvelle dimension à la connaissance du renseignement pour les non-spécialistes, qui peuvent y découvrir quantité d’informations dans une démarche compréhensible, et apporte un traitement du sujet de manière inédite, notamment en valorisant la représentation cartographique et en abordant les enjeux du renseignement à l’ère numérique.
Philippe Boulanger
ANNEE 2014
DALCHE Patrick Gautier (sous la direction), La Terre, connaissance, représentations, mesure au Moyen Age, Turnhout, Brepols, collection L’atelier du médiéviste 13, 2013, 710 p.
Sous la direction de Patrick Gautier Dalché, une équipe de sept médiévistes vient de réaliser un ouvrage peu commun tant par son approche globale que par la qualité scientifique de l’étude. L’ouvrage porte sur la connaissance, les représentations et la mesure de la Terre entre le Ve et le XVe siècle en Europe. Le contenu de l’ouvrage offre plusieurs qualités que les spécialistes et les passionnés de la cartographie, d’histoire de la géographie et de géographie historique apprécieront.
La première qualité consiste à ne pas publier un manuel d’histoire de la géographie et de la cartographie comme le précise Patrick Gautier Dalché dans l’introduction. L’ouvrage se fixe comme objectif de présenter un état des lieux historiographiques, une analyse des savoir-faire géographiques dans l’Occident médiéval et, surtout, une étude de 110 textes, publiés dans la version latine et traduite en français, liés à une diversité de thématiques qui s’y réfèrent.
Bien que l’ouvrage ne présente qu’un faible corpus d’illustrations cartographiques, parfois, par rapport aux centaines de références présentées, ce qui conduit à nous reporter vers les atlas historiques traitant de cette période, les auteurs nous amènent à comprendre les représentations de l’espace avec une qualité scientifique rarement atteinte jusqu’alors. Toutes les références médiévales connues sont abordées pour comprendre la manière dont les différentes élites, selon les époques, utilisent les techniques cartographiques et sont amenées à se représenter la Terre et leur environnement. L’ambition scientifique de cette publication apparaît donc large car les savoir-faire géographiques appartiennent à des domaines diversifiés comme l’astronomie, l’astrologie, la théologie, le droit, la technique mais aussi l’économie et ce qui serait appelé aujourd’hui la géographie culturelle. « Nommer, décrire, expliquer, telles étaient les fonctions assignées à la géographie » au début du Moyen Age, en suivant « le système aristotélicien de l’interaction entre les quatre éléments, la perfection logique de ce système entraînant une certaine paralysie ». Cette conception de la représentation de la Terre commence à s’en acquitter à partir du XIIe siècle comme en témoigne la prise en compte de l’évolution du relief du sol, considérée jusqu’alors comme immuable, de la découverte d’autres espaces que méditerranéens (vers l’Asie, les rivages africains, les îles de l’océan Indien, puis vers le Nouveau Monde) par les voyageurs. Cette découverte, stimulée par la curiosité, la confiance en l’astrologie et les nouvelles techniques, favorise la mise à jour des connaissances et des dénominations, le passage des nomenclatures héritées de l’Antiquité à une « somme » sur le monde, qu’elle soit physique (relief, climat, hydrographie) ou humaine (villes, populations, activités, mœurs et croyances). Selon les auteurs, « c’est cette « image du monde » que le Moyen Age lègue aux Temps Modernes, image qui ne sépare pas histoire (ou légende) et géographie, image incertaine, évoluant avec les progrès de l’exploration ».
L’ouvrage se structure en deux parties. Dans la première, intitulée « une image du monde, la géographie dans l’Occident médiéval (Ve-XVe siècle) », les auteurs s’intéressent à l’évolution des mentalités dans la manière de penser l’espace et aux productions, littéraires et cartographiques, relatives à ces représentations de la Terre. Ils distinguent quatre périodes marquées par leurs spécificités dans de multiples domaines : le temps des « auctoritates » (Ve-XIe siècle) caractérisé par les héritages de l’Antiquité tardive et les débuts d’une « géographie médiévale » sous influence de la Bible et de Rome ; le temps des questionnements (XIe-XIIIe siècle) qui constitue une période d’ouverture vers d’autres savoir-faire, notamment arabes, de multiplication des œuvres (celles de maîtres chartrains et anglais, celles des récits de voyage, celles liées à une représentation imagée et abstraite) ; le temps des voyageurs (1250-début XVe siècle) qui conduit à l’approfondissement des connaissances et des conceptions de l’espace, liées aux marchands, aux pèlerins, aux croisés, qui appellent à d’autres aspirations géographiques (les cartes régionales, les mappemondes, les cartes marines) ; le temps des humanistes (XVe siècle) qui favorise une reconstruction de l’espace antique, des sources d’études (les répertoires, les encyclopédies) ainsi qu’une « renaissance » du savoir.
La seconde partie, intitulée « Thèmes et documents », présente une approche inédite par la diversité des thématiques traitées et des sources rassemblées. La Terre dans le Cosmos (l’habitabilité de la Terre, les coordonnées géographiques, les influences célestes), l’espace habité (les méthodes, les mappemondes, la géographie des humanistes), la représentation cartographique de l’espace maritime, le voyage (pèlerinage et sainteté, itinéraires, dévotion et curiosité, les peuples du monde, les îles inconnues entre autres), les cartes et plans à grande échelle, les techniques et pratiques de la mesure du sol en composent les chapitres successifs. A partir de textes choisis et analysés, les auteurs font découvrir quantité de connaissances sur une diversité de sujets, telles la connaissance de la Pannonie selon divers auteurs du Ve au XVe ou la « géographie politique » d’un héraut d’armes en 1416, ou encore de la conception de l’île de Thulé par Pétrarque, des Tables de Charlemagne, des cartes et de la stratégie dans un projet de croisade (1321), d’une mappemonde dans un manuscrit de la Bible en 1172, d’un Tableau de la mer par Felix Fabri au XVe siècle, des différentes mesures employées (par projectile, corde, règle). Les sujets abordés sont d’une richesse et d’une diversité pour la connaissance des pensées géographiques qui révèlent une grande qualité par le traitement des sources écrites retenues. Cet ouvrage constitue une somme d’informations et de connaissances sur la « géographie médiévale » en Occident dont l’une des grandes qualités est d’accéder directement à un choix diversifié de sources littéraires et d’en approfondir la connaissance par une analyse précise.
Philippe Boulanger
PITTE Jean-Robert, La bouteille de vin, Histoire d’une révolution, Paris, Tallendier, 2013, 311 p.
La bouteille s’apparente à l’un de ces objets communs sur nos tables, tellement communs que nous serions tentés d’oublier qu’elle a révolutionné nos manières de vivre. Elle révèle non seulement ce que nous sommes à une période donnée mais aussi la lente diffusion d’une manière de consommer les liquides qu’elle contient. Jean-Robert Pitte nous présente un ouvrage d’une grande érudition sur un sujet qui nous apprend beaucoup sur les civilisations, les arts de vivre et les identités de chacun.
Aujourd’hui, 30 milliards de bouteilles sont fabriqués par an dans le monde. Si le processus a pris une dimension industrielle depuis le XXe siècle, il n’en fut pas évidemment de même dans les différentes aires culturelles selon les époques. Les bouteilles ne sont pas innocentes, écrit l’auteur. « Leur forme et leur couleur sont non seulement l’aboutissement d’une longue histoire technique associant verrerie, viticulture, négoce et mode de consommation, mais révèlent aussi la culture de tous les acteurs de cette chaîne complexe. La puissance d’évocation de la stricte bordelaise n’est en rien semblable à celle de la sensuelle champenoise ou bourguignonne ou de la leste flûte à corset de Provence ». La bouteille évoque le désir de tous les plaisirs. Sa rondeur inspire les poètes et les artistes qu’ils soient peintres ou maîtres-verriers. Son image renvoie à la manière de concevoir le contenant, les pratiques culinaires et la personnalité de ses consommateurs. Toutefois, l’intention première de son invention repose sur la nécessité de conserver le vin, d’éviter qu’il ne tourne au vinaigre.
Les hommes ont mis ainsi bien des siècles pour arriver à ce résultat. Les viticulteurs recherchent, depuis l’invention du vin au Moyen-Orient 8 000 ans av. J. C., un mode de conservation hermétiquement bouché et imperméable à l’air. Le récipient le plus ancien semble être l’outre de peau, connu vraisemblablement durant le Paléolithique. Depuis l’Antiquité, se sont succédés des procédés différents comme la mise au point du dolium au Moyen-Orient, vaste récipient de terre cuite, enterré ou posé sur le sol, pouvant contenir jusqu’à 2 500 litres, l’amphore inventée au IVe millénaire av. J.C. en Méditerranée orientale dont la capacité varie selon les régions et les périodes, puis le tonneau dont la technique de fabrication est connue des Etrusques vers les VIIe-VIe siècles av. J.C. Parallèlement à ces formes de récipients qui traversent les âges jusqu’à nos jours, d’autres peuvent être signalées comme le pot, le pichet, la cruche et la gourde de vin qui permettent de transvaser le vin jusqu’à la coupe, le gobelet ou la timbale. La principale révolution qui conduira à la naissance de la bouteille apparaît, explique Jean-Robert Pitte, déjà au Ie siècle av. J.C. avec l’invention de la canne à souffler en Egypte ou en Syrie. L’art du verre permet ainsi de perfectionner la maîtrise de la conservation du vin tout en personnalisant les formes du contenant, ce tout au long des différentes civilisations du Moyen-Orient et de l’Occident.
Découvrant toute la richesse que recouvre la forme de la bouteille dans les années 1960, Jean-Robert Pitte partage avec le lecteur sa passion pour le vin, l’esthétisme de son contenant et la culture des hommes qu’elle reflète. Il nous apprend beaucoup avec ce bel ouvrage qui se lit dans un style fluide et agréable, contenant de très belles illustrations dont certaines sont issues de sa collection privée. La diffusion du vin et l’amélioration des procédés des techniques de conservation constituent le cœur d’une révolution culturelle. Celle-ci commence dans les vignobles de Perse où l’art du verre est parfaitement maîtrisé au point de réaliser des bouteilles en verre épais à la fin du XVIIe siècle, permettant la commercialisation sur de longues distances. A la même époque, la région de Newcastle, au Nord de l’Angleterre, devient l’un des principaux centres verriers du monde grâce au charbon et participe à la diffusion de formes diverses, en « puits et globe » et en oignon connues déjà en Belgique et dans les Pays-Bas, puis cylindrique à épaules plus carrées.
Parallèlement à l’usage du bouchon de liège pour conserver les arômes du vin, adopté par les Anglais à partir des exploitations forestières portugaises, les qualités du verre s’améliorent pour obtenir une couleur sombre et noire, favorisant la conservation du liquide, et d’une meilleure résistance aux conditions de déplacement. Les besoins en importation du vin du Sud-Ouest de la France, de la vallée du Rhin ou du Portugal sont anciens et ces avancées techniques de la verrerie permettent d’en améliorer non seulement le transport et la conservation du vin, mais aussi la diffusion. Celles-ci profitent ensuite à d’autres régions productrices, du mousseux de Champagne au XVIIe siècle et au new french clarets du Bordelais au XVIIIe siècle. Les grands modèles de bouteilles de vin en Europe apparaissent à la fin du XVIIIe siècle selon l’adoption de la législation, des techniques employées et des besoins régionaux. En France, les formes deviennent ovoïdes et à épaules tombantes en Champagne et en Bourgogne, cylindrique à épaule carrée dans le Bordelais à partir du XIXe siècle. Ailleurs, dans le monde, comme dans certaines régions françaises marquées par des influences extérieures, des « niches régionales » se font jour, traduisant ainsi des degrés de raffinement des arts de vivre et des techniques, telle la bouteille à long col d’Alsace, le clavelin du Jura, la fiasque paillée de Toscane. Une fois de plus, Jean-Robert Pitte transforme notre regard sur les cultures qui nous entourent, nous aide à en décoder la richesse tout en nous faisant partager sa passion pour le vin.
Philippe Boulanger
ANNEE 2013
VALLAURI Daniel, GREL Audrey, GRANIER Evelyne, DUPOUEY Jean-Luc, Les forêts de Cassini. Analyse quantitative et comparaison avec les forêts actuelles.
Rapport WWF / INRA, 2012. 64 p. + CD
L’INRA, le WWF et les réserves naturelles catalanes s’unissent pour publier un intéressant rapport, agrémenté de nombreux documents graphiques et cartographiques, qui porte sur l’exploitation d’un document incontournable : la carte de Cassini.
Dès le XVIIIe siècle, la carte de Cassini a été utilisée pour tenter d’évaluer les surfaces forestières françaises, en particulier par Tellès d’Acosta (1791) et Young (1792). On estimait alors, sur la base de calculs assez précis compte tenu des techniques disponibles, que la France disposait de 6,1 millions d’hectares d’après Tellès d’Acosta, et 7,6 millions d’hectares d’après Arthur Young. Mais pendant deux siècles, les estimations de ces deux auteurs n’ont pas été améliorées. Les outils actuels et notamment les S.I.G. permettent un travail précis et de multiples manipulations statistiques et cartographiques ; c’est ce qu’ont engagé les auteurs de ce petit ouvrage, après vectorisation de la totalité des 181 feuilles de la carte de Cassini. L’objectif n’est pas uniquement d’alimenter l’histoire des forêts et des paysages en données quantitatives ; l’ouvrage s’inscrit dans les problématiques actuelles d’identification des forêts anciennes, travail pour lequel la France accuse un retard considérable sur certains de ses voisins.
Les résultats obtenus ne sont pas révolutionnaires ; ils affinent les estimations précédentes. Si l’on ne prend en compte que le territoire français actuel couvert par la carte, Cassini de Thury et ses successeurs ont représenté entre 1749 et 1790 un total de 6,6 millions d’hectares de forêts, soit un taux de boisement de 13%.
Les auteurs s’engagent dans une intéressante comparaison avec les forêts françaises actuelles. Les « forêts de Cassini » ne sont pas réparties comme les forêts du début du XXIe siècle. Alors que les surfaces boisées de la moitié nord de la France sont restées relativement stables, celles du sud ont connu entre 1790 et 2012 des changements très importants (taux de boisement passés de 9 à 44% en Aquitaine, 6 à 46% en Languedoc-Roussillon, 13 à 46% en PACA). Les chiffres et cartes proposés par les auteurs ne surprendront personne ; c’est leur précision qui fait leur valeur.
Le travail effectué est exemplaire dans son ambition, car travailler à l’échelle de la France entière pouvait sembler une gageure délicate. Il est également exemplaire par le sens critique et la prudence dont font preuve les auteurs. En effet, l’utilisation de la carte de Cassini ne peut manquer de soulever un certain nombre de problèmes méthodologiques. Ceux-ci portent notamment sur la fiabilité des informations représentées, et notamment des surfaces en bois. Par une comparaison avec différentes cartes contemporaines, les auteurs montrent que les surfaces forestières sont probablement sous-représentées sur la carte de Cassini, et que les surfaces obtenues après vectorisation devraient probablement être augmentées pour correspondre à la réalité du XVIIIe siècle. C’est sans doute pour cette raison qu’il existe une telle différence entre les chiffres publiés dans le cadre de cet ouvrage (taux de boisement de 13%), et ceux tirés du cadastre dit « napoléonien » (taux de boisement de 17% sur la surface commune aux deux cartographies) : Cassini sous-estime les forêts, et le cadastre les surestime sans doute, ce qui fait que les surfaces boisées du XVIIIe siècle paraissent moins étendues que celles de 1830, alors qu’on sait par ailleurs que bon nombre de défrichements sont intervenus entre-temps. La conclusion est évidente, même si les auteurs ne s’engagent pas dans ce sens : les comparaisons d’un siècle à l’autre sont délicates, parce que l’information ne porte pas sur les mêmes objets. Cassini prenait en compte le boisement, dans une optique plutôt paysagère, utile aux voyageurs et aux armées ; le cadastre, lui, précisait un statut fiscal qui ne correspondait pas forcément à l’occupation du sol ; les statistiques récentes prennent à nouveau en compte le boisement et non un statut administratif et/ou juridique.
La valorisation des données recueillies par les auteurs ne fait que commencer ; signalons que le CD qui acompagne l’ouvrage comprend, entre autres, les couches SIG libres de droit. Bon nombre de chercheurs pourront trouver là un fertile terrain de jeux.
Xavier Rochel
BARTOLI Michel. Louis de Froidour (1626-1685). Notre héritage forestier. Collection « les dossiers forestiers » n° 23. Paris : Office National des Forêts, 2012, 220 pages. URL : http://www.onf.fr/lire_voir_ecouter/
Louis de Froidour est l’un des personnages les plus éminents de l’histoire forestière française. Dans l’épisode de très grande portée qu’est la réformation « colbertienne », Froidour incarne le versant administratif et technique du grand bouleversement des années 1660-1670 ; il est celui que l’Histoire retient généralement pour illustrer les difficultés rencontrées par le pouvoir royal dans l’application d’un droit forestier unifié et d’une politique forestière cohérente, au sein d’un Etat qui était alors encore bien mal cimenté. Bon nombre de chercheurs, parmi lesquels Michel Devèze, ont déjà étudié et présenté le personnage et son action.
Michel Bartoli, forestier de formation, mais aussi historien prolifique, est l’auteur de multiples publications sur l’histoire des forêts et des forestiers. Il apporte ici une monographie qui, sans nul doute, sera très largement diffusée et appréciée, puisqu’elle n’est pas commercialisée mais se trouve librement téléchargeable sur le site de l’Office National des Forêts. L’ouvrage gênera donc peut-être les tenants irréductibles du format papier, tandis que les férus du numérique apprécieront les facilités offertes par le PDF, où la recherche de mots clés est par exemple particulièrement facile, malgré un volume écrit assez considérable – 220 pages au total.
L’ouvrage est clairement divisé : une première partie constitue une biographie très classique, une seconde expose « la méthode Froidour » dans son activité réformatrice, une troisième évoque la sylviculture et une quatrième, l’aménagement des forêts. La cinquième et dernière partie est consacrée à « l’héritage forestier » lié à Froidour. Le tout est agrémenté de documents pertinents, mais peut-être trop fortement dominés par les reproductions de documents d’archives, où les géographes remarqueront avec plaisir quelques croquis et plans des années 1660 et 1670, et regretteront l’absence de toute carte relative à l’activité du grand forestier, ne serait-ce qu’une représentation sommaire du territoire concerné.
Né dans l’Aisne, Louis de Froidour était un homme du Nord, qui fit ses premières armes dans le Bassin parisien. Grâce à la protection de Colbert, sa carrière fut brillante malgré des origines roturières. En 1666, il fut chargé d’appliquer la grande réformation « colbertienne » dans la grande maîtrise de Toulouse, sur une très vaste région étendue du Pays Basque au Vivarais. Soumettre une forêt, ou un ensemble de forêts à une « réformation » consistait alors en une opération complexe. Il s’agissait d’inventorier et cartographier les surfaces boisées existantes ; d’en évaluer l’état et la valeur ; de vérifier dans quelle mesure les communautés rurales pouvaient ou non en profiter ; d’édicter pour l’avenir des règles de gestion plus ou moins strictes. Bien entendu, l’opération prenait une tournure judiciaire, car les abus constatés devaient être réprimés.
Arrivé sur place, Froidour se heurta à de multiples reprises à des obstacles inattendus. Les forêts étaient bien différentes de celles du Bassin Parisien pour lesquelles la législation avait été pensée ; on note avec intérêt ce passage transcrit par l’auteur, où Froidour fait le récit de sa première rencontre avec les forêts « plantées de sapins (…) cette sorte d’arbres (…) droits comme des flèches et sans branches qu’au houppier » (p. 109). Les structures politiques et sociales étaient elles aussi particulières ; des communautés solidaires et des seigneurs puissants étaient prêts à s’opposer, y compris de vive force, aux tentatives d’intrusion du pouvoir royal. Enfin, plus encore que dans le Nord du royaume, les fonctions de la forêt mêlaient production de bois et pratiques agraires : le pastoralisme surtout, ainsi que les « artigues » et autres cultures de marge faisaient de l’espace forestier un embrouillamini paysager et fonctionnel où la « rigueur des ordonnances » peinait à trouver sa place.
Quelle fut l’oeuvre de Louis de Froidour dans ce contexte difficile ? L’homme était sévère, comme il sut le prouver face aux officiers corrompus ; mais il savait aussi être pragmatique. Il ne tomba pas dans le piège d’une application aveugle des règles du taillis sous futaie dans des forêts montagnardes souvent résineuses, où la futaie jardinée seule pouvait donner de bons résultats. Il accepta, bon gré mal gré, la tradition pastorale en forêt. Par une approche souple et sensée des réalités du temps et du lieu, il contribua à ce que l’irruption d’un pouvoir centralisé ne soit pas trop mal ressentie et à ce qu’elle puisse, en quelque sorte, s’enraciner dans la durée. N’opposons pas sans nuance l’approche de Froidour à celle réputée plus rigide des forestiers du XIXe siècle : bien des « hussards verts » surent, comme leur prédécesseur du XVIIIe siècle, composer avec les exigences des populations montagnardes, et se montrer bien plus pragmatiques que ne le prétend une légende noire.
Xavier Rochel
GUYARD Patricia. Les forêts des salines. Gestion forestière et approvisionnement en bois des salines de Salins au XVIe siècle. Besançon : Association des amis des archives de Franche-Comté, 2013, 2 volumes : 446 et 282 pages.
Le sel est fondamental dans l’alimentation des hommes, et dans celle des animaux. Loin des littoraux, il constituait autrefois une denrée rare et chère, qu’il fallait obtenir à grands frais par l’évaporation des eaux saumâtres issues de bancs de sels souterrains. En Franche-Comté, des salines furent donc implantées et exploitées en différents lieux, là où de telles eaux étaient disponibles. Les sites de Salins et d’Arc-et-Senans, inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial, sont évidemment les plus emblématiques, mais ils sont bien loin d’être les seuls : citons avec l’auteur (p. 11), les noms évocateurs de Saulnot, Soulce-Cernay, Lons-le-Saunier ; ou encore les noms moins parlants de Montmorot, Grozon, Scey-sur-Saône. Le fonctionnement de tels établissements nécessitait évidemment d’énormes quantités de bois et de charbon de bois : on parle parfois de « sel ignigène » pour désigner les produits ainsi obtenus, et ces salines étaient autrefois désignées, avec les forges et autres proto-industries, par le vocable « bouches à feu ». L’approvisionnement en bois des salines était, pour les puissants qui les contrôlaient, une problématique de premier plan ; bien évidemment, il en est resté un très important volume d’archives.
La publication ici présentée a pour objectif de contribuer à faire avancer la connaissance et l’exploitation de ces archives. Qu’on ne cherche pas là une monographie historique sur un site industriel. L’auteur, Patricia Guyard, est archiviste paléographe, et l’ouvrage est essentiellement une édition critique de textes d’archives relatifs aux salines de Salins et à leur approvisionnement en bois au XVIe siècle.
Le volume I correspond donc à une compilation de textes, tandis que le tome II est curieusement intitulé « annexes » alors qu’il constitue sans doute, surtout pour le lecteur pressé, le volume le plus éclairant ; il présente la documentation réunie tout en essayant d’en retenir l’essentiel, d’en tirer le plus de cohérence possible à travers un certain nombre de thématiques essentielles. A lire le titre du 1er chapitre de ce volume, on s’attendrait à une présentation large, au prisme de l’historiographie française et européenne, qui prendrait en compte les études existantes, déjà assez nombreuses, sur l’histoire de la forêt, l’histoire de l’industrie. Mais à cette échelle large, la mise en perspective des documents étudiés reste assez peu développée ; le contexte technique, politique, et géohistorique est peu utilisé pour éclairer la documentation réunie. Les références aux régions voisines et à l’historiographie sont souvent assez allusives, donc frustrantes pour le lecteur (vol. II, page 21). C’est surtout dans un contexte régional et local que l’auteur offre, avec rigueur et érudition, toutes les clés pour la compréhension des textes édités.
Au XVIe siècle, les salines de Salins constituaient un établissement énorme, une « ville dans la ville », siège d’une activité financièrement très intéressante pour les comtes de Bourgogne et différents propriétaires associés. Il faut en réalité distinguer deux établissements. L’un, la Grande Saunerie, était plutôt domanial. L’autre, le Puits à Muire, peut être qualifié de « privé », même si la réalité était bien entendu extrêmement complexe, d’autant que le pouvoir souverain chercha activement à ériger la production de sel en monopole, avec moins de succès que dans la Lorraine voisine. Chaque établissement disposait de ses réseaux d’approvisionnement. La Grande Saunerie disposait de forêts affectées, les « fassures », dont le produit pouvait être complété par des « bois de vente » obtenus par les voies commerciales. Quant au Puits à Muire, dépourvu de forêts affectées, il devait se contenter de bois de vente obtenus sur le marché.
L’approvisionnement en bois comme la vente du sel étaient partagés en deux territoires dits d’Amont et d’Aval. Les bassins d’approvisionnement concernés semblent avoir été très étendus : il s’agissait de trouver de grandes quantités de bois façonnés en « chevasses » et « fassins », qui devaient être utilisés pour la cuite de l’eau salée ou « muire » ; ainsi que du charbon de bois utilisé pour les dernières phases de la production (séchage du sel). Cet approvisionnement, qui dut être assez facile pendant un temps, se heurta au XVIe siècle à une vive concurrence. C’est d’ailleurs un contexte commun avec la Lorraine : les conflits liés à la ressource ligneuse étaient exacerbés par l’essor démographique et économique de la région, tandis que le pouvoir souverain devait légiférer à tour de bras, renforcer les structures d’encadrement telles que les grueries, et arbitrer les conflits en veillant à protéger les intérêts des établissements industriels stratégiques et lucratifs. A Salins, les administrateurs des deux salines « mirent en œuvre de véritables stratégies pour capter, garder et agrandir leurs aires d’approvisionnement » ; ils devaient compter avec d’autres usines à feu, mais aussi avec les communautés rurales, les usages pastoraux de la forêt, le risque du défrichement. C’est ainsi que, selon les mots de Patricia Guyard, « se constitua dès le XVe siècle un territoire industriel né de l’économie du bois pour les salines ».
La spatialisation des informations issues de ces archives est donc évidemment fondamentale. On sait quelles belles pages d’Histoire ont été consacrées à l’étude des bassins d’approvisionnement en bois des villes et des industries (par exemple les travaux de Jean Boissière sur l’approvisionnement de Paris, ou les ouvrages déjà anciens sur « forges et forêts » et « le bois et la ville » édités sous l’égide du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises en 1990 et 1991). Patricia Guyard n’a pas éludé la question et un certain nombre de cartes viennent donc agrémenter l’ouvrage. Le travail n’apporte pas une vision complète des « territoires industriels » en question. Il manque, sans doute, une carte de synthèse des bassins d’approvisionnement avec les limites « d’Amont » et « d’Aval » ; elle serait probablement plus utile au lecteur que les cartographies plus pointues, d’intérêt plus local, présentées pages 161, 175, 191, 212, 214.
Quant à la gestion forestière, elle est assez peu abordée par les textes présentés ; les sources sont, au XVIe siècle, assez laconiques sur le sujet, même si Lucien Turc a pu en tirer quelques belles pages dans les années 1950. C’est donc surtout à la connaissance du fonctionnement politique, juridique, administratif et économique du système d’approvisionnement en bois que l’ouvrage est particulièrement utile.
Xavier Rochel
DAI PRA Elena (sous la direction), 2013, Apsat 9, Cartografia storica e paesaggi in Trentino, approcci geostorici, Sap Società Archeologica, 337 p.
Elena Dai Prà (université de Trente) vient de publier, sous sa direction, une publication collective remarquable sur la géographie historique de la région du Trentin. Plus de 16 contributions mettent en évidence la grande richesse des collections archivistiques de cette région. A travers l’étude des cartes produites depuis le XVIIe siècle, une géographie historique de Trente nous est rendue compréhensible non seulement à travers la diversité des thèmes traités mais encore par la qualité des reproductions publiées.
La grande richesse des contributions abordant le thème de la frontière, des fortifications ou des paysages ruraux et urbains en fait un ouvrage de référence en géographie historique. Les différentes contributions permettent de comprendre, à partir du XVIIe siècle, la manière dont évolue cet espace tampon entre les grands empires, situé aujourd’hui dans le Nord-Est de l’Italie et appelé la région de Trente Haut-Adige. Elles analysent également les différents modes de gestion du territoire ainsi que les bouleversements politiques, économiques et socio-culturels qui résultent de son intégration à l’Italie en 1919.
L’ouvrage se structure en trois parties de manière équilibrée par le nombre d’articles attribués. La première partie valorise la diversité des fonds archivistiques et cartographiques. Elle pose la question de l’exploitation et de l’interprétation des cartes en géographie historique pour la région du Trentin. Entre autres, la contribution de Davide Allegri s’intéresse à la production archivistique et cartographique sous la période napoléonienne dans le département du Haut-Adige. Elle montre l’intérêt particulier du stratège et de l’administrateur français pour la position géostratégique des confins du Tyrol, situé entre le Royaume d’Italie, celui de Bavière et les provinces Illyriques, comme la volonté politique de mener des campagnes de bornage de la frontière dans les années 1810-1813.
La deuxième partie analyse la géographie historique de la région du Trentin à partir de différents cas d’études s’appuyant sur la cartographie et la toponymie. La contribution de Elena Dai Prà et Anna Tanzarella, sur la sémiologie de la carte comme un outil de compréhension des mutations territoriales, par exemple, met en exergue la place spécifique de la région depuis l’époque moderne, en raison du pluralisme linguistique qui domine, de son rôle de carrefour des influences extérieures comme sa position géopolitique instable à travers la représentation des symboles, des couleurs, des toponymes des documents.
Enfin, la dernière partie se veut résolument contemporaine et prospective sous le titre de « cartographie et projet ». Les différents auteurs, comme Marco Mastronunzio traitant de la géométrie et du graphisme comme moyen d’appréhender le territoire contemporain, témoignent de l’apport de la géographie historique dans les représentations cartographiques actuelles, s’appuyant désormais sur des données numériques.
En somme, cette publication collective révèle la grande diversité de la production géographique et cartographique de la région du Trentin depuis le XVIIe siècle, liée à sa position de confins et d’espace tampon entre des entités politiques plus puissantes. La représentation du territoire apparaît marquée notamment par l’influence française depuis le XIXe siècle avant son intégration à l’Italie. Outre le plaisir de découvrir des reproductions cartographiques d’une grande qualité, l’ouvrage permet de mieux comprendre le réel apport de la géographie historique dans la réflexion géographique contemporaine.
Philippe Boulanger
NOIZET Hélène, BOVE Boris et COSTA Laurent, Paris de parcelles en pixels, Presses universitaires de Vincennes, Comité d’histoire de la Ville de Paris, 2013, 343 p.
Cet ouvrage collectif se veut une « analyse géomatique de l’espace parisien médiéval et moderne » qui, comme le précise le sous-titre, pourrait être technique voire dissuasif. Il apparaît, en réalité, comme une somme d’informations géographiques particulièrement riches résultant de la combinaison de compétences et d’expertises dans différents domaines. Il contribue à approfondir la connaissance des sociétés et des espaces parisiens grâce à la production de nouvelles informations cartographiques et de nouvelles analyses à partir de celles-ci.
Tout d’abord, cet ouvrage résulte du colloque organisé, en juin 2010, dans le cadre du projet Alpage, financé par l’Agence nationale pour la recherche (2006-2010), permettant de réunir les savoir-faire des sciences humaines et des sciences et techniques de l’information et de la communication. La production d’un système d’information géographique inédit, produit à partir des plans de Philibert Vasserot datant du début du XIXe siècle, offre ainsi une base de données très utile pour le géographe, l’historien ou l’archéologue. Le résultat est tout à fait étonnant et suscite, un intérêt réel pour toute méthodologie en géographie historique.
La constitution de l’Atlas de Paris par Philippe Vasserot, architecte au service des Hospices de la Ville de Paris, s’inscrit dans un contexte particulier, juste après l’adoption du système métrique (1795) et de la numérotation des maisons (1805) comme de la mise en œuvre du plan d’Edme Verniquet achevé vers 1800. Ce programme de cartographie dirigé par Vasserot à partir de 1810 s’achève en 1836. Il présente un progrès dans la précision du dessin, par exemple, en apportant un soin du détail pour représenter les porches, portes, portillons ou fenêtres. Un ensemble de plans par îlots, le plus souvent à une échelle au 1/200e, permet d’identifier chaque parcelle de Paris. Chacune d’entre elles est rendue par une couleur différente et présentée par un plan de coupe des bâtiments à environ 1 mètre du sol avec les différents détails (portes, murs, fenêtres, escaliers, etc.). La première partie de l’ouvrage, intitulée Méthodes de reconstitution du plan Vasserot, débute par l’analyse du plan de Vasserot (Michel Denès) et la conception du projet d’intégration du plan dans un système d’information géographique. La deuxième partie valorise les résultats obtenus en procédant à l’analyse spatiale de l’espace parisien à partir de quatre grandes thématiques : les enceintes du Xe au XVIe siècle, les espaces ruraux et urbains (voirie, censives urbaines par exemple), la morphologie urbaine et les usages de l’espace (fiscal, religieux et aristocratiques).
Les contributions des historiens, géographes et informaticiens, au nombre de 16, donnent ainsi un apport d’informations géographiques et de géolocalisations inédites. La démarche méthodologique, qui consiste à exploiter des données anciennes, à partir d’un plan méconnu, pour créer une nouvelle base de données numérique aboutit à des résultats renouvelant la connaissance cartographique et géographique à différents siècles de l’espace parisien. Il en est ainsi du tracé des enceintes médiévales qui est resté paradoxalement, comme le souligne Claude Gauvard en conclusion, mal connu, des espaces occupés par l’aristocratie nobiliaire aux cotés d’autres métiers, des bourgeois et des élites de l’échevinage parisien. La production de nombreuses planches du plan de Vasserot et de nouvelles cartes de grande qualité visuelle permet ainsi de mieux comprendre les réseaux d’organisation de l’espace et les modes de fonctionnement de la société au sein de la capitale.
Philippe Boulanger
SUBRA Philippe, Le Grand Paris, géopolitique d’une ville mondiale, Paris, Armand Colin, coll. Perspectives géopolitiques, 2012, 315 p.
Philippe Subra, Professeur à l’Institut français de géopolitique (Université Paris VIII), présente une étude remarquable sur le Grand Paris. Reconnu comme l’un des rares spécialistes français de la géopolitique locale et de l’aménagement du territoire, il analyse les nombreux enjeux, les rivalités et les représentations liés au projet du Grand Paris. L’ouvrage est incontournable pour qui s’intéresse aux mutations en cours de la métropole parisienne.
L’analyse est ambitieuse sur un sujet d’actualité difficile à cerner depuis plusieurs années. L’auteur relève avec brio ce défi car le style et la pensée rendent claires un projet d’une rare complexité. Tout l’intérêt est de comprendre les rivalités de pouvoirs entre les différents acteurs politiques et institutionnels qui conduisent à la réalisation d’un aménagement territorial d’envergure nationale et internationale.
Tous les grands partis politiques se sont impliqués dans le projet du Grand Paris. L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy (2007-2012), en fit « l’un des dossiers emblématiques de son quinquennat ». L’Etat, la Région, la Ville de Paris, les sept autres départements environnants, les 400 communes de l’agglomération, les communautés d’agglomération et de communes se sont aussi mobilisés, mis en concurrence pour mener leurs propres stratégies, tant les enjeux politiques, économiques et socio-culturels sont importants à l’échelle nationale et mondiale. En effet, la métropole parisienne constitue une agglomération de 10 millions d’habitants (18% de la population nationale, l’équivalent de la population belge). Elle représente un Produit intérieur brut de 553 milliards d’euros en 2010, soit autant que le PIB de la Turquie ou des Pays-Bas. En raison de ses nombreux avantages dans de multiples secteurs d’activités, de son histoire et de sa culture, de son rayonnement international, elle appartient au groupe restreint des quatre premières grandes villes mondiales avec New York, Londres et Tokyo.
En revanche, de multiples difficultés de fonctionnement l’amènent à perdre cette place de ville mondiale. Le développement continu des nouvelles métropoles des pays émergents, comme Shanghai et Sao Paulo, tend à reléguer progressivement l’agglomération parisienne à un rang secondaire sur de multiples aspects liés aux réseaux de transport, à la qualité de la vie, à l’emploi ou au rayonnement culturel. L’aménagement du Grand Paris apparaît donc comme un enjeu majeur lié à la mondialisation des échanges tant en termes d’aménagement du territoire que de géopolitique mondiale.
Cette analyse du Grand Paris ne néglige aucun aspect et donne sa place à toutes les analyses nécessaires pour en comprendre la dimension géopolitique, à la fois à des échelles géographiques variables (le monde, le territoire national, la région, la commune) et à des rythmes historiques bien distincts pour en mesurer les phases de croissance. Dans une première partie, intitulée « L’Ile-de-France, métropole en crise ? », Philippe Subra s’intéresse aux raisons qui ont conduit à la conception du Grand Paris. La concurrence entre les villes mondiales, la fatigue d’un système de transports aménagés pour des besoins bien moindres voici plus d’un demi-siècle, la ségrégation et la crise du logement nous rappellent les conditions difficiles que peuvent rencontrer les Franciliens dans leur vie quotidienne, mais aussi la nécessité d’intervenir pour enrayer le déclin de Paris à l’échelle mondiale.
Dans une seconde partie, intitulée « Une gouvernance problématique », l’auteur analyse les jeux de pouvoirs liés à l’évolution des plans d’aménagement depuis la Seconde Guerre mondiale, les batailles politiques qui précédent sa conception comme celle du contrôle du Schéma directeur de l’aménagement urbain. Sont successivement traités les rivalités de pouvoirs pour le contrôle du Schéma directeur de la région Ile-de-France entre 2004 et 2010, les rivalités et les stratégies entre la RATP et la SNCF, les projets d’aménagement autoroutiers et aéroportuaires. Tous les aspects territoriaux et institutionnels sont ainsi clairement posés pour aborder d’autres dimensions géopolitiques liées au Grand Paris : la « balkanisation du pouvoir local en Ile-de-France », les rivalités et les complémentarités entre Paris et la banlieue, la concurrence entre l’Etat et l’émergence d’un pouvoir francilien fort. A partir du discours de Roissy du président Sarkozy, en juin 2007, le projet est devenu source de conflictualité. Un secrétariat d’Etat au Grand Paris est formé tandis que les différents projets proposés entre les acteurs politiques et institutionnels s’affrontent. Le chapitre 9 sur « Nanterre-La Défense » présente une analyse précise des enjeux d’aménagement de l’un des espaces clefs de l’agglomération à travers ce que l’auteur appelle la « bataille de Nanterre », entre 1995-2000 et le Plan de renouveau de la Défense de Nicolas Sarkozy, en 2006, qui prépare la reprise en main par l’Etat.
Par la loi sur le Grand Paris (août 2009-mai 2010), un consensus est adopté et, après trois années de débats, conduit à un accord sur la création de la Société du Grand Paris, chargée de l’aménagement d’un nouveau réseau de transport sans que la gouvernance de la métropole ne soit définitivement réglée. La Communauté urbaine, souhaitée par l’Etat en 2007 pour la métropole parisienne, n’a toujours pas abouti.
La question de la gouvernance territoriale et des concurrences entre les forces politiques font l’objet de la troisième partie, intitulée « Mutations électorales et rivalités politiques : un paysage en recomposition ». L’aménagement du Grand Paris est conçu alors que les forces politiques mènent de nouvelles stratégies d’appropriation politique et territoriale : le Parti socialiste à la conquête de la banlieue communiste, les rivalités entre écologistes et socialistes à Paris, les offensives du Front national. L’enjeu est le contrôle des nombreuses et puissantes institutions que compte l’Ile-de-France. La conduite du Grand Paris peut donc encore évoluer car la gouvernance territoriale est le résultat des jeux de pouvoirs entre ces forces politiques. Il reste de nombreuses questions en suspens que l’auteur aborde en conclusion.
Cet ouvrage, concis par le style et précis dans son argumentation, richement illustré de cartes analytiques, est un ouvrage pionnier en la matière. La démonstration est d’une grande clarté pour traiter toutes les dimensions d’un problème majeur de gouvernance territoriale. Sans nul doute, il renouvelle l’approche géopolitique par ses nombreuses qualités et renseigne sur un débat politique qui est loin d’être achevé.
Philippe Boulanger
GAZAGNADOU Didier, La poste à relais en Eurasie, la diffusion d’une technique d’information et de pouvoir (Chine, Iran, Syrie, Italie), Editions Kimé, 2013, 200 p.
Cet ouvrage de Didier Gazagnadou, professeur d’anthropologie du monde arabe et de l’Iran à l’Université de Paris VIII, constitue une somme d’informations remarquable, résultant d’une grande érudition, sur les techniques de diffusion des courriers : la poste à relais. Publiée pour la première fois en 1994, cette nouvelle édition s’enrichit de nouveaux apports de la recherche. Elle n’est pas sans rappeler, par la qualité de l’analyse et de la démonstration, les grands travaux de géographie historique publiés par Fernand Braudel sur l’Economie-Monde, Xavier de Planhol sur la diffusion de l’Islam, Jean-Robert Pitte sur le développement des châtaigneraies en Europe ou celles des techniques de viticulture à travers le monde.
Comme le souligne l’auteur, l’information est toujours un élément central de la construction d’un Etat. Ce fait se vérifie dans le développement d’un réseau sino-mongol de diffusion de l’information ingénieux, avec chevaux et courriers, dans le grand empire mongol. Au XIIIe siècle, celui-ci s’est étendu à travers toute l’Asie, de la Palestine à la Chine et aux autres royaumes asiatiques sous sa tutelle (la Corée par exemple). Sans un système de communication et d’information performant, parmi les plus modernes en son temps, la puissance mongole n’aurait pu atteindre un tel niveau d’expansion territoriale.
Ce système trouve ses origines dans la mise en place des premiers postes à relais dès le IIIe siècle avant J.C. Il connaît une constante amélioration. La hiérarchisation des missions, l’organisation territoriale rigoureuse et l’augmentation des effectifs employés à cette fonction, conduit à consolider la puissance géopolitique, à des fins politiques et militaires ainsi qu’économiques, des grands souverains chinois. Sous la dynastie des Tang (VIIe-Xe siècles), par exemple, le réseau comprend 1 643 postes à relais dont 1 297 relais par voie de terre, 260 relais par voie d’eau et 90 relais mixtes, distants chacun d’une vingtaine de kilomètres. Il couvre alors 32 500 kilomètres de parcours, supposant la mobilisation de près de 20 000 employés, 42 000 chevaux et 1 384 bateaux de postes. Ce système est ensuite étendu à cet immense empire mongol, le plus grand que l’humanité ait put connaître.
Certaines puissances étatiques s’en inspirent d’ailleurs pour asseoir leur propre expansion. Le sultan mamelouk imite ce modèle de relais de poste en Palestine et en Syrie, après sa victoire sur les Mongols en 1260. Les parcours et l’organisation de la poste russe jusqu’à Pierre le Grand, en Russie et en Sibérie, s’appuient également sur un réseau de techniques établi par les Mongols. Le Duché de Milan fonde son propre système de communication vers la fin du XIVe siècle en reprenant ces mêmes techniques. Cette organisation est à l’origine, pour l’auteur, de la « première poste à relais européenne ». Contrairement au modèle mongol, les différents systèmes de diffusion de l’information qui se mettent en place en Europe s’ouvrent progressivement aux individus. Ils ne sont plus strictement réservés aux fonctionnaires et à une administration centralisatrice.
Tout l’intérêt de cet ouvrage consiste à comprendre le phénomène de la diffusion de l’information et le fonctionnement du système de postes à relais dans différentes cultures d’Eurasie. La démonstration s’appuie sur de nombreuses cartes inédites et une structure en quatre parties. La première aborde les origines du système à travers « le bureaucrate, le paysan et le postier », qui se développe en Chine entre le IIIe siècle et le XIIIe siècle. La deuxième partie, intitulée « les mongols, la guerre et l’information », montre la réappropriation du modèle chinois et son renforcement à des fins de conquêtes et de surveillance territoriale. La troisième partie (« Le sultan, le territoire et la poste ») met en évidence les différents systèmes de communication utilisés par le souverain et son administration centralisatrice : le service postal par chevaux mongols et mamelouks en Asie occidentale, la poste aux pigeons et par signaux optiques à la fin du Moyen-Age. La quatrième partie (« L’Etat, la poste et l’individu ») traite de la reprise de ce système de relais à poste par les Européens : la poste milanaise, la poste à relais de chevaux en Europe, la poste d’Etat en France au XVe siècle et les débuts de la poste royale du roi Louis XI.
Cet ouvrage constitue un apport de connaissances sans équivalent sur un sujet quasiment d’actualité. L’essor des nouvelles techniques d’informations et de communications est sans comparaison avec les systèmes chinois, mongol et mamelouk. Il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans une certaine continuité géographique et historique : les grandes routes terrestres de l’information, la globalisation de la communication, l’information comme pilier de fonctionnement d’un Etat sont autant d’éléments qui existaient déjà à travers le système de relais à poste durant deux millénaires en Asie.
Philippe Boulanger
Année 2012
RAULIN Henri, Maisons paysannes d’Europe. Ancrage dans l’histoire et manières d’habiter. Préface de Jack Goody, avant-propos de Colette Pétonnet, Paris, Ibis Press, 2009.
En un peu moins de 250 pages d’un ouvrage superbement illustré et soigneusement mis en page, l’ethnologue Henri Raulin présente l’essentiel de ses observations, conduites depuis de nombreuses années, sur les maisons paysannes en Europe. L’auteur a évité - et est allé au-delà - de l’impossible catalogue. Il a au contraire procédé par touches successives, en pointant les problèmes-clés ou les exemples-clés, allant des descriptions aux hypothèses, et adressant au lecteur les ultimes questions sur la diffusion d’un type architectural, d’une influence culturelle, d’une technique de construction. Comme pour montrer dès le début l’ancrage qu’il attribue à son sujet, l’auteur commence son livre par un développement sur « Grands empires et maisons paysannes ». Mais il sait rester prudent lorsqu’il suggère une filiation entre la maîtrise de la voûte par les Romains et la large extension de celle-ci dans l’architecture paysanne européenne, en particulier au sud des Alpes.
En Europe orientale, l’influence des empires de l’Empire byzantin apparaîtrait non seulement dans l’architecture civile d’Istanbul, célèbre pour ses maisons à pans de bois, mais aussi aux abords immédiats de la mer Noire, en Turquie, en Roumanie et en Bulgarie, et dans une partie de l’intérieur de la péninsule balkanique. Plus à l’ouest, en Bulgarie centrale, Grèce, Albanie et dans les pays de l’ex-Yougoslavie, le bois ne disparaît pas dans la construction, et H. Raulin identifie dans ces contrées une aire de la maison « turque ». Celle-ci caractérise plutôt l’habitat des propriétaires fonciers en milieu rural et celui des notables en milieu urbain, et l’un de ses traits les plus marquants est l’étage d’habitation en encorbellement. Mais l’auteur reconnaît aussi que la part respective des influences turque et byzantine reste aujourd’hui difficile à établir pour caractériser ces maisons.
A côté de ces courants impériaux, l’auteur souligne aussi des courants plus indigènes, tels qu’ils apparaissent avec les constructions sur poteaux de bois, les plus anciennes en Europe, et celles aussi dont on retrouve le plus facilement les traces. L’on en retrouve encore des exemples en Podolie, où des bâtiments annexes sont construits en poteaux enfoncés dans des trous et sont recouverts par une toiture à quatre versants, sans doute proche de celle qui devint la toiture courante dans les maisons protohistoriques sur poteaux de la vallée du Danube, du nord de la France ou de l’Angleterre. La construction en troncs d’arbres horizontaux apparaît à l’âge du bronze, du Jura franco-suisse à la plaine du nord de la Russie actuelle, où elle s’est maintenue jusqu’à nos jours. Son expression la plus connue et la plus étendue est la construction « pièce sur pièce », qu’on retrouve aussi bien dans les Bornes ou le Beaufortin qu’en Ukraine et en Russie, avec l’isba.
En outre, dès le Néolithique, une opposition apparaît entre la prédominance du bois dans les Alpes et au Nord, celle de la pierre au sud de ce massif. Et c’est seulement à partir de la Renaissance qu’une période de reconstruction s’amorce, qui sera caractérisée par l’apparition progressive des modèles régionaux, et s’achèvera suivant les pays entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle.
Dans une dernière partie, H. Raulin n’oublie pas de montrer les relations entre les maisons et l’organisation de la famille et de la parenté, en égratignant un peu au passage les théories d’Emmanuel Todd au sujet de la présence du modèle patriarcal autoritaire au nord de l’Europe, et de la cohabitation parents-enfants qu’il aurait nécessairement impliqué. Enfin, l’auteur a rédigé en fin de volume un « petit guide de découverte des musées de plein air » en Europe, auquel l’ouvrage aura remarquablement préparé le lecteur.
Jean-René Trochet
Université Paris-Sorbonne
RAGGIO O. et SINIGAGLIA R., Geografie in Gioco. Massimo Quaini : Pagine scelte e bibliograpfia. A Cura del Dottorato in Geografia storica, Università degli Studi du Genova, Edizioni APM, 2012, 155 p.
CERRETI Claudio, Della società geografica italiana e della sua videnda storica (1867-1997), Roma, 2000, 158 p.
La géographie historique italienne suit une dynamique scientifique similaire à celle connue en France. Un regain d’intérêt se manifeste depuis plusieurs décennies. Il tend même à se renforcer par la fondation d’une nouvelle collection « Transverse » chez l’éditeur Il melangolo. Celle-ci est lancée par le Centre d’études en géographie historique, animé par les professeurs Claudio Cerreti (Université de Rome 3), Massimo Quaini (Université de Gênes) et Luisa Rossi (Université de Parme). Les prochaines publications porteront sur Per una nuova storia della geografia italiana avec des articles de Claudio Cerreti, Alex Cittadella, Floriana Galluccio, Carlo A. Gemignani, Francesco Micelli, Calogero Muscarà, Paola Pressenda, Massimo Quaini, Luisa Rossi, Emilia Sarno, Paola Sereno, Maria Luisa Sturani). Un second ouvrage (Massimo Quaini, Il filo e la matassa) abordera l’évolution de la géographie historique italienne jusqu’aux années 1960.
Dans une autre collection, un ouvrage couronnant quarante années de publication en géographie historique de Massimo Quaini vient de paraître sous la direction de Osvaldo Raggio et Roberto Sinigaglia. Il présente une sélection d’extraits, comme le précise le titre, de l’importante production scientifique de notre collègue, professeur à aux universités de Bari et Gênes, entre 1963 et 2011.
L’ouvrage s’articule autour de 28 extraits de publications suivis d’une bibliographie complète de l’auteur. Un très grand nombre de sujets sont traités et offrent une vision large de la conception des travaux scientifiques de l’auteur. De la géographie historique des paysages agraires de Ligurie à la place de la mémoire dans les identités culturelles, en passant par la géoarchéologie et la valorisation du patrimoine, le lecteur prend conscience de la place consacrée au passé dans ses écrits. L’ouvrage apparaît donc d’un grand apport par la qualité des extraits retenus et invite à approfondir, pour ceux qui sont intéressés, la lecture de cet ouvrage.
Parallèlement à d’autres publications que la revue de géographie historique signalera dans les prochains numéros, nous pouvons rappeler un important travail de géographie historique et d’histoire de la géographie italienne : Della società geografica italiana e della sua videnda storica (1867-1997).
Claudio Cerreti, Professeur à l’Université de Rome 3, est l’un des éminents spécialistes de la géographie historique italienne actuellement. Il est l’auteur d’une remarquable étude sur la Société de géographie italienne. Fondée en 1867 afin de consolider la récente unité politique de la péninsule italienne, cette Société de géographie devient un centre de réflexion intellectuelle très important et réunit toute une partie de l’élite politique, militaire, commerciale et d’affaires du pays. L’étude montre également comment les travaux de la Société, tous présentés à la fin de l’ouvrage, sont entrepris à des fins de connaissances géographiques, de diffusion de l’information sur les régions italiennes comme sur les nouvelles terres colonisées en Afrique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
A travers les 14 chapitres de l’ouvrage, Claudio Cerreti nous livre une analyse érudite de la montée en puissance de la Société de géographie dans le pays, la composition sociale de ses membres, son rayonnement international dans les congrès géographiques, ses orientations scientifiques, où la dimension en géographie historique se manifeste clairement, engagées par chacun des 23 présidents de la Société entre 1867 à la fin des années 1990.
Philippe Boulanger




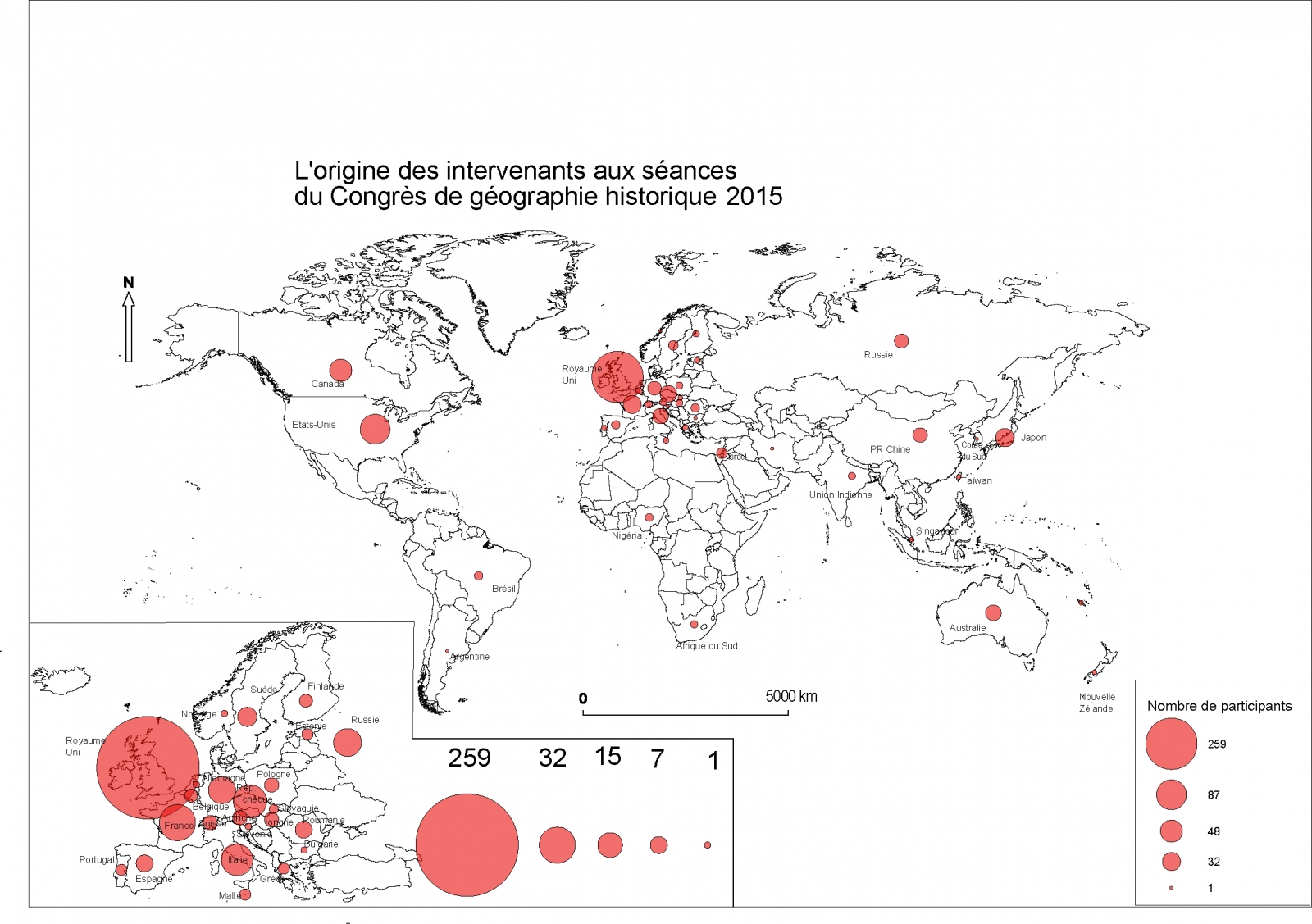
.jpg)
