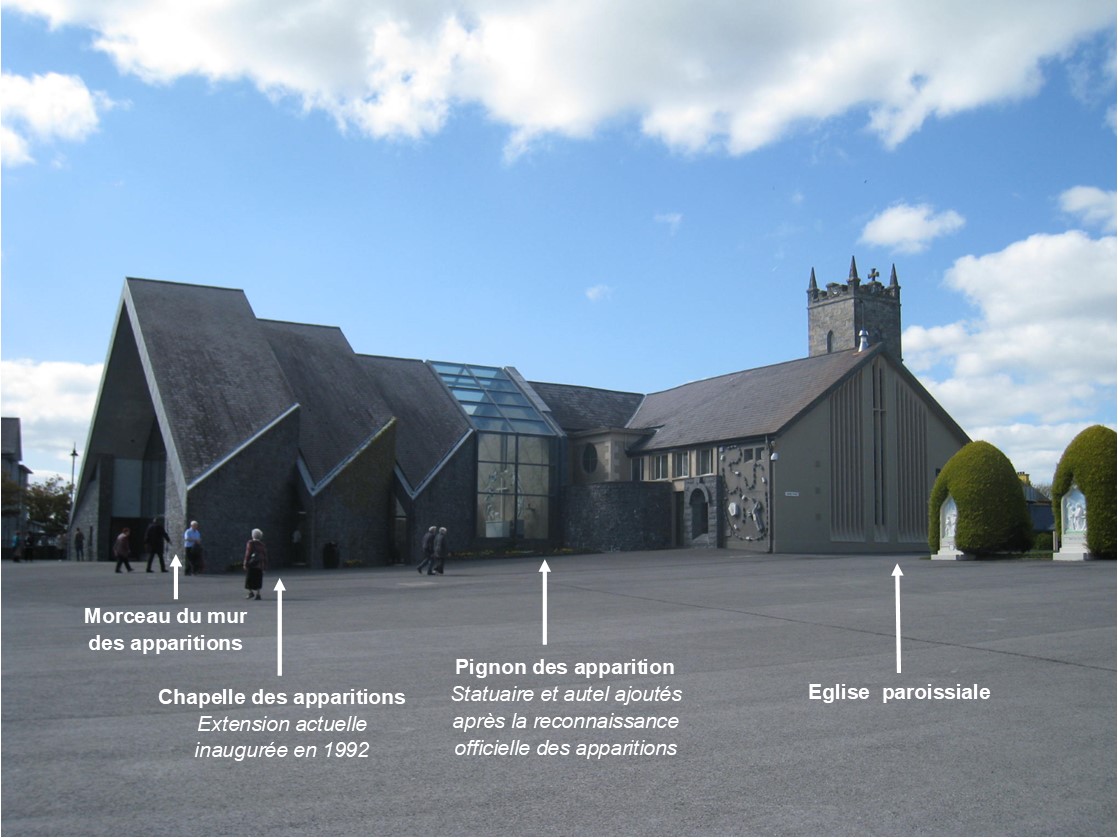Liste des articles
Editorial : Comment penser les savoirs géographiques à l’époque moderne (XVe-XIXe s.) ? | Publié le 2020-11-05 13:50:08 |
Par Étienne Bourdon (Maître de conférences HDR en Histoire moderne, Université Grenoble Alpes, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (UMR CNRS 5190)
Il est bien connu que la géographie est animée par des changements profonds et des progrès considérables entre le XVe et le XIXe siècle. Aux côtés de la médecine, de l’astronomie ou de la physique, qui connaissent aussi des renouvèlements importants, la géographie émerge comme une nouvelle manière de dire le monde. Elle est alors autant un échantillonnage du monde que l’expression d’une puissante volonté d’embrasser le sens et l’espace de l’ensemble terrestre de la Création tant par les techniques de la géométrie et de la cartographie, par la narration ou la description, que par les méditations cosmographiques. Cartes, atlas, géographies, cosmographies, récits, paysages et vues de villes s’entrecroisent et constituent le laboratoire de l’émergence de ce nouveau regard sur le monde. La géographie apparaît progressivement comme une des manières les plus pertinentes de discourir sur les territoires multiscalaires des hommes. Il n’est donc pas étonnant qu’elle émerge de l’histoire et des belles lettres, mais aussi des mathématiques et de l’histoire naturelle, et qu’elle convoque les illustres Anciens (Strabon, César…) comme les simples voyageurs contemporains. Au-delà de la prose du monde qu’elle déploie, la géographie gagne une réputation d’utilité, elle devient un discours vrai et expérimenté sur le monde. Outre la formation de l’honnête homme, elle s’avère nécessaire aux marchands et aux muletiers, aux princes et aux soldats, aux peintres et aux ingénieurs militaires, aux étudiants et aux pèlerins, aux lieutenants généraux de police et aux administrateurs du royaume. La géographie est aussi intimement liée à l’affirmation du pouvoir politique des États et à leur stratégie de prestige conduisant à présenter leurs territoires dans le registre d’une nature dominée, d’un État contrôlé, riche et puissant, borné par des frontières naturelles qui en assurent l’évidence et en garantissent la légitimité. Progressivement, la géographie assoit sa légitimité, se rapproche du pouvoir et s’institutionnalise, des cartographes royaux de la Renaissance aux premières chaires de géographie instituées au XIXe siècle. Le lectorat de la géographie s’en trouve renouvelé et très largement étendu. Pour autant, cette discipline émergente ne se réduit pas à une simple description neutre et distanciée du monde, mais trahit aussi les regards, les aspirations et les horizons d’attente des sociétés humaines qui la produisent. Au cours des siècles qui nous intéressent ici, les hommes pensent de plus en plus avec la géographie et par la géographie. La géographie s’empare du Monde et délaisse progressivement la Création aux théologiens, la sphère aux mathématiciens, la planète aux astronomes et la terre aux naturalistes. C’est cette histoire longue que nous nous proposons d’aborder dans ce dossier.
Il s’agit donc de penser les savoirs géographiques en historiens, en interrogeant les conditions sociales, politiques et intellectuelles dans lesquelles ils peuvent être mis en œuvre, mais également les discours – d’intentions, de définitions et de justifications – produits par les contemporains. Cela nécessite une prise de distance avec la pensée positiviste longtemps mise en œuvre en histoire des sciences, dont la finalité essentielle était de décrire la dynamique du progrès des connaissances, et dont les enjeux principaux étaient l’identification de l’erreur et la validation rétrospective d’un savoir jugé « vrai » dans le dévoilement progressif d’un monde objectivable. Notre intention est, à l’inverse, d’interroger la géographie comme la construction d’un certain rapport au monde, à l’espace et aux territoires, et de mettre au jour la pensée du monde qu’elle exprime.
Il n’est donc pas étonnant qu’en s’interrogeant sur la façon dont on a pensé les savoirs géographiques du XVe au XIXe siècle nous soyons amenés à soulever de nombreuses questions à la fois d’ordre historique mais aussi épistémologique à l’image de la carte Recens et integra orbis descriptio d’Oronce fine (1534) qui illustre notre dossier. Celle-ci rappelle que la géographie n’est pas un simple discours sur la dimension spatiale de la terre. Penser le savoir, ce n’est pas seulement dire ce que la géographie d’une époque a été. C’est véritablement s’interroger sur cette forme de médiance entre l’homme et le monde. De la Renaissance au XIXe siècle les savoirs géographiques se renouvellent, se structurent, la discipline m’émancipe, se diffuse et finalement s’enseigne. Tout cela renvoie nécessairement à des niveaux ou des types de savoirs. Il nous faut donc appréhender la grande diversité des formes d’expression du savoir géographique, des descriptions et des cartes bien sûr, mais aussi des récits d’ascensions, des armoriaux, des inventaires de bibliothèques ou des sélénographies, en s’intéressant tant aux discours sur les savoirs qu’à leurs diffusions et leurs usages. Il faut alors s’interroger sur les conditions sociales, politiques et intellectuelles dans lesquelles ces savoirs géographiques sont mis en œuvre, mais également les discours qui les supportent.
Cette réflexion vise donc également à identifier les contextes intellectuels et les pratiques qui éclairent la caractérisation et le statut du savoir géographique à des époques successives et à comprendre l’articulation de ces grands moments. Le choix d’une chronologie large, du XVe au XIXe siècle, permet d’appréhender le long processus d’émergence, de rationalisation et d’intellectualisation de la dimension spatiale des sociétés. Dans le discours géographique, au-delà de la description de l’espace et de l’ailleurs, se dévoile un discours multiscalaire sur soi, sur le territoire, l’identité et le rapport au monde.
Ce sont toutes ces thématiques qui parcourent les articles qui vont suivre. Pіеrre Соuhаult ouvre la réflexion en étudiant l’apport des hérauts d’armes aux savoirs géographiques aux XVe et XVIe siècles. Alors que leur fonction s’organise et s’institutionnalise dans les maisonnées royales et aristocratiques, ils sont l’auteur de petites encyclopédies chevaleresques et nobiliaires. Ainsi émerge, au sein de cette littérature pré-géographique, de véritables chorographies du royaume qui informent sur l’univers mental de la société chevaleresque de l’époque. Ce phénomène est amplifié au XVIe siècle avec un renouvellement social des hérauts plus souvent issus des milieux artistiques ou lettrés. En Europe, se dessine une géographie politique et féodale, faite de milieux et de pouvoirs hiérarchisés, seigneuriaux, urbains et ecclésiastiques, qui ne sont pas sans idéalisation de la société et des princes. Plus loin de l’Europe, se mêle aux hiérarchies politiques une attention pour les curiosités et merveilles du monde nourrissant la pensée de l’époque sur altérité spatiale, géographique et anthropologique.
Leonardo Carrio Cataldi étudie la construction des images du monde et la constitution du savoir cosmographique dans le cadre de la monarchie hispanique au XVIe siècle. Il met en évidence la pluralité des manières de penser le monde, non seulement en cartographe, et souligne la dimension sociale, politique et matérielle de la fabrique cartographique, que ce soit dans les grands atlas ou dans la cartographie régionale. Tout en soulignant l’importance d’une histoire matérielle des savoirs géographiques, Leonardo Carrio Cataldi montre de quelle manière ceux-ci sont utilisés dans une ambition universaliste à des fins politiques, impériales et religieuses. La géographie se voit confirmée dans sa fonction politique et éducative. L’article propose une analyse des mécanismes sociaux, politiques et intellectuels de la fabrique cartographique du monde au travers des figures majeures de Benito Arias Montano, Juan de Ovando et Jerónimo de Chaves.
Le XVIe siècle est en effet une période cruciale dans l’histoire des savoirs géographiques et dans la manière dont on les pense. C’est ce que montre Fiona Lejosne au sujet des Navigationi et viaggi (Venise, 1550-1559) de l'humaniste et secrétaire de la République de Venise Giovanni Battista Ramusio. Il s’agit de repenser le monde en s’éloignant du regard Ptoléméen au profit de la valorisation de l’expérience d’observateurs contemporains, essentiellement par leurs récits de voyages. Cette vaste compilation d’une soixantaine de textes permet de multiplier les regards et d’approcher au mieux les réalités géographiques quitte à accepter l’incomplétude des récits, voire leurs contradictions. Ce n’est plus le chiffre qui dit la vérité du monde mais la description de ses caractéristiques au profit d’une géographie qualitative. L’analyse des paratextes met en lumière la façon dont Ramusio pense ses sources, l’utilité qu’il voit dans les savoirs géographiques, leurs processus, leurs dynamiques d’élaboration et leurs limites, ainsi que le poids relatif – et parfois les contradictions – entre le savoir antique et les connaissances nouvelles. Pour autant, l’expérience viatique, chorographique et narrative n’est pas le seul horizon des savoirs géographiques : ceux-ci se combinent avec les spéculations de « l’œil de l’intellect » qu’offre la petite échelle de la cosmographie. Ainsi, le regard géographique se construit dans la combinaison de récits localisés, leur mise en relation et la reconstitution globale des espaces par la macrostructure de la compilation.
Colin Dupont étudie les plans de ville des anciens Pays-Bas dressés par Jacques de Deventer qui travaillait au service de Philippe II dans la seconde moitié du XVIe siècle. Là encore, les savoirs géographiques disent le regard qui est porté sur l’espace urbain. Outre la fonction d’inventaire, ces cartes spatialisent et mettent en exergue les pôles de pouvoirs civils, militaires, religieux et de justice. Par une sorte d’énumération graphique des territoires, le choix des bâtiments et des lieux représentés révèle les échelles spatiales et politiques du pouvoir ainsi que la vision polylocale de l’espace qui est le témoin d’un espace de la pratique. Le cadrage dessine des unités spatiales ou paysagères, mettant en exergue les points de rupture dans une lecture fonctionnelle de la ville.
Axelle Chassagnette étudie la lente émergence de l’enseignement de la géographie à l’université de Marbourg entre 1527 et 1637. Celle-ci se déploie lentement dans le cadre des aspects pratiques et géométriques des mathématiques (arpentage, projections cartographiques, ingénierie militaire…), avec l’histoire ou encore par l’étude d’auteurs classiques. Cela contraste avec l’intérêt grandissant que portent les missionnaires, les marchands et les navigateurs à la géographie. Il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que Jacob Müller, qui occupe la chaire de mathématiques à partir de 1625, fasse apparaître de façon plus claire cet enseignement géographique. Il est cependant encore intimement lié aux activités d’ingénieur, d’architecte et de conseiller militaire de Müller auprès du landgrave de Hesse-Darmstadt dans le contexte du début de la guerre de Trente Ans.
Nydia Pineda De Ávila s’intéresse aux études portant sur la lune, la sélénographie, au XVIIe siècle. Elle souligne de quelle manière se croisent des interrogations scientifiques et des enjeux politiques, intellectuels et institutionnels. Par un raisonnement analogique, l’étude de la Lune se voit appliquer un ensemble de concepts et le vocabulaire de la géographie terrestre, en reprenant parfois les toponymes antiques. De la même manière, les grandes interprétations théologiques et la toponymie biblique de l’espace terrestre sont mobilisés par certains cartographes pour voir dans le relief de la Lune la marque de la bienveillance divine ou la mémoire des lieux de mémoire biblique. Face à un objet lointain que seules les rudimentaires lunettes astronomiques permettent d’approcher, Nydia Pineda De Ávila observe de quelle manière est pensé l’espace lunaire. Dans une analyse détaillée de la Plenilunii Lumina Austriaca Philippica de Michael Van Langren, qui travaille au service de Philippe IV d’Espagne, on peut observer de quelle manière, comme pour les savoirs géographiques terrestres, la sélénographie est utilisée à des fins politiques, notamment pour flatter le prince et en attendre le soutien en retour. La Lune apparaît bien, ici, comme un théâtre projectif de la Terre et révèle un usage des savoirs visant à s’assurer de réseaux politiques et intellectuels entre les princes et les hommes de savoirs, ainsi qu’à irriguer la République des Lettres.
Nicolas Vidoni réfléchit à la façon dont les découpages administratifs et policiers à Paris au XVIIIe siècle nous renseignent sur la façon dont est pensé l'espace urbain. Il identifie un mode de lecture de la ville qui est loin d’être neutre et qui est spécifique à la police de la Lieutenance générale. Créée en 1667, celle-ci produit de nombreux savoirs sur la ville drainée dans les rues de Paris par l’expérience spatiale des inspecteurs et des commissaires. Ceux-ci ont pour fonction de visiter les différents quartiers de la ville afin de constater les infractions, mais aussi d’établir des listes pour un meilleur contrôle des usages de l’espace, d’évaluer les capacités fiscales des différents quartiers ou encore afin de visiter leurs informateurs. Pour cela, la Lieutenance générale mobilise l’outil cartographique notamment pour la réformation des quartiers et le décompte des maisons. Les connaissances sont aussi formalisées sous forme de listes et de tableaux, et contribuent, par leur diffusion, à l’émergence d’une pensée policière de l’espace. Ici, c’est dans le cadre de l’espace géométrique que se pense la géographie.
En se situant en aval de la construction des savoirs, Nicolas Verdier s’intéresse à un autre aspect de la pensée géographique. Il s’interroge sur l’identité du lectorat des livres de géographie entre la fin du XVIIesiècle et le début du XIXe siècle. Malgré les nombreuses difficultés pour en cerner les contours, il parvient par le croisement de différentes démarches à reconstituer le poids des ouvrages de géographie dans l’ensemble des publications et des savoirs de l’époque, à mettre en évidence le lectorat dont se réclame leurs auteurs, et à analyser les annonces de publications qui paraissent dans la presse en prenant l’exemple du Mercure galant(puis français). Par cette réflexion sur les usages des savoirs, il montre de quelle manière les livres de géographie deviennent de plus en plus nombreux et s’imposent dans les bibliothèques, trouvent leurs publics, même si la discipline ne s’institutionnalise que très lentement, à la fin du XIXe siècle dans le cas français.
Lucie Haguet aborde d’un autre aspect des savoirs géographiques. À partir de l’étude de Jean-Baptiste d'Anville, elle étudie l’effet de la réputation, voire de la célébrité, de ce géographe des Lumières. Elle révèle la façon dont il a travaillé à sa notoriété pour mettre en avant la qualité de ses cartes, et en se construisant une image de rigueur, de savant solitaire totalement dédié à son travail, et en faisant jouer ses cercles de sociabilités. Il jouit progressivement d’une grande réputation qui contribue incontestablement à l’insérer dans des réseaux puissants, ce qui lui permet, en retour, d’accroître ses moyens financiers et d’accéder à des informations géographiques plus nombreuses et de plus grande qualité. Cela amène Lucie Haguet à s’interroger sur la fabrique sociale des « grands hommes » et la construction d’une discipline qui peine alors à s’imposer dans les institutions officielles. Il s’agit bien d’une autre manière de penser les savoirs géographiques, ici à l’échelle sociétale, en se questionnant sur la façon dont ils sont reçus, comment sont perçus les géographes, et de quelle manière se construit leur légitimité sociale et intellectuelle.
Samia Ounoughi aborde, avec originalité, un dernier aspect des savoirs géographiques. À partir de l’étude de l’ensemble des articles de la revue de l’Alpine Club de Londres parus dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle étudie les conditions expérimentales, sociales et intellectuelles de la création de nouveaux savoirs sur les Alpes par les Britanniques, « du piolet à la plume ». Au carrefour de la géographie, de la cartographie et de l’histoire du voyage et de la langue, elle se positionne dans une démarche résolument interdisciplinaire, et applique les méthodologies linguistiques de l’anglistique à l’analyse des savoirs géographiques. Ainsi, par l’analyse du discours, elle sonde les réflexions contemporaines sur les savoirs géographiques en construction. Elle aborde la topogenèse, et plus particulièrement le phénomène qu’elle propose d’appeler la « toponymation », et le métadiscours sur la création des cartes géographiques. Elle démontre ainsi que, si la géo-graphie est littéralement « l’écriture de la terre », il est nécessaire de disséquer la langue afin de sonder la construction de ce discours pour mieux comprendre l’agencement de la pensée géographique entre l’expérience de l’alpiniste, la rigueur du scientifique et la créativité de l’écrivain.
Enfin, Axelle Chassagnette reprend certains éléments saillants de cette réflexion collective pour en proposer quelques prolongements.
Editorial : L’Europe « lotharingienne », une idée géopolitique IXe-XXIe siècles | Publié le 2014-05-19 22:00:19 |
Par François Pernot, Professeur des Universités en histoire moderne à l’Université de Cergy-Pontoise, EA 2529 Civilisations et identités culturelles comparées (CICC) (1),
« Il serait curieux, l’article : ‘Comment naît et s’impose un mythe historique’ qui suivrait dans ses avatars la destinée posthume de ce partage entre dynastes turbulents, entre frères se disputant un héritage mal loti et dont l’accord, rédigé avec des naïvetés un peu comiques par des gens d’affaires du IXe siècle, se voit soudain promu à la dignité d’acte providentiel, gros de dix siècles d’histoire européenne (2)… » Lucien Febvre.
« Topoï de l’historiographie européenne (3) », le partage et traité de Verdun de 843 est le point de départ obligé de toute étude sur l’Europe lotharingienne entre les XVe et XVIIIe siècles, sur l’idée géopolitique qu’elle représente et sur la manière dont cette histoire et cette idée fondent l’ordre européen occidental au cours de la période moderne, voire jusqu’à nos jour (4).
Verdun, 843 : la naissance d’un territoire disputé dix siècles durant
En août 843, à Verdun, après la mort de leur père Louis le Pieux en juin 840 et une guerre qui les a opposés pour l’héritage, les trois petits-fils de Charlemagne se partagent les territoires de l’Empire en trois bandes « longitudinales » nord-sud : Charles reçoit le royaume occidental bordé à l’est par l’Escaut, la Saône et le Rhône, ou Francia occidentalis, futur royaume de France ; à Lothaire sont attribuées la couronne impériale ainsi qu’une bande de territoire entre l’Escaut et le Rhin, plus la Bourgogne, la Suisse, l’Italie, la Provence, l’ensemble étant dès lors désigné comme la Francia media et plus tard la Lotharingia —« royaume de Lothaire » — ; enfin, Louis — surnommé le Germanique — prend les territoires à l’est du Rhin, ou Francia orientalis, bientôt appelée Germanie.
Initiateur, lourd de conséquences, fondateur et curieux : tels sont les qualificatifs qui définissent le mieux ce partage (5). Initiateur car il organise l’ordre politique et international des États d’Europe occidentale aux époques médiévale et surtout moderne et constitue l’acte de naissance de la « question d’Occident ». Initiateur également, parce qu’il est à l’origine du processus d’unité française (6), car, si deux États n’ont pas aussitôt été crées, leur construction résulte justement de l’affrontement de deux peuples « français » et « allemand » dans « l’aire de confrontation franco-germanique (7) » pour la conquête de la bande centrale entre Rhin, Alpes centrales et orientale à l’est, Escaut, Meuse, Saône et Rhône à l’ouest, cette terre sans doute improbable comme royaume indépendant, mais riche et chargée de symboles — c’est la terre des capitales et des grandes résidences impériales, des dynasties franque et austrasienne — et donc que chacun des royaumes de l’est et de l’ouest doit s’approprier pour prendre l’ascendant sur l’autre.
Partage lourd de conséquences, ensuite, car il ne tient plus compte des limites de la Gaule sur le Rhin et crée donc entre la France et le Saint Empire qui apparaît au Xe siècle un territoire rapidement disputé, la première n’ayant de cesse de vouloir y prendre pied et l’Empire de contenir cette pression. Ce partage est donc souvent considéré comme à l’origine de plus de dix siècles de luttes politiques, diplomatiques, militaires entre les royaumes de l’est et de l’ouest, pour la possession des territoires médians, véritables enjeux géohistoriques des guerres européennes.
Partage fondateur aussi, car il installe un royaume à l’existence éphémère, la Lotharingie (8), terre qui, de temps en temps dans l’Histoire, se rêve un seul État rassemblé, mais qui est le plus souvent une zone politiquement morcelée, une « Europe d’entre-deux » âprement contestée, une bande centrale régulièrement dévastée par les armées de l’est comme de l’ouest lors du très long conflit historique européen « [s’enracinant] sur les débris de l’ancienne Lotharingie, de Milan à Gand », en bref : « […] un espace privilégié, l’espace futur de tous les grands affrontements de l’époque moderne, qui s’inscrit profondément, comme un sillon militaire, au cœur de l’Europe […] : l’Italie du Nord, la frontière de l’est et du nord de la France, ces voies ouvertes, passages obligés des armées du roi, de l’empereur et de leurs alliés si elles veulent se rencontrer (9) ». En effet, du début de l’époque moderne jusqu’en 1940, c’est par là que passent toutes les offensives des armées espagnoles, impériales, allemandes, ou de leurs alliés, essentiellement par les trois grandes vallées qui convergent sur Paris : l’Oise, la Marne, la Seine. Cette Europe est donc celle des guerres et des champs de bataille, des armées et des places fortes : en 1557 on se bat à Saint-Quentin, en 1558 à Thionville, en 1636 à Dole, en 1643 à Rocroi, en 1644 à Fribourg-en-Brisgau, en 1648 à Lens, en 1674 à Seneffe, à Entzheim et à Mulhausen, en 1675 à Turckheim, en 1690 à Fleurus (ainsi qu’en 1794), en 1693 à Neerwinden, en 1705 à Wissembourg (ainsi qu’en 1793 et en 1870), en 1709 à Malplaquet, en 1712 à Denain, en 1745 à Fontenoy, en 1792 à Jemmapes, en 1793 à Wattignies et Neerwinden, en 1870 à Sedan, en 1914-1918 et puis encore en 1940… La liste est longue, elle est révélatrice de la place — sinon de l’enjeu — géostratégique que tient l’Europe lotharingienne.
Une précision de vocabulaire : cette Europe, des Provinces Unies à l’Italie du Nord n’est pas celle « médiane » des géographes, ni « l’Europe moyenne », ni évidemment la Mitteleuropa, et pas non plus « l’Europe rhénane », ce qualificatif étant trop restrictif et ne rendant pas compte de toute l’ampleur géographique de cette Europe qui est aussi mosane et mosellane. Nous avons donc choisi de la qualifier de « lotharingienne » car il s’agit de la meilleure désignation à condition de considérer la référence « lotharingienne (10) » comme se rapportant au royaume de Lothaire Ier quand il est question de l’ensemble de la bande de la Mer du Nord au golfe de Gênes, la dénomination d’Europe « lotharingo-bourguignonne » ou « d’entre-deux » correspondant davantage au royaume de Lothaire II, autrement dit la « zone intermédiaire » qui s’étend aujourd’hui sur une partie des Pays-Bas, la Belgique, l’ouest de l’Allemagne, le Luxembourg, l’est de la France — Lorraine, Alsace et Franche-Comté —, entre Escaut, Meuse et Rhin donc, sur les marges de la France et de l’Empire.
Curieux partage enfin. À bien y regarder, aucune raison relevant de la géographie physique ne dicte particulièrement dans cette zone l’installation d’un État indépendant. Certes, les régions qui s’étendent de la Mer du Nord à la Méditerranée sont arrosées par des fleuves ou des rivières (11) — Escaut, Meuse, Moselle, Rhin, Saône, Rhône —, mais elles se caractérisent surtout par une grande hétérogénéité physique et ne sont en rien isolées car elles sont le plus souvent rattachées à des formations géographiques plus vastes comme la plaine de l’Europe du Nord, les massifs hercyniens, le bassin parisien, les pays alpestres, la plaine padane... Par ailleurs, ces régions recoupent plusieurs aires linguistiques, essentiellement celles des parlers romans et germaniques. Curieux donc et entêtant partage car la bande de territoires qu’il érige en royaume correspond aussi à l’Europe des villes et du commerce, des expériences politiques et des libertés, des républiques, des cités, des cantons, des contacts entre le nord et le sud, entre l’est et l’ouest, l’Europe des diplomates et des négociations, des unités et des ruptures politiques, la « faille géohistorique lotharingienne » comme l’a désignée Jean‑Paul Charnay qui « juxtapose deux ensembles civilisés et subit les avancées et les reculs des empires, pays ou provinces. Elle couvre des limes, des marches, des « terres gastes » où jouent sur des décennies et des siècles une manière d’architechtonique des plaques. Les puissances y naissent, s’y usent, y périclitent dans un jeu polymorphe toujours renouvelé, mêlant les populations et les religions, brassant idéologies, flux commerciaux et philosophies politiques, lieux où se combattent et alternent les souverainetés (12) ».
Et de fait, c’est là que se développent des États somme toute improbables, que ceux-ci aient une durée de vie limitée comme l’État bourguignon, plus longue, comme la Savoie, ne soient que rêvés comme l’État lorrain de Léopold, ou encore perdurent, comme les Pays-Bas ou la Suisse. Curieux partage de 843 car ni la géographie, ni la langue, ni même les traditions politiques n’incitent ces pays à être unis dans un même État. Partage presque incongru, de hasard, car il ne repose finalement que sur une pratique successorale, un droit coutumier des Carolingiens qui, à l’opposé des Romains — dont ils se veulent pourtant les héritiers —, considèrent qu’un royaume est propriété privée, patrimoine familial et donc un bien que l’on découpe au gré des successions.
Du Xe au XIVe siècle, l’Europe lotharingienne relève des empereurs germaniques
L’histoire de l’espace lotharingien et les problématiques que cet espace soulève sont explicités dans ce numéro spécial de la Revue de Géographie Historique par Jens Schneider et Tristan Martine dans leur article « La production d’un espace : débuts lotharingiens et pratiques de la frontière (IXe-XIe siècle) ». Après avoir présenté la dénomination de cet espace politique qui est créé au IXe siècle, en distinguant notamment Francia Media, Lotharingie et Lorraine, les deux auteurs détaillent très finement dans leur travail les différents changements territoriaux du royaume de Lothaire II jusqu’au XIe siècle et sont ainsi amenés à poser la délicate question de la délimitation de cet espace aux frontières complexes à appréhender et à cartographier.
De fait, après 843, l’histoire du royaume de Lotharingie tourne très vite court : à la mort de Lothaire Ier en 855, la zone centrale est partagée par le traité de Prüm entre ses trois fils : Louis II reçoit la partie sud, le royaume d’Italie ; Lothaire II la partie nord, qui garde le nom de Lotharingie ; et Charles la partie centrale, ou royaume de Provence. À la mort de Charles de Provence en 863, ses possessions sont partagées entre ses deux frères et, après la mort de ce dernier en 869, la Lotharingie est divisée entre ses oncles Louis le Germanique et Charles le Chauve, partage ratifié par le traité de Meersen de 870. Puis, en 875, à la mort de Louis II, Charles le Chauve prend le royaume d’Italie. En 879, Charles le Gros, roi de Francia orientalis, s’empare à son tour de l’Italie alors que, l’année suivante, en 880, par le traité de Ribemont, Louis III et Carloman II, les petits-fils de Charles le Chauve, abandonnent la Lotharingie au roi de Germanie Louis II le Jeune. Par ce traité, la Francia occidentalis revient à ses frontières de 843.
En 888, Rodolphe, gouverneur de la Bourgogne supérieure, un territoire du royaume de Provence, prend son indépendance : ledit royaume est alors partagé en deux, entre Bourgogne inférieure ou Cisjurane et Bourgogne supérieure ou Transjurane. En 933, Rodolphe II, déjà roi de Transjurane, devient aussi roi de Cisjurane : il réunit ainsi les deux royaumes qui prennent le titre de royaume d’Arles, indépendant de la France.
Quant à la « Lotharingie », elle se divise en une multitude de terres plus ou moins indépendantes : les seigneuries alsaciennes, le duché de Lorraine qui seul conserve dans son nom le souvenir de l’ancien royaume de Lothaire Ier, et qui est une principauté quasi indépendante au Moyen Âge, l’évêché-principauté de Liège, tous les duchés et comtés des Pays-Bas. Après 987, tout en gardant une certaine indépendance, la Lotharingie est rattachée à la Germanie ; elle se partage alors en deux duchés, la Lorraine inférieure ou Ripuaire (ducatus Lotharingiae Ripuariorum) — avec le duché de Lothier — Et Jean-Marie Cauchies nous donne dans ce numéro spécial un bel article sur le sujet — ou de Brabant, le diocèse de Cambrai, l’évêché de Liège, de Cologne, la Gueldre et les pays rhénans intégrant la ville royale d’Aix-la-Chapelle — et la Lotharingie ou Lorraine Mosellane (ducatus Lotharingorum, ducatus Mosellanorum) — c’est-à-dire la Lorraine proprement dite, le Luxembourg, les diocèses de Trêves, Strasbourg, Metz, Toul, Verdun, et une partie du Palatinat. Le terme de « Lotharingie » peut donc prêter à confusion car il recouvre une réalité qui n’a cessé de se rétrécir géographiquement et ne se rapporte plus qu’à la partie supérieure de la Francia Media, celle de Lothaire II, et non pas au royaume de Lothaire Ier.
Dans son ouvrage Auf der Suche nach dem verlorenen Reich. Lotharingien im 9. und 10. Jahrhundert (13), Jens Schneider bouleverse quelque peu la représentation que l’on se faisait jusqu’ici de la Lotharingie du Moyen Âge, et qui devait beaucoup aux travaux de nombreux historiens, de Robert Parisot à Thomas Bauer. S’appuyant sur des recherches relevant de champs aussi divers que la géopolitique, la diplomatique, l’histoire religieuse, l’histoire du droit, des institutions et des rituels politiques, il rejette en effet l’image d’un royaume lotharingien se coulant dans les frontières de l’Austrasie mérovingienne et surtout bénéficiant d’une cohérence propre : selon lui en effet, il n’existe pas un espace lotharingien, mais plusieurs, dès la seconde moitié du IXe siècle. Par ailleurs, il décrit des frontières extrêmement mouvantes entre les différentes régions lotharingiennes, ce qui indique non seulement l’absence de cohérence lotharingienne, mais aussi le fait que les limites politiques, géographiques ou linguistiques, politiques ou naturelles n’ont justement pas été un frein au développement d’une identité lotharingienne et d’une unité politique. Et, il n’agit pas là d’un paradoxe car, pour Jens Schneider, si les « Lotharingies » n’ont pu trouver une cohérence en tant qu’État, c’est en raison de l’absence d’un pouvoir fort et centralisé, du manque d’ambition de la plupart des princes lotharingiens de l’époque et enfin du fait que ceux-ci ne sont jamais parvenus à se construire un passé commun créateur d’un sentiment d’appartenance à un même État et ce constat valable pour les IXe et Xe siècles, l’est tout autant au XVe et encore au XVIIIe siècle (14).
Du XIIIe au XVe siècle, la France entreprend sa marche historique vers l’est
Dès la fin du IXe siècle, en raison de la faiblesse des derniers Carolingiens de l’ouest puis des premiers Capétiens, les rois de Germanie — puis les souverains du Saint Empire à partir de la fin du Xe siècle (15) — se sont donc emparés facilement de toute la zone intermédiaire, de l’Europe lotharingienne, aussi bien la « Lotharingie » — la Lorraine et le Brabant — que la partie sud, le « royaume d’Arles » — le bassin du Rhône, de Besançon à Marseille.
Cependant, ces empereurs usent leurs forces politiques et militaires en Italie et leur pouvoir décline en même temps que les rois de France accroissent leur puissance et commencent à leur arracher des territoires les uns après les autres. À partir du XIe siècle environ et pendant près de huit siècles, l’essentiel des efforts des souverains français vise à grignoter avec patience les terres à l’est de la « limite des quatre rivières » — et pas seulement celles de langue romane. L’objectif de cette politique est-il de prendre possession de la Francia media ? Certainement. Et c’est d’abord dans la partie sud que les Capétiens portent leurs efforts car il s’agit sans doute de la zone la plus facile à conquérir. De fait, après le XIIIe siècle, de la Méditerranée au Rhône moyen, le pouvoir du roi de France n’est plus vraiment remis en question. Aussi, au XIIIe siècle, la Provence, qui est la principauté la plus importante de la région, pénètre dans le domaine capétien avant son annexion définitive en 1481— entre temps, Lyon et le Dauphiné ont également été réunis au royaume de France.
Dès le XIIIe siècle, la France s’est donc mise en marche le long de la transversale ouest-est, celle « des ambitions françaises (16) », vers l’est, les Alpes d’abord et le Rhin ensuite, et il s’agit là assurément d’une politique nouvelle. L’objectif est-il de repousser progressivement l’ancienne « limite des quatre rivières » vers l’est ? Assurément, ce n’est pas le bon questionnement : il ne faut pas raisonner par rapport au trait, à la ligne, à la limite à atteindre, mais en fonction de territoires, de surfaces, d’aires à posséder. Ce n’est pas atteindre une ligne qui compte, c’est la conquête et l’annexion de nouvelles terres, celles de la Francia media de 843. Nous n’avons guère qu’un témoignage pour appuyer la validité de cette hypothèse à l’époque médiévale, celui du récit de la rencontre bien connue, en 1299, à Quatre-Vaux, entre Toul et Vaucouleurs, du roi Philippe le Bel et de l’empereur Albert Ier de Habsbourg (17). Il y est question d’un différend frontalier et d’érection de bornes-frontières dans la vallée de la Meuse, mais ce n’est pas le motif de la rencontre qui est important pour notre propos ; ce qu’il faut retenir c’est la façon dont elle est présentée en France et dans les territoires allemands puisque l’on imagine aussitôt un traité secret entre les deux souverains : Philippe aurait promis à Albert son appui pour que la couronne impériale reste de manière héréditaire dans la maison de Habsbourg ; de son côté, Albert aurait donné à Philippe la vallée du Rhône et la rive gauche du Rhin. Ces rumeurs sont-elles fondées ? Les archives ne permettent pas de répondre. Toutefois, le plus important, est que l’on ait pu imaginer que le roi de France manifestait de telles ambitions sur la « bande lotharingienne », preuve s’il en est que cette idée existait.
De Philippe le Bel à Louis XI, la politique des rois de France se fait de plus en plus pressante dans la zone intermédiaire : de Valenciennes au Dauphiné, en passant par les évêchés lorrains, le Barrois, le comté de Bourgogne, le Lyonnais, le Forez et le Vivarais, ils progressent patiemment vers l’est, devenant les gardiens d’une abbaye — ainsi en 1258, le comte de Champagne Thibaud V est-il le gardien de l’importante abbaye de Luxeuil, une charge reprise par le roi de France Philippe le Bel —, les protecteurs d’une ville, parfois d’un territoire, entreprenant aussi de se constituer toute une clientèle de seigneurs, de petites principautés, de petits États qui se tournent de plus en plus volontiers vers eux et ce d’autant plus que l’empereur, lointain, est plus occupé par la défense de l’Empire sur ses limites orientales. Avant le XVIe siècle, la France a donc déjà conquis et annexé une bonne moitié de la partie sud de l’ancien royaume de Lothaire Ier et ces conquêtes et annexions sont solides car, lorsque le royaume est en plein marasme politique entre 1419 et la paix d’Arras de 1435, même si à plusieurs reprises le duc de Savoie et le prince d’Orange multiplient les interventions dans les pays rhodaniens pour tenter de détacher ceux-ci au nom d’un royaume bourguignon, Lyon reste fidèle et le Dauphiné dans son ensemble. Soulignons ici que les ennemis des rois de France, ce sont alors les ducs de Bourgogne, mais pas les empereurs allemands et que, depuis Bouvines en tous cas, la France et le Saint Empire vivent en assez bonne intelligence, le roi venant même au secours de l’empereur à l’occasion, comme en 1444, lorsque Frédéric III, en guerre contre les cantons suisses, et le duc de Lorraine René d’Anjou, en conflit avec ses créanciers les bourgeois de Metz, demandent l’aide de Charles VII. Et ce dernier, lors de sa chevauchée, ne manque jamais de rappeler que les droits de la France s’étendent jusqu’au Rhin et que « les terres qui lui appartiennent depuis l’Antiquité doivent lui être restituées » comme l’affirment haut et fort non seulement le jeune dauphin, mais aussi son père quand il somme Metz de lui obéir « tel que subjetz doivent faire au souverain (18) ».
Parallèlement, deux États intermédiaires placés entre la France et un ou plusieurs des États du Saint Empire commencent à s’affirmer : la Confédération suisse et la Savoie. La première est née par l’alliance de plus en plus étroite de districts et villes à tel point que la fidélité à l’Empire disparaît très vite, puis elle s’est étendue vers l’Italie et, à la fin du XVe siècle, dans la haute vallée du Rhône. Quant à la Savoie, elle apparaît entre Bourgogne et Italie lorsque les comtes de Maurienne, bientôt comtes puis ducs de Savoie, prennent de l’importance sur le versant occidental des Alpes avant que les progrès de la France et des ligues suisses ne les stoppent et ne les contraignent à inverser leur axe d’expansion pour conquérir le versant italien — le premier duc de Savoie est également prince de Piémont.
L’Europe lotharingienne est-elle une bande de terres « qualifiante » pour la domination sur l’Europe ? (19)
Pour comprendre ce que représente la bande lotharingienne pour les princes et les lettrés non seulement à l’époque médiévale, mais aussi et surtout à l’époque moderne, il faut, une fois encore, en revenir au partage de Verdun. Les historiens n’ont pas manqué de s’étonner de la configuration très particulière de cet État étiré comme pour former l’épine dorsale de l’Europe, et de dénoncer son manque de viabilité : « … impossible Lotharingie (…) écrit Fernand Braudel, et les deux capitales — Aix-la-Chapelle au nord, Rome au sud — et, pour les relier, une absurde et interminable bande de territoire, d’environ 200 km de large sur 1 500 de long. Cette extravagance ‘isthmique’ franchissait les Alpes et se prolongeait à travers l’Italie jusqu’au-delà de Bénévent (20). »
Il s’agit là d’une vérité sûre de son avenir. Nous disposons en effet aujourd’hui de cartes précises qui nous permettent de visualiser l’étroitesse de ce royaume, notamment dans sa partie nord et de voir qu’il a la géographie contre lui et que le fait d’être enserré entre deux grands États le fragilise et l’expose au risque de disparaître en étant absorbé par l’un ou l’autre. Toutefois, c’est la lecture d’une carte et la connaissance de ce qui s’est passé ensuite qui nous conduisent à ce constat. Pour les dirigeants et les lettrés de l’époque, la géographie physique et la forme même d’un royaume comptent peu ; en ont-ils d’ailleurs une vision claire ? Ce qui est important ici, c’est moins la zone que le point, moins le territoire que les villes et les routes parcourant celui-ci, ses richesses, ce qu’il représente en termes d’Histoire, de symboles.
Nous ne suivrons pas non plus Pierre Chaunu quand il écrit que « la part de Lothaire n’est pas la bonne part (...). Celle de Louis est meilleure (...) [et que] la part de Charles est, sans doute, la meilleure, parce que c’est elle qui retient environ la moitié de l’ancien Regnum Francorum (21) ». En réalité, la part de Louis est beaucoup moins intéressante que celle de Lothaire car formée de territoires récemment rattachés — la Bavière en 787 ou la Saxe au début du IXe siècle — et donc mal intégrés et très pauvres : la Francia orientalis est en effet le lot le moins peuplé et le moins urbanisé ; elle est aussi la partie du Regnum Francorum la plus menacée par les raids des Danois et des Vikings, au nord, et des Slaves et des Avars, à l’est. La part de Charles elle-même est médiocre car, si elle s’étend sur des terres riches et stables entre Loire et Escaut — et encore, ces territoires commencent-ils déjà à faire l’objet de raids dévastateurs des hommes du Nord —, toutes les terres au sud de la Loire, et notamment l’Aquitaine, y sont mal intégrées. Et donc le partage de 843 ne semble pas né d’une simple solution de facilité, cette division nord-sud dans laquelle Roger Dion voyait l’unique solution pour permettre aux trois frères d’accéder équitablement aux principales ressources économiques de l’ex-Empire de Charlemagne (22). Il faut chercher l’explication ailleurs, dans le symbolisme chrétien fort attaché à cette bande centrale.
La Lotharingie est en effet le morceau de choix, parce qu’elle est la part de l’empereur. Elle comprend le berceau franc et une partie de l’Austrasie, et c’est aussi sur son sol que s’élèvent la plupart des grandes villae et des grands fiscs carolingiens, sans oublier les deux capitales que sont Rome et Aix-la-Chapelle. Et il faut toujours garder à l’esprit que le partage de 843 ne représente que celui du Regnum Francorum, pas de l’Empire. En effet, l’idée selon laquelle un Empire uni continue d’exister perdure bien au-delà et, pour les trois frères, l’Empire reste synonyme d’Église, donc indivisible. C’est pourquoi, le Regnum Francorum peut être divisé en autant de royaumes et de dynasties imaginables sans que cela ne gêne les peuples dès lors que l’unité de l’ensemble continue d’être assurée par l’Église et l’empereur.
Or ce dernier a reçu l’Europe lotharingienne en même temps que la couronne impériale. Et c’est sans doute ici que se trouve la clé de l’importance géopolitique de la partie médiane car « la promotion des cadets ne peut se marquer que par un accès au noyau dur, celui qui fédère le Regnum Francorum (23) » et nous formulons l’hypothèse qu’il s’agit là d’une motivation des rois de France et des empereurs germaniques pendant la période moderne — du moins au XVIe siècle et peut-être encore au XVIIe siècle — pour prendre le contrôle de cette zone : elle représente l’Europe « qualifiante » pour la domination d’un souverain sur les autres. Pour les rois de France, elle est le territoire à conquérir, le cœur territorial historique de la dynastie franque et carolingienne, la plus belle pièce du patrimoine de Charlemagne — perdu par les souverains de Francia occidentalis, usurpé par les empereurs allemands — ; pour ces derniers, elle représente le centre de gravité de la terre carolingienne, dont la possession confère la légitimité sur l’Empire et donc pour faire valoir leur suprématie sur les rois européens ; elle doit leur donner en particulier l’ascendant historique sur le voisin français et assurer leur filiation avec Charlemagne — ce que ne leur assurent pas les territoires autrichiens. Aussi s’emploient-ils, du moins Maximilien et Charles Quint, à en prendre possession puis, quand ils constatent leur difficulté et même leur impossibilité à empêcher la marche historique de la France, à y créer ou laisser se créer des « États-tampons ».
Aussi, les politiques des rois de France, des empereurs, des souverains et des princes concernés par cette zone — comme les rois d’Espagne aux XVIe et XVIIe siècles —, sont étroitement liées à la géopolitique de l’Europe lotharingienne car essentiellement tournées vers le contrôle voire l’annexion de cette zone.
L’Europe lotharingienne : un enjeu géopolitique majeur à l’époque moderne
En matière de géopolitique de d’histoire de l’idée géopolitique de l’Europe lotharingienne entre la fin du XVe siècle, c’est‑à‑dire le moment où les grands États et États-nations européens se forment, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, trois grandes options géopolitiques se dessinent pour cette vaste région (24).
La première est celle de la tentation de l’indépendance : à deux reprises au moins, l’Europe lotharingienne a essayé de se concrétiser sous forme d’un ou plusieurs grands États. Pure réflexion intellectuelle de lettrés nostalgiques ? Simple argument historique ? Réelle volonté politique ? Le premier « avatar » de la Lotharingie apparaît ainsi à la fin de l’époque médiévale avec l’État bourguignon (25), État original qui essaie tant bien que mal de se couler dans des limites lotharingiennes, mais représente surtout un « accident » face à la politique d’expansion vers l’est des Capétiens. Cependant, aux XIVe et XVe siècles, profitant de la faiblesse de ces derniers, les ducs de Bourgogne — des princes de la maison de France — tentent de réunir sous une seule et même domination les régions flamandes, bourguignonne, alsacienne et lorraine, le dernier des grands ducs d’Occident échouant devant Nancy en 1477. Et Jean-Marie Cauchies dans son article « Le Lothier : variations séculaires entre territoire et mémoire (IXe – XVIIIe siècle) » montre avec une précision historique rigoureuse comment l’espace séparant Escaut et Rhin offre l’exemple d’une filiation territoriale entre Francia media (milieu du IXe siècle), Lotharingia (seconde moitié du IXe siècle) et Lothier (depuis les Xe-XIe siècles). Dès le XIIe siècle, ce Lothier se réduit au seul Brabant, mais la référence au Lothier survit toutefois et est intégrée dans la longue titulature des ducs Valois de Bourgogne, entrés au XVe siècle en possession du Brabant. Jean-Marie Cauchies analyse très finement comment, dans l’entourage de ces princes, on recourt à la fiction historique pour se remémorer la Lotharingie tout entière et à inspirer dans le même sens les récits de chroniqueurs et les pratiques héraldiques et que la même référence tient aussi sa place dans le vocabulaire des gouvernés, brabançons en tout cas, aux temps modernes.
Après la mort de Charles le Téméraire en 1477, le concept et l’idée de Lotharingie, de création ou de re-création d’un « État lotharingien », resurgissent de manière sporadique à l’occasion de discussions de temps de guerre pour réfléchir à l’après-guerre : vers 1638-1639, lorsque Richelieu encourage Bernard de Saxe-Weimar dans ses attaques en Franche-Comté en lui promettant de reformer un royaume lotharingien en sa faveur, avec l’Alsace, Ferrette, les montagnes et une partie du canton de Bâle, auxquels viendraient s’ajouter les pays d’entre Meuse et Moselle (26) ; ou encore en 1709-1710, quand le duc Léopold de Lorraine forme le projet éphémère de reconstituer une grande principauté regroupant, bien au-delà de la Lorraine, Alsace et Évêchés, voire Luxembourg et Franche-Comté (27). Et Laurent Jalabert explique bien dans son article « Du territoire d’entre-deux à la limite : l’espace lorrain à l’épreuve de l’Etat, XVIe-XVIIIe siècles » les tentatives de l’Etat ducal lorrain de développer un État reconnu et protégé internationalement alors que les intérêts stratégiques et diplomatiques français visaient à l’assimilation d’une marge déjà fortement ancrée dans sa sphère culturelle. S’intéressant à la problématique des frontières et de leur construction, il montre comment la mainmise française sur l’espace lorrain, définitive au XVIIIe siècle, ouvre un nouveau champ de définition des frontières de l’Etat, d’où une relecture de la vision de l’espace de la monarchie française à l’aide des nouveaux outils de cartographie. La mise en œuvre des limites devient le moteur de l’élaboration des frontières parce que les visions stratégiques ne priment plus ; dès lors, la volonté de faire disparaître les motifs de contestations, souvent d’origine féodale, semble dominer la dynamique des échanges et annoncer la fin des enclaves et des condominiums.
Ces questions de frontières complexes donnent naissance à des problèmes de description et de cartographie des espaces lorrains étudiés dans le très bel article d’Axelle Chassagnette « Le bleu est Lorraine, le jaune France » : décrire et cartographier l’espace lorrain à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) ». Cette étude montre que les difficultés techniques et financières inhérentes à la construction des cartes et à l’élaboration des descriptions textuelles produisent, jusqu’au XVIIe siècle, des représentations davantage construites sur l’invocation de l’héritage historique des territoires que sur l’état politique contemporain. Au XVIIIe siècle, à l’inverse, s’impose une représentation strictement politique des territoires, attentive à la figuration linéaire des limites.
En réalité, comme la Lotharingie est une construction politique qui s’est vidée de sa réalité, une construction de l’esprit, elle devient — comme toute construction de l’esprit — durable et surtout féconde dans la mesure où elle fournit un imaginaire à l’agrégation des principautés. Princes, dirigeants politiques, ministres, diplomates, légistes, juristes, lettrés, chroniqueurs, font donc parfois appel au « mythe » fondateur du royaume de Lothaire et aux souvenirs « lotharingiens » pour appuyer leurs choix politiques ou ceux de leurs souverains, et justifier ainsi certaines volontés d’indépendance politique entre France et Saint Empire.
La deuxième option est celle de la conquête et de l’annexion, lorsque la zone moyenne de l’Europe lotharingienne est progressivement absorbée par les avancées politiques, diplomatiques ou militaires françaises. Ainsi, après l’échec de l’État bourguignon, s’offre aux rois de France l’opportunité de redonner au royaume les anciennes frontières de la Gaule en annexant de larges pans de la bande centrale. Cependant, ils ne saisissent pas leur chance, les cantons suisses et la Savoie consolident leurs positions et, surtout, la Franche-Comté et les Pays-Bas, qui auraient pu alors basculer côté français par mariage, passent à la maison d’Autriche puis à l’Espagne. Après cela, les progrès territoriaux français vers l’est et le nord-est, lents et discontinus au XVIe siècle, s’accélèrent au XVIIe : candidature de François Ier à la succession impériale de manière à donner de la légitimité à sa politique italienne et plus largement à sa politique extérieure anti-Habsbourg tournée vers l’est, vers la bande lotharingienne, dans les dernières années de son règne ; occupation militaire, à la suite du traité de Chambord (28), sous Henri II, en 1552, des Trois-Évêchés de Metz, Toul et Verdun, ce qui donne à la France accès au cœur même du duché lorrain et la fait accéder à l’Europe d’entre-deux ; réunion de la Bresse et du Bugey en 1601 ; cession formelle des acquis de 1552 et 1559 et réunion de la partie sud de l’Alsace lors de la paix de Westphalie de 1648 ; annexion officielle de la Franche-Comté en 1678 ; réunion de presque toute l’Alsace en 1679-1689 ; saisie de Strasbourg en temps de paix en 1681 ; puis intégration à la France de toute la Lorraine — déjà occupée par elle en 1678-1697 — après la mort de Stanislas en 1766.
Quant au Saint Empire et à la monarchie espagnole, entre les XVIe et XVIIIe siècles, ils perdent de nombreux territoires entre Rhin et Meuse, entre Alpes et Rhône, mais ceux-ci ne sont pas tous des gains territoriaux pour la France. Ainsi, trois États se développent à partir de régions détachées de l’Empire, la Savoie, les cantons suisses et les Provinces Unies — sans qu’aucun souvenir lotharingien ne soit avancé pour appuyer leur création —, ces trois États d’entre-deux se sentant de plus en plus étrangers au corps politique impérial, tout comme la Lorraine d’ailleurs, et s’opposant de plus en plus souvent aux réformes impériales.
Enfin, des dernières décennies du XVe siècle à la fin du XVIIIe, la troisième option géopolitique consiste justement pour la France comme pour l’Empire, lorsque ceux-ci sont trop faibles, à laisser des « États-tampons », « États-glacis », « États-barrières » s’installer, éventuellement en faisant référence à l’État de Lothaire — sans d’ailleurs distinguer bien précisément s’il s’agissait de l’État de Lothaire Ier ou de celui de Lothaire II. Pour la première fois après l’échec de l’État bourguignon, la référence à la Lotharingie transparaît dans un projet de 1508 de l’empereur Maximilien qui prévoit de rassembler les biens héréditaires de la Maison d’Autriche et la Franche-Comté dans un même royaume, mais ce projet est vite abandonné. Par la suite, en 1512, Maximilien se résout à faire de l’héritage des ducs de Bourgogne un « cercle de Bourgogne » intégré à l’Empire et, faute de savoir quelle politique mener dans l’Europe lotharingienne, Charles Quint sort ce cercle de l’orbite impériale lors des Transactions d’Augsbourg du 26 juin 1548, confirmées par la Pragmatique Sanction du 4 novembre 1549, en plaçant tous les Pays-Bas à l’intérieur et en lui donnant un statut de quasi-indépendance. Charles Quint instrumentalise donc le concept d’État lotharingien « historique » pour créer un État frontalier –État-tampon– associé à l’Empire car, pas plus que le Téméraire, les Habsbourg n’ont intérêt à évoquer le souvenir d’un royaume de Lotharingie indépendant de l’ensemble impérial. Et, contrairement à ce qu’affirme Pierre Iweins, ce choix qui, selon lui, va à l’encontre de la politique impériale, est en réalité très logique (29). On le sait, depuis les années 1530, en effet, les conseillers castillans de Charles Quint s’interrogent sur l’utilité de conserver les Flandres dans la monarchie espagnole. Faut-il alors s’étonner que, à partir des années 1540, las et songeant peut-être déjà à abdiquer, l’empereur envisage de plus en plus de replier l’Espagne sur la péninsule Ibérique ? (30). Par la suite, en 1598, Philippe II pratique la même politique en détachant les Pays-Bas et la Franche-Comté de la couronne espagnole pour les confier aux Archiducs. Ainsi, il apparaît bien que l’Europe lotharingienne demeure au cœur des préoccupations des souverains espagnols du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe et ce, à notre sens, pour deux raisons : d’une part, elle est le socle sur lequel courre le camino español, boulevard périphérique militaire tournant autour de la France vital stratégiquement parlant, d’autre part, elle permet de fixer le conflit entre France et Empire, entre France et Espagne, très loin de l’Espagne péninsulaire.
L’Europe lotharingienne, une idée géopolitique toujours d’actualité ?
L’histoire de l’Europe lotharingienne et de l’idée géopolitique qu’elle représente ne s’arrête pas avec la Révolution Française, elle atteint son point d’orgue lorsque la France révolutionnaire puis impériale poursuit l’œuvre de la monarchie en matière de progression territoriale vers l’est — cette fois clairement au nom des frontières naturelles et d’une rationalité géographique — et accède pleinement à la bande lotharingienne, au cœur de l’Europe, en s’avançant jusqu’aux limites extrêmes de la Gaule de César. Cependant, le concept de frontières naturelles est trop « limitant » pour la Révolution comme pour Napoléon : leurs armées dépassent largement ces supposées limites et, comme il est hors de question de rendre les pays conquis, on les transforme en « Républiques Sœurs », États-satellites formant un glacis politico-militaire sous influence et contrôle français, « États-tampons ». Il s’agit là des dernières annexions françaises et des dernières créations — voulues par la France — d’États lotharingiens aux dépens du Saint Empire qui disparaît en 1806.
À la fin de 1811, l’Empire français s’étend sur tout le territoire de la France pré-révolutionnaire auquel il faut ajouter des conquêtes de la République, les anciennes Provinces Unies et, au sud-est, la côte occidentale de l’ancien royaume d’Italie, y compris Rome, ainsi que les Provinces Illyriennes et les îles ioniennes. La France étend encore son influence sur plusieurs territoires et royaumes satellites : confédération du Rhin, Empire d’Autriche, royaumes de Prusse, de Naples, d’Espagne, Danemark, Suède, nouveau duché de Varsovie et république de Dantzig.
Certes, cet Empire laisse bien loin derrière lui les frontières naturelles traditionnelles de la France, mais, de 1795 à 1812, les territoires de la bande lotharingienne interagissent puissamment entre eux et sur lui en constituant le « noyau dur », le core de l’Empire napoléonien. C’est la thèse développée par Michael Broers dans une très belle et solide étude concluant que si ce sont dans les territoires intermédiaires, dans la bande lotharingienne, que les « réformes » napoléoniennes en matière politique, juridique, économique et social sont le mieux accueillies et réussissent le mieux, c’est parce qu’ils sont déjà prédisposés à les accueillir et à les accepter (31). Selon lui, l’Empire napoléonien est un Empire « intérieur » s’appuyant sur un noyau territorial, un centre géographique fort et bienveillant à l’égard du système impérial et comprenant l’est de la France, les territoires allemands de l’ouest, le nord de l’Italie et les Pays-Bas, l’Europe lotharingienne du traité de Verdun de 843, ce que Michael Broers appelle la « macro-région centrale », la « zone de référence européenne » — the European heartland (32) — et qui n’est ni la France, ni la Chrétienté, mais dont l’importance s’est trouvée renforcée avec les guerres contre l’Angleterre et le blocus continental. Ce constat amène l’auteur à développer également l’argument selon lequel, plutôt que d’« Empire napoléonien », il est préférable de parler de « système d’États » ou de « sphère d’hégémonie » et que la « macro-région centrale » inclut plusieurs types d’États — France et ses départements, États alliés, États-satellites —, les frontières internationales entre eux perdant quelque peu de leur sens. Michael Broers va plus loin en ajoutant que dans cette perspective, la « macro-région centrale », cœur politique, économique et culturel de l’Europe napoléonienne apparaît comme une étape historique entre « l’impossible Lotharingie » de Fernand Braudel et la « banane bleue » — un concept que l’on doit au géographe Roger Brunet pour désigner cette « terre de prospérité » courant des Pays-Bas à l’Italie du Nord. Et de fait, en poursuivant cette thèse, force est de constater que l’ordre napoléonien s’est particulièrement bien implanté dans la « zone européenne de référence » : Napoléon n’a en effet pas de mal à contrôler les grands centres urbains du nord de l’Italie, de l’Allemagne occidentale, ou des Pays-Bas, ou encore les territoires rhénans où il trouve notamment un vrai soutien dans les rangs des élites urbaines. Partant, cette réussite entraîne un processus d’acculturation qui a donné toute sa force au concept de « macro-région » en faisant revivre des forces géopolitiques jusque-là sous-jacentes.
Comment caractériser le destin géopolitique de la « zone centrale » au cours des épisodes révolutionnaires et napoléonien ? Tout d’abord, si la Révolution essaie de donner des frontières naturelles à la France, calquées sur la géographie, sur les « accidents naturels » chers à Braudel, Napoléon les fait voler en éclats car sa vision de l’Europe ne peut que laisser de côté cette doctrine, comme le souligne Ilja Mieck (33).. En fait l’Europe napoléonienne ne dispose, par essence, d’aucune frontière, ni historique, ni naturelle. Elle ne doit être pensée et perçue en termes ni historiques, ni géographiques, mais seulement géopolitiques et socio-économiques. Ce que par ailleurs Michael Broers résume par une formule qui fait sens : « Dans ses tentatives pour redéfinir la carte de l’Europe, c’est Napoléon et non les Girondins de 1792, qui apparaît comme le vrai révolutionnaire, en cherchant — à demi consciemment —, à faire revivre les « régions naturelles » de l’Europe pour renverser non seulement les frontières artificielles de l’Ancien régime, mais aussi les fausses soi-disant « frontières naturelles » de 1792 (34) ».
En 1814 puis 1815, la France est ramenée dans ses limites de 1792 et les anciennes monarchies essaient donc tant bien que mal de ressouder les morceaux d’Europe qui avaient volé en éclats sous les coups des armées de la Révolution puis de l’Empire napoléonien. Et, au milieu du XIXe siècle donc, la « petite faille » géohistorique de l’Europe (35) se rouvre avec l’indépendance et la partition de la Belgique et des Pays-Bas, puis la guerre suisse de 1847, la guerre franco-prussienne de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne après l’expulsion des Autrichiens d’Italie. Puis, avec la seconde Révolution industrielle et les traités réglant les conflits du XXe siècle, une partie seulement de l’espace lotharingien, l’espace rhénan, suscite un nouvel intérêt (36).
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les concepts d’espace lotharingien et d’État-tampon lotharingien sont de nouveau évoqués. Du côté allemand, une école pangermaniste définit la Bourgogne comme appartenant aux « marches de l’ouest » — Westmarken —, des terres à reconquérir (37). Georges Bischoff cite ainsi un extrait du Journal de Josef Goebbels du 3 novembre 1939, d’après lequel Hitler aurait envisagé le repeuplement de la Bourgogne par des colons venus du Tyrol du sud cédé à l’Italie fasciste, pour recréer une nouvelle terre d’Empire (38). Plusieurs historiens, germanistes et polémistes français, allemands et flamands collaborent à ce « Westprogramm » dès l’été 1940, tels le journaliste allemand Karl Mehrmann — SS-Sturmführer en 1934 — pour qui l’État bourguignon de Charles le Téméraire constitue une poussée expansionniste française en direction du Rhin (39) et ces travaux alimentent les écrits du Bourguignon Johannes Thomasset comme de l’abbé nationaliste flamand Jean-Marie Gantois qui souhaitaient que la Flandre française soit intégrée au Reich allemand (40).
Du côté britannique, américain, mais aussi français, nombre de dirigeants et de diplomates s’intéressent aussi aux espaces lotharingiens, tirent les premières leçons de l’entre-deux-guerres et de la défaite de 1940, et s’interrogent sur la viabilité des petites nations dans le nouvel ordre international d’après-guerre, à commencer par le chantre de la Pan Europe, Richard Coudenhove-Kalergi en exil aux États-Unis, et par le professeur E. H. Carr en Grande-Bretagne (41). « Ces deux Européens convaincus se prononcent clairement pour la suppression des États nationaux et la création d’une Europe unifiée, écrit Thierry Grosbois. Ces perspectives de suppression de ce que les Américains considéraient comme des Etats lilliputiens reçoivent un accueil favorable au sein des milieux gouvernementaux (42) ».
En réalité, trois séries de projets se succèdent : le 22 mai 1942, à Washington, Churchill conseille aux autorités américaines de réunir la Belgique, la Hollande et le Danemark au sein d’une fédération des Pays-Bas, mais l’idée de Lotharingie n’est pas encore invoquée d’ailleurs qu’y ferait le Danemark, un peu lointain ? Deuxième projet, à peu près dans le même temps, Henry Wallace, vice-président des Etats-Unis, suggère à Roosevelt de rattacher la Belgique et les Pays-Bas à la France ! Suggestion rejetée par Churchill. Troisième projet, le 15 mars 1943, Roosevelt s’entretient avec Eden de la possibilité de créer à la fin de la guerre un nouvel État appelé Lotharingia (!) puis Wallonia formé par la réunion de la Wallonie, du Luxembourg, de l’Alsace-Lorraine et d’une partie du nord de la France. Ce projet est même très sérieusement étudié par des conseillers du président pendant plusieurs mois, comme l’attestent des documents du département d’État américain, avant d’être abandonné, Churchill s’y déclarant totalement opposé. Anthony Eden écrit ainsi dans ses Mémoires qu’il « versa de l’eau froide sur ce feu et le Président n’a plus reparlé de cette affaire (43) ». Ces projets confus, outre qu’ils témoignent d’une connaissance très approximative des réalités européennes de la part des autorités américaines, expriment surtout un grand embarras : celui des Anglo-saxons et d’abord des Américains, qui ne savent que faire des petits États dans leur plan de réorganisation mondiale après guerre.
Au sein du CFLN, on réfléchit aussi beaucoup à l’Europe de l’après-guerre : René Mayer, dans une note du 30 septembre 1943, envisage une fédération européenne regroupant, en plus de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, un État rhénan comprenant le bassin de la Ruhr, et éventuellement ensuite l’Italie, ce que Gérard Bossuat appelle une « Lotharingie industrielle (44) ». Ce projet d’État rhénan est soutenu par le général de Gaulle. Ainsi, le 24 février 1944, il demande à Massigli d’étudier les conditions dans lesquelles pourrait vivre une Rhénanie-Ruhr-Sarre détachée du Reich et rattachée à un bloc occidental, rattachement lié à la réalisation d’une fédération stratégique et économique entre la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Italie, et à laquelle pourrait se rattacher éventuellement la Grande-Bretagne. De Gaulle développe cette idée devant Mendès France venu s’informer des vues du Général sur le projet d’union ouest-européenne : « La Ruhr et les Rhénanie seront le lien commun des pays occidentaux libérés ; ce sera un Reichsland ; pour cimenter l’Europe libérée, c’est bien qu’elle ait quelque chose qui soit sa propriété collective ». Massigli mobilise alors tous ses collaborateurs et se met au travail. Au bout de quelques semaines, il est perplexe : comment détacher stratégiquement et économiquement la Rhénanie-Westphalie du reste de l’Allemagne ? Ce point, pour Massigli, est « enveloppé de brumes (45) ».
Aujourd’hui, les références à l’Europe lotharingienne, à l’idée géopolitique qu’elle représente et à son souvenir servent tant à ceux qui développent des discours et des projets politiques pro-européens qu’indépendantistes et anti-européens. En effet, le nom de « Lotharingie » comme l’adjectif « lotharingien » ont parfois resurgi dans les discours de tels ou tels groupes ou partis de la droite extrême en Europe pour appuyer un discours très violemment anti-Europe voire indépendantiste.
À l’opposé, certains se sont emparés de la notion d’« espace lotharingien » pour en faire le cœur de l’Europe et, en tant que tel, un territoire privilégié pour mettre en pratique l’unité du continent et tester les différents concepts de « pratique de l’Europe », notamment celui d’« Europe des régions » en s’appuyant d’ailleurs sur le fait que la toute première des « Euro-régions » créées, « Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz » (Sar-Lor-Lux-Rhénanie-Palatinat), a vu le jour justement dans cette bande lotharingienne. D’autres voient dans la « banane bleue » le dernier avatar de la Lotharingie, fer de lance de la révolution industrielle et concentrant depuis la fin du XIXe siècle l’essentiel des richesses économiques de l’Europe (46). Cette vision n’est pas dépourvue d’arrière-pensées politiques, comme le montre Éric Auburtin dans sa thèse (47) et dans son très intéressant article « Le système de représentations lotharingien ». Pour lui, la Grande Région Sarre-Lorraine-Luxembourg-Rhénanie-Palatinat-Wallonie constitue depuis les années 1990 un nouvel objet territorial transfrontalier, mais comme son devenir est encore incertain, les acteurs régionaux cherchent à donner à leur projet une certaine substance géopolitique en mobilisant des référents historiques comme celui de la Lotharingie. Il s’agit avant tout pour eux de projeter le citoyen européen dans un nouveau cadre de référence qui transcende la réalité des Etats-nations respectifs, mais s’appuie sur des contours anciens qu’il pourra plus aisément s’approprier. La Lotharingie intègre ainsi un système de représentations à géographie variable, articulant aussi les temps « longs » et « courts » de l’Histoire, au profit d’un nouveau projet géopolitique dont les contours et la signification varient suivant le positionnement des acteurs concernés.
La géopolitique de l’Europe lotharingienne présente donc, d’une part, de profondes permanences historiques tant au Moyen Âge qu’à l’époque moderne, d’autre part, d’étonnantes nouveautés dans la mesure où « l’espace d’entre-deux », d’entre Escaut, Meuse et Rhin, a vu apparaître et se développer — avec plus ou moins de bonheur — des créations politiques originales, États nouveaux, républiques marchandes, royaumes éphémères, tout en jouant un rôle moteur dans la mise en place d’un certain ordre politique et international européen. Et même, depuis peu, la géographie politique de la bande lotharingienne intéresse les géographes spécialistes des frontières (49) et les aménageurs étudiant les fondements géohistoriques de ce qu’ils nomment une « marge centrale ». L’Europe lotharingienne représente ainsi un laboratoire géopolitique d’analyse et de réflexion pour construire l’Europe et, en interrogeant l’idée d’« État lotharingien » et la notion de « cœur de l’Europe », en étudiant les sources de l’histoire de cette idée géopolitique d’« Europe lotharingienne », c’est l’Europe elle-même toute entière qui se révèle, l’identité européenne réelle, celle qui est pour nous l’addition d’identités particulières. Et il nous semble que cette connaissance historique et géopolitique de l’« Europe lotharingienne » peut permettre de comprendre les affrontements du passé et donc savoir comment réagir pour surmonter les tendances centrifuges du continent. Elle peut ainsi aider à décider de l’avenir.
Pour conclure en reprenant une partie de l’argumentaire avancé par Yves Lacoste dans le volume d’Hérodote consacré à l’Europe médiane, formulons l’hypothèse que redonner à la Lotharingie et à l’axe lotharingien une place primordiale en Europe en reformant par la pensée un ancien ensemble géopolitique, permettrait peut-être d’impulser un nouveau dynamisme européen, d’améliorer les échanges commerciaux et les flux démographiques, de faire de l’axe nord-sud celui d’un nouveau progrès conjurant ainsi l’axe est-ouest, celui des grandes invasions et des dynamiques de conflits (48). À n’en pas douter, l’Europe lotharingienne constitue un modèle en ce sens qu’elle exalte d’une certaine manière le schéma de « l’Europe des régions » à l’opposé du schéma d’une « Europe des nations » (49).
Mots-clés : Lotharingie, Europe lotharingienne, traité de 843, partage de Verdun, Etat lorrain, Etat bourguignon, géohistoire.
Keywords : Lotharingia, Lotharingian Europe, treaty of Verdun, treaty of 843, Lotharingian state, Burgundian state, geohistory.
Notes :
(1) Cet article constitue un développement d’une partie de l’essai intitulé L’Europe lotharingienne, histoire d’une idée géopolitique, fin XVe siècle-fin XVIIIe siècle, présenté par l’auteur dans l’habilitation à diriger des recherches réalisée sous la direction de M. le Professeur Lucien Bély, l’habilitation sur Entre France et Empire : terres de contacts, terres de frontières et terres de batailles ayant été soutenue le 29 novembre 2011, à l’Université de Paris-Sorbonne devant un jury composé de M. Lucien Bély, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (directeur), M. Jean-Pierre Bois, Professeur émérite à l’Université de Nantes (président), M. Géraud Poumarède, Professeur à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, M. Jean-François Solnon, Professeur à l’Université de Franche-Comté, M. René Vermeir, Professeur à l’Université de Gand (Belgique), M. Éric Vial, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise.
(2) Febvre Lucien, Le Rhin. Histoire, mythes et réalités, Peter Schöttler éd. (pour la partie de L. Febvre), Paris, Perrin, [1985], 1997, 288 pages, p. 109.
(3) Chaunu Pierre, La France, Paris, Laffont, 1982, 388 pages, p. 115.
(4) Pour une vue actuelle et conceptuelle de la géographie historique de l’Europe d’entre-deux, on consultera : Béatrice Giblin et Yves Lacoste, Géo-histoire de l’Europe médiane : mutations d’hier et d’aujourd’hui, Paris, La Découverte, 1998, 224 pages. Yves Lacoste, « Europe médiane ? » in Hérodote, 1er trimestre 1988, n°48, p. 6. Cependant, globalement, la bibliographie sur cette thématique de la géographie historique de l’Europe lotharingienne, du moins pour la période moderne, fait défaut.
(5) Sur le traité de Verdun, des études déjà anciennes : Roger Dion, « À propos du traité de Verdun », Annales E.S.C., 1950, n°4, p. 461 à 465. Louis Ferdinand Ganshof, « Zur Entstehung und Bedeutung des Vertrags von Verdun (843) » in Deutsches Archiv, 1956, n°12, p. 312 à 330. De nouvelles pistes de recherche à propos de ce traité et de ses conséquences ont été ouvertes : Claus-Peter Clasen, « Die Vertrage von Verdun und Coulaines (843) als politische Grundlagen des westfränkischen Reiches » (« Les traités de Verdun et Coulaines de 843 comme fondements politiques du royaume franc occidental »), Historische Zeitschrift, 1963, n°196, p. 1 à 35. Josef Fleckenstein, « 843. Le traité de Verdun ébauche l’Europe des nations » in Antoine Compagnon et Jacques Seebacher (dir.), L’Esprit de l’Europe, Paris, Flammarion, 1993, tome 1, 351 pages, p. 56 à 63. Michel Parisse, « 843, Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, porte le premier titre de roi de France », in Alain CORBIN (dir.), 1515 et les grandes dates de l’Histoire de France revisitées par les grands historiens d’aujourd’hui, Paris, Seuil, 2005, 479 pages, p. 51 à 54.
(6) Sur la formation territoriale de l’État français par rapport aux voisins orientaux, germaniques, impériaux, allemands et italiens, nous citerons pour mémoire seulement, une bibliographie ancienne dont les titres constituent aujourd’hui des objets historiques : Albert Demangeon, « La formation de l’État français » [1940], Acta geographica, octobre-décembre 1971, p. 217-238. Lucien Febvre, L’Europe. Genèse d’une civilisation, cours professé au Collège de France en 1944-1945, établi, présenté et annoté par Thérèse Charmasson et Brigitte Mazon, avec la collaboration de Sarah Lüdemann. Préface de Marc Ferro, Paris, Perrin, 1999, 425 pages. Citons aussi l’ouvrage discutable de Walther Kienast, Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit : (900-1270), Leipzig, Koehler et Amelang, 1943, 262 pages (consulter la recension faite par Louis Halphen, Bibliothèque de l’école des Chartes, volume 106, n°106-1, 1946, p. 106-107). Auguste Longnon, Atlas historique de la France depuis César jusqu’à nos jours. Textes explicatif des planches, Paris, Hachette, 1884-1907, VI‑290 pages. Auguste Longnon, La Formation de l’unité française. Leçons professées au Collège de France en 1889-1890 publiées par H.-François Delaborde (éd.), préface de Camille Jullian, Paris, A. Picard, 1922. Même anciens, les ouvrages de Ferdinand Lot et d’Henri Pirenne restent consultables pour la chronologie des événements et pour l’intérêt « historique » que ces ouvrages constituent en eux-mêmes : Ferdinand Lot, Naissance de la France, Paris, Fayard, collection « Les grandes études historiques », 1970, 728 pages. Henri Pirenne, Histoire de l’Europe des invasions au XVIe siècle (préface de Jacques Pirenne), Paris, F. Alcan, 1936, 492 pages. Cependant, depuis une trentaine d’années, les historiens médiévistes et modernistes ont totalement renouvelé l’étude de la formation du territoire français et des prémisses de l’État : Colette Beaune, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard, 1985, 431 pages. Bernard Guenée, « Y a-t-il un État des XIVe et XVe siècles ? » in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, année 1971, volume 26, n°2, p. 399 à 406 et Bernard Guenée, « Espace et État dans la France du bas Moyen Âge » in Économies, Sociétés, Civilisations, année 1968, volume 23, n°4, p. 744 à 758. Fernand Braudel, L’Identité de la France, (3 tomes), tome 1 « Espace et histoire », Paris, Arthaud, 1986 (1re édition) et Paris, Flammarion, « Champs », 1990, 410 pages — un très bel ouvrage, paradoxal sous la plume d’un des Maîtres de l’École des Annales car redonnant toute sa place à l’histoire politique, l’histoire événementielle, les guerres et les batailles, l’histoire des frontières et des territoires. Xavier de Planhol, Géographie historique de la France, (avec la collaboration de Paul Claval), Paris, Fayard, 1988, 635 pages. Sans oublier l’ouvrage de Pierre Chaunu déjà cité : Pierre Chaunu, La France, op. cit. et celui d’Alfred Fierro-Domenech, Le Pré carré. Géographie historique de la France, Paris, Laffont, 1986, 325 pages.
(7) L’expression est d’Alfred Fierro-Domenech, op.cit., p. 23, carte 1B.
(8) Sur la Lotharingie au Moyen Âge, les historiens lorrains après le Doyen Jean Schneider, Michel Bur puis surtout Michel Parisse, belges avec Paul Bonenfant, luxembourgeois avec Michel Margue, et allemands, ont largement contribué — grâce notamment aux Journées lotharingiennes — à lancer de nombreux travaux de grand intérêt : Paul Bonenfant, « État bourguignon et Lotharingie », Bulletin de la classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, Académie royale de Belgique, 1955, t. XLI, n°5, p. 266 à 282. Paul Bonenfant, « La persistance des souvenirs lotharingiens. À propos d’une supplique brabançonne au pape Martin V », Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 1952, fascicule 27, p. 53 à 64. Hans-Walter Herrmann et Reinhard Schneider (dir.), Lotharingia. Eine europäische Kernlandschaft um das Jahr 1000. Actes du colloque des 24-26 mai 1996 à Saarbrücken, Saarbrücken, Veröffentl. der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung, n°26, 1995. Rosamund McKitterick, « The diffusion of insular culture in Neustria between 650 and 850 : the implications of the manuscript évidence » in Hartmut Atsma (dir.), La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850, actes du colloque historique international, Beihefte der Francia, 16/2, Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1989, 2 vols. XXXII-594 pages et VIII‑544 pages, p. 395 à 431. Michel Parisse, « Désintégration et regroupements territoriaux dans les principautés lotharingiennes du XIe au XIIIe siècle » in Alfred Heit (dir.), Zwischen Gallia und Romania, Frankreich und Deutschland. Konstanz und Wandel raumbestimmender Kräfte. Vorträge auf dem 36. Deutschen Historikertag, Trèves, 8-12 octobre 1986, Trèves, Trierer Historische Forschungen, Band 12, 1987, p. 155 à 180. Michel Parisse, « La Lotharingie : Naissance d’un espace politique », dans Hans-Walter Herrmann et Reinhard Schneider (dir.), Lotharingia. Eine europäische Kernlandschaft um das Jahr 1000. Actes du colloque des 24-26 mai 1996 à Saarbrücken, Saarbrücken, Veröffentl. der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung, 26, 1995, p. 31 à 48. Michel Parisse, « Austrasie, Lotharingie, Lorraine », in Guy Cabourdin (dir.), Encyclopédie illustrée de la Lorraine. Histoire de la Lorraine : L’époque médiévale, Nancy-Metz, Presses universitaires de Nancy, 1990, 253 pages. Pays (les) de l’entre-deux au Moyen-Age. Questions d’histoire des territoires d’Empire entre Meuse, Rhône et Rhin, Actes du 113e congrès national des sociétés savantes, Histoire médiévale et philologie, Strasbourg, 1988, Paris, Éd. du C.T.H.S., 1990. Jean Schneider, « Lotharingie, Bourgogne ou Provence ? L’idée d’un royaume d’entre-deux aux derniers siècles du Moyen Âge », Liège et Bourgogne. Actes du colloque tenu à Liège les 28, 29 et 30 octobre 1968, Paris, « Les Belles Lettres », Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et lettres de l’Université de Liège, 1972, fascicule CCIII, 258 pages, p. 15 à 44. Jens Schneider, « La Lotharingie était-elle une région historique ? » in Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations, XXXVIIe Congrès de la SHMES, Mulhouse, 2-4 juin 2006, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 425 à 433.
(9) Bois Jean-Pierre, L’Europe à l’époque moderne. Origines, utopies et réalités de l’idée d’Europe XVIe-XVIIIe siècles, Paris, A. Colin, 1999, p. 88 à 96.
(10) Pour éviter d’alourdir notre texte, nous ne conserverons plus les guillemets à Europe « lotharingienne ».
(11) La limite fixée à Verdun entre la Francia occidentalis et la Francia media est aussi appelée « limite des quatre rivières » — Escaut, Meuse, Saône et Rhône.
(12) Charnay Jean Paul, « La diagonale tragique de l’Europe », Géostratégie, 2005, n° 8, p. 35 à 44, p. 35.
(13) Schneider Jens , Auf der Suche nach dem verlorenen Reich. Lotharingien im 9. und 10. Jahrhundert, Cologne-Weimar-Vienne, Böhlau Verlag, 2009, 672 pages.
(14) Ibidem.
(15) Dès les années 1040, l’empereur d’Allemagne Henri III parvient à réunir à l’Empire les provinces françaises du royaume d’Arles, ainsi que les terres lorraines ou « Lotharingie ».
(16) Cf. Livet Georges, « Strade et poteri politici nei ‘pays d’entre deux’ : il modello lorenese (secc. XV-XVII) », Quaderni storici, n°1, avril 1987, n°64, p. 81 à 110, p. 93-94.
(17) Traité d’alliance entre Philippe le Bel, roi de France et Albert, roi des Romains, fait à Quatrevaux, le 8 décembre 1299, Archives nationales, Trésor des chartes des rois de France, J 610, n°19 (Musée de l’histoire de France, AE III 6), orig. latin, parchemin. Publié d’après l’original dans M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Hanovre-Leipzig, éd. Jacobus Schwalm, 1906, t. IV, pars 1, p. 63.
(18) Cité par Francis Rapp, Le Saint Empire romain germanique. D’Otton le Grand à Charles Quint, Paris, Tallandier « Points Histoire », p. 295.
(19) Nous ne détaillerons pas cette question qui a fait l’objet d’une communication. François Pernot, « L’espace lotharingien a la Renaissance : les « terres du milieu » qualifiantes pour la domination européenne ? », Communication présentée au Congrès International La Renaissance en Europe dans sa diversité, Nancy, 10-14 juin 2013. À paraître.
(20) Braudel Fernand, L’Identité de la France… op. cit., p. 315-316.
(21) Chaunu Pierre, La France, op. cit., p. 115.
(22) Dion Roger, Les Frontières de la France, Paris, Hachette, 1947, 112 pages (réédition, Brionne (Eure), Gérard Montfort, 1979), cité par Étienne Juillard, L’Europe rhénane. Géographie d’un grand espace, Paris, A. Colin, 1968, p. 21.
(23) Chaunu Pierre, La France, op.cit., p. 115.
(24) Cf. pour la problématique de notre travail et les trois grandes options géopolitiques : François Pernot, « L’Europe « lotharingienne », sa place et sa représentation dans la construction des États européens et dans les projets de construction européenne du XVe au XXe siècle », Communication présentée au colloque international des 14e Journées lotharingiennes – 10-13 octobre 2006 – Université du Luxembourg – La Lotharingie en question : identités, oppositions, intégration/ Lotharingische Identitäten im Spannungsfeld zwischen integrativen und partikularen Kräften. Colloque organisé par le Laboratoire de recherche en Histoire à l’Université du Luxembourg (Campus Limpertsberg) et le Centre luxembourgeois de Documentation et d’Études Médiévales (CLUDEM) avec le soutien du FNR et de Forum Europa. In Michel Margue (dir.), La Lotharingie en question : identités, oppositions, intégration, actes des 14e Journées Lotharingiennes, 10‑13 octobre 2006, Luxembourg, CLUDEM (Centre luxembourgeois de documentation et d’études médiévales) - Université du Luxembourg, tome 26, 2009.
(25) Sur l’État bourguignon, outre l’ouvrage fondamental de Bertrand Schnerb, L’État bourguignon 1363-1477, Paris, Perrin, 1999, nous renvoyons à la bibliographie détaillée que nous avons donnée dans notre communication, « L’espace lotharingien a la Renaissance : les « terres du milieu » qualifiantes pour la domination européenne ? », Communication présentée au Congrès International La Renaissance en Europe dans sa diversité, Nancy, 10-14 juin 2013. À paraître.
(26) Berenger Jean, « L’Alsace, enjeu de la diplomatie européenne au XVIIe siècle », Bulletin de la Société d’Histoire Moderne, 1988, 16e série, n°40, 87e année, p. 2 à 10, supplément à la Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1988, n°4, p. 4.
(27) Cf. Pernot François, « Le duc de Lorraine dans la recomposition géopolitique », Communication présentée au colloque international Une paix pour l’Europe et le monde, Utrecht, 1713, Paris, 24-25-26 octobre 2013. Colloque organisé par le groupe Diplomatie et Paix (Universités Bordeaux 3, Nantes, Paris-Sorbonne). À paraître.
(28) Weber Hermann, « Le traité de Chambord (1552) », Charles Quint, le Rhin et la France : droit savant et droit pénal à l’époque de Charles Quint, Strasbourg, Istra, « Publications de la société savante d’Alsace et des régions de l’Est », 1973, p. 81 à 91 ; p. 81.
(29) Iweins Pierre, « Le rêve lotharingien », in Revue Générale (belge), n° 1 (janvier 1981), p. 41 à 46 ; p. 46.
(30) Pernot François, La Franche-Comté espagnole à travers les archives de Simancas une autre histoire des Franc-Comtois et de leurs relations avec l’Espagne, de 1493 à 1678, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2003, pp. 326-336.
(31) Broers Michael, « Napoleon, Charlemagne, and Lotharingia : Acculturation and the Boundaries of Napoleonic Europe » in The Historical Journal, Cambridge University Press, mars 2001, vol. 44, n°1, p. 135 à 154, p. 135.
(32) Ibidem, p. 137.
(33) Mieck Ilja, « Deutschlands Westgrenze », in Alexander Demandt, (dir.), Deutschlands Grenzen in der Geschichte, Munich, Beck, 1991 (2e éd.), p. 220.
(34) Broers Michael, op. cit., p. 151 (traduit par l’auteur).
(35) Pour reprendre la formule de Jean-Paul Charnay in « L’Europe dans ses neutralités géohistoriques », Géostratégiques n° 13, juillet 2006.
(36) Cf. Pernot François, « Royaume des Deux-Belgiques, « rive gauche du Rhin », État rhénan, « Wallonia », « Reichsland Rhénanie-Ruhr-Sarre »… : États-frontières, États-tampons, ou glacis militaires entre France et Allemagne (XIXe-XXe siècles) ? ». In Frédéric Dessberg et Frédéric Thébault (dir.), Sécurité européenne : Frontières, glacis et zones d’influence de l’Europe des alliances à l’Europe des blocs (fin XIXe s.-milieu XXe s.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, Centre de recherche en histoire internationale et atlantique, Centre de Recherche des Écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan (CREC), Écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan, 2007, 257 pages, p. 103 à 112.
(37) Voir un ouvrage collectif se voulant « scientifique » qui constitue un manifeste de cette « école pangermaniste »: Friedrich HEISS, Günter LOHSE et Waldemar WUCHER (dir.), Deutschland und der Westraum, Berlin-Prague-Vienne, Volk und Reich Verlag Amsterdam, 1943, 343 pages.
(38) Bischoff Georges, « La ‘Langue de Bourgogne’. Esquisse d’une histoire politique du français et de l’allemand dans les pays de l’entre-deux », in Publications du Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe‑XVIe siècles), n°42, 2002, Rencontre de Porrentruy (27 au 30 septembre 2001) « Entre Royaume et Empire : frontières, rivalités, modèles », p. 101 à 118, p. 117.
(39) Ibidem, p. 117, note 72.
(40) Voir ici Olivier Laurent, Nos ancêtres les Germains. Les archéologues au service du nazisme, préface de Jérôme Prieur, Paris, Tallandier, 2012, 314 pages.
(41) Sur les projets d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale : Robert Dallek, Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, New-York, 1979 ; rééd. Oxford, Oxford Univesrity Press, 1995, 671 pages. Thierry Grosbois, « La politique étrangère du Grand-Duché de Luxembourg, entre 1940 et 1944, dans son contexte international », in Les Années trente, base de l’évolution économique, politique et sociale du Luxembourg d’après-guerre ? Actes du colloque de l’Aleh, du 27-28 octobre 1995, Luxembourg, 1996, p. 51 à 68. (Beiheft zu Hemecht, 1996). Thierry Grosbois, « Les projets des petites nations de Benelux pour l’après-guerre 1941-1945 » in Michel Dumoulin (sous la direction de), Plans des temps de guerre pour l’Europe d’après-guerre 1940-1947, Actes du colloque de Bruxelles 12-14 mai 1993, Groupe de liaison des historiens auprès des communautés, Paris, L.G.D.J., p. 95 à 125. Pierre Guillen, « La France libre et le projet de fédération ouest-européenne 1943-1944 », ibidem, p. 153 à 173. Gérard Bossuat, « Jean Monnet et l’avenir de l’Europe 1940-1948 », ibidem, p. 325 à 365. Jean-Baptiste Duroselle, L’idée d’Europe dans l’Histoire, Paris, Denoël, « Europa Una », 1965, 347 pages. Thierry Grosbois, Le Benelux, « laboratoire » de l’Europe ? Témoignage et réflexions du comte Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, Bruxelles, Ciaco, 1991, 125 pages. Jean-Paul Lehners, « Zur historischen Legitimation einer Raum Konstruktion : die europaïsche Grossregion Saar-Lor-Lux » in Westfltlischen Forschungen 46, 1996, p. 259 à 274. Gilles Pécout (dir.), Penser les frontières de l’Europe du XIXe au XXIe siècle, Paris, PUF, 2004, 379 pages. Krzysztof Pomian, L’Europe et ses nations, Paris, Gallimard, 1990, 251 pages. Hagen Schulze, État et Nation dans l’histoire de l’Europe (préface de Jacques Le Goff), Paris, Seuil, 1996, 410 pages. André Segal, « Existe-t-i1 un espace historique belge ? » Historiens et Géographes, n°345, p. 143 à 153. Christian Vandermotten et Bernard Dézert, L’identité de l’Europe. Histoire et géographie d’une quête d’unité, Paris, Armand Colin, 2008, 334 pages. Jan Zielonka, Europe as Empire. The nature of the enlarged European Union, Oxford, Oxford University Press, 2006, IX-293 pages. John L. Harper, American Visions of Europe, Roosevelt, Kennan and Acheson, New-York, John Lamberton Harper, 1994 ; réédit. Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 365 pages.
(42) Thierry Grosbois, « Les projets des petites nations de Benelux pour l’après-guerre 1941-1945 » op. cit., p. 106.
(43) Eden Anthony, Mémoires, tome 2, L’épreuve de force, Paris, Plon, 1960, 619 pages, p. 376.
(44) Guillen Pierre, « La France libre et le projet de fédération ouest-européenne 1943-1944 » op. cit., p. 158 et Gérard Bossuat, « Jean Monnet et l’avenir de l’Europe 1940-1948 », op. cit., p. 337.
(45) Mémoire de Massigli à Dejean, 7 mars 1944, MAE Correspondance politique 717, f°331. Cité par Pierre Guillen, « La France libre et le projet de fédération ouest-européenne 1943-1944 » op. cit., p. 161-162.
(46) Sur l’historiographie de la « banane bleue », voir : Guy Baudelle, « Figures d’Europe : une question d’image(s) », Norois, n°194 (2005/1). URL : http://norois.revues.org/index604.html
(47) Auburtin Éric, Dynamiques et représentations transfrontalières de la Lorraine. Analyse géopolitique appliquée, thèse de doctorat de géographie (spécialité géopolitique) soutenue à l’Université de Paris VIII, sous la direction de Mme Béatrice Giblin-Delvallet, avec un jury composé de MM. Wolgang Brücher, Laurent Carroue, François Hulbert, 2 tomes, 2002, p. 303. Et, du même, un article reprenant ce thème dans les Annales de l’Est, 2005-1.
(48) Voir en particulier Raymond Woessner, Les Processus de la territorialisation : quelles conditions pour la possibilité de l’advenue d’un système spatial ? Habilitation à diriger des recherches sous la direction de Serge Ormaux, professeur de géographie, directeur de l’UMR ThéMA (UMR 6049, Théoriser et Modéliser pour Aménager), Besançon, Université de Franche-Comté, UFR des Sciences de l’Homme, du Langage et de la Société, volume 1 : Synthèse, 2007. Ainsi que Groupe Frontière, Christiane Arbaret-Schulz, Antoine Beyer, Jean-Luc Piermay, Bernard Reitel, Catherine Selimanovski, Christophe Sohn et Patricia Zander, « La frontière, un objet spatial en mutation », EspacesTemps.net, Textuel, 29 octobre 2004, http://espacestemps.net/document842.html. Christiane Arbaret-Schulz, « Histoires de frontières et de villes frontières », Revue Mosella, 1999, t. 24, n°1/2, Actes du Colloque International L’Europe rhénane et l’Europe centrale-Dynamique et mutations, Hommage au Professeur François Reitel, Université de Metz, 11‑13 mars 1998, p. 125 à 132. Patrick Gonin, Jean-Pierre Renard, « Région et frontière : du concept au terrain. L’exemple de la frontière franco-belge », in Agnès Guellec (dir.), La région européenne. La marge de manoeuvre, Presses Universitaires de Rennes, 1994, p. 263 à 292. Denis Menjot, Les Villes-frontières. Moyen Âge-Époque moderne, Paris, L’Harmattan, 1996. Christian Pradeau, Jeux et enjeux des frontières, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1993. John R.-V. Prescott, Boundaries and frontiers, London, Allen and Unwin, 1978. Jean-Pierre Renard (dir.), Le Géographe et les frontières, Paris, L’Harmattan, 1997. Jean‑Pierre Renard (dir.), 2002, « La frontière : limite politique majeure, mais aussi aire de transition », in Collectif, Limites et discontinuités en géographie, Paris, SEDES, p. 40 à 66. Eric Auburtin, Dynamiques et représentations transfrontalières de la Lorraine. Analyse géopolitique appliquée, thèse de doctorat de géographie (spécialité géopolitique) soutenue à l’Université de Paris VIII, sous la direction de Mme Béatrice Giblin-Delvallet, avec un jury composé de MM. Wolgang Brücher, Laurent Carroue, François Hulbert, 2 tomes, 2002. Voir aussi Darrell DelamaidE, The New Superregions of Europe, New York, Oxford University Press, 1994, 336 pages [titre français : Le Nouveau puzzle européen, Paris, Calmann-Levy, 1994]. Voir aussi, Antoine Beyer, Transports et frontières de l’Europe rhénane, UFR de géographie et d’aménagement, Université Paris-Sorbonne, 11 août 2010, non publié.
(49) Lacoste Yves, « Europe médiane ? » in Hérodote, n°48, 1er trimestre 1988, p. 6 : « Former par la pensée un nouvel ensemble géopolitique dont les contours plus ou moins flous ne correspondent pas du tout aux ensembles établis depuis plus ou moins longtemps ou repenser à d’anciens ensembles qui ont existé autrefois, écrit Yves Lacoste, c’est commencer à prendre conscience que des phénomènes nouveaux sont en train d’apparaître et que la situation, comme les rapports de force, commence à changer. C’est ce qui semble se produire actuellement dans toute une partie de l’Europe, même si ces aspirations et ces projets sont encore confus. »
La renaissance de la géographie historique en France depuis les années 1990 | Publié le 2013-06-03 13:59:57 |
Par Philippe Boulanger, Professeur des universités en géographie à l’Université de Cergy-Pontoise, membre du laboratoire Espaces, Nature et Culture (UMR 8185).
Résumé : Depuis l’époque moderne, la géographie historique française est une approche évolutive de la géographie. Elle connaît son plein essor surtout du début du XIXe jusqu’au milieu du XXe siècle. Aujourd’hui, un regain d’intérêt se distingue autant dans la communauté des géographes que celles des historiens. Pourquoi la géographie historique est-elle si méconnue alors qu’elle suscite un nouvel intérêt aujourd’hui ?
Mots-clefs : géographie historique, histoire, France, temporalités, échelles spatiales.
Abstract : Since the modern period, the French historic geography is an evolutionary approach of the geography. It knows its full development especially of the beginning of the XIXth until the middle of the XXth century. Today, a renewed interest distinguishes itself as much in the community of the geographers as those of the historians. Why is the historic geography so underestimated while it arouses a new interest today?
Keywords : historical geography, history, France, temporality, spatial scales.
Les Français affectionnent traditionnellement les oppositions et les différences. Ils aiment opposer la droite à la gauche, le rugby au football, la croissance à la crise, l’histoire à la géographie. Jean-Robert Pitte écrivait ainsi en 1994 que « l’histoire et la géographie entretiennent en France des rapports de couples orageux » [Pitte, 1994]. Il est vrai que les historiens et les géographes se reprochent mutuellement de ne pas parfaire à la complémentarité. Les géographes remettent en cause le poids de l’histoire dans les différentes instances de l’enseignement histoire-géographie et le savoir érudit trop éloigné des préoccupations concrètes et présentes d’une société en rapide mutation (Jean-Robert Pitte).
Les historiens voient dans une forme de géographie actuelle l’emploi abusif de concepts complexes et peu accessibles aux non-initiés. Cette situation peut apparaître bien paradoxale car la complémentarité de l’histoire et de la géographie constitue une permanence de la culture française dans ce domaine. Les deux favorisent à travers les siècles, au moins depuis l’époque moderne, la formation des élites, la représentation et la consolidation du territoire politique, la construction de l’Etat-nation.
En particulier, la manière d’exprimer cette complémentarité s’est développée dans la géographie historique dont les origines apparaîtraient dès le XVIe siècle. Celle-ci semble avoir toujours existé et incarne même au XIXe siècle la pratique géographique au côté de la géographie physique. Malgré les différends qui ont opposé historiens et géographes après la Seconde Guerre mondiale, la géographie historique n’a jamais cessé d’être représentée par de grandes figures de la géographie française. Par ailleurs, si elle semble avoir toujours existé, elle n’en demeure pas moins méconnue et mal aimée, dans la recherche comme dans l’enseignement secondaire ou supérieur. On assiste cependant, aujourd’hui, à un regain d’intérêt pour cette pratique de la géographie en France lié à l’évolution et aux exigences d’une société obligée de respecter de nouvelles normes juridiques dans l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Pourquoi la géographie historique est-elle si méconnue alors qu’elle suscite un nouvel intérêt aujourd’hui ?
I-Une approche géographique naissant à l’époque moderne
A.Les origines de la géographie historique en France sembleraient apparaître dès le XVIe siècle dans l’enseignement jésuite.
Cet enseignement ne fait pas la distinction entre l’histoire et la géographie dans un contexte où les notions d’Etat, de frontières naturelles et d’espace administratif se construisent au sein du pouvoir royal. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, comme le souligne Jean-René Trochet, le développement des travaux d’érudition des textes médiévaux par un corps de spécialistes participe également à cette complémentarité. Les savants reconstituent les anciennes circonscriptions territoriales et déchiffrent le sens des noms de lieux de sorte que se met en place une sorte d’histoire de la propriété et de l’occupation du sol en France [Trochet, 1995].
B.Son essor au XIXe siècle sous l’influence de la pensée allemande
A partir du début du XIXe siècle, cette première forme de géographie historique entre dans une phase d’essor sous l’influence de la pensée allemande. La conception espace-temps des géographes prussiens participe à la formation des élites militaires et politiques germaniques. Elle s’appuie sur une approche globale du sujet étudié où l’histoire et la géographie sont étroitement mêlées, une sorte de « totalité géographique » selon Paul Claval [Claval, 1998]. Les origines historiques et les faits naturels sont imbriqués dans les travaux des géographes Alexandre de Humboldt (1769-1859) et de Friedrich Von Richthofen (1833-1905). Cette évolution influence directement la pensée française dans de multiples domaines et, notamment, dans les institutions de la géographie naissante. En 1821, la Société de géographie de Paris est créée et rassemble des explorateurs, des historiens, des naturalistes mais aussi des militaires et des entrepreneurs du négoce international. Dans l’enseignement supérieur, la géographie s’impose sous la forme de géographie historique. En 1809, une chaire d’histoire et de géographie moderne est créée à la Sorbonne qui devient une chaire de géographie en 1812. En 1866, une chaire de géographie et statistique est ouverte au Collège de France où Auguste Longnon enseigne la géographie historique de 1892 à 1911, notamment l’histoire des pays et des noms de lieux.
A l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, la première chaire de géographie est occupée par Théophile Lavallée qui y enseigne la géographie physique, historique et militaire jusqu’en 1869 [Boulanger, 2002]. A cette époque, la géographie est encore considérée comme une science auxiliaire de l’histoire et une science de cabinet. Les géographes sont spécialisés dans l’analyse des archives à contenu géographique et s’intéressent, dans la tradition des siècles passés, aux données régionales ou aux foyers des grandes civilisations (Rome et l’Egypte ancienne par exemple). Les lendemains de la défaite française face à l’Allemagne en 1870-1871 marquent un nouveau tournant de la géographie historique. Les institutions et les enseignements géographiques sont reconnus et réorganisés grâce aux travaux d’une nouvelle génération de géographes français. Vidal de la Blache 1845-1918) en est l’un des plus illustres représentants [Berdoulay, 1995]. Historien de formation, il enseigne la géographie à la faculté de Nancy puis à l’Université de la Sorbonne à partir de 1898. Il publie Tableau de la géographie de la France en 1903, premier volume d’une Histoire de la France des origines à la Révolution, dirigée par Ernest Lavisse, dans lequel la géographie et l’histoire sont étroitement associés dans une géographie physique et humaine. L’auteur y présente une relation entre la globalité géographique et la description des mœurs des habitants dans des aires géographiques qui n’ont plus pour limites les circonscriptions administratives mais celles des genres de vie. Lorsqu’il étudie, par exemple, l’étendue des forêts de Sologne, il évoque les origines médiévales et féodales pour en expliquer l’importance dans les genres de vie locaux. Ses études portent sur les espaces humanisés dans le temps présent et dans une perspective historique.
Cette manière de concevoir la géographie est suivie par plusieurs générations de géographes avant la Seconde Guerre mondiale. Lucien Gallois (1857-1941), dans Régions naturelles et noms de pays (1908), suit cette démarche pour analyser les modalités de la dénomination des circonscriptions rurales françaises. Philippe Arbos, dans la Vie pastorale dans les Alpes françaises (1922) montre l’importance des déplacements des habitants et des troupeaux dans les moyennes montagnes depuis le Moyen-Age. En somme, durant cette deuxième période, la géographie historique se situe au coeur de la démarche géographique et participe directement à la formation de plusieurs générations de géographes et d’historiens.
C.Le maintien du rayonnement de la géographie historique
De la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui, la géographie historique demeure l’une des manières de considérer la discipline malgré la distanciation de plusieurs courants de la géographie des méthodes historiques. Si elle apparaît en net recul dans la recherche, plusieurs géographes la maintiennent à haut niveau de rayonnement. Roger Dion (1896-1981), spécialiste de géographie rurale et professeur au Collège de France à partir de 1948, consacre plusieurs études dans une perspective historique. Dans sa thèse de doctorat sur le Val de Loire (1931), il exploite les noms de lieux comme témoins des types d’économie rurale. Dans son Essai sur la formation du paysage rural français (1934), il décrit et explique les origines des paysages ruraux français. Dans Histoire de la vigne et du vin en France (1957), ouvrage de référence encore aujourd’hui, il s’intéresse à l’évolution de la vigne et des vignobles depuis l’Antiquité.
Dans l’ensemble, la géographie historique est essentiellement consacrée aux structures agraires et aux paysages ruraux à travers les époques. Pierre Brunet, autre exemple, soutient une thèse de doctorat en 1960 intitulée Structure agraire et économie rurale des plateaux tertiaires entre la Seine et l’Oise où les différences d’aménagement entre les vallées et les plateaux s’expliquent par la présence de plusieurs abbayes sur ces derniers dès la période médiévale [Trochet, 1995]. A la fin du XXe siècle, cette orientation marquée vers les questions rurales tend cependant à évoluer. Une nouvelle génération de géographes ouvre d’autres perspectives mises provisoirement en retrait des recherches. Jean-Robert Pitte, dans Histoire du paysage français (1983), analyse l’évolution des paysages ruraux comme urbains. Xavier de Planhol, outre ses travaux sur les formes d’habitat et de paysages ruraux, publie de nombreux ouvrages sur la géographie historique des civilisations (l’Islam), la géographie historique de la France et les genres de vie (la consommation alimentaire). De nouvelles synthèses sont publiées comme celle de Jean-René Trochet, professeur de géographie historique à la Sorbonne, intitulée Géographie historique, hommes et territoires dans les sociétés traditionnelles [Trochet, 1998].
La géographie historique connaît un net regain d’intérêt parmi ces nouvelles générations de géographes qui ouvrent de nouveaux champs de recherche. Le colloque international, organisé, en collaboration par Jean-René Trochet et l'auteur de cet article, en Sorbonne en 2002, Où en est la géographie historique ?, en témoigne. Les thématiques y sont apparues étonnement diversifiées vers la géographie de la santé, de la zoographie, du patrimoine industriel et des transports, de la démographie ou des questions militaires. La redécouverte de la géographie historique constitue un phénomène bel et bien majeur de la géographie française en ce début du XXIe siècle au point que l’une des questions au programme des concours de recrutement de l’enseignement secondaire à la même période s’intitulait Espaces et temporalités.
II-Le regain d’intérêt pour la géographie historique aujourd’hui
A.Une combinaison des temporalités
Ce regain d’intérêt pour la géographie historique parmi les géographes depuis les années 1990 s’explique pour différentes raisons. Celles-ci renvoient à la fois à la combinaison des temporalités, à la diversité des thématiques et au jeu des échelles géographiques. Contrairement à la méthode historique, qui distingue quatre grandes périodes (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine), la géographie historique ne se soucie pas de découpages temporels figés et orientant les études dans une période en particulier. Elle se construit selon des dynamiques et des rythmes temporels qui varient selon l’objet étudié. Cette différence avec l’histoire n’empêche pas de réfléchir sur la manière d’appréhender la notion d’échelle temporelle. Dans un article publié en 1995, Pierre Flatrès montre qu’il existe deux rythmes majeurs [Flatrès, 1994]. Le premier porte sur la géographie dite rétrospective. Le terme n’est peu, voire pas du tout employé, alors que la démarche se rencontre surtout dans les travaux des historiens.
Fernand Braudel, dans la Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (1949) emploie l’expression de « géographie humaine rétrospective ». Pour Jean-Robert Pitte, la géographie rétrospective serait « l'application des méthodes modernes de la géographie à des situations du passé et avec les sources et documents du passé ». Son intérêt réside dans l’analyse des phénomènes géographiques à un moment défini dans le passé. L’étude de Marie Saudan, Espaces perçus, espaces vécus : géographie historique du Massif central du IXe au XIIe siècle, en est un exemple [Saudan, 2004]. Cette géographie historique du Massif central traite des espaces politico-administratifs civils et ecclésiastiques, des espaces monastiques à travers la structure des réseaux de dépendances monastiques, des espaces de diffusion des monnaies et des espaces culturels en lien avec les pratiques de l’écrit. A travers l’étude des chartes (soit 2765 textes en latin), l’auteur montre ainsi les mutations et les permanences des modes de vie des habitants du Massif central à des échelles spatiales variées. Il en résulte, notamment, que ce territoire, qui n’a jamais formé une entité politique, continue de présenter des éclatements spatiaux au travers des phénomènes étudiés sans que la montagne ne joue d’influence spécifique. Le second rythme temporel renvoie à la géographie dite historique.
Pour Xavier de Planhol, elle se définit par des « incursions des géographes dans le domaine historique », « la recherche dans le passé d’une explication du présent » sans rechercher la reconstitution historique globale. Pierre Flatrès emploie l’expression de « tri des traces du passé » pour comprendre le présent. Jean-Robert Pitte, dans Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales (2005) illustre cette seconde démarche [Pitte, 2005]. En mêlant histoire et géographie, l’auteur fait découvrir toutes les facettes d’un fossé qui s’est creusé depuis des siècles entre Bordeaux et Bourgogne au travers des modes de fabrications des vins, de leur commerce et de leur consommation, des cultures et des vies qui s’y sont consacrées avec passion. Sur une période longue, de l’Antiquité à aujourd’hui, il montre que les bons terroirs résultent à la fois de données physiques avantageuses et du savoir-faire des vignerons qui se perfectionne lentement depuis les premières implantations de vignes durant l’Antiquité gallo-romaine. Par exemple, au Moyen-Age, les moines de Cîteaux, propriétaires du Clos de Vougeot, améliorent des techniques ancestrales et abandonnent le complantage (vignes mêlées aux arbres fruitiers). Le premier attrait de la géographie historique se distingue justement dans cette souplesse d’analyse des rythmes temporels où les grandes périodes ne forment pas d’ensembles cloisonnés, mais au contraire une continuité où les éléments du passé permettent de comprendre les faits actuels.
B.La transversalité des thématiques
La deuxième spécificité de la géographie historique se rencontre dans la transversalité des thématiques. Là aussi, cette approche de la géographie apparaît ouverte à de multiples domaines des sciences. La conception d’Auguste Longnon, professeur au Collège de France entre 1892 et 1911, qui s’intéressait essentiellement aux évolutions des circonscriptions territoriales, est de longue date dépassée, même si elle reste utile à la formation des chartistes à l’Ecole des Chartes. Elle a pu encore connaître un certain rayonnement par l’ouvrage de Léon et Albert Mirot (1947). Mais, depuis le début du XXe siècle, la géographie historique s’ouvre à un large éventail de thématiques. Elle apparaît traditionnellement politique (les circonscriptions territoriales et la géographie des frontières) et rurale (les techniques et les structures agraires, les formes d’habitat, les paysages agraires, les mutations de l’espace agricole). Elle tend à se diversifier vers d’autres thématiques comme celle de l’aménagement du territoire (les grandes politiques des Etats), de la géographie urbaine (mutations des paysages urbains et de l’urbanisme), économique (études des espaces et des paysages industriels, agricoles, tertiaires, des réseaux de transport et d’échange), sociale (les genres de vie, les contrastes régionaux des pratiques religieuses, des niveaux d’alphabétisation, etc.). L’approche culturelle occupe une place à part. Déjà explorée par l’école vidalienne, elle suscite un intérêt particulier depuis les années 1980 autant parmi les géographes que parmi les historiens.
L’historien Alain Corbin, dans Le territoire du vide, le désir du rivage de 1750 à 1850, montre que, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, la plage est perçue comme un espace de transition entre les hommes et le chaos de l’univers marin [Corbin, 1990]. Elle fait partie des interdits que les mythes et l’interprétation biblique entretiennent depuis l’Antiquité. A partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les valeurs attachées à cet espace sont inversées. Le littoral attire et fascine une minorité de personnes, comme les scientifiques, qui apprécient la contemplation du spectacle d’un rivage travaillé par les vagues, les bains de mer dont on découvre les bienfaits pour le corps, le plaisir d’une promenade dans une atmosphère oxygénée.
Outre les données physiques et techniques, Jean-Robert Pitte, dans Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales, accorde une large place aux facteurs culturels puisque ce sont justement les hommes qui sont au cœur de la géographie historique. Si les techniques évoluent vers la recherche de la qualité au XVIIIe siècle, les vins de Bordeaux et Bourgogne suivent des destins différents parce que conçus pour des clientèles elles-mêmes différentes. Dès le milieu du Moyen-Age, les Bourgognes sont consommés sur les tables des rois, des papes et des évêques, les Bordeaux sont exportés vers l’Angleterre dès que l’Aquitaine passe sous domination des Plantagenêts en 1152. Ces chemins qui se séparent dans l’évolution des vignobles ne cessent pas de s’éloigner durant le faste XVIIIe siècle. La formation des grands domaines fonciers appartenant à de puissantes familles, les investissements réalisés, les exigences nouvelles des clientèles, les réseaux de commerce vers la mer du Nord pour l’un, vers Paris et les régions accessibles pour l’autre, contribuent largement au creusement des différences. L’auteur montre aussi le poids des différences de ces deux mondes qui ne se côtoient pas. « En caricaturant quelque peu, les Bordelais ont des diplômes, parlent anglais et parfois une autre langue étrangère, lisent quotidiennement la presse économique, s’habillent à la mode des gentlemen farmers anglais (...). Les Bourguignons, au contraire, pour beaucoup d’entre eux ne font pas d’études poussées, s’habillent dans le style rustique ou sportif (...), et ont des manières fièrement assumées de paysans » [Pitte, p. 167-168]. Les différences sont finalement présentes dans tous les domaines, non seulement dans la saveur des vins, mais aussi dans la forme des bouteilles (bordelaise/champenoise-bourguignonne), le lieu et le moment de la dégustation (en carafe et à table dans le Bordelais, en bouteille et « quand on a soif » en Bourgogne et à Paris), le contact entre buveur et vignerons plus ouvert et moins maniéré en Bourgogne. La pratique religieuse, où l’influence protestante marque bien des manières d’être et de penser le vin dans le Bordelais, mais non dans la Bourgogne traditionnellement catholique, contribue aussi à mieux comprendre ces différences. Par exemple, le choix du cabernet-sauvignon à Bordeaux répond au besoin de séduire une clientèle protestante nord-européenne, en accord avec une conception puritaine du monde, d’où des saveurs qui inspirent le contrôle de soi-même. Les vins de Bourgogne renvoient à une influence plus catholique et latine d’autant que l’Eglise a été un grand propriétaire de vignobles jusqu’à la Révolution. L’auteur aime rappeler la sentence du cardinal de Bernis (probablement apocryphe) : « je dis ma messe au grand meursault pour ne pas faire la grimace au Seigneur en communiant » (p. 228).
En somme, la géographie historique forme une discipline à part entière, compte tenu de la diversité de ses thématiques, qui souffre cependant d’un déficit de reconnaissance dans le domaine de l’enseignement supérieur. Il est rare que, dans les Universités, un enseignement spécifique y soit consacré. Le plus souvent, elle est abordée séparément, parfois à titre introductif, dans l’une des branches de la géographie, qu’elle soit rurale, urbaine, économique ou politique. Toujours est-il que la géographie ne peut se passer des facteurs historiques pour assimiler les mutations du temps présent.
C.Une combinaison des échelles spatiales
Enfin, il ne saurait être de géographie historique sans faire référence à la combinaison des échelles spatiales. L’étude d’un même phénomène peut révéler des dynamiques différentes selon l’échelle locale, régionale, continentale ou planétaire. Là encore, la géographie historique se distingue de l’histoire par ce jeu des effets d’échelles avec, pour conséquence, l’emploi de méthodes de travail adaptées et variées selon les cas.
L’étude de Xavier de Planhol, L’eau de neige (1995), illustre à la fois l’approche culturelle en géographie historique et ce jeu des échelles spatiales. Il montre que la consommation d’une boisson fraîche ne constitue pas une habitude commune à tous aux origines des civilisations, mais bel et bien une transgression d’un ordre naturel. Les sociétés consomment traditionnellement les boissons chaudes ou tièdes. Pour démontrer ce fait, l’auteur suit trois grandes idées. La première est de rappeler que le besoin de rafraîchir la boisson naît dans l’Orient antique (en Egypte) parmi les élites, puis s’est développé progressivement vers l’Occident à partir de la Renaissance, enfin étendu dans les classes populaires à partir du XXe siècle. Les usages évoluent ainsi de l’Orient vers l’Occident, puis de l’Occident vers les colonies, des élites vers les classes populaires. Les sociétés inventent et adoptent ainsi des techniques différentes pour destiner aux jours les plus chauds cette fraîcheur. La deuxième idée apparaît justement dans les différences culturelles de mise au point des techniques de rafraîchissement. Xavier de Planhol en distingue alors trois principales : les procédés chimiques et naturels, la glaciaire qui conserve la glace et la neige, le réfrigérateur qui devient un produit de masse au dernier siècle. Enfin, l’auteur montre que cette habitude alimentaire, si commune aujourd’hui, s’est inégalement développée dans le monde avec quelques pôles régionaux de résistance. Il distingue l’usage courant de la glace naturelle dans les zones tempérées à hiver froid (Russie, Canada, Norvège, etc.), la recherche de la glace, parfois sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, dans la zone tempérée à hiver modéré (commercialisée dans les zones urbaines), la consommation de l’eau de neige dans la zone subtropicale méditerranéenne (Afghanistan, Iran, Italie du Sud, Chili, Syrie) prélevée en hiver puis conservée dans des puits. Enfin, des zones de résistance se font jour selon les époques et les civilisations. Au XIXe siècle, en Prusse orientale et en Baltique occidentale, l’aristocratie se refuse à consommer une boisson fraîche puisque le froid renvoie à l’enfer. Au XXe siècle, la bière et le thé en Angleterre, le saké et le thé dans l’aire sino-japonaise se dégustent traditionnellement tièdes. En somme, le jeu des échelles et des typologies spatiales favorisent une toute autre analyse.
La géographie historique française ne cesse donc d’évoluer selon des perspectives plus larges tant par les thématiques que par les méthodes -d’érudition et de terrain- employées. En dehors de tout plaisir qu’elle procure au chercheur, quels usages et quelles utilités peuvent en être tirés ?
III-De l’utilité de la géographie historique
La question de l’utilité a été posée à de multiples reprises depuis plusieurs années. Jean-Yves Puyo, en 2007, notait la difficulté pour la géographie historique à mieux être entendue, à se débarrasser d’une « image un peu poussiéreuse voire surannée » dans le courant d’une « nouvelle géographie » [Puyo, 2007]. En réalité, la géographie historique semble de mieux en mieux trouver sa place dans la recherche, depuis les années 2000, parallèlement au renouvellement des outils et des démarches géographiques pour répondre aux besoins d’une société en mutation permanente. La révolution des nouvelles technologies (Information-communication, systèmes d’information géographique) en est la principale raison. Elle permet de nouveaux usages des données du passé des territoires et des hommes.
A.Mieux comprendre son environnement
Le colloque international de géographie historique, organisé à l’Université Paris-Sorbonne en 2002, pose de nombreuses questions, mais apporte aussi de nombreuses propositions concernant l’utilité de la géographie historique. La géographie historique répond d’abord au besoin et à la nécessité de mieux comprendre et gérer l’environnement. Au XXe siècle, le défrichement intensif du bocage dans certaines régions de l’Ouest de la France, à des fins de rentabilité économique et agricole, conduit régulièrement, en période de fin d’hiver notamment, à des inondations dommageables aux personnes et aux biens matériels. Les différents travaux de géographie historique rurale, à la même époque des remembrements, avaient démontré que les structures agraires anciennes, originaires du XIe-XIIe siècle, ont été adoptées pour répondre à un besoin économique et social. La suppression du bocage conduit à bouleverser un écosystème et un mode traditionnel du travail de la terre, exposant les sociétés à de nouveaux risques naturels. Les replantations actuelles de haies d’arbres sur la façade et les échecs des remembrements auraient pu être ainsi évités en suivant les travaux d’André Meynier, Pierre Flatrès et Jean Peltre [Pitte, 2005].
Dans certaines régions forestières, la géographie historique aide également à la prévention contre les risques naturels. Comme le souligne Christine Bouisset dans ses travaux sur la connaissance des incendies de forêt dans le Var, la géographie historique fait un retour sous la pression de la législation. Le code de l’environnement de 1987 oblige à informer les populations des risques éventuels tandis que, depuis 1995, les dispositifs réglementaires intègrent systématiquement une analyse historique des phénomènes naturels à risques. Dans le massif des Maures, l’analyse de la répétition et de la fréquence des incendies de forêts, à partir de sources écrites et orales, conduit à observer que les incendies se reproduisent au même lieu. Ce n’est pas tant le tourisme, l’exode rural ou l’abandon de l’entretien des forêts qui constituent le phénomène explicatif essentiel, mais le fait que les feux réapparaissent aux mêmes endroits. La prise en compte de ces comportements permet ainsi de mieux mesurer la prévention et le risque encouru par les sociétés.
Ailleurs, en Lorraine, la remise en cause des modèles sylvicoles à la fin du XXe siècle, afin d’améliorer leur gestion, aboutit à la recherche des paysages d’autrefois. S’est ainsi posée la question de la redécouverte des aménagements forestiers antérieurs au XXe siècle dans une région où la forêt constitue un enjeu économique et culturel essentiel compte tenu des superficies concernées, comme dans les Vosges. Des pressions divergentes entre les groupes d’intérêts, entre les écologistes et les forestiers notamment, se sont manifestées [Husson, 2005]. Les travaux sur la géographie historique des milieux forestiers aident à mieux comprendre le fonctionnement global des écosystèmes et des sylvosystèmes passés et présents. Ils tendent aussi à faciliter la mise en œuvre des chartes forestières, à concevoir « des architectures de peuplement plus cohérentes possibles » et à dépassionner la patrimonialisation des forêts. L’apport de la géographie historique se révèle finalement essentiel pour mieux concevoir les aménagements futurs des milieux naturels.
B.Répondre aux besoins d’aménagement du territoire
La géographie historique présente également l’utilité de répondre aux besoins de la société pour aménager le territoire. Jean-Robert Pitte, en 2005, soulignait cette dimension essentielle :
« Se pencher sur l’histoire de l’aménagement et du paysage résultant de celui-ci, est une démarche indispensable aujourd’hui. Trop d’erreurs ont été commises depuis la Révolution industrielle, et même avant, au nom du bonheur de l’humanité. (…) Réfléchir au bilan du productivisme agricole, industriel et urbain peut inciter les décideurs politiques et économiques à plus de sens des responsabilités, plus de respect des attentes profondes et formulées des citoyens, des consommateurs, des usagers » [Pitte, 2005].
En matière d’aménagement industriel, par exemple, les travaux sur les paysages industriels de Leipzig-Halle de Michel Deshaies en témoignent [Deshaies, 2005]. Cette région allemande de l’ex-RDA est marquée par plusieurs siècles d’exploitation minière (cuivre et lignite). Le régime socialiste, avant 1989, avait même accentué les aménagements industriels bouleversant plus encore le paysage naturel. Dans les années 1990, la crise industrielle conduit à l’arrêt brutal de presque toutes les activités minières.
La question du devenir de ces espaces industriels s’est donc vite posée pour les élus politiques et a conduit à mener des études pour des travaux d’aménagement paysagers, notamment du passé. Les résultats des études conduisent à deux conclusions majeures. Dans le bassin de lignite, l’exploitation du charbon était de création relativement récente, soit dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il n’existe donc pas une forte tradition minière qui aurait influencé la reconversion des sites. En effet, les espaces d’extraction ont pu être transformés en espaces lacustres et en aires de loisirs des citadins. En revanche, dans le bassin cuprifère, la tradition minière apparaît beaucoup plus ancienne. Les premières exploitations se sont ouvertes au XIIe siècle. L’activité constitue un pilier de l’identité et de la culture des habitants. Afin de ne pas rompre avec cette longue histoire minière, il a été décidé de fossiliser les paysages et de favoriser leur mise en valeur. L’apport de la géographie historique aide ainsi à mieux connaître les mentalités et les attitudes des décideurs, les identités locales afin de favoriser des plans d’aménagements harmonieux selon la culture du moment.
L’apport de la géographie historique s’inscrit finalement là où les activités humaines ont laissé des traces. Elle permet de reconstituer le fil directeur du passé des territoires et des hommes comme en témoignent les études d’aménagement des espaces ruraux et urbains qui intègrent plus fréquemment le facteur historique. La reconversion des berges de la Seine à Paris en aires de loisir pour les citadins pendant le mois d’août résulte de plusieurs années d’études du passé de ces espaces. Celles-ci ont montré que jusqu’au XXe siècle les quais du fleuve étaient des espaces de vie, souvent festifs, depuis la fin du Moyen-Age. L’aménagement des voies autoroutières sur ces emplacements a bouleversé les genres de vie et leurs modes d’appropriation au début des années 1970. Les politiques d’aménagement actuelles reconstituent progressivement et temporairement un passé devenu source de nostalgie.
C.Favoriser le lien social et créer des espaces en harmonie avec les sociétés
La finalité de la géographie historique est donc plurielle. Elle tend à influencer les décideurs, respecter les attentes du citoyen, créer des espaces en harmonie avec les sociétés. Sa dimension civique est, comme la géographie dans son ensemble, porteuse de nouvelles réflexions sur la responsabilité du citoyen quant au choix des genres de vie. La thèse de Romain Garcier sur La pollution industrielle de la Moselle française 1850-2000 en est un exemple illustratif. Depuis la fin du XIXe siècle, le bassin-versant français de la Moselle (11 500 km2) est confronté à la pollution industrielle alors que les modalités pratiques de la gestion de la pollution de l’eau sont très mal connues. L’auteur montre, au contraire, que la conscience de pollution industrielle était générale et partagée entraînant des initiatives pour la combattre. Mais les mesures prises par l’Etat se sont révélées inefficaces. L’auteur met en évidence, en particulier, l’impuissance des scientifiques à proposer des procédés d’épuration satisfaisants pour certains produits comme l’ammoniaque, d’où une situation de dégradation acceptée de fait par la population et les autorités.
Parallèlement, la législation interdit les déversements industriels dans les eaux mais est incapable de l’appliquer dans les sites appropriés d’où une situation inextricable (Jusqu’en 1996, il n’existe aucun délit de pollution dans le droit français). La pollution tend donc à s’accroître selon le développement des activités industrielles, surtout avant 1914 et au début des années 1960. L’essor industriel de la Lorraine fait l’objet d’un consensus entre les pouvoirs publics, les industriels et les populations au nom d’un progrès qui permet de négliger tous les effets néfastes de l’industrialisation.
La nature apparaît instrumentalisée au profit des industriels, intégrée dans les structures de production industrielle de sorte que les effets de la pollution ne sont pas perçus comme un problème d’aménagement. A partir de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau contexte se dégage : la reconnaissance du lien entre l’aménagement de la nature et de la pollution industrielle, les incidents de pollution condamnés par la justice, le développement d’une thématique de la pénurie d’eau qui heurte le consensus lorrain, la planification de l’eau en raison des pénuries potentielles et des pollutions. Un phénomène de prise de conscience de la pollution se fait jour. De fortes pressions commencent à s’exercer sur les industriels. La canalisation de la Moselle en 1964 permet la mise en place des commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre contre la pollution.
Parallèlement, la question de la salinité du Rhin se pose dès 1972 quand interviennent les pays voisins contre la pollution par chlorures. Le consensus lorrain commence à s’effriter. A partir des années 1980, le contexte de la crise industrielle, les mouvements écologistes, les études scientifiques et les exigences des pays voisins concernés par le problème de la pollution de la Moselle favorisent la construction d’un autre mode de gestion. Le choix du bassin rhénan comme district international expérimental (directive-cadre européenne sur l’eau de 2000) en est le résultat. Cette étude permet ainsi de mieux appréhender le problème de la pollution des eaux dans le temps et surtout de poursuivre le processus de dépollution toujours en cours.
La géographie historique est probablement l’une des premières formes pratiquées de la discipline actuelle. Elle apparaît aussi la plus érudite, la plus savante tant les méthodes sont diversifiées, empruntées autant à l’histoire qu’aux autres sciences humaines. Malgré sa dimension pluriséculaire et ancienne, force est de remarquer que pendant presque un demi-siècle, elle fut peu connue ou reconnue dans les instances de la recherche et dans les savoirs universitaires en France. Cette tendance semble se renverser progressivement depuis les années 1980. Les géographes sont plus nombreux à reconsidérer la place du facteur historique dans l’approche spatiale, prenant conscience de son apport pour mieux gérer les enjeux sociaux et territoriaux actuels. Le plus grand nombre de thèses de géographie historique soutenues à l’Université, dans des proportions relatives néanmoins, témoigne de ce regain d’intérêt parmi la nouvelle génération de chercheurs.
Bibliographie :
Berdoulay V., 1995, La formation de l’école française de géographie, Cths, Format 17, 252 p.
Boulanger P., 2001, La géographie militaire française, Economica, 617 p.
Boulanger P., 2002, La France : Espace et temps, Edition du temps, 294 p.
Boulanger P. et Trochet J.-R. (dir.), 2005, Où en est la géographie historique ?, Paris, Actes du colloque international tenu en Sorbonne du 12 au 14 septembre 2002, L’Harmattan, 346 p.
Claval P., 1998, Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Paris, Nathan Université, 543 p.
Corbin A., 1990, Le territoire du vide, le désir du rivage de 1750 à 1850, Paris, Flammarion-Gallimard, 407 p.
Deshaies M., 2005, « Réaménagement ou préservation des paysages miniers ? L’exemple de la région de Halle-Leipzig », in Trochet J.-R. et Boulanger P. Où en est la géographie historique ?, L’Harmattan, p. 179-194.
Flatrès P., 1994, « La géographie historique rétrospective », in Hérodote, n°74-75, p. 63-69.
Garcier R., 2005, La pollution industrielle de la Moselle française 1850-2000, thèse de doctorat, Université Paris VII, sous la dir. de Jean-Paul Bravard, 477 p.
Husson J.-P., 2005, « La géographie historique, une discipline citoyenne au service des actuels aménagements forestiers pleuronectiformes », in Où en est la géographie historique ?, L’Harmattan, p. 203-212.
Mirot A. et L., 1947, 1980, Manuel de géographie historique de la France, 618 p.
Pitte J.-R, 1994, « De la géographie historique », in Hérodote, n°74-75, p. 14-21.
Pitte J.-R., 2005, Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales, Paris, Hachette Littératures, 250 p.
Pitte J.-R., 2005, « La géographie historique au service des problèmes d’aujourd’hui », Où en est la géographie historique ?, L’Harmattan, p. 195-202.
Planhol X., 1988, Géographie historique de la France, Paris, Fayard, 1988, 1995, 638 p.
Planhol X., 1993, Les nations du Prophète, Paris, Fayard, 1993, 894 p.
Planhol X., 1994, L’eau de neige, Paris, Fayard, 474 p.
Planhol X., 2000, L’Islam et la mer, Paris, Fayard, Perrin, 2000, 658 p.
Puyo J-Y, 2007, « Que peut apporter la géographie historique en ce début du XXIe siècle ? », in Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, n°23, Géographie historique, pour un autre regard, p. 1-3.
Saudan M., 2004, Marie Saudan, Espaces perçus, espaces vécus : géographie historique du Massif central du IXe au XIIe siècle, thèse de doctorat sous la direction de M. Parisse et M. Fray, Université de Clermont 2, 739 p.
Trochet J.-R., 1997, Géographie historique de la France, Presses universitaires de France, Que sais-je ?, 127 p.
Trochet J.-R., 1998, Géographie historique, Hommes et territoires dans les sociétés traditionnelles, Nathan Université, 251 p.
Histoire-géographie, géographie historique et histoire géographique dans l'enseignement secondaire | Publié le 2013-06-03 13:59:32 |
Par Nicola Peter Todorov, Centre d’histoire du XIXe siècle (EA3550), Université de Rouen et enseignant dans l’Académie de Rouen
Résumé : Dans l’enseignement secondaire, la géographie est enseignée essentiellement par des historiens, ce qui conduirait à une mauvaise image de cette discipline auprès des élèves. Plusieurs enquêtes sont utilisées pour vérifier cette idée. Ensuite, quelques pistes pour tirer profit de la complémentarité des deux disciplines dans l’enseignement secondaire sont suggérées. La comparaison des pratiques des historiens et des géographes avec celles d’autres disciplines montre que la distance entre les deux communautés est finalement assez relative.
Mots-clés: histoire-géographie, perception de la géographie, enseignement secondaire
Abstract: In secondary schools in France, geography is mainly taught by history graduates, which is supposed to give students a bad image of geography. Some enquiries will be used to test this idea. Then some ideas will be suggested to take advantage of the complementarity of both subjects. Comparing the practices of historians and geographers with those of other fields reveals that the two subjects have more ties than it is often thought.
Key words: Secondary school subject history-geography, perception of geography
Lorsque, il y a 12 ans, j’ai participé à une séance de l’école doctorale de Paris 1 consacrée à la géographie historique, notre invité d’honneur Jean-Robert Pitte déplorait que dans l’enseignement secondaire la géographie soit enseignée essentiellement par des historiens de formation, ce qui aurait des conséquences négatives sur la perception de la géographie par les élèves (Pitte, 2002).
« Trop peu nombreux sont, hélas, les professeurs de collège ou de lycée avec autant de plaisir et donc de talent, l’histoire et la géographie, faute de connaissances suffisantes et de goût pour les acquérir. La disproportion des étudiants en histoire et en géographie en est la conséquence, qui se perpétue dans l’origine disciplinaire des admis au CAPES d’Histoire et de Géographie : 90% d’historien contre 10% de géographes, environ.» Il ne s’agit pas d’un point de vue isolé :Le regret d’une géographie enseignée majoritairement par des historiens est assez souvent repris par des géographes universitaires, qui déplorent souvent « le ‘mauvais’ enseignement de la géographie dans le secondaire»(Moriniaux, 2005).En France, aujourd’hui, il n’est pas exagéré de dire que la géographie est enseignée par des historiens, puisque plus de 90% des lauréats du CAPES sont historiens de formation.
Prenant ces remarques très à cœur, nous avons réfléchi dès l’entrée dans l’enseignement secondaire à des façons de contrecarrer ce phénomène d’une géographie parent pauvre de l’histoire. Encore faudrait-il qu’il soit avéré. Dès le début de notre activité d’enseignement, nous avons profité des fiches de renseignement que nous- comme de nombreux collègues - faisons remplir par les élèves d’une classe que nous venons de prendre en charge pour enquêter sur la perception de la discipline et notamment l’image respective dont jouissent l’histoire et la géographie auprès des élèves, en posant notamment la question de leur préférence. Comparée aux enquêtes plus systématiques menées depuis, notamment sur l’enseignement de l’histoire-géographie au collège, la façon de procéder peut paraître critiquable, moins rigoureuse, car les données recueillies dépendaient du public d’élèves, qui ne reflète pas la composition du groupe des élèves au niveau national. Mais l’historien - comme le géographe historique - travaille avec les sources dont il dispose. Après avoir présenté et analysé les résultats de notre propre enquête, nous allons aborder un certain nombre de points de convergence entre l’histoire et la géographie enseignées dans le secondaire.
I- La mal-aimée ?
Sans mettre en cause la meilleure image de l’histoire, les enquêtes menées en 2005 relativisent l’idée d’une perception négative de la géographie, mais incitent aussi à chercher des explications plus complexes que la seule disproportion de l’origine disciplinaire. Ainsi, d’après l’enquête menée par Nicole Braxmeyer, sur plus de 3000 collégiens, 23,4% des élèves, souhaiteraient faire davantage d’histoire en cours et 19,2% plus de géographie (Braxmeyer et al., 2007). L’interprétation de ces pourcentages est évidemment ambiguë dans la mesure où le souhait de faire plus de géographie peut signifier ou bien que le professeur consacre trop de temps à l’histoire ou bien qu’ils réussit nettement mieux à donner le goût de la géographie que celui de l’histoire. Le même raisonnement s’appliquerait bien sûr aussi à l’histoire. Toujours est-il que l’écart entre les deux pourcentages paraît moins important qu’on ne pourrait croire.
Quant à la préférence des élèves ressentis par les professeurs, 43,3% des enseignants interrogés perçoivent les élèves comme plus intéressés, attentifs et enthousiastes en histoire, contre 39,9% en géographie. Si ces écarts sont significatifs sur un échantillon de 1113 enseignants, ils ne sont pas aussi importants que ne le laisserait présager la différence de formation initiale des enseignants : en effet près des trois quarts (73,2%) des professeurs d’histoire-géographie de collège ayant participé à cette enquête ont des diplômes universitaires exclusivement en histoire et 17,2 % exclusivement en géographie (Braxmeyer et al., 2007).
Surtout, un autre apport intéressant de cette étude, est le fait que la perception des contenus des deux disciplines et leur évolution de la classe de 6e à celle de 3e reflètent davantage les contenus respectifs des programmes scolaires et ceci aussi bien pour la géographie que pour l’histoire. Or, si la dernière réforme des programmes du lycée a donné lieu à une consultation des enseignants, ceux-ci, en tant que fonctionnaires, appliquent d’abord les programmes nationaux. Les programmes de géographie sont bel et bien élaborés de concert avec des géographes universitaires…
L’apport de notre enquête aux recherches existantes se situe dans l’étude de la perception des lycéens de la seconde à la terminale. Nous avons analysé les réponses de 936 élèves aux questions suivantes :
Aimez-vous l’histoire-géographie ?
Avez-vous une préférence pour l’une ou l’autre matière ?
Quels sont les mots, termes, idées qui vous viennent spontanément à l’esprit quand on évoque a) l’histoire ?
b) la géographie ?
Les fiches concernent des élèves à l’entrée en seconde, première ou terminale dans 4 lycées de l’Académie de Rouen, 2 dans la Seine maritime et deux dans l’Eure.L’enquête a été menée de 2002 à 2012. Sur le plan méthodologique, on pourrait objecter que la première question concernant l’attrait général de la discipline histoire-géographie pourrait conduire à des réponses convenues, dans la mesure où les lycéens pourraient éviter de déclarer à leur nouveau professeur leur désintérêt pour sa discipline. Cela n’a pas empêché un certain nombre d’élèves d’avouer que l’histoire-géographie n’était pas leur tasse de thé. Le même reproche méthodologique ne serait guère à retenir pour la question de la préférence.
Au total, 603 élèves ont exprimé une préférence, plus ou moins nuancée, pour l’une ou l’autre matière. Le résultat est moins rassurant que ne le laisserait penser l’enquête citée plus haut et tend à corroborer l’opinion exprimée par Jean-Robert Pitte: seulement 30% des lycéens se prononçant sur leur préférence déclarent préférer la géographie. Donc 70% favorisent l’histoire.Cela ne veut pas dire que 30% de l’ensemble des élèves éprouvent du plaisir à faire de la géographie au lycée, car ceux qui n’expriment pas de préférence apprécient soit l’histoire-géographie en général, soit ne l’aiment pas. De même, préférer l’une ou l’autre discipline ne veut pas nécessairement dire apprécier le « couple » en général, mais peut signifier que l’une ou l’autre matière soit moins « mal aimée ». Parmi les élèves s’exprimant sur leur préférence, les filles étaient majoritaires (59%). Il y a peu de différence entre filles et garçons quant à leur appréciation de la géographie : 28,9% des filles et 31,5% des garçons disent préférer la géographie.
En revanche, une évolution semble se dessiner au cours du cycle secondaire. Alors que seulement 27,5% des élèves entrant en seconde déclarent aimer davantage la géographie, cette proportion augmente pour les élèves entrant en première : presque 31,9%. Mais il ne s’agit pas des mêmes élèves, les élèves interrogés en seconde n’ayant pas été interrogés une deuxième fois en classe de première. On note un score un peu meilleur pour la géographie dans les classes technologiques – 36,5% préfèrent la géographie. Interrogés aussi sur la motivation du choix de leur filière, ces élèves déclarent majoritairement vouloir poursuivre des études supérieures courtes. C’est aussi dans ce groupe que l’on trouve le plus souvent des justifications pour la faveur donnée à la géographie : elle est considérée comme plus pratique et utile dans la vie quotidienne. Pourtant, les termes les plus fréquemment évoqués par les élèves dans l’ensemble pour définir spontanémentla géographie se réfèrent à l’échelle mondiale, comme « monde », « connaissance de la terre », « compréhension du monde », « découverte du monde » ou « de la Terre ».
Quoi qu’il en soit, il ne semble guère que la différence de la formation initiale des professeurs soit le seul facteur explicatif du désamour relatif pour la géographie. Si l’on s’intéresse par exemple au choix de l’option pour le commentaire scientifique et pédagogique, qui constitue la troisième épreuve écrite de l’agrégation interne d’histoire-géographie, la proportion des candidats optant pour la géographie se situe à plus de 40% avec une évolution de 39% à 44% entre 2007 et 2010 (Dusseau, 2010), des proportions largement supérieures à celle des diplômés de géographie parmi les professeurs d’histoire-géographie. Bien des enseignants semblent donc découvrir le charme de la géographie en l’enseignant.
II-Points de convergence
Les quatre rapports privilégiés des deux disciplines inventoriés par Darby en 1953 (Clout, 2005), en fait revus en 1962 (Baker, 2003), peuvent se révéler en partie fécondsdans l’enseignement secondaire. Considérons par exemple les géographies du passé (pastgeographies) évoquées par le grand géographe anglais.La géographie historique entendue comme reconstitution de géographies du passé n’est pas en soi inscrite aux programmes de géographie du secondaire. Mais les programmes d’histoire offrent de nombreuses possibilités d’enrichir la réflexion par la prise en compte d’aspects spatiaux. Comme on le sait, en France, l’histoire se caractérisait par une forte dimension spatiale. Dans le cadre d’un enseignement d’histoire, la géographie ne serait réduite au rôle de servante qu’en apparence, à savoir quand on considère les contenus transmis et les interprétations proposées. Il n’en est pas de même quand on envisage cette géographie historique comme une sorte de consolidation ou de réactivation de savoir-faire acquis dans les cours de géographie. Car comme le souligne Christian Grataloupcette géographie du passé « définit […] une approche strictement géographique, synchronique, d’une société ; la seule chose qui la distingue d’une autre forme de géographie, c’est qu’elle s’attaque à des espaces révolus, situés dans le passé. » Dans un cours d’histoire, l’enseignant peut donc, avec ses élèves, mobiliser des pratiques apprises en géographie, car « rien ne complique l’approche géographique » (Grataloup, 2005). Reconstituer une géographie du passé dans le cadre d’un cours d’histoire revient à mettre l’histoire au service des objectifs méthodologiques géographiques des programmes.
Si la géographie inscrite dans les programmes du secondaire est bien celle du présent, le recours aux héritages spatiaux (Durand-Dastès, 1984), de l’organisation reçue, comme l’un des trois types de contraintes agissant en géographie, pour expliquer des agencements actuels, n’est pas l’apanage de géographes historiques. Par exemple, l’étude de la répartition de la population mondiale, prévue par les anciens programmes de seconde en vigueur jusqu’en 2010, nécessitait bel et bien une prise en compte de l’histoire du peuplement. Si la question de la population en tant que telle a disparu du nouveau programme de géographie de seconde, il est remarquable que certains aspects de l’histoire du peuplement de la terre aient été intégrés dans le nouveau programme d’histoire de seconde, applicable depuis 2010. La question « Les Européens dans le peuplement de la terre » ne requiert pas seulement un va-et-vient entre plusieurs échelles d’étude, mais pourrait bien correspondre à une géographie vue « comme un récit ». Si cette forme de géographie a bien des limites (Claval, 2006), elle peut bel et bien se prêter à une utilisation didactique. Le recours à la géographie dans les cours d’histoire et vice-versa à l’histoire dans les cours de géographie montre que finalement les deux disciplines sont plus proches qu’on le pense.
III-La distance entre histoire et géographie – une question d’échelle d’observation ?
Bien entendu, on pourrait objecter qu’il y aurait là un risque de brouiller les limites entre les deux disciplines. Les élèves pourraient bien se demander « sommes-nous dans un cours d’histoire ou de géographie ? » Et bien sûr, comme l’écrit François Dosse, le maintien de l’union du couple « histoire-géographie » ne peut se faire que dans le respect des exigences épistémologiques des deux partenaires. Mais en fait, le divorce ou pour reprendre une expression de ce même historien, « l’interdisciplinarité conçue comme un partage des espaces » de l’histoire et de la géographie ou « comme une interdisciplinarité en autarcie » n’est que relatif. Cet historien voit entre autre dans le jeu des échelles, le changement de focale, les nouvelles bases de la discipline scolaire histoire-géographie, leurs enjeux communs, alors qu’il y a une vingtaine d’années, la géographie était considérée comme la seule des sciences sociales « à jouer sur les changements d’échelles » (Scheibling, 1994).
En fait, la formation universitaire en histoire et surtout les programmes de concours de recrutement, depuis des décennies, couvrent, des espaces d’échelle continentale, voire mondiale, et ceci dans toutes les quatre périodes traditionnellement découpées, obligeant à faire un effort de synthèse, d’abstraction et donc prise de hauteur de vue à partir de multiples cas territoriaux et de l’acquisition de connaissances sur des ensembles géographiquement vastes et très différents. Disserter sur « Les révolutions en Europe et aux Amériques de 1773 à 1802 » ou « Les campagnes françaises, allemandes, espagnoles et italiennes des années 1830 aux années 1920 »implique réellement un changement d’échelle. En outre, par la nature même du travail historique, il ne peut guère s’agir d’un simple va-et-vient entre le niveau continental ou supranational et le niveau national. Ce dernier n’est généralement reconstitué que grâce à des monographies régionales ou locales dont l’assise spatiale est dictée par le cadre des travaux de recherches et surtout la nature de la documentation ; l’histoire se reconstituant par traces.
Cette relative familiarité de l’historien avec le jeu des échelles d’observation apparaît particulièrement quand on la compare avec les pratiques d’autres disciplines. Le décentrage national se pratique entre autre dans les sections internationales, binationales et européennes, qui se sont beaucoup généralisées dans l’enseignement secondaire, y compris dans les filières technologiques et en lycée professionnel pour ces dernières. Cet enseignement disciplinaire en langue étrangère incombe majoritairement au professeur d’histoire-géographie.
Les compétences acquises par les enseignants de langue dans les cours de civilisation anglo-saxonne, germanique, hispanique, etc. reflètent certes des connaissances sur les différentes aires de civilisations. Les questions de civilisation mises aux programmes des concours de langue concernent généralement une période dans une aire de civilisation, par exemple « Les deux Allemagnes de 1949 à 1989 ». le changement d’échelle se limite bien souvent et au mieux à un comparatisme binational. Et encore les références à l’espace national français remontent pour le professeur de langue à sa propre scolarité secondaire, à moins que le cursus ne soit complété par des cours de géographie et d’histoire de la France.Même si certaines questions des programmes de civilisation invitent à étudier les rapports de plusieurs nationalités comme c’est le cas de l’actuelle question de l’agrégation d’allemand « L’Empire austro-hongrois : les enjeux de la présence allemande en Europe centrale (1867-1918) », le cadre spatial des questions des concours d’histoire est autrement plus large. Que l’on compare le sujet actuel de l’agrégation d’anglais « La décolonisation britannique (1919-1984) » avec le sujet actuel d’histoire contemporaine de l’agrégation d’histoire « Les sociétés coloniales : Afrique, Antilles, Asie (années 1850 – années 1950) ».
La problématique des transferts culturels, très féconde et développée d’ailleurs par les études civilisationnelles, supposait d’ailleurs l’existence d’ensembles nationaux dans des périodes reculées (Espagne, 1994, 2000), mais impliquait aussi une certaine rigidité scalaire.Le va-et-vient entre le général et le particulier est sans doute nécessaire en histoire et en géographie.
Si notre enquête tend plutôt à confirmer que la géographie est moins appréciée par les élèves que l’histoire, les raisons en sont multiples. Surtout, à y regarder de près et à comparer les pratiques des deux disciplines avec celles d’autres sciences humaines, l’histoire et la géographie semblent être plus proches qu’on le croit. Sans se considérer mutuellement comme servantes l’une de l’autre, le recours plus systématique à leurs apports réciproques potentiels permet sans doute d’embellirla vie de ce couple.Ne serait-il pas un objectif utile de cette nouvelle revue de mettre à disposition d’un large public d’enseignants des analyses susceptibles d’enrichir bien des contenus d’enseignement des programmes du secondaire ?
Bibliographie
Baker A. R.H., 2003, Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge studies in historicalgeography, Cambridge, CUP.
Braxmeyer N., 2007, « Les pratiques d’enseignement, d’histoire, de géographie et d’éducation civique au collège », Éducation & formations n° 76 [décembre 2007] p. 96-106
Braxmeyer N., Guillaume J.-Cl., Régnier C., 2007, « Image de la discipline et pratiques d’enseignement en histoire-géographie et éducation civique au collège », Les dossiers, n° 183 [mars 2007], MEN-DEPP.
Claval P., 2006, Epistémologie de la géographie, Paris, Armand Colin.
Durand-Dastès F., « La question “où ?”et l’outillage géographique », Espace-Temps, n°26-27-28, p. 8-21
Dosse F., « Le couple histoire-géographie en question », Apprendre l’histoire et la géographie à l’école
http://www.espacestemps.net/document396.html
http://eduscol.education.fr/cid46010/une-nouvelle-alliance-entre-histoire-et-geographie.html
Dusseau J., 2010, Rapportdu jury. Agrégation interne et CAERPA. Histoire-géographie. http://www.education.gouv.fr/cid51128/sujets-agregation-externe-2010.html
Espagne M., 2000, Le creuset allemand, histoire interculturelle de la Saxe. XVIIIe- XIXe siècles, Paris, PUF.
Espagne M., 1994, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle »,Genèses, 17, 1994. p. 112-121.
Grataloup C., « Géographie historique et analyse spatiale de l’ignorance à la fertilisation croisée », in Boulanger P., Trochet J.-R., (dir.), 2005, Où en est la géographie historique? Entre économie et culture, l’Harmattan, p. 33-41
Moriniaux C., Moriniaux V., « Géographie, Histoire, Géographie historique, en France et en Allemagne », in Boulanger P., Trochet J.-R., (dir.), 2005, Où en est la géographie historique? Entre économie et culture, l’Harmattan, p. 89 – 97
Pitte J.-R.,2002, « La géographie au service de l’histoire », Hypothèses 2001. Travaux de l’école d’histoire. Publications de la Sorbonne, p. 75-78
Scheibling J.,1994, Qu’est-ce que la géographie ?, Paris, Hachette.
Les villes du passé face à leur environnement | Publié le 2013-06-03 13:59:04 |
Par Eric Fouache, Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne, Vice Chancelier PSUAD, Vice Président de l’IAG, Membre Senior de l’IUF, UMR 8185 ENeC.
Résumé : L’avènement des villes s’est produit au Moyen Orient autour de 3000 av J.-C. L’approche géoarchéologique permet d’étudier les dynamiques environnementales en relation avec l’archéologie et donc de reconstituer les risques urbains anciens. L’enjeu de ces recherches pour une meilleure compréhension des risques actuels, pour l’aménagement, mais aussi pour la mémoire patrimoniale de ces recherches est primordial. Les villes ont de tout temps été sensibles aux cataclysmes et aux risques naturels mais ont aussi fait émerger par leurs aménagements et la coexistence de groupes humains denses des risques spécifiques.
Mots clefs : Ville, Risques, Géoarchéologie, Archéologie, Environnement, Aménagement, Patrimoine.
Abstract : The advent of towns happened in the Middle East towards 3000 BC. The geo-archeological approach allows studying environmental dynamics related to archeology reconstituting ancient urban hazards. The interest of these studies for understanding today’s hazards is obvious. Towns have ever been exposed to cataclysmic events and natural hazards, but have also given rise to special equipment, making possible dense settlement close to natural hazards.
Key words : towns, hazards, geo-archeology, archeology, environment, equipment, legacy.
Si on situe l’aboutissement du processus de néolithisation vers 6000 av JC, tout d’abord au Moyen Orient, la ville apparaît après une longue maturation autour de 3000 avant JC le long de grands fleuves pour la Mésopotamie sur les territoires actuels de l’Irak, de l’Iran et de la Syrie, comme dans la vallées du Nil, du Jourdain, de l’Indus, du Gange et du Fleuve Jaune. La date d’apparition sur les continents africains, méso et sud américain pose encore question mais est plus récente Ce qui la distingue de villages ou de concentrations de petites agglomérations agricoles qui apparaissent au Néolithique c’est la concentration en un même lieu des pouvoirs économiques, politiques, sociaux et religieux, qui se traduisent par une forte concentration relative de populations de non agriculteurs et un cadre monumental souvent entouré d’un mur d’enceinte.
La géoarchéologie est une approche interdisciplinaire que nous définissons comme fondée sur l’utilisation des méthodes et techniques issues des géosciences, de l’archéologie et de la géographie, pour la reconstitution, dans une perspective archéologique multi scalaire et diachronique des paléo-environnements et des dynamiques paysagères, en relation avec l’occupation humaine [Fouache, 2010]. L’approche géoarchéologique permet dans le contexte d’études urbaines d’appréhender l’évolution des dynamiques environnementales au cours du temps et l’évolution parallèle des aléas, des enjeux et donc des risques. Les grands aménagements contemporains comme la réalisation d’un parking souterrains à Lyon (Quai Saint Antoine) ou le creusement de tunnels à Istanbul (quartier de Yenikapi) pour relier en passant sous la corne d’or et le Bosphore le vieux Stamboul à la ville asiatique multiplient dans les centres anciens les fouilles archéologiques de sauvegarde associées à des études environnementales en l’occurrence l’identification du lit de la Saône au premier Âge du Fer [http://lugdunumactu] et la fouille d’un port byzantin des Xe et XIe siècles ap. J.-C. [Degremont, 2009]. Il y a là un enjeu majeur pour réconcilier aménagement, archéologie, histoire, et favoriser la compréhension des dynamiques environnementales par les populations urbaines en intégrant une perspective patrimoniale. Cette préoccupation est mondiale, surtout dans les très grandes métropoles.
Expliquer les risques urbains-du passé peut être aussi une grande source d’enseignement pour prévenir ceux du présent et ancrer les politiques de prévention dans une réelle compréhension de l’interaction entre les dynamiques naturelles et celles engendrées par les sociétés humaines. Il ne faut cependant pas céder à une peur irrationnelle des risques environnementaux. Entre l’Âge du Bronze pour le Moyen Orient, l’Âge du Fer en Europe Occidentale et la fin de l’époque moderne, pour rester dans une approche plus archéologique qu’historique, les exemples de civilisations urbaines qui se sont effondrées uniquement à cause de crises environnementales sont rares.
I- Villes et cataclysmes
Pour les villes du passé le risque majeur est bien sûr, comme aujourd’hui, le cataclysme qu’il s’agisse des effets directs d’une catastrophe naturelle ou des effets induits du fait de la société. Au premier plan de ces cataclysmes il faut placer les éruptions volcaniques, les tremblements de terre et les tsunamis [Fouache, 2006]. Par le passé de nombreuses villes ont été rayées de la carte, Pompéi, Herculanum, Stabie en Campanie lors de l’éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C ., Akrotiri à Santorin entre 1635 et 1628 av J.-C., Héliké emporté dans le golfe de Corinthe en 373 av J.-C. Le séisme de Lisbonne en 1755, suivi de son Tsunami et de la destruction de la ville par l’incendie qui suivit est un bon exemple du rôle amplificateur des conséquences de la catastrophe lié aux aménagements humains. La catastrophe de Fukushima s’inscrit dans cette lignée historique.
Mais qu’une ville soit rayée de la carte est plutôt une exception, car hier comme aujourd’hui la norme c’est que la ville renait de ses cendres au même endroit, pour autant que le système politique et social permette de lever les ressources pour le faire et que la ville réponde à une nécessité dans le système socio-économique, politique et religieux. Ce sont ces impératifs socio-économique, politiques et/ou religieux qui font que la ville se maintient au même endroit que ce soit pour des raisons de site ou pour des raisons de représentation. Mais l’exposition aux risques « dits naturels » d’une ville ne se limite pas aux cataclysmes.
II- Les risques naturels non cataclysmiques
La localisation fréquente des villes en bordure des cours d’eau [Bravard et Magny, 2002] ou au bord de la mer les rend vulnérable aux crues brutales, aux inondations et à l’évolution du trait de côte [Morhange et al., 2007]. Le site premier est souvent à l’abri, de ces aléas, sur un promontoire ou une colline, mais il y a dès la fondation de la cité une ville basse, des faubourgs, un port qui eux sont exposés, puis très vite une croissance urbaine qui s’étend dans des zones à risque car le site initial était trop étroit. La ville de Sommière construite dans le Gard, au pied de la colline qui supporte son château, à même le lit d’inondation de la Vidourle en porte témoignage malgré la forte fréquence des crues cévenoles. L’acceptation sociale du risque, l’adoption de comportements collectifs de gestion de la contrainte peut être un facteur d’acceptation. C’est ainsi que les Egyptiens anciens voyaient à juste titre une invasion nourricière dans les inondations du Nil, et que les Vénitiens ont très tôt appris à vivre avec les phénomènes d’Acqua Alta. En effet le milieu choisi peut lui même être la cause de la richesse de la ville. La ville de Mari [Margueron, 2004] sur le moyen Euphrate en Syrie actuelle est intimement liée au fleuve, à son espace agricole irriguée et à la voie d’eau. Ces avantages légitiment tout au long des IIIe et IIe millénaires des aménagements coûteux que la civilisation sumérienne d’Uruk a les moyens humains et financiers de soutenir. Le mur d’enceinte du palais de Mari apparaît ainsi comme étant autant une digue qu’une fortification. Il en va de même à Babylone sur le Tigre, entre la fin du XVIIe et le XIe siècle av J.-C. les rois babyloniens n’ont cessé de devoir exhausser leurs remparts, sur près de 20 m au total, pour compenser l’alluvionnement intense du fleuve. Au final ce ne sont pas les crues du fleuve qui provoqueront la chute de Babylone mais l’invasion des Mèdes.
Ce que les études des géoarchéologues nous apprennent aussi, couplées aux études des paléoclimatologues, c’est qu’à l’échelle de l’Holocène [Mayewski et al., 2004], les 10 000 dernières années, les dynamiques environnementales ont varié, la répartition saisonnière des types de temps, les températures dans une fourchette de plus ou mois 2 degrés de moyenne annuelle, les précipitations dans des fourchettes irrégulières [Birck et al., 2005] aux conséquences d’autant plus importantes que l’on se trouve dans des milieux de marges de l’œkoumène. En conséquence la morphogenèse et les rythmes hydrologiques des cours d’eau et donc les risques hydro-morphologiques ont évolué [Arnaud-Fassetta, 2000, 2008] entre des périodes d’accalmie, comme l’optimum médiéval, et d’autres de plus forte fréquence d’événements exceptionnels, comme le petit âge de glace.
Dans le même temps les modifications apportées par les sociétés dans la mise en valeur des bassins-versants ont inter-agi avec ces dynamiques naturelles, tantôt en amplifiant les crises environnementales, tantôt en trouvant un équilibre [Diamond 2006]. C’est ainsi que la ville d’Ephèse du fait de l’érosion liée à la mise en valeur agricole de son arrière pays a fini du fait de la progradation du delta du Kuçuk Menderes a fini par perdre sa fonction portuaire [Kraft et al. 2007]. Mais la ville ne fait pas que subir son environnement elle l’affecte elle même.
Carte 1 : Les villes du passé face à leur environnement
III- L’impact de la ville sur son environnement
Dès l’origine l’impact d’une ville sur son environnement est important. La forte concentration d’hommes, Xi’an – dans la province chinoise de Shaanxi –aurait compté plus d’un million d’habitants en l’an 1000 av J.-C par exemple, a toujours favorisé les épidémies [Hays, 2005], l’épidémie qualifiée de peste, en fait plus probablement le typhus, qui toucha Athènes 430 à 427 av J.-C est restée célèbre, les pollutions [Botsos et al., 2003], ainsi qu’une consommation accrue de ressources naturelles et énergétiques. La géoarchéologie est confrontée à ces paléo-pollutions dans l’étude des sédiments intra-sites ou dans celle des archives sédimentaires d’anciens bassins portuaires, de sédiments lacustres ou fluviaux situés à l’aval des villes. C’est ainsi que la concentration de plomb, de scories, de métaux lourds sert de traceur et de marqueur au géoarchéologue tandis que l’étude des squelettes des nécropoles permet de s’intéresser à l’état sanitaire des populations et identifier l’impact de maladies chroniques comme attester d’épidémies.
Les sociétés urbaines du passé dans leurs formes les plus abouties ont pris en compte une partie de ces risques en fonction des connaissances de leur époque. L’alimentation en eau potable des villes, il n’est que de penser aux fontaines, aux citernes urbaines, aux réseaux de qanâts [Briant, 2001] qui au premier millénaire avant J.-C. se généralisent sur le plateau iranien et au-delà ou aux aqueducs du monde romain [Bonnin, 1985], l’élimination des eaux usées et des déchets urbains, l’installation de nécropoles à l’extérieur de la ville, des législations pour essayer de limiter les risques d’incendie, des pratiques de construction parasismiques, la construction de digues et de levées, ou le cantonnement d’activités polluantes comme les tanneries dans des quartiers spécifiques en témoignent. Il faut cependant veiller à ne pas appliquer nos normes de responsabilité aux sociétés urbaines du passé.
IV- De la responsabilité nouvelle des sociétés urbaines contemporaines
Dans le domaine épidémiologique comme dans le domaine environnemental, il y a en effet une différence de taille entre les sociétés urbaines du passé et celles d’aujourd’hui. Notre civilisation avec la connaissance de la théorie de la tectonique des plaques, les énormes progrès des géosciences et de la biologie, est la première à avoir une compréhension scientifique de la genèse des éruptions volcaniques, des séismes, des tsunamis, des mouvements de terrain, comme de la genèse des crises environnementales ou sanitaires du passé et à concevoir de la prospective.
Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et technologiques la prévention des risques naturelles et des risques majeurs devrait être une priorité absolue pour les villes du monde entier appuyée sur cinq piliers : l’étude des aléas, la prise en compte des enjeux, la définition des risques, l’adoption de règles d’urbanisme et la formation des populations aux situations de crise adaptés à chaque contexte urbain. A l’échelle de la planète que se soit à cause du manque de spécialistes, de moyens, de l’absence de volonté politique, de la corruption ou d’intérêts financiers mal compris cette situation est encore une rare exception.
V- Les causes de la disparition d’une ville
Si la ville est construite dans une topographie spécifique, avec des contraintes de sites et des risques liés aux aléas, elle est par essence une production sociale, économique, religieuse et politique. Pour preuve toutes les villes, à toutes les périodes, sont fondées soit par un mythe, soit par un décret. Au Moyen Orient les premières villes reconnues et partiellement explorées sont de toute évidence des villes neuves [Margueron, 2004] qui présentent toutes les caractéristiques du volontarisme. Plus tard, les fondations cachent en fait souvent des refondations et le désir du pouvoir d’imposer durablement sa marque dans l’histoire. De ce point de vue la ville de Kar-Tukulti-Ninurta [Eickhoff, 2005] est emblématique. Située en rive droite du Tigre sur le territoire Irakien d’aujourd’hui elle a ainsi été fondée par le roi Tukulti-Ninurt 1er qui a régné de 1244 à 1208 av J.-C. Cette véritable ville nouvelle de l’époque a été dotée d’un plan d’urbanisme formé de quadrilatères, de canaux, de vergers et de remparts en brique cuite. Son fondateur voulait en faire une nouvelle capitale mais il mourut avant qu’elle ne fut achevée et elle périclita très vite.
Ce que l’archéologie nous apprend, c’est que les villes disparaissent avec les civilisations qui les ont porté pour des raisons souvent beaucoup plus sociales, politiques et religieuses qu’environnementales. On évoque souvent l’aridification du climat [Kuzuçuoglou et Marro, 2007 ; Fouache et al., 2009] qui suit l’optimum holocène pour expliquer les grandes crises culturelles observées en Aie Occidentale, telle que la disparition de l’Empire d’Akkad (Weiss et al., 1993) dans le golfe Arabo-Persique ou l’Abandon des villes harrapéennes dans la vallée de l’Indus. Il s’agirait soit de fluctuations d’échelle millénaire ou centenales, soit d’évènements abrupts ou encore d’une évolution progressive du climat vers l’asséchement en relation avec l’affaiblissement de la mousson indienne [Lézine et al. 2007]. L’analyse pollinique et des spéléothèmes démontre dans la région la réalité d’un affaiblissement de la mousson indienne entre 4700 et 4200 BP [Ivory et Lézine] mais le lien effectif avec l’effondrement des civilisations de la fin du Bronze n’est une certitude.
Lorsque l’on discute de la question de l’effondrement des civilisations de l’Âge du Bronze au Proche et au Moyen-Orient on doit donc faire attention de distinguer entre les grands ensembles urbains, centre des pouvoirs économiques, politiques et culturels, très dépendant de flux extérieurs, qui sont effectivement très vite abandonnés à la fin du troisième millénaire et les petits sites urbains et ruraux comme ceux de la région de Sabzevar [Fouache et al., 2010] en Iran par exemple qui connaissent une pérennité de l’occupation. Il faut également prendre en compte la durée de l’aridification, qui n’est pas du tout un phénomène brutal, mais une lente évolution sur 600 ans. Attribuer au seul facteur climatique la cause de ces effondrements des civilisations du Bronze apparaît en état des connaissances archéologiques comme une simplification abusive.
Si on se déplace sur l’Asie centrale dans le contexte de l’Asie centrale protohistorique, les recherches archéo-environnementales récentes [Cattani 2005, Francfort 2005, Francfort 2009, Francfort et Tramblay 2010, Luneau 2010] tendraient à montrer que l’apogée de la civilication de l’Oxus se constitue sur la fin de cette phase d’aridification, attestée par les études environnementales (Cremaschi, 1998), notamment l’avancée des dunes du Kara-Kum et en parallèle celle des populations des steppes vers le sud [Cattani, 2005], tandis que son effondrement se produirait au moment où une nouvelle phase humide se met en place.
Profiter des fouilles archéologiques de sauvegarde dans les villes pour, au sein d’un tissu urbain dense, réaliser des études géoarchéologiques sur les dynamiques environnementales du passé est une chance. Cela permet de mieux comprendre les contraintes de site initial, et de reconstituer l’histoire de l’évolution dynamique des contraintes environnementales, lesquelles ont inter-agi avec les dynamiques engendrées par les aménagement des sociétés.
Ces reconstitutions permettent de mieux comprendre le caractère pérenne ou aléatoire des risques, d’en préciser le temps de retour et de mener une politique de prévention plus efficace. Cette histoire environnementale peut aussi constituer un enjeu patrimonial qui peut être donné à voir à la société, et être utilisé à des fins pédagogique pour expliquer la nature des aléas, l’évolution des enjeux et des risques, en situant la situation actuelle dans une double histoire celle de l’environnement et des sociétés. Il ne faut pas cependant se focaliser uniquement sur le risque environnemental pour nos villes.
Si la prévention des risques majeurs, la diminution des rejets polluants et la gestion des déchets, l’optimisation de la gestion des ressource en eau, la maîtrise de la croissance des mégalopoles sont des enjeux majeurs, le plus grand danger pour la pérennité de nos villes, du fait des masses humaines qui y vivent et y sont de plus en plus concentrées, est en réalité, aujourd’hui comme hier social et politique.
Remerciements :
Je suis tout particulièrement redevable, dans la préparation de cet article, à Annie Caubet, Conservateur général honoraire du musée du Louvre, de ses remarques et propositions sur les villes du Moyen Orient.
Bibliographie
Arnaud-Fassetta G, « 2000 – 4000 ans d’histoire hydrologique dans le delta du Rhône. De l’Âge du bronze au siècle du nucléaire », Grafigéo, 11, collection mémoires et documents de l’UMR PRODIG, Paris, 229 p.
Arnaud-Fassetta G, 2008, « La Géoarchéologie Fluviale. Concepts, attendus et méthodes d’étude rétrospective appliquées à la caractérisation du risque hydrologique en domaine méditerranéen », Écho-Géo, 4, 2-11.
Borsos E., Makra L., Beczi R., Vitanyi B., Szentpéteri M., 2003, « Anthropohenic air pollution in the ancient times », Acta Climatologica et Chrorologica, Tom. 36-37, 5-15.
Bravard J.-P., Magny M., 2002, Les fleuves ont une histoire. Paléo-environnements des rivières et deslacs français depuis 15 000 ans, 312p.
Birck J., Battarbee R., Macay A., Oldfiel F., 2005, Global Change in the Holocene. Holder Arnold. 480 p.
Bonnin J., 1985 – L’eau dans l’Antiquité, Eyrolles, 488 p.
Briant P (Ed.), 2001, « Irrigations et drainages dans l’Antiquité, Qanats et canalisations souterraines en Iran, en Egypte et en Grèce », Persika 2, Paris, 190p.
Cattani, M., 2005, « Margiana at the end of Bronze Age and beginning of Iron Age », in Uistokov civilizacii. Sbornik statej k 75-letiju Viktora Ivanovicha Sarianidi, M. F. Kosarev, P. M. Kozhin, et N. A. Dubova (Dir.), Moscou, Kollektiv avtorov, p. 303-315.
Cremaschi, M., 1998, « Palaeohydrography and Middle Holocene Desertification in the Northern Fringe of the Murghab Delta », in The Archaeological Map of the Murghab Delta, Preliminary Reports 1990-95, (Reports and Memoirs, vol. Series Minor Volume III), A. Gubaev, G. A. Koshelenko, et M. Tosi (Dir.), Rome, Instituto Italiano per l'Africa e l'Oriente. Centro Scavi e Ricerche Archeologiche, p. 15-25.
Degremont C., 2009, « Istanbul : le port byzantin de Yenikapi », Archeologia, n° 469, 16-25.
Fouache E., 2006, 10 000 d’évolution des paysages en Adriatique et en Méditerranée Orientale, Travaux de la Maison de l’Orient Méditerranéen (TOM), Volume 45. Lyon; Paris, diff. De Boccard. 225p.
Eickhoff T., 1985, Kār-Tukulti-Ninurta, Eine mittelassyrische Kult- und Rezidenzstadt, ADOG 21, Berlin.
Fouache E., Lezine AM., Adle S., Buchsenschutz O., 2009, « Le passé des villes pour comprendre leur futur. In Villes et géologie urbaine », Géosciences, 10. 54-61.
Fouache E., 2010, « L’approche Géoarchéologique », in Regards croisés sur l’étude archéologique des paysages anciens. Nouvelles recherches dans le Bassin méditerranéen, en Asie Centrale et au Proche et au Moyen-Orient, H. Alarashi, M.-L. Chambrade, S. Gondet, A. Jouvenel, C. Sauvage et H. Tronchère (Èds), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 2010, 256 p. : nombreuses ill. ; 30 cm.- (Travaux de la Maison de l’Orient ; 56). 17-30.
Fouache E., Cosandey C., Francfort HP., Bendezu-Sarmiento J., Vahdati AA., Lhuillier J., 2010, « The Horst of Sabzevar and regional water ressources from the Bronze Age to the present day (Northeastern Iran) », Geodinamica Acta, 23/5-6, 287-294.
Francfort, H.-P., 2005, « La civilisation de l'Oxus et les Indo-Iraniens et Indo-Aryens », in Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale, (Collège de France. Publications de l'Institut de Civilisation Indienne, vol. 72), G. Fussman, J. Kellens, H.-P. Francfort, et X. Tremblay (Dir.), Paris, Diffusion de Boccard, p. 253-328.
Francfort, H.-P, 2009, « L’âge du bronze en Asie centrale. La civilisation de l’Oxus », Anthropology of the Middle East, 4 (1), p. 91-111.
Francfort, H.-P., et Tremblay, X., 2010, « Marhai et la Civilisation de L’Oxus », Iranica Antiqua, XLV, p. 51-224.
Hays J.N., 2005, Epidemics and pandemics : their impacts on human history, 513p.
Ivory S.I., Lezine A.-M., Climate and environmental change at the end of the Holocene Humid Period : a pollen record off Pakistan, CR Geoscience.
Kuzuçuoglou C., Marro C., 2007 (Eds.), « Sociétés humaines et changements climatiques à la fin du troisième millénaire : une crise a t’elle eu lieu en Haute Mésopotamie ? » Actes du colloque de Lyon, 5-8 décembre 2005. Varia Anadolica 19, 590p.
Luneau E., 2010, L'Age du Bronze Final en Asie Centrale Méridionale (1750=1500//1450 avant n.e.) : la fin de la civilisation de l'Oxus, Thèse nouveau régime. Université de Paris 1. 612p
Kraft J.C., Brückner H., Kayan I., Engelmann H., 2007, « The geographies of Ancient Ephesus and the Artemision in Anatolia », Geoarchaeology, 22, N°1, 121-149.
Lézine A.-M., Tiercelin J.-J., Robert C., Saliège J.-F., Cleuziou S., Inizan M.L., Braemer F., 2007 – Centenial to millennial-scale variability of the indian monsoon during the early Holocene from sediment, pollen , and isotope record from the desert of Yemen. Palaeogeogr.Palaeoclimatol.Palaeoecol, 243, 235-249.
Margueron J.-C., 2004, Mari : métropole de l’Euphrate au IIe et au début du IIe millénaire av J.-C., ERC.
Mayewski P., Rohling E., Stager J., Karlen W., Maasch K., Meeker L., Meyerson E., Gasse F., Van Kreveld S., Holmgren K., Lee-Thorp J., Rosqvist G., Rack F., Staubwasser M., Schneider R., Steig E., 2004, « Holocene climate variability », Quaternary Research 62, 243-255.
Morhange C., Marriner N., Sabatier F., Vella C., 2007, Risques littoraux en Méditerranée. Méditerranée, 108, 149p.
Veyret Y., 2009, « Du risque à la gestion des villes : la ville durable », in Villes et géologie urbaine, Géosciences, 10. 94-101.
Weiss H., Courty M.A., Wetterstrom F., Guichard F., Senior L., Meadow R., Curnow A., 1993 -), « The Genesis and Collapse of the Third Millenium North Mesopotamia Civilization », Science 261, 995-1004.
Site internet :
http://lugdunumactu.wordpress.com/2010:12/11/fouilles-archéologiques-du-quai-st-antoine-lyon/
La géographie historique, une courte histoire | Publié le 2013-06-03 13:58:18 |
Par Paul Claval, Université de Paris-Sorbonne
Résumé : Longtemps au service des cartographes, les géographes tirent parti des récits de voyage pour préciser la longitude des lieux. Lorsque la cartographie scientifique les prive de cette tâche, ils mobilisent leurs savoir-faire pour reconstituer les cadres où s’est déroulée l’histoire. Le géographe moderne est un homme de terrain, mais qui n’a pas oublié sa formation historienne : les structures qu’il découvre dans le paysage ont une longue histoire, qui s’inscrit dans des temporalités spécifiques. La géographie vidalienne invite ainsi les historiens à s’interroger sur la longue durée. La géohistoire de Braudel explore le jeu croisé des temporalités environnementales, économiques et politiques. Dans les pays de langue anglaise, la géographie historique se coule dans les cadres temporels proposés par l’histoire en faisant alterner les tableaux datés et l’analyse des évolutions. Le tournant culturel met l’accent sur le jeu des représentations et des imaginaires que partagent les acteurs de l’histoire.
Mots-clefs : cartographie, histoire, géohistoire, longue durée, temporalités, tableaux datés, séquences évolutives, représentations, imaginaires.
Abstract: For a long time, geographers relied on their analysis of exploration and travel narratives for measuring the longitude of places. When scientific cartography deprived them from this task, they used their familiarity with historical documents in order to provide historians with a view of the past geographical environments in which history unfolded. Modern geographers essentially rely on fieldwork, but have not forgotten their competence in history: the structures they discover in the landscapes have a long history, which falls within specific temporalities. In this way, the Vidalian geography invites historians to analyse long duration. Braudel’s geohistory explores the interplay of environmental, economic and political temporalities. In English-speaking countries, historical geography slipped into the temporal divisions proposed by history through the alternation of dated pictures and evolutionary sequences. The cultural turn stresses the role of the representations and geographical imagination shared by historical actors.
Keywords: cartography, history, geohistory, long duration, temporalities, static pictures, evolutionary sequences, representations, geographical imagination.
La géographie historique ? Son principe semble simple : décrire et analyser une région, un pays ou le monde à un moment passé de son évolution comme nous le ferions pour un espace contemporain. La réalité est plus complexe : il ne s’agit pas seulement de dresser le tableau d’un morceau de l’écorce terrestre à un moment précis du passé, mais de saisir les évolutions qui le caractérisent, et la (ou les) temporalité(s) qui y sont à l’œuvre. La place et le rôle de la géographie historique dans la géographie en général, et dans la géographie humaine plus particulièrement, n’ont cessé de changer. Nous voudrions évoquer leur évolution et souligner la signification de celle-ci.
I-La dimension historique des travaux de la géographie traditionnelle
A.Jusqu’au XVIIIe siècle : l’enquête historique comme base de la cartographie
Le Père de Dainville (1963) le soulignait justement : de la Renaissance au XVIIIe siècle, le géographe pratiquait un métier qui ne ressemblait guère à celui qui est aujourd’hui le sien. Il contribuait à la fabrication des cartes en recueillant une partie de l’information indispensable à la localisation des lieux à la surface de la terre : son but n’était pas de décrire ce qui caractérisait tel ou tel point, mais de le situer. Depuis l’Antiquité, les méthodes astronomiques permettaient, en principe, de déterminer les coordonnées d’un point. Faute de disposer de chronomètres pour conserver le temps, on ne possédait cependant pas de moyen de mesurer les longitudes. Depuis Galilée, on pouvait, il est vrai, le faire à partir de l’observation des satellites de Jupiter, mais la construction des tables indispensables pour interpréter les résultats était lente, et les calculs à effectuer réservaient l’opération à des astronomes avertis. L’évaluation les longitudes reposait dans la plupart des cas sur la compilation des distances terrestres mentionnées dans les récits des voyageurs, et sur celle des parcours maritimes consignés dans les journaux de bord des bateaux. Le géographe était un homme de cabinet ; il dépouillait les relations de voyage des explorateurs et les indications enregistrées par les navigateurs ; il les recoupait avec les informations déjà mobilisées dans les cartes anciennes. Le géographe s’attachait ainsi à une forme très particulière de géographie historique.
B.La mutation cartographique du XVIIIe siècle et la reconversion vers la géographie historique
Comme Anne Godlewska (1999) l’a montré, l’invention du chronomètre par John Harrison, ainsi que le progrès des méthodes astronomiques de mesure des longitudes, bouleversent la situation dans le courant du XVIIIe siècle. L’information nécessaire au dessin des cartes n’a plus à être cherchée dans des documents d’archives. Les ingénieurs-géographes et topographes la tirent directement des mesures qu’ils effectuent sur le terrain. Dans un premier temps, leur formation demeure double, mathématique et historique (Godlewska, 1999). Très vite, elle n’intègre plus que la géométrie, la géodésie et l’astronomie. Les géographes ont perdu leur métier. Ils doivent en inventer un autre. Leur reconversion s’appuie sur ce qu’ils savent déjà faire : analyser des documents anciens, qu’il s’agisse de récits de voyages ou de journaux de bord. Ce qui change, c’est la finalité de leur travail : le but n’est plus d’en extraire les informations utiles pour bâtir l’image de la terre aujourd’hui ; leur ambition est de préciser ce qu’était la topographie, la disposition des villes ou le tracé des routes à tel ou tel moment du passé.
Le géographe pratique une géographie historique modeste, mais indispensable à l’historien : il lui indique comment se présentait la scène où se sont déroulés les grands évènements du passé ; il explique ce qu’était le delta du Nil au temps des Pharaons, l’avancée des rivages en Mésopotamie à l’époque de Sumer, ou la topographie des lieux où Hannibal écrasa les légions romaines à Cannes. La géographie est une servante de l’histoire. Ceux qui la pratiquent demeurent des hommes de cabinet. Ils s’illustrent dans la reconstitution de la géographie de l’Egypte ancienne, ou dans le suivi de la transformation des Etats et des circonscriptions administratives de l’Antiquité, du Moyen Age ou de l’Europe moderne. Auguste Longnon (1878), un des meilleurs spécialistes de ce courant, précise, par exemple, ce qu’étaient les diocèses et les pagi de la Gaule au VIe siècle.
C.La nouvelle géographie de terrain ne rompt pas avec l’histoire
C’est contre cette conception de la géographie, que personnifie alors Auguste Himly, que la géographie moderne s’affirme dans le dernier quart du XIXe siècle, autour de Vidal de la Blache. L’importance de la mutation se lit à un fait : le géographe a cessé d’être un homme de cabinet. C’est de la pratique du terrain qu’il tire désormais ses savoirs et sa légitimité. La mutation est importante. On aurait cependant tort de la croire totale : le géographe garde, en France, une formation historique. Vidal de la Blache consacre une vingtaine d’années à doter les géographes français d’un instrument qui leur manque : un grand atlas moderne. Pour réaliser celui qu’il publie en 1894, il interprète des récits de voyages, analyse des documents diplomatiques, dépouille des recueils ou des cartes de limites administratives - toutes démarches que les géographes maîtrisent et mobilisent depuis longtemps. Lorsqu’un différend éclate entre le Brésil et la France sur le tracé des frontières de la Guyane, c’est sur cette partie de son métier que Vidal appuie l’expertise qu’il prépare pour le gouvernement français, comme le souligne La Rivière Vincent Pinzon (1902), où il présente son analyse.
Les premiers Vidaliens sont formés à la géographie historique traditionnelle avant de découvrir le terrain et l’analyse régionale : Lucien Gallois consacre sa thèse aux géographes allemands de la Renaissance (1890), et ne s’intéresse que plus tard à la mosaïque des pays qui entourent Lyon (1891-1892 ; 1894-1895). Son ouvrage le plus connu, Régions naturelles et noms de pays (1908), mobilise à nouveau les savoir-faire de la géographie historique traditionnelle. La partie de leur métier qu’ils doivent à l’histoire continue à être utile à la nouvelle génération des géographes de terrain. Ils l’emploient, en particulier, pour retracer l’histoire des divisions régionales sur lesquelles ils travaillent. Ce n’est pas là un aspect mineur de la discipline : la thèse secondaire d’Albert Demangeon (1905 ; 1907) porte sur Sources de la géographie aux Archives nationales. La dimension historique du métier de géographe ne s’est donc pas perdue, mais c’est à l’appréhension d’autres objets qu’elle sert désormais.
II-Les structures géographiques comme nouvel objet de la géographie historique, ou l’invention de la longue durée
A.La découverte de nouveaux objets géographiques
Le géographe de cabinet ne s’attachait pas à la physionomie des pays, à leurs paysages. S’il parlait de leurs habitants, c’était pour en évaluer le nombre, et non pour décrire leurs coutumes ou leur existence quotidienne. Le géographe de terrain décrit ce qu’il voit. Il parle du relief, des forêts, des bois, des pâtures, des prés, des champs, des jardins, des fermes, des villages, des bourgs et des villes. Il saisit les hommes au travail et met en évidence les résultats de leur activité. La géographie humaine qui est en train de se constituer cherche à comprendre la distribution des hommes, de leurs actions et de leurs œuvres à la surface de la terre. Elle s’appuie sur les cartes de densité, qui posent le problème des rapports des groupes à l’environnement. Elle s’attache à la circulation, qui affranchit les groupes des contraintes locales. Cette quête se fonde sur l’analyse les paysages, où se lisent à la fois le jeu des forces naturelles et le travail des générations passées et présentes ; il repose sur la description des genres de vie (Vidal de la Blache, 1886 ; 1911), qui font comprendre comment l’environnement est exploité et comment les liens sociaux se tissent.
Paysages et genres de vie sont observés aujourd’hui, mais les géographes découvrent leur étonnante stabilité au cours des temps. Ceux qui analysent les travaux et les jours des paysans provençaux de la fin du XIXe siècle se croient transportés au temps d’Hésiode : les labours se font toujours à l’araire ; les cultivateurs se consacrent à la même trilogie de plantes méditerranéennes, le blé, la vigne et l’olivier (Sur ce point, l’interprétation de Vidal est en défaut : la culture de l’olivier ne s’est, semble-t-il, développée qu’après Hésiode. Vidal, de la Blache, 1922, p. 81); les paysages qui en résultent sont semblables à ceux que décrivaient déjà les agronomes latins ; ils juxtaposent l’ager (l’espace cultivé), le saltus (les terrains de parcours où les troupeaux pâturent les clairières ouvertes dans des forêts dégradées qui servent à produire bois de chauffage et charbon de bois), et la silva (la forêt originaire, aux arbres puissants et à la faune redoutable). Dans la France de la fin du XIXe siècle, les bocages s’opposent aux campagnes :
« Mais, à défaut d’un changement de relief, l’aspect du sol ne laisse aucun doute. On vient de quitter les plaines agricoles et découvertes, les campagnes : voici qu’on s’engage dans des pays accidentés coupés de haies d’arbres, dans des bocages. C’est le nom pittoresque et juste qui est caractéristique de l’Ouest » (Vidal de la Blache, 1888/1897, p. 155 de la réédition Sanguin, 1993) (les italiques sont de nous).
La géographie de terrain telle qu’elle est pratiquée aux alentours de 1900 met en évidence des structures dont la permanence est frappante : (i) des systèmes agraires, qui donnent aux paysages ruraux leurs traits les plus remarquables ; (ii) des ensembles d’activités si intimement liées qu’ils n’évoluent guère - les genres de vie -, si bien que ceux que pratiquent les agriculteurs et les pasteurs du début du XXe siècle ressemblent à ceux de l’Antiquité ; (iii) des groupements régionaux, car les divisions qui structurent l’espace du temps présent sont parfois en place depuis des siècles, depuis Rome par exemple, comme le soulignait déjà Giraud-Soulavie (1783).
B.Une géographie historique des structures
La prise en compte des nouveaux objets que constituent les genres de vie, les paysages ou les divisions territoriales oblige les géographes des alentours de 1900 à ne pas se contenter du terrain. De quand datent ces traits, qui ont si longtemps échappé à l’emprise du temps ? Sont-ils immuables ? Certains concluent à la hâte, de leur origine lointaine, à leur permanence sur des temps très longs (Roupnel, 1934) : le bocage et les campagnes ne seraient-ils pas la signature des groupes ethniques qui ont les premiers pris possession du pays ? La démarche est généralement plus prudente. Elle est rétrospective : ici, le bocage domine ; le faisait-il il y a cinquante ans, cent ans, deux cents ? Comme les documents manquent généralement au-deçà d’une certaine date, on laisse le problème en suspens. Le bocage de pierre de la région de Gramat, dans le Lot ? Blaise de Montluc (1592/1964) le signale dans ses mémoires : il n’engage pas le combat avec l’armée protestante qu’il poursuit, car les murets l’empêcheraient de faire donner sa cavalerie… Les enclos de ce secteur ont quatre siècles et demi au moins. On ne peut en dire plus, mais on aimerait remonter plus haut, jusqu’au moment où les parcellaires et les clôtures se sont mis en place : on comprendrait alors les processus qui leur ont donné naissance et ont assuré, au moins au départ, leur stabilité.
L’approche historique que pratique la géographie humaine présente ainsi des caractères profondément originaux. Elle ne traite pas de la même temporalité que l’histoire : elle s’intéresse à celle des objets singuliers qu’elle vient de découvrir. Le découpage en siècles, en générations, en règnes, en ères ne lui apporte rien. Découvrant l’objet qu’elle cherche à expliquer dans le présent, elle l’analyse dans une perspective rétrospective : elle remonte le temps jusqu’au moment où la structure a pris corps. Les élèves de Vidal reconstituent ainsi l’évolution de la société et des paysages de la région sur laquelle porte leur thèse : Jules Sion (1908) retrace l’histoire du plateau de Caux jusqu’à l’époque où apparaissent les ateliers à domicile qui font de cette région une grande productrice de textiles ; dans les vallées, la narration commence plus tard, au moment où la force de l’eau est mobilisée pour mouvoir les métiers, ce qui concentre l’industrie le long des petites rivières.
Au moment de rédiger leur thèse, la plupart des jeunes géographes présentent les évolutions de manière chronologique, mais leur enquête a progressé à l’inverse. Plus original, Pierre Deffontaines met en scène la démarche qu’il a réellement suivie : dans Les Hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne Garonne (1932) et selon les chapitres, il remonte plus ou moins loin dans le passé : jusqu’au moment où se sont mis en place les traits qu’il observe aujourd’hui. La géographie humaine française d’inspiration vidalienne fait ainsi une large place à la démarche historique. Elle ne présente pas, en revanche, de tableaux des espaces qu’elle analyse saisis à tel ou tel moment du passé : les temporalités qu’elle met en évidence sont celles des objets géographiques que le présent révèle, mais qui existent depuis déjà plus ou moins longtemps.
La géographie historique française excelle à évoquer l’évolution des structures agraires (Bloch, 1931 ; Dion, 1934), de la culture de la vigne (Dion, 1959), des siècles obscurs du Maghreb (Gautier, 1927) ou du paysage français (Pitte, 1984). Elle ne présente pas de portrait daté d’un pays. Le Tableau de la géographie de la France (Vidal de la Blache, 1903) dessine les traits traditionnels du pays (le volume sert d’introduction à l’Histoire de France des origines à la Révolution, que dirige Ernest Lavisse), mais sans préciser à quel moment ils ont pris naissance. Certains auteurs poussent cette logique à l’extrême. C’est le cas de Xavier de Planhol. Sa Géographie historique de la France (1988) aurait pu se structurer autour d’un certain nombre de vues fixes et datées. Ce n’est pas le parti qu’il retient. L’ouvrage ne distingue que deux temps : celui, très long et qui prend généralement fin au XIXe siècle, où la différenciation des paysages ne cesse de s’accentuer ; celui, relativement bref, où la tendance est à l’uniformisation. C’est la période de différenciation qui paraît la plus riche à Xavier de Planhol : il me demande de traiter de la seconde phase, qui l’intéresse moins.
C.Autour des paysages agraires : la géographie rénove l’histoire
Les géographes français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe inventent une autre façon de concevoir la recherche historique. Ils ne partent pas des archives et de l’écrit. Les paysages et les genres de vie ont longtemps échappé à l’attention des élites qui encadraient les sociétés. Les savoir-faire, les tours de main, les connaissances empiriques que mobilisaient agriculteurs, pasteurs, forestiers, mineurs, artisans n’étaient consignés nulle part : ils faisaient partie de la sphère de l’oralité et de ce qui se transmet par le geste et l’imitation. Les historiens ignoraient ces domaines. Ils s’appuyaient sur les traces écrites des civilisations passées. Celles-ci traitaient de l’action des princes et des grands capitaines. Elles passaient sous silence les masses populaires.
Une réaction s’était dessinée au milieu du XIXe siècle : des travaux d’histoire sociale et d’histoire économique étaient apparus, mais ils reposaient essentiellement sur l’exploitation de témoignages écrits : rapports de police sur les grèves et les mouvements sociaux, mercuriales de prix, relevés salariaux, actes notariés enregistrant les contrats de travail. Dans le monde rural, ces documents étaient souvent rares : on ne connaissait souvent que la condition juridique des terres et de ceux qui les travaillaient. Les efforts faits pour saisir en totalité les mondes passés étaient limités par le privilège donné à l’écrit. L’archéologie, qu’elle soit historique ou préhistorique, ouvrait d’autres perspectives, puisqu’elle appréhendait les sociétés d’hier à travers leurs outils, les restes de leurs artefacts et les ruines de leur habitat. Mais le matériel analysé provenait souvent de tombes, si bien qu’il résultait de choix dont la logique n’était pas facile à percer. Dès que l’archéologue tombait sur une inscription, c’est à elle qu’allaient ses efforts, car il retrouvait le terrain familier de l’histoire.
Les perspectives qu’ouvrent les géographes sont différentes : ils traitent de l’activité même des classes laborieuses et l’appréhendent à travers leurs genres de vie et les marques que ceux-ci ont imprimées dans les paysages et dans l’habitat. Les étudiants en histoire bénéficient, à l’époque, de la même formation que les géographes : ils ne s’y trompent pas. Ils se passionnent pour ces nouveaux objets sur lesquels Vidal de la Blache et les Vidaliens attirent l’attention. Lucien Febvre comprend parfaitement ce que l’on peut tirer de l’analyse des divisions régionales :
« La Franche-Comté n'est pas une région naturelle […]. Il n'y a pas de région naturelle pour servir de cadre, de lit à cette province. C'est l'homme qui l'a bâtie, à partir d'éléments très divers détachés par lui de grands ensembles géographiques : les Vosges, la plaine de la Saône et le Jura, auxquels ils appartenaient naturellement » (Febvre, 1905, p. 75-76).
Febvre n’attend pas de la géographie qu’elle lui offre un cadre tout tracé où développer l’analyse historique. Elle l’invite à explorer une histoire généralement négligée, celle de la construction des cadres territoriaux :
« Ainsi une région, une contrée, un pays n'est pas un ensemble de ressources, de productions mortes. C'est un réservoir d'énergie, de forces vivantes, qui, en accord avec un mouvement perpétuel, pratiquent le secours mutuel, résistent et se substituent l'une à l'autre et s'adaptent aux nouvelles conditions perpétuellement engendrées par le mouvement du temps lui-même » (ibid., p. 16).
Cette histoire ne s’inscrit pas dans les cadres chronologiques généralement acceptés. Les évolutions qu’elle appréhende sont lentes, même si elles comportent aussi des coupures, des révolutions. L’Ecole des Annales doit une bonne partie de son originalité à ce que Marc Bloch et Lucien Febvre tirent de la géographie : un élargissement des perspectives qui conduit l’historien à mettre en œuvre des démarches imaginées par les géographes – ou par les spécialistes des autres sciences sociales. La Société féodale souligne admirablement ce que Marc Bloch (1935) a appris de la géographie de son temps (Claval, 2012) : avant d’aborder les dimensions sociales de la vie féodale (les liens du sang, la vassalité et le fief, puis les classes et le gouvernement des hommes), il s’attache aux conditions matérielles qui prévalaient à l’époque. Il analyse pour cela les rapports des groupes à leur environnement : c’est de cela que traitent Les Caractères originaux de l’histoire rurale française (Bloch, 1931).
L’essentiel, en ces temps, est de produire les blés indispensables à l’alimentation des hommes : cela implique la mise au point de rotations qui évitent l’épuisement des terres et assurent l’alimentation du bétail dont on attend travail et fumures. L’outillage, araire ou charrue, constitue une autre variable. Plusieurs solutions sont possibles.
« D’abord un type de sol pauvre et d’occupation lâche, longtemps tout à fait intermittent et qui toujours – jusqu’au XIXe siècle – demeura telle, pour une large part : régime des enclos. Viennent ensuite deux types d’occupation plus serrée, comportant tout deux, en principe, une emprise collective sur les labours, seul moyen, vu l’extension des cultures, d’assurer entre les moissons et le pacage l’équilibre nécessaire à la vie de tous – tous deux, par conséquent, sans clôtures. L’un, que l’on peut dire ‘septentrional’, a inventé la charrue et se caractérise par une cohésion particulièrement forte des communautés ; son signe visible est l’allongement des champs et leur groupement en séries parallèles. Probablement, ce fut des mêmes milieux que partit l’assolement triennal […]. Le second des deux types ouverts, […] qu’il est permis pour simplifier […] d’appeler ‘méridional’, unit la fidélité au vieil araire et […] à l’assolement biennal, avec, dans l’occupation et la vie agraire elle-même, une dose sensiblement moins forte d’esprit communautaire » (Bloch, 1931, p. 64-65).
A la suite de Marc Bloch et durant une génération, la géographie historique française se consacre pour l’essentiel à l’histoire des paysages agraires – les historiens prenant plus tard le relais des géographes en ce domaine.
D.Structures géographiques, longue durée en géohistoire
Il faut cependant attendre la génération de Fernand Braudel, pour que la logique profonde de la géographie historique d’inspiration vidalienne soit totalement dégagée. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (1949) met en scène trois temporalités : (i) celle du cadre géographique et des modes de production et de circulation que les hommes mobilisent pour vivre ; (ii) celle de l’économie, de ses oscillations et de ses crises, et (iii) celle de l’histoire au sens classique : dynamique des Etats, action des politiques et des militaires, luttes, guerres, révolutions. Ces trois temporalités interfèrent évidemment : pour comprendre l’histoire, il convient de les analyser toutes trois.
Fernand Braudel résume la leçon de La Méditerranée et le monde méditerranéen… dans l’article qu’il consacre, dans Annales. Economies, Sociétés, Civilisation à la longue durée (Braudel, 1958) : c’est bien cela que la géographie vidalienne a apporté à l’histoire. Ce qu’elle a invité à écrire, ce n’est pas de la géographie historique, au sens habituel du mot, c’est de la géohistoire : un exercice qui a pour but de mener parallèlement l’analyse de toutes les temporalités à l’œuvre dans le milieu naturel et dans la vie sociale : celles qui sont liées à l’environnement ; celles qui reflètent l’inventivité technique des hommes ; celles qui résultent des formes de sociabilité qu’ils savent nouer et des institutions qu’ils créent ; celles qui retracent l’action des sphères dirigeantes.
Ecrire la géohistoire des sociétés et des constructions politiques est difficile. Le seul à s’être résolument lancé dans ce genre est Braudel lui-même. Il en conçoit très tôt le programme, comme en atteste un de ses cahiers de captivité (Braudel 1997). Il s’y applique trois fois, pour la Méditerranée d’abord (1949), à propos de la montée du capitalisme ensuite (1967-1979), autour de l’Identité de la France (1986) enfin. Les résultats sont inégaux – l’Identité de la France déçoit, mais peut-être seulement parce que l’ouvrage est resté inachevé.
III-De Eduard Hahn à Sauer : la genèse d’une géohistoire environnementale
C’est en France qu’est née la géohistoire. Elle y prend une forme essentiellement sociale et économique. C’est aux Etats-Unis, mais en s’inspirant de recherches allemandes, que se construit la géohistoire environnementale.
A.Les racines allemandes : Eduard Hahn et Otto Schlüter
Au départ, il y a Eduard Hahn. De formation naturaliste, il s’intéresse aux plantes et aux animaux sur lesquels repose l’existence des agriculteurs et des pasteurs (Hahn, 1892 ; 1896a ; 1914). C’est donc vers la préhistoire qu’il se tourne – vers la néolithisation plus précisément. Dans certaines régions du globe, le passage à l’agriculture et à l’élevage a été simultané. Dans d’autres, la domestication des plantes n’est en rien liée à celle des animaux. C’est dans les steppes du Croissant fertile que la culture des céréales apparaît d’abord. C’est là aussi que l’on commence à domestiquer les bovins, les ovins et les chevaux. Est-ce dans le but de mobiliser leur force et de faciliter les travaux agricoles, ou pour disposer de nouvelles ressources alimentaires, que l’on se met ainsi à élever des animaux ? Ce n’est pas ce que les documents archéologiques et l’interprétation des mythes suggèrent à Eduard Hahn : la mutation a des racines religieuses (Hahn, 1896b).
Les deux structures que constituent les agricultures à la houe (celles auxquelles aucun élevage n’est associé) et les agricultures à la charrue, auxquelles conduit très vite la domestication des animaux, se mettent ainsi en place très tôt et dans des contextes différents, ; elles opposent, depuis, les pratiques qui dominent l’Ancien Continent du Japon à l’Irlande en passant par la Chine, l’Indochine, l’Indonésie, l’Inde, l’Asie centrale, le monde méditerranéen et l’ensemble de l’Europe à celles qui caractérisaient, avant les contacts, le Nouveau Monde, l’Afrique sub-saharienne, l’Océanie et certaines régions peu pénétrables de l’Asie du Sud et du Sud-Est.
La piste qu’exploite Otto Schlüter diffère de celle ouverte par Eduard Hahn : il s’attache aux paysages plus qu’aux techniques de ceux qui les transforment (Schlüter, 1899). La géographie qu’il propose retrace l’humanisation de l’environnement, ses modalités et ses conséquences (Schlüter, 1928 ; 1952-1958). En Europe centrale, qu’il étudie plus particulièrement, l’accent est mis sur la déforestation et la mise en culture. Schlüter reconstitue les reculs ou les avancées des boisements au cours de l’histoire. Il mobilise pour ce faire les méthodes que les sciences naturelles sont en train de mettre au point : dendrochronologie, analyse des pollens conservés dans les tourbes, étude des sédiments holocènes, etc. Il repère ainsi les crises profondes que subit parfois l’environnement, puis les phases où les conditions d’exploitation deviennent plus stables.
Du début du XXe siècle aux années 1960, la géographie allemande, qui est axée sur le paysage, doit beaucoup à Otto Schlüter : elle se présente souvent comme une géohistoire de l’environnement humanisé. C’est cependant outre-Atlantique que les recherches de ces précurseurs allemands portent surtout leurs fruits.
B.Carl Sauer et la géohistoire environnementale
Carl Sauer naît dans une petite communauté d’immigrants allemands installés dans l’Arkansas (Sauer, 1956 ; 1963). Son père, qui y enseigne l’allemand, veille à ce qu’il reçoive une solide instruction, complétée par un long séjour en Forêt Noire. Le résultat, c’est que Sauer est aussi sensible à ce qui se fait aux Etats-Unis et dans le monde anglophone qu’en Allemagne. Il connaît également le français – et la géographie française. Sa formation de géographe, il l’acquiert dans le Middle West – c’est la partie des Etats-Unis où, au début du XXe siècle, la discipline est la mieux implantée. Ceux qui la pratiquent ont le souci de la doter de méthodes rigoureuses. Sauer tire profit de leurs enseignements. C’est avec ce bagage qu’il s’installe en Californie, où il enseigne à Berkeley à partir de 1923. Il s’y lie avec un anthropologue, Alfred Kroeber, qui l’initie aux études amérindiennes. Il découvre aussi, dans le Mexique voisin, une civilisation rurale qui diffère profondément de celle qui s’est imposée aux Etats-Unis. Il consacre désormais une grande partie de ses recherches aux communautés amérindiennes et aux établissements coloniaux espagnols. De sa connaissance de la géographie allemande, il tire un certain nombre d’idées-forces : l’approche se fait sur le terrain, à travers le paysage ; le but est d’évaluer les transformations que l’humanisation y a induites, ce qui suppose un travail patient de botaniste et de zoologue : lui seul permet de repérer les espèces que l’homme a volontairement apportées et celles dont il a seulement facilité la propagation. La géographie que pratique Sauer voit dans les paysages des ensembles naturels remodelés par les groupes humains. Elle reconstitue leur genèse, retrace leur évolution et mesure l’impact à long terme de ces transformations. La géohistoire environnementale de Sauer attache un prix particulier aux processus de diffusion, ce qui est normal dans un pays balayé par des fronts pionniers successifs.
Ce que la démarche de Sauer partage avec celle des Vidaliens français, c’est l’idée que les réalités géographiques sont des structures qui ont une temporalité propre – d’où l’accent qu’il place aussi sur la longue durée. Ce par quoi sa perspective diffère, c’est qu’elle s’attache moins aux agents de la transformation, aux hommes, aux genres de vie, qu’aux résultats de celle-ci tels qu’on peut les lire dans les espaces cultivés, dans ceux qui l’ont été et sont retournés à la friche ou à la forêt, ou dans les artefacts et constructions que les hommes ont mis en place.
Cette géohistoire environnementale est volontiers critique vis-à-vis des méthodes mobilisées par les colons installés en Amérique du Nord ou dans d’autres environnements jusque-là peu humanisés : Sauer juge très sévèrement le gaspillage des ressources et le massacre des milieux naturels qui caractérisent les Etats-Unis du XIXe et du XXe siècles (Sauer, 1938 ; 1947). C’est à travers des ouvrages comme Agricultural Origin and Dispersals (1952) que l’on mesure le mieux l’originalité de son approche.
Ses élèves développent ses idées dans deux directions. (i) Une partie travaille sur les sociétés et l’espace nord-américains et reconstitue le cheminement, vers l’intérieur du continent, des différents types d’habitat élaborés par les colons à leur arrivée sur la côte Est (Kniffen, 1965). (ii) L’autre s’attache aux transformations des environnements naturels dont l’homme est responsable. L’étude la plus célèbre en ce domaine est sans doute celle qu’Andrew Clark (1949) consacre à la destruction de la faune et de la flore indigènes dans l’île du Sud de Nouvelle-Zélande sous l’impact de la colonisation. En Amérique même, les travaux consacrés à ces thèmes soulignent l’ampleur de l’humanisation du Nouveau Continent par les Amérindiens, ce qui conduit à réévaluer leurs effectifs au moment des premiers contacts, comme le font les travaux de Denevan (1977). Quelques-uns des ouvrages contemporains dont le succès éditorial est le plus grand s’inspirent de ce courant : Biological Imperialism de A. Crosby (1986), 1491. New Revelations of the Americas before Columbus de Charles Mann (2005/2007), ou Collapses. How Societies Choose to Fail or to Succeed de Jared Diamond (2005/2006). Leur pertinence dans le monde actuel vient de l’orientation écologique qu’a toujours eue l’école de Berkeley.
IV-Darby, Broek et la géographie historique de langue anglaise
A.Broek et Darby
L’orientation que prend la géographie historique de langue anglaise est dans l’ensemble différente. Aux Etats-Unis, Derwent Whittlesey (1929) avait essayé de codifier cette démarche en lui assignant un rôle précis : fournir des tableaux successifs de la physionomie d’une région ou d’un pays à certaines dates. C’est ce qu’il appelait sequent occupance. Un géographe américain d’origine néerlandaise, C. O. Broek, prend le contrepied de cette position dans l’étude qu’il consacre en 1932 à The Santa Clara Valley, California : a Study in Landscape Change. Il y analyse à la fois les formes successives prises par l’occupation du sol et les évolutions qui en expliquent la genèse.
C’est en Grande-Bretagne que ces idées trouvent leur formulation définitive. Les recherches géographiques sur le passé y portent la marque de Clifford Darby. Celui-ci ne cherche pas à saisir les temporalités propres aux objets spécifiquement géographiques. Il accepte les cadres temporels définis par les historiens. Ses recherches portent d’abord sur les Fens, cette vaste zone de marais qui s’ouvre au Nord de l’Est-Anglie, et dont Cambridge est proche (Darby, 1940a et b). Son propos est d’abord d’écrire une monographie régionale, celle de cet ensemble à l’époque médiévale, mais la région est si singulière qu’il est conduit à insister sur l’histoire complexe de l’endiguement et de l’assèchement dont est né le milieu moderne. Comme aux Pays-Bas, les terres sont toujours menacées par les eaux, celles des inondations provoquées par les fortes pluies, et celles qui viennent du gonflement de la mer lors des grandes marées ou du passage de dépressions exceptionnelles. Les Fens sont une longue création humaine, que Clifford Darby reconstitue du Moyen Age au XVIIe siècle, lorsque de grands ingénieurs hollandais achèvent d’en maîtriser les eaux. C’est donc à l’étude des processus à l’œuvre sur une période assez longue que Darby s’attache d’abord.
Les recherches de Clifford Darby lui valent très tôt la notoriété. Il est ainsi appelé à diriger un ouvrage sur la géographie historique de l’Angleterre. Publié avant la guerre (Darby, 1936), il est repris après celle-ci (Darby, 1973). Darby a conscience des deux perspectives qu’appelle une telle entreprise : elle peut se concevoir comme la reconstitution du visage d’un pays à certains moments (il parle de ‘thèmes horizontaux’), ou bien comme l’analyse des processus de changement géographique qui y sont à l’œuvre (ce sont ses ‘thèmes verticaux’).
A l’instar de Broek, Darby distingue donc deux types d’analyses, qui alternent (Darby, 1951 ; 1952). Certaines dressent un tableau de ce qu’était l’Angleterre à telle ou telle date. Si l’ouvrage ne contenait que ces développements, il ne permettrait pas de suivre en continu les transformations du pays : au lieu de se présenter comme un film, le devenir de l’Angleterre se réduirait à la projection d’un certain nombre de vues fixes. Pour animer cette histoire et passer d’un tableau géographique à l’autre, il convient d’intercaler des chapitres qui traitent du devenir des populations, des activités économiques et des paysages au cours du temps qui les sépare.
La géographie historique que propose ainsi Darby, avec sa succession d’images arrêtées et de séquences filmées, s’inscrit dans la trame temporelle élaborée par les historiens. Les vues fixes sont cependant déterminées par les dates où l’on dispose de données nombreuses et fiables. En Angleterre, le Domesday Book, grande enquête fiscale menée par Guillaume le Conquérant en 1086, vingt ans après la Conquête, recense les hommes, les terres, les troupeaux, les carrières et les mines de l’ensemble du Royaume. C’est un document inestimable. Clifford Darby décide de l’exploiter : avec l’équipe qui l’entoure, il met plus de trente ans à le faire pour l’ensemble du pays (Darby, 1977). C’est qu’une exigence méthodologique particulière s’impose à qui s’intéresse à la géographie historique : le travail mené diffère de celui de l’historien par un trait essentiel : toutes les données numériques doivent être cartographiées. C’est particulièrement difficile dans le cas du Domesday Book, car, selon les régions, les forêts, par exemple, sont mesurées par leur extension du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, par leur superficie (mais les unités ne sont pas les mêmes d’une partie à l’autre de l’Angleterre) ou par la taille des troupeaux de porcs qu’elles sont capables de nourrir !
B.L’influence de Darby
L’influence qu’exerce Darby est considérable en Grande-Bretagne et dans l’ensemble du monde anglophone. A Cambridge, où se situe le département pilote en matière de géographie historique, Alan Baker (1968 ; 1980), qui forme des générations de jeunes spécialistes en ce domaine, lui voue un véritable culte, ce qui ne l’empêche pas de faire évoluer les problématiques. La plupart des grandes entreprises de géographie historiques des trente années qui suivent la Seconde Guerre mondiale s’inspirent directement de Darby : c’est en particulier le cas de l’histoire de l’Europe que rédige Norman Pounds (1973-1979). Britannique installé aux Etats-Unis, la démarche qu’il met en œuvre s’inscrit dans la même perspective que celle développée par Darby.
Ralph Brown, le grand maître de la géographie historique américaine du milieu du XXe siècle, pratique aussi bien le tableau daté que l’étude des séquences de transformation. Mirror for Americans, qui le fait connaître en 1943, reconstruit l’image de la façade atlantique des Etats-Unis en 1810. Cinq ans plus tard, sa géographie historique des Etats-Unis alterne les tableaux datés et l’étude des transformations (Brown, 1948). Celles-ci prennent une coloration particulière, dans la mesure où elles sont marquées par la poussée des fronts pionniers et la conquête de la totalité de l’espace entre les deux Océans par la colonisation. Un style original de géographie historique s’impose donc dans le monde de langue anglaise dans les trente ans qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Il conduit à la rédaction de grandes synthèses, qui appréhendent un pays (l’Angleterre, les Etats-Unis) ou un continent (l’Europe) à travers une alternance de tableaux datés et de séquences évolutives.
Toute la géographie de langue anglaise ne s’inscrit cependant pas dans la perspective illustrée par Darby. Dans la mesure où il fait la part plus large à l’environnement, Don Meinig est plus proche de Sauer, mais il innove surtout en s’attachant aux diverses options retenues par les pionniers dans les milieux secs de l’Australie méridionale (1962) ou de l’Ouest des Etats-Unis (1968 ; 1971), ou à l’évolution des conceptions géostratégiques qui modèlent l’Amérique du Nord (Meinig, 1886-2004). En Australie, Joe Powell (1975 ; 1988) développe des perspectives assez voisines. Il en va de même de M. Williams dans ses travaux sur la forêt américaine (1989).
Dans le même temps, les monographies continuent, dans le monde de langue anglaise comme en France, à s’attacher plus particulièrement à l’histoire des campagnes et des systèmes agraires (Campbell, 2000 ; Dodgshon, 1980).
V-La géographie historique après le tournant culturel
La Nouvelle Géographie des années 1950 et 1960 a peu d’impact sur l’écriture de la géographie historique, car elle s’intéresse surtout aux aspects théoriques de la discipline et aux méthodes quantitatives. Fascinée par les processus, elle ouvre cependant des perspectives intéressantes sur les faits de diffusion, comme en témoignent les travaux de Torsten Hägerstrand (1968) ou d’Allan Pred (1972).
Géohistoire économique et sociale, géohistoire environnementale et géographie historique à la manière anglaise ou américaine s’inscrivent dans la perspective de la géographie classique, marquée (i) par une curiosité très forte pour les relations des groupes humains à leur environnement, (ii) par un souci de scientificité qui interdit de s’attacher à la subjectivité des acteurs géographiques, et (iii) par une volonté de neutralité, qui limite l’engagement social et politique du chercheur. La Nouvelle Géographie, qui se développe de la fin des années 1950 au début des années 1970, est également conçue dans un cadre proche du positivisme classique – celui du néo-positivisme de l’école de Vienne. Ces présupposés s’effacent à partir de 1970. Cela entraîne une transformation profonde de la géographie et de la géographie historique. On en prend progressivement conscience : comme on le dit à partir de la fin des années 1990, la géographie connaît un tournant culturel.
A.Perspective critique et engagement social
L’accent sur les paysages et la dimension environnementale de la discipline avait conduit la géographie historique classique à privilégier le passé rural et ses évolutions lentes. Jusque-là négligés, le monde industriel et les villes attirent de plus en plus de chercheurs. En Grande-Bretagne, beaucoup abordent ces problèmes dans une perspective historique, qu’il s’agisse de Derek Gregory 1982), de Langton (1979 ; 1984), de Dennis (1984), d’Overton (1996) : il s’agit de raconter la révolution industrielle là où elle est née, d’analyser la révolution agricole qui en est le pendant, et de souligner les spécificités de la géographie sociale à laquelle elles donnent naissance. Les perspectives de ces auteurs sont fortement marquées par le radicalisme plus ou moins marxiste qui est alors à la mode en Grande-Bretagne
La société qui se met en place dans les grandes métropoles du XIXe siècle invente la modernité : d’où la fascination qu’exerce Paris sur un géographe comme David Harvey. C’est que cette modernité se traduit par une mutation sociale qu’accentue l’action de Haussmann (Harvey, 1985 ; 2003) : elle aboutit à la Commune et à la réaction que dirige alors la bourgeoisie parisienne ; le Sacré Cœur est là pour rappeler à tous la faute immense qu’a constituée cette révolution (Harvey, 1979) !
B.La géographie historique des représentations
Le tournant culturel va plus loin. Il provoque une révision des objectifs de la géographie historique : il ne s’agit plus de dresser l’état d’une région ou d’un pays à un moment donné du passé ou de préciser les dynamismes à l’œuvre au cours de telle ou telle période ; le propos n’est plus de saisir les temporalités propres aux objets géographiques et la manière dont elles se combinent à d’autres temporalités. C’est aux acteurs que l’on s’attache désormais, à la manière dont ils vivent leur temps, dont ils perçoivent les espaces où ils évoluent et ceux avec lesquels ils sont en relation.
Ces approches n’avaient pas été ignorées par la génération précédente, même si elles étaient peu nombreuses. Clifford Darby s’était amusé à reconstituer la géographie imaginaire du Wessex telle que la peignait Thomas Hardy (1948). John Kirtland Wright (1947) avait insisté sur le rôle de l’imagination en géographie. Dès 1927, il avait exploré le monde des Croisades en s’interrogeant sur les savoirs géographiques mis en œuvre par les acteurs géographiques du temps.
Deux idées avaient ainsi émergé. La première, c’est que le passé est fondamentalement différent du présent, parce que sa culture diffère de la nôtre : « Le passé est un pays étranger » , selon la belle formule de David Lowenthal (1985). La seconde, c’est que la prise en compte des attitudes et des comportements compte au moins autant que celle des aptitudes naturelles dans l’explication des évolutions historiques : c’est la leçon de l’Histoire de la vigne et du vin en France de Dion (1959). L’ouvrage est révolutionnaire parce qu’il rompt avec l’environnementalisme jusque-là dominant dans ce type de travaux, et part des aspirations et des projets des producteurs et des consommateurs : on offre à boire pour honorer ses hôtes, ce qui suppose que le vin soit de qualité. Toute la course aux vignobles de cru sort de là.
Le renouveau de la géographie historique tient à ce qu’elle ne s’arrête plus aux structures, mais s’attache à la manière dont celles-ci ont été façonnées par l’initiative humaine (human agency, disent les auteurs de langue anglaise), comme le soulignent Cole Harris en 1971 ou Derek Gregory en 1981. Le courant radical de langue anglaise accorde très vite un large intérêt aux problèmes des représentations, comme le montrent les travaux de James Duncan sur Kandy (1990), ou ceux de Denis Cosgrove (1993) sur les paysages palladiens de la Vénétie à la jointure des XVIe et XVIIe siècles. Alan Baker théorise le mouvement (1984 ; 1992). D’autres dimensions sont également explorées, celle du souvenir par exemple (Johnson, 2003), ou de l’identité (Matless, 1998). La philosophie critique française à la manière de Michel Foucault ouvre de nouvelles perspectives, qui sont rapidement exploitées dans le monde de langue anglaise par les élèves de Baker, Felix Driver par exemple, dans son travail sur les Workhouses (1993) – un bel exemple d’exclusion sociale forcée à l’époque où le capitalisme triomphe et développe les techniques de surveillance. Les curiosités d’Ogborn (1998), de Hannnah (2000) et de Chris Philo (2004) sont assez proches, mais la vue la plus synthétique sur les rapports du pouvoir à l’espace, dans une perspective historique, est sans doute celle de Cole Harris (1991). L’orientation radicale entraîne le succès des thèmes post-coloniaux : la géographie historique s’attache à l’impérialisme européen, à la construction des empires coloniaux (Butlin, 2009), aux conceptions qu’ils mettent en œuvre (Driver, 2001) ou aux paysages qu’ils font naître (Clayton, 2000).
Le tournant culturel va un pas plus loin lorsqu’il s’attaque à la globalisation. Peter Taylor (1999) en suit la traduction idéologique des Pays-Bas à l’Angleterre et aux Etats-Unis du XVIe siècle à aujourd’hui – c’est une façon d’élargir les géohistoires à la manière de Braudel ou de Wallerstein. Edward Said (1978) ouvre des perspectives nouvelles sur les rapports de domination dans un monde globalisé : ses vues sur l’orientalisme influent profondément sur la plupart des travaux consacrés aux géographies impériales. La domination y est souvent véhiculée par la manière dont le monde est dit et écrit, comme le souligne Ogborn (2007) dans le cas de la Compagnie anglaise des Indes orientales. La globalisation fait connaître d’autres mondes aux Occidentaux : elle les oblige à inventer de nouvelles manières de penser l’altérité. Pourquoi ne pas situer les formes sociales auxquelles on aspire dans les mondes que l’on est en train de découvrir ? C’est à ce mouvement que s’attache Jean-François Staszak dans Les Géographies de Gauguin (2003). Il mène ces recherches un pas plus loin dans les travaux qu’il consacre depuis à l’exotisme.
La géographie historique est longtemps apparue comme un domaine un peu mineur de la discipline. Cela tenait au rôle qu’elle avait joué au temps où elle était servante de la cartographie, puis de l’histoire. Elle s’est progressivement émancipée. A partir du moment où la géographie humaine naissante met en évidence l’existence d’objets géographiques créés par les hommes au sein du cadre environnemental dans lequel ils évoluent, elle ouvre de nouvelles perspectives à la géographie historique : celles-ci s’attachent ainsi aux temporalités que l’exploitation et l’aménagement de l’espace imposent aux sociétés humaines, à la manière des recherches françaises et germano-américaines, et les réinsèrent dans les découpages temporels auxquels les historiens sont habitués, à la manière d’une partie de la géographie historique britannique ou américaine. Le tournant culturel élargit encore le champ de la géographie historique, qui devient plus engagée, plus ‘politique’, mais qui découvre surtout, dans le jeu des représentations, un immense domaine qu’elle s’emploie à explorer.
Les ouvrages de synthèse et de réflexion sur la géographie historique se multiplient (Baker, 1980 ; 1992 ; 2003 ; Boulanger et Trochet, 2005 ; Butlin, 1992 ; Graham et Nash, 1999 ; Morrissey et al., 2009 ; Trochet, 1997 ; 1998) : la discipline est entrée dans sa phase de maturité.
Bibliographie
Baker, A.R.H. 1968, « A note on the retrogressive and retrospective approaches in historical geography », Erdkunde, vol. 22, p. 244–5.
Baker, A. R. H. (ed.), 1980, Progress in Historical Geography, Newton Abbott, David and Charles.
Baker, A.R.H., 1984, « Reflections on the relations of historical geography and the Annales school of history» , in A.R.H. Baker and D. Gregory (eds), Explorations in Historical Geography: Inter- pretative Essays, Cambridge, Cambridge University Press, p. 1–27.
Baker, A. R. H. (ed.), 1992, Ideology and Landscape in Historical Perspective. Essays on the Meaning of Some Places in the Past, Cambridge, Cambridge University Press.
Baker, A. R. H., 1999, Fraternity among the French Peasantry : Sociability and Voluntary Associations in the Loire Valley, 1815-1914, Cambridge, Cambridge University Press.
Baker, A.R.H., 2003, Geography and History: bridging the Divide, Cambridge, Cambridge University Press.
Bloch, M., 1931, Les Caractères originaux de l'histoire rurale française, Oslo, Institut pour l'Etude comparée des civilisations ; rééd. présentée par Pierre Toubert, Paris, A. Colin, 1988.
Bloch, M., 1935, La Société féodale. La formation des liens de dépendance, Paris, A. Michel.
Boulanger, P. et J.-R. Trochet (dir.), 2005, Où en est la géographie historique ? Paris, L’Harmattan.
Braudel, F., 1949, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Armand Colin.
Braudel, F., 1958, « La longue durée» , Annales E. S. C., n° 4, p. 725-753.
Braudel, F. 1967-1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles, Paris, A. Colin, 3 vol
Braudel, F., 1986, L'Identité de la France, Paris, Arthaud-Flammarion, 3 vol. : 1- Espace et histoire; 2 et 3, Les Hommes et les choses.
Braudel, F., 1997 [1941-44], « Géohistoire : la société, l’espace et le temps » , in Braudel, F., Les Ambitions de l’histoire, Paris, Éditions de Fallois, p. 68-114.
Broek, C. O., 1932, The Santa Clara Valley, California : a Study in Landscape Change, Utrecht, Oosthoek.
Brown, R. H., 1943, Mirror for American : Likeness of the Americain Seaboard, 1810, New York, Americain Geographical Society.
Brown, R. H., 1948, Historical Geography of the United States, New York, Harcourt Brace.
Butlin, R., 1993, Historical Geography. Through the Gates of Space and Time, Londres, Arnold.
Butlin, R., 2009, Geographies of Empires : European Empires and Colonies, c. 1880-1960, Cambridge, Cambridge University Press.
Campbell, B.M.S., 2000, English Seigneurial Agriculture, 1250–1450, Cambridge, Cambridge University Press.
Campbell, B.M.S. and Bartley, K. 2006, England on the Eve of the Black Death: an Atlas of Lay Lordship, Land and Wealth, 1300–1349, Manchester, Manchester University Press.
Clark, A., 1949, The Invasion of New Zealand by People, Plants and Animals : the South Island, New Brunswick, Rutgers University Press.
Claval, P., 1981, « La géographie historique» , Annales de Géographie, vol. 80, p. 669-678.
Claval, P. 1984, « The historical dimension of French Geography» , Journal of Historical Geography, vol. 10, n° 3, June, p. 229-245.
Claval, P., 2012, « Marc Bloch géographe » , sous presse.
Clayton, D. 2000, Islands of Truth: the Imperial Fashioning of Vancouver Island, Vancouver, University of British Columbia Press.
Cosgrove, D. 1993, The Palladian Landscape: Geographical Change and its Cultural Representation in Sixteenth-Century Italy, Leicester, Leicester University Press.
Crosby, A.W., 1986, Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe, 900-1900, Cambridge, Cambridge University Press.
Dainville, F. de, 1963, Le Langage des géographes, Paris, Picard.
Daniels, S. 1999, Humphry Repton: Landscape Gardening and the Geography of Georgian England, New Haven, Yale University Press.
Darby, H. C. (ed.), 1936, An Historical Geography of England before A. D. 1800, Cambridge, Cambridge University Press.
Darby, H. C., 1940, The Medieval Fenlands, Cambridge, Cambridge University Press.
Darby, H.C., 1940, The draining of the Fens, Cambridge, Cambridge University Press.
Darby, H.C., 1948, « The regional geography of Thomas Hardy’s Wessex », Geographical Review, vol. 38, p. 426–43.
Darby, H.C., 1951, « The changing English landscape », Geographical Journal, vol. 117, p. 377–94.
Darby, H.C., 1953, « On the relations of geography and history », Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 19, p. 1–11.
Darby, H.C., 1962, « The problem of geographical description », Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 30, p. 1–14.
Darby, H.C. (ed), 1973: A New Historical Geography of England and Wales, Cambridge, Cambridge University Press.
Darby, H.C., 1977, Domesday England, Cambridge, Cambridge University Press.
Darby, H.C., 2002, The Relations of History and Geography: Studies in England, France and the United States, Exeter, Exeter University Press.
Deffontaines, P., 1932, Les Hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne-Garonne, Lille, SLIC.
Deffontaines, P., 1948, Géographie et religions, Paris, Gallimard.
Demangeon, A., 1905, Les Sources de la géographie de la France à la Bibliothèque Nationale, Paris, Société Nouvelle de Librairie et d'Edition.
Demangeon, A., 1907, « Les recherches géographiques dans les archives », Annales de Géographie, vol. 16, p. 193-203.
Denevan W.M. (ed.), 1977, The Native Population of the Americas, Madison, University of Wisconsin Press.
Dennis, R. 1984, English Industrial Cities in the Nineteenth Century: a Social Geography, Cambridge, Cambridge University Press.
Diamond, J., 2006, Effondrements, Paris, Gallimard ; ed. or. am. Collapses. How Societies Choose to Fail or to Succeed, New York, Viking, 2005.
Dion, R., 1934, Essai sur la formation du paysage rural français, Tours, Arrault.
Dion, R., 1959, Histoire de la vigne et du vin en France, Paris, chez l’auteur
Dodgshon, R.A., 1980, The Origins of British Field Systems: an Interpretation, London, Academic Press.
Dodgshon, R.A., 1987, The European Past: Social Evolution and Spatial Order, London, Macmillan.
Dodgshon, R.A., 1998, Society in Time and Space: a Geographical Perspective on Change, Cambridge, Cambridge University Press.
Driver, F., 1993, Power and Pauperism: the Workhouse System 1834–1884, Cambridge, Cambridge University Press
Driver, F. 2001, Geography Militant: Cultures of Exploration and Empire, Oxford, Blackwell.
Duncan, J.S, 1990, The City as Text: the Politics of Landscape Interpretation in the Kandyan Kingdom, Cambridge, Cambridge University Press.
Febvre, L., 1905, Les régions de la France. IV - La Franche-Comté, Publications de la Revue de Synthèse historique, Paris, Cerf, 77 p.
Gallois, L., 1890, Les Géographes allemands de la Renaissance, Paris, Leroux.
Gallois, L., 1891-1892, « La Dombes» , Annales de Géographie, vol. 1, p 121-131.
Gallois, L., 1894-1895, « Mâconnais, Charolais, Beaujolais, Lyonnais », Annales de Géographie, vol. 3, n° 10, p. 201-212, n° 12, p. 428-449; vol. 4, n° 16, p. 287-309.
Gallois, L., 1908, Régions naturelles et noms de pays, Paris, A. Colin.
Gautier, E.-F., 1927, Les Siècles obscurs du Maghreb, Paris, Payot.
Giraud-Soulavie, J.-L., 1783, Histoire naturelle de la France méridionale, Paris, 7 vol.
Godlewska, A., 1999, Geography Unbound. French Geographic Science from Cassini to Humboldt, Chicago, Chicago University Press.
Graham, B. and Nash, C. (eds), 1999, Modern Historical Geographies, London, Longman.
Graham, B., Ashworth, G. and Tunbridge, J., 2000, A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy, Oxford, Oxford University Press.
Gregory, D., 1981, « Human agency and human geography », Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 6, p. 1–18.
Gregory, D., 1982, Regional Transformation and Industrial Revolution: a Geography of the Yorkshire Woollen Industry, London, Macmillan and Minneapolis, University of Minnesota Press.
Gregory, D., 2009, War Cultures, New York, Routledge.
Hägerstrand, T., 1968, Innovation Diffusion as a Spatial Process, Chicago, Chicago University Press ; éd. or., 1953.
Hahn, E., 1892, « Die Wirtschaftsformen der Erde» , Petermanns Mitteilungen, vol. 38, p. 8-12.
Hahn, E., 1896a, Die Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen, Leipzig, Duncker et Humblot.
Hahn, E., 1896-b, Demeter und Baubo. Versuch einer Theorie der Entstehung unseres Ackerbau, Lübeck.
Hahn, E., 1914, Von der Hacke zum Pfluge, Leipzig, Quelle et Meyer.
Hannah, M., 2000, Governmentality and the Mastery of Territory in Nineteenth-Century America, Cambridge, Cambridge University Press.
Harris, R.C., 1971, « Theory and synthesis in historical geography », Canadian Geographer, vol. 15, p. 157–72.
Harris, R.C., 1991, « Power, modernity and historical geography », Annals of the Association of American Geographers, vol. 81, n° 4, p. 671–83.
Harvey, D., 1979, « Monument and myth» , Annals of the Association of American Geographers, vol. 69, p. 362–81.
Harvey, D., 1985, Consciousness and the Urban Experience, Oxford, Blackwell.
Harvey, D., 2003, Paris, Capital of Modernity, London and New York, Routledge.
Johnson, N.C., 2003, Ireland, the Great War and the Geography of Remembrance, Cambridge, Cambridge University Press.
Kniffen, Fred B., 1965, « Folk housing : key to diffusion », Annals of the Association of American Geographers, vol. 55, p. 549-577.
Langton, J., 1979, Geographical Change and Industrial Revolution: Coalmining in South-West Lancashire, 1590–1799, Cambridge, Cambridge University Press.
Langton, J., 1984, « The Industrial Revolution and the regional geography of England» , Transactions of the Institute of British Geographers, New Sery, vol. 9, p. 145–67.
Longnon, A., 1878, Géographie de la Gaule au VIème siècle, Paris, Hachette.
Lowenthal, D., 1985, The Past is a Foreign Country, Cambridge, Cambridge University Press.
Mann, C. C., 2005, 1491. New Revelations of the Americas before Columbus ; trad. fse, 1491. Nouvelles Révélations sur les Amériques avant Christophe Colomb, Paris, A. Michel, 2007.
Matless, D. 1998, Landscape and Englishness, London, Reaktion Books.
Meinig, D. W., 1962, On the Margins of the Good 3arth : The South Australien Wheat Frontier 1869-1884, Chicago, Rand McNally.
Meinig, D. W., 1968 , The Great Columbia Plain : a Historical Geography, 1805-1910, Seattle, University of Washington Press.
Meinig, D. W., 1971, Southwest : Three Peoples in Geographical Change, 1600-1700, Londres, Oxford University Press.
Meinig, D.W., 1986–2004, The Shaping of America: a Geographical Perspective on 500 Years of History, New Haven (Ct), Yale University Press, 4 vols.
Montluc, Blaise de, 1592, Commentaires de messire Blaise de Montluc, mareschal de France, Bordeaux, S. Millanges ; éd. La Pléïade, Paris, Gallimard, 1964.
Morrissey, J., Strohmayer, U., Whelan, Y. and Yeoh, B., 2009, Key Concepts in Historical Geography, London, Sage.
Ogborn, M., 1998, Spaces of Modernity: London’s Geographies 1680–1780, New York, Guilford Press.
Ogborn, M. 2007, Indian Ink: Script and Print in the Making of the English East India Company, Chicago, The University of Chicago Press.
Overton, M., 1996, Agricultural Revolution in England: the Transformation of the Agrarian Economy 1500–1850, Cambridge, Cambridge University Press.
Philo, C., 2004, A Geographical History of Institutional Provision for the Insane from Medieval Times to the 1860s in England and Wales: the Space Reserved for Insanity, Lampeter (Wales) and New York, The Edwin Mellen Press.
Pitte, J.-R., 1983, Histoire du paysage français, Paris, Tallandier, 2 vol.
Planhol (X ? de), avec la collaboration de P. Claval, 1988, Géographie historique de la France, Paris, Fayard.
Pounds, N. J. G., 1973-1979, An Historical Geography of Europe, Cambridge University Press, 2 vol.
Powell, J. M., 1975, Australian Space, Australian Time : Geographical Perspectives, Londres, Oxford University Press.
Powell, J. M., 1988, An Historical Geography of Modern Australia: the Restive Fringe, Cambridge, Cambridge University Press.
Pred, A. R. 1973, Urban Growth and the Circulation of Information: the United States’ System of Cities, 1790–1840, Cambridge (Ma), Harvard University Press.
Roupnel, G., 1934, Histoire de la campagne française, Paris, Grasset.
Said, E. W., 1980/1978, L’Orientalisme. L’Orient vu par l’Occident, Paris, le Seuil ; éd. or., Orientalism, New York, Pantheon Book ; Londres, Routledge et Kegan Paul.
Sauer, Carl O., 1956, « The education of a geographer », Annals of the Association of American Geographers, vol. 46, p. 287-299.
Sauer, Carl, 1938, « Themes of Plant and Animal Destruction in Economic History» , Journal of Farm Economics, vol. 20, p. 765-775; réimpression in : John Leighly, 1963, Land and Life, Berkeley, University of California Press.
Sauer, C. O., 1947, « Early relations of man to plants », Geographical Review, vol. 37, n°1, p. 1-25.
Sauer, Carl O., 1952, Agricultural origins and dispersals, Washington, American Geographical Society.
Sauer, Carl O. 1963, Land and Life. A Selection of the Writings of Carl Ortwin Sauer, Berkeley, University of California Press.
Schlüter, O., 1899, « Bemerkungen zur Siedlungsgeographie» , Geographische Zeitschrift, vol. 5, p. 65-84.
Schlüter, O. 1928, « Die analytische Geographie der Kulturlandschaft» , Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Sonderband über Hundertsjahrfeier, p. 388-411.
Schlüter, O., 1952-1954-1958, « Die Siedlungsräume MittelEuropa in frühgeschichtlicher Zeit» , Forschungen zur Deutschen Landeskunde, vol. 67, 74 et 110.
Sion, Jules, 1908, Les Paysans de la Normandie orientale, Paris, A. Colin.
Taylor, P. J., 1999, Modernities: a Geohistorical interpretation, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Trochet, J.-R., 1993, Aux Origines de la France rurale, Paris, CNRS.
Trochet, J.-R., 1997, La Géographie historique en France, Paris, PUF.
Trochet, J.-R., 1998, Géographie historique. Hommes et territoires dans les sociétés traditionnelles, Paris, Nathan.
Vidal de la Blache, P., 1886, « Des rapports entre les populations et le climat sur les bords européens de la Méditerranée », Revue de Géographie, vol. 19, p. 409-419.
Vidal de la Blache, P., 1888/1897, « Des divisions fondamentales du sol français» , Bulletin littéraire, vol. 2, n° 1, p. 1-7.
Vidal de la Blache, P., 1894, Histoire et géographie. Atlas général, Paris, A. Colin.
Vidal de la Blache, P., 1902, La Rivière Vincent Pinzon : étude sur la cartographie de la Guyane, Paris, F. Alcan.
Vidal de la Blache, P., 1903, Tableau de la géographie de la France, Paris, Hachette.
Vidal de la Blache, P., 1911, « Les genres de vie dans la géographie humaine» , Annales de Géographie, vol. 20, n° 111, p. 193-212 ; n° 112, p. 289-304.
Vidal de la Blache, P., 1922, Principes de géographie humaine, Paris, A. Colin.
Whittlesey, D., 1929, « Sequent occupance », Annals of the Association of American Geographers, vol. 19, 1929, p. 162-165.
Williams, M., 1989, Americans and their Forests: a Historical Geography, Cambridge, Cambridge University Press.
Wrigley, E.A. and Schofield, R.S., 1981, The Population History of England 1541–1971: A Reconstruction, Cambridge, Cambridge University Press.
Wright, J. K., 1925, The Geographical Lore of the Time of the Crusades: a Study in the History of Medieval Science and Tradition in Western Europe, New York, Dover.
Wright, J. K., 1947, « Terrae incognitae: the place of the imagination in geography », Annals of the Association of American Geographers, vol. 37, p. 1–15.
Pour une géographie historique du bouton de culotte | Publié le 2013-06-03 13:57:45 |
Par Jean-Robert Pitte, Membre de l’Institut, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Résumé : La géographie historique du bouton est plus complexe qu’il n’y paraît. Son usage reflète le perfectionnement culturel des sociétés depuis l’Antiquité car il montre une manière de porter le vêtement plus facilement. Il est identifié en Chine durant l’Antiquité et se retrouve en matériau dur en Europe au Moyen-Age avant de connaître une diffusion plus large à partir du XIXe siècle. Son évolution dans l’espace et dans le temps témoigne de sa lente appropriation par les sociétés sous des formes et pour des raisons diverses.
Mots-clefs : géographie historique et culturelle, civilisation, bouton, vêtement, néolithique, Antiquité, Moyen-Age, France, Chine, Japon, Europe, Equateur, Allemagne, Angleterre, Belgique.
Abstract : Historical geography of the production and use of buttons is more complex than it seems to be. Its use reflects how societies have culturally perfected themselves since the ancient times, showing the manner of wearing clothing more comfortably. Use of buttons goes back at least to Ancient China and has been proved for Medieval Europe Then it spread much more widely from the 19th century onwards. Historical development of buttons and the spatial patterns of their distribution testify how societies have appropriated themselves this object in different ways and for different reasons.
Key words : Historical and cultural geography, civilization, button, garment, Neolithic, Antiquity, Middle Ages, France, China, Japan, Europe, Ecuador, Germany, England, Belgium.
À l’occasion de la fondation d’une nouvelle revue de géographie historique, j’aimerais revenir sur une petite controverse qui m’avait opposé naguère à Claude Bataillon et à Roger Brunet et qui touche à la légitimité de cette branche de notre discipline, plus largement, à la géographie elle-même. Lors de la retraite de Xavier de Planhol au milieu des années 1990, ses élèves et collègues avaient souhaité lui offrir des mélanges. Compte tenu de la diversité de ses centres d’intérêt et du nombre de ceux qui souhaitaient apporter leur contribution, il a finalement été décidé que Daniel Balland rassemblerait les textes concernant les mondes turc, arabe et persan, tandis que je me chargerais des textes sur l’Europe. C’est de ce dernier volume qu’il s’agit ici (1). Claude Bataillon, spécialiste de l’Amérique latine, signa trois ans plus tard un compte-rendu dans L’Espace géographique (2). Voici des extraits significatifs de celui-ci :
I- Une géographie historique et culturelle
L’enfer éditorial est pavé d’ouvrages collectifs sans cohérence. C’est souvent le cas des publications de colloques. C’est presque toujours le cas des volumes d’hommages. A contrario nous pensons à quelques exceptions d’ouvrages réellement organisés autour de la personne à honorer : Pierre Monbeig, Bernard Kayser, Gilles Sautter et Paul Pélissier ; peut-être que ces hommes remarquables, mais partiellement en marge de l’establishment universitaire, ont suscité des projets originaux…
Au contraire l’hommage au professeur X. de Planhol est un modèle du genre : après sa photographie, qui peut-être fait sourire volontairement, bibliographie de l’intéressé, puis une vingtaine d’articles classés… par ordre alphabétique d’auteurs. On y trouve des textes impossibles à caser ailleurs, qui n’appartiennent ni à la géographie culturelle ni à la géographie historique […].
Tout est objet géographique à condition d’être localisé ? Alors l’élevage du hamster est un objet d’étude aussi légitime que celui du chien de berger (souvenons-nous de l’émoi provoqué par ce thème présenté par X. de Planhol devant l’Association de Géographes Français au printemps 1968). On peut faire une géographie de la production et de la consommation des boutons de culotte, comme celle du saucisson sec, ici présentée par J.-R. Pitte : l’un et l’autre sont des données culturelles.
Longtemps en France, la géographie s’attachait en priorité aux faits socio-économiques, « forces productives » analysées dans leur actualité : la géographie « historique et culturelle » serait une revanche contre les canons de cette orthodoxie ? Encore faut-il convaincre qu’on a quelque chose d’important à expliquer, c’est-à-dire qu’un thème est pertinent pour comprendre l’organisation d’un espace […]. Chez nos cousins sociologues aussi, la frivolité de recherches étroites sur les affiches de mode ou sur le cybersexe « en eux-mêmes » peut irriter, surtout si la « demande sociale » supposée de la production scientifique est satisfaite grâce à des fonds publics.
La géographie historique va-t-elle de soi ? Remarquons le groupement traditionnel de « l’histoire de la géographie et de la géographie historique » : un ghetto ? En fait l’histoire de la géographie fait partie de l’histoire de la connaissance, longtemps peu prisée des géographes en France […].
Mais pour nous la géographie historique n’a pas de statut clair : comme les adeptes des autres sciences sociales du contemporain, les géographes sont amenés à des rétrospectives portant sur des périodes plus ou moins longues et usent pour cela des méthodes de recherche d’archives et de critique des textes des historiens : tout le monde a droit de faire de l’histoire, parce qu’il en a besoin, et bonne si possible, car un large public en a le goût. Je considère qu’une spécificité des géographes est un rapport au présent : non pas nécessairement le « terrain », scrogneugneu, que l’on arpente de son godillot, mais ce contact précaire avec les témoins ou les acteurs qui permet d’appréhender des sociétés localisées en train de façonner des territoires. Libre à chacun de se priver de cette chair du social.
En lisant ce compte-rendu peu amène pour les auteurs, le coordonnateur de l’ouvrage, pour Xavier de Planhol lui-même et, en outre, énonçant une vision de la géographie historique à laquelle il m’était et m’est encore impossible d’adhérer, j’avais donc pris la décision d’adresser aussitôt une lettre à Roger Brunet, Directeur de la rédaction de L’Espace géographique, accompagnée d’un texte en forme de droit de réponse et demandant sa publication dans une prochaine livraison de la revue. Voici le texte en question.
II- La guerre des boutons de culotte n’aura pas lieu
Le compte-rendu tardif et acidulé que Claude Bataillon vient de donner du volume d’hommages offerts à Xavier de Planhol appelle de nombreuses remarques. En voici quelques unes volontairement non polémiques.
Malgré l’effort du ou des coordonnateurs, les volumes de Mélanges sont le plus souvent aussi disparates que l’œuvre des maîtres auxquels ils sont destinés. Quel chercheur assez fécond et influent pour mériter cet honneur ne s’est intéressé qu’à un thème précis tout au long de sa vie ? Rappelons la philosophie d’un genre que l’on est tout à fait libre de ne pas apprécier et auquel personne n’est tenu de participer. Il s’agit, avant tout, d’un témoignage d’amitié à l’égard d’un collègue ou d’un maître dont on a beaucoup appris et avec lequel on a beaucoup échangé. Pour démodé que soit ce sentiment, la reconnaissance n’en est pas moins noble et sympathique. Les Mélanges, écrits pour le plaisir de leur destinataire, remplissent cette première et éminente fonction. La générosité est donc intrinsèquement liée au genre. Chaque participant sincère tente de donner le meilleur de lui-même. Les savants ayant aussi leurs petites faiblesses ou leurs passages à vide, il faut bien reconnaître que les contributions sont parfois d’inégale richesse. Devrait-on pour autant exercer la même sévérité que dans une revue « à comité de lecture » ? Probablement pas. D’ailleurs les revues en question présentent aussi de grandes disparités de qualité d’un article à l’autre et, encore plus, de thématiques, hormis les numéros spéciaux. Personne ne songe à s’en plaindre, car c’est un genre obligé et attendu et, grâce aux bibliographies, les lecteurs intéressés parviennent toujours à retrouver l’article qui répondra à leurs interrogations. La vie scientifique est inséparable de l’érudition et celle-ci oblige à des recherches fouillées, y compris dans des ouvrages et des revues improbables.
Concernant les Mélanges offerts à Xavier de Planhol, rappelons qu’ils ne constituent que la partie européenne d’un hommage complété d’un beaucoup plus gros volume consacré au monde islamique, objet de l’essentiel des recherches du récipiendaire. Les thèmes abordés font tous référence à l’une ou l’autre des facettes de son œuvre : épistémologie, structures agraires, habitat, alimentation, etc. Plusieurs articles adoptent une problématique très large ; d’autres au contraire abordent un détail. Sont-ils moins intéressants pur autant ? L’accueil exceptionnel fait par la presse à L’eau de neige de Xavier de Planhol (Fayard, 1995) démontre le contraire. Ce livre d’une éblouissante érudition retrace en 500 pages un cheminement intellectuel de 50 ans autour du rafraîchissement des boissons. La conclusion de cet ouvrage révèle des aperçus à la fois profondément neufs et exprimés avec modestie : le contraire de la cuistrerie qui tient lieu de science. Claude Bataillon a bien raison de rappeler la communication de Xavier de Planhol en 1968 sur le chien de berger. Elle jetait un éclairage nouveau sur le développement d’une technique pastorale liée à la genèse du paysage de champs ouverts. Cerner les moments et les lieux de cette évolution valait bien un article dans le BAGF et ne méritait sûrement pas les aboiements de certains.
L’aimable passion de Xavier de Planhol pour les détails qui ouvrent les larges horizons est sans doute l’aspect le plus déroutant de sa méthode. Chacun reconnaîtra qu’elle n’a jamais entravé chez lui le sens des larges synthèses. Les fondements géographiques de l’histoire de l’Islam (1968), Les zones tropicales arides et subtropicales (1970), sa Géographie historique de la France (1988), Les nations du prophète (1993), Les minorités en islam (1997), L’Islam et la mer en cours d’achèvement sont autant d’ouvrages fondamentaux, reconnus par les savants des autres disciplines et par le grand public. Combien de géographes de cette génération peuvent se targuer d’un tel bilan ? Dès lors, les maisons sous la roche, les enseignes ou le saucisson constituent de très modestes travaux d’érudition que les vrais chercheurs sauront un jour solliciter pour les intégrer à de vastes synthèses. Le bouton de culotte est mis en cause par Claude Bataillon pour ridiculiser de tels choix. Malheureusement, cet exemple est des plus mal venus. En effet, l’évolution de la mode féminine européenne au XVIIIe siècle, particulièrement la profusion des rubans et des boutons, est l’un des moteurs de la révolution industrielle. Les révolutions culturelles sont toujours préalables aux révolutions techniques : c’est une constante de l’histoire de l’humanité et cela justifie pleinement pour le bouton une approche géographique.
Plus grave : Claude Bataillon conteste la légitimité de la géographie historique. C’est son droit, mais cette position est malheureusement très archaïque. Elle revient à nier le droit aux géographes, aux spécialistes de l’espace et du territoire, d’utiliser leur regard et leurs méthodes pour éclairer des situations passées. Pourquoi devrions-nous nous châtrer et considérer « qu’une des spécificités des géographes est le rapport au présent » ? Comme si le passé et le présent, l’espace et le temps, l’homme et son environnement, le quantifiable et le qualitatif, l’exact et le flou pouvaient être, devaient être séparés. Oui, définitivement, le géographe cherche à comprendre où et pourquoi les choses, les êtres et leurs œuvres se localisent et se répartissent de telle manière plutôt que de telle autre. Que les faits soient d’aujourd’hui, d’hier ou d’avant-hier ne change rien à l’affaire. Le réel est un. Seule l’inflation du savoir interdit aujourd’hui d’être réellement universel. Il n’est pas interdit d’être curieux et cultivé. Il n’est pas interdit de chercher aux confins des disciplines établies. On pourra contester le mariage français de l’histoire et de la géographie. On ne saurait nier que si les historiens étaient un peu meilleurs géographes et les géographes un peu meilleurs historiens, le statut de la géographie et son utilité sociale seraient aussi bien reconnus que ceux de l’histoire. C’est l’enseignement qu’il faut, par exemple, retirer des Lieux d’histoire de Christian Grataloup.
Rien n’est pire que l’indifférence et le silence. Merci à Claude Bataillon d’avoir rendu compte des Mélanges de Planhol. Dommage qu’il ait préféré la bile à l’encre et ait donné l’impression que les textes rassemblés ne présentaient guère d’intérêt, alors qu’il s’agit d’un recueil dans lequel chacun pourra trouver au moins un texte qui lui ouvrira des horizons nouveaux, le réjouira et l’aidera à progresser sur le chemin du savoir. N’est-ce pas ce que l’on demande aussi à toute livraison d’une revue, y compris à L’Espace géographique ?
Peu après, je reçus de Roger Brunet la réponse suivante :
Montpellier, le 19 janvier 1999
Monsieur,
Vous nous avez fait parvenir un texte intitulé « la guerre des boutons de culotte n’aura pas lieu », au titre de l’usage d’un « droit de réponse » à un compte rendu publié dans L’Espace géographique sous la signature de Claude Bataillon et consacré au volume d’hommages à Xavier de Planhol.
Le comité de rédaction de L’Espace géographique, après avoir pris connaissance de ce texte, a considéré qu’il n’entrait nullement dans la catégorie des droits de réponse, puisque le texte de Claude Bataillon, au demeurant des plus modérés, est présenté comme un compte-rendu de lecture, ne dépasse à aucun moment ce que l’on pourrait estimer comme étant les limites d’une critique littéraire ordinaire, et ne vous met pas en cause, pas plus qu’il ne mettait en cause la personne de Xavier de Planhol.
En revanche, votre propre texte porte principalement sur une défense et illustration de celle-ci, qui n’était pas l’objet du compte-rendu. Il emploie des qualificatifs qui seraient de nature à susciter de nouvelles polémiques (archaïque, bile, acidulé, tardif). Il accuse arbitrairement Claude Bataillon de « nier le droit » qu’auraient les géographes de s’intéresser au passé, ce qui est évidemment absurde, et prétend pourtant donner des leçons.
C’est pourquoi le comité de rédaction a décidé, à une très large majorité, que votre texte ne serait pas publié dans la revue.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma parfaite considération.
Cette lettre fut immédiatement suivie d’une autre lettre émanant de Claude Bataillon lui-même :
Portet, le 22 janvier 1999
Cher collègue,
L’Espace géographique me communique votre texte sur mon CR du volume d’hommage à X. de Planhol et la réponse de R. Brunet. Je n’étais pas à la réunion du comité de la revue qui a écarté ce texte comme « droit de réponse ».
En reprenant ce que j’ai écrit, deux aspects m’importent :
-le « genre » volume d’hommage : oui j’y suis allergique pour des tas de raisons. Les revues se permettent (de moins en moins) une forte dispersion thématique, mais au nom d’apports nouveaux dans un champ relativement cohérent et leurs sommaires sont repérables sur internet ; où retrouver la table des matières d’un livre d’hommage ? Et je plaide pour ces exemples inverses d’efforts utiles réalisés autour de Monbeig, de Sautter et Pélissier, avec des efforts de cohérence.
-Bien plus sérieux le droit d’exister pour une géographie historique qui soit non pas un outil pour expliquer l’organisation territoriale présente, mais une histoire en tant que telle. Je suis assez sensible à l’intérêt des recherches aux jointures des disciplines et sais que celles-ci n’existent pas hors de contextes particuliers, différents dans les différents pays et en différentes époques. C’est précisément la capacité d’une discipline de constituer un champ cohérent qui me semble importante pour que les recherches aux jointures soient fécondes. Je ne crois pas que la géographie historique soit une discipline différente de l’histoire, et pense qu’une réflexion sur les outils spécifiques et les modes de fonctionnement des deux disciplines géographie et histoire doit être approfondie pour avancer à ce sujet.
Bien à vous.
Il m’a semblé utile, sans nul esprit de rancune, de livrer ici les pièces de ce débat qui remonte à une quinzaine d’années. L’eau a coulé sous les ponts et naît fort opportunément aujourd’hui une nouvelle revue de géographie historique. Par ailleurs, lorsqu’on recense les sujets de recherche des jeunes géographes ces dernières années, on se dit que la vision de Claude Bataillon en 1998 est plutôt datée, que la géographie historique, comme la géographie culturelle, ont acquis de nouveau une pleine légitimité et ont pignon sur rue. Les échanges entre la géographie et l’histoire méritent d’être renforcés, rénovés, nourris de recherches croisées. À côté des géographes éclairant des situations passées, a heureusement surgi une nouvelle génération d’historiens qui se servent des méthodes de la géographie. Citons, par exemple, Gérard Chouquer, de l’EHESS, qui s’intitule lui-même archéogéographe et travaille aussi bien sur les cadastres antiques que sur les aménagements fonciers actuels, ou le moderniste Jean-Marc Moriceau qui fait renaître brillamment l’histoire rurale en pleine complicité avec les géographes de Caen.
III- Esquisse d'une géohistoire du bouton
Comme on l’imagine, la petite phrase farceuse et assassine de Claude Bataillon concernant les boutons de culotte m’avait en son temps piqué au vif. Le temps est venu de clore ce débat et d’offrir enfin à ce collègue l’esquisse d’une géographie historique du bouton de culotte qu’il a bien méritée et qu’il voudra bien, je l’espère, accepter avec le sourire. Si j’avais été sollicité pour contribuer à ses propres Mélanges, publiés à son intention (3), c’est ce que j’aurais envoyé sans hésiter ! En effet, les militaires ont beaucoup contribué à structurer les États-nations en Amérique latine et l’on sait combien les militaires aiment les boutons qui favorisent l’ajustement de leurs uniformes et rehaussent leur prestige…
Le sujet du bouton est bien plus ample qu’il n’y paraît : il mériterait une thèse ou plutôt un symposium pluridisciplinaire, tant il fait appel à des savoirs complexes et divers. L’humanité a porté pendant des millénaires et porte encore dans certaines régions du monde des vêtements dépourvus de boutons : pagnes en cuir, écorce ou tissu enroulés autour de la taille (Egypte antique, mondes malais, mélanésien, polynésien), amples étoffes drapées (toge romaine, sari, mehlafa des femmes Maures ou Touaregs, shuka des Massaï) ou munies d’un orifice permettant de passer la tête (boubou, poncho), vêtements du haut disposant de manches cousues et que l’on enfile par la tête (tuniques des Amérindiens du nord et des inuit), pantalons cousus que l’on enfile par les pieds et que l’on retient à la taille par une ceinture (braies, chausses, culottes, pantalons des cavaliers des steppes d’Asie), etc. Le kimono japonais ou le hanbok coréen sont des vêtements féminins à manches que l’on croise sur le devant, mais qui ne peuvent être maintenus que grâce à une ceinture (obi japonais) dont la mise en place et le port obéissent à un rituel complexe. Les vêtements drapés sont élégants, mais se maintiennent difficilement à la place qui leur est assignée. C’est la raison pour laquelle furent inventées les fibules, ancêtres des épingles à nourrice, des broches et des boucles de ceintures, dont les premiers exemplaires connus remontent au Bronze final (civilisation mycénienne) et qui n’ont cessé de se perfectionner jusqu’à devenir des objets précieux, véritables marqueurs sociaux. On les nomme fermail dans la France médiévale. Elles sont encore portées avec certains vêtements traditionnels de diverses régions du monde comme le kilt écossais.
Le bouton représente un incontestable perfectionnement, car il permet à la fois un habillage et un déshabillage faciles grâce à des vêtements ouverts et adaptés à la forme du corps que l’on passe par les bras ou par les jambes, mais aussi le maintien en place ceux-ci sans qu’il soit besoin de les réajuster en permanence. Les vêtements boutonnés sont donc propices à la mobilité, au travail et à l’action. Cette invention à la fois simple et savante apparaît d’une part en Chine et, d’autre part, dans l’Europe médiévale.
Le bouton chinois remonte à une époque sans doute ancienne. C’est une simple boulette de tissu ligaturé, fixée sur un pan de vêtement croisé que l’on enfile dans un passant rapporté sur l’autre pan afin de le maintenir rapproché du premier. Sa rusticité n’en fait pas un marqueur social en soi, à la différence du tissu dont il est fabriqué : lin, coton ou soie, même si sa facture est plus raffinée, surtout s’il est brodé, sur les vêtements de soie, par exemple le qipao des femmes de la haute société mandchoue pendant la dynastie Qing (XVIIe-XXe siècles). Cette robe longue et ample a évolué au XXe siècle, à partir de la ville de Shanghai, en devenant moulante et fendue sur le côté, des pieds jusqu’à la cuisse, fermée sur le devant et en haut par une rangée de petits boutons chinois. Chez les hommes, la veste portée sur une robe et boutonnée jusqu’en haut se nommait changshan. Le costume mao n’a conservé d’elle que le boutonnage jusqu’au cou, mais au moyen de boutons à l’occidentale, en plastique pour les civils, en métal pour les militaires.
Le bouton en matériau dur est une invention européenne du Moyen Âge. Cousu directement sur un pan du vêtement, il est passé dans une fente ménagée sur l’autre pan, la boutonnière, ce qui donne à l’assemblage une bien plus grande résistance à l’effort que son équivalent chinois. C’est la raison pour laquelle il a séduit les hommes de l’aristocratie, cavaliers amoureux de la chasse et contraints à la guerre. Ces attaches de petit format, munies d’une queue trouée destinée à les coudre, se nomment alors noiel, noyel, nuel, nuiel ou nouyau, par analogie avec le noyau des petits fruits, tels ceux de la cerise ou de la prunelle. Joinville les mentionne dans ses mémoires à propos d’une robe offerte en 1250 par le sultan d’Egypte à Saint-Louis qui est son prisonnier, évoquant « grant foison de noiaus touz d’or… » (4).
C’est vers cette époque que change leur nom et qu’on les désigne par le mot bouton. Celui-ci dérive (5) du francique botan qui a donné le verbe bouter, lequel veut dire pousser. On ne retrouve dans arc-boutant, boutefeu, etc. Bouton apparaît pour la première fois chez Chrétien de Troyes en 1160 chez qui il désigne alors un bourgeon, c’est-à-dire une excroissance végétale qui pousse, puis en 1236, chez G. de Lorris, dans Le roman de la rose où il désigne une fleur avant son épanouissement. Chrétien de Troyes, dans Cligès, vers 1170, l’emploie pour la première fois au sens de petite pièce circulaire servant à fermer un vêtement, par analogie entre la forme de celle-ci et le bourgeon ou le bouton de fleur. Dès lors, la fente consolidée du pan du vêtement qui fait face à celui qui porte les boutons est dénommée boutonneure, puis boutonnière. Un larcin commis à la fin du Moyen Âge à Paris consiste en « un chapperon d’escarlate vermeille à boutons d’argent dorez… deux bourses et un pelleton à boutons d’argent dorez, huit petits boutons et un clou d’argent blanc… une boutonnetière esmaillée à seize boutons… » (6). La facture de ces boutons se perfectionne. De nombreux musées en possèdent et l’on en distingue parfois sur certains tableaux. Ils sont coulés (plomb) ou estampés (cuivre, argent) et portent de plus en plus souvent des ornements. Les premiers boutons percés de quatre ou six trous apparaissent au XVe siècle. Ils deviendront de plus en plus fréquents, mais les boutons à queue subsistent encore aujourd’hui sur certains vêtements (7). Les boutons servent à fermer les robes masculines ou féminines sur le devant ou le long des manches. Lorsque se répand à partir du XIVe siècle et surtout au cours de la Renaissance la mode des surcots ou chemises à épaules bouffantes, le boutonnage du bas des manches devient nécessaire afin de les resserrer au poignet et maintenir le foisonnement du tissu à la hauteur de l’épaulement. Cette pratique entraîne une diffusion plus large du petit accessoire, facilitée par la baisse du coût du cuivre. Un ou deux boutons à la hauteur des poignets subsistent aujourd’hui sur les chemises masculines et les chemisiers féminins. Les boutons de manchette, souvent en métal précieux, sont une invention du XVIIIe siècle qui s’est répandue au XIXe et a servi de signe distinctif pour la bourgeoisie et, plus largement, les cols blancs. Aujourd’hui, ils représentent un marqueur social des cadres supérieurs, au même titre que les chemises et costumes à rayure (8).
Dès cette époque, l’emplacement des boutons de vêtement principal est sexué : la rangée se situe à droite pour les hommes et à gauche pour les femmes. Plusieurs explications peuvent être avancées. La première est que la plupart des hommes s’habillent depuis longtemps seuls (9) et qu’il est plus facile pour les droitiers –majoritaires- de saisir les boutons de la main droite, active, pour les glisser dans la boutonnière tenue passivement par la main gauche. Les aristocrates devaient, par ailleurs pouvoir accéder facilement à leur épée, placée sous le pan de gauche de leur vêtement de manière à être saisie de la main droite. Il fallait donc que le pan de gauche soit placé par-dessus le pan de droite, ce qui n’exigeait pas de déboutonnage. Les femmes de la bonne société étaient souvent aidées pour s’habiller. Les boutons situés à gauche étaient donc à droite pour leurs femmes de chambre. Par ailleurs, tenant habituellement leurs jeunes enfants sur le bras droit, il leur était plus facile de leur donner à la demande, dans un premier temps, le sein droit et donc de déboutonner le vêtement avec la main gauche (10).
C’est au XVIIe siècle que le bouton devient plus qu’auparavant un simple accessoire de mode, perdant même sa fonction d’attache. Certains vêtements de cour, tant féminins que masculins, en comportent des dizaines. Les matériaux les plus luxueux sont utilisés : passementerie de soie, nacre, ivoire, métaux précieux, diamants et autres pierreries. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la porcelaine fait son apparition (11). Les grands peintres se font à l’occasion miniaturistes et signent des pièces uniques (Isabey, David, par exemple) (12). C’est ce qui fera dire à Charles Dickens à propos des boutons qu’ « il y a assurément quelque charme à voir la plus petite chose si finement ouvragée, comme pour rappeler au négligent que ce qui vaut la peine d’être fait mérite d’être bien fait. » (13). L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ne consacre pas moins de quatre pages de texte (14) et de six pages de planches aux boutons et aux instruments du boutonnier.
Ecclésiastiques séculiers (15), magistrats et avocats, professeurs portent depuis plusieurs siècles des soutanes ou des toges qui se ferment sur le devant par une impressionnante rangée de petits boutons. Ces uniformes sont encore portés aujourd’hui par tous, soit dans l’exercice habituel de leurs fonctions, soit à l’occasion de cérémonies particulières. Les boutons sont recouverts de tissu noir, violet, écarlate, selon la couleur du vêtement et le rang de celui qui le porte. Seuls les ecclésiastiques résidant dans les contrées tropicales et le pape portent une soutane blanche. Pie V est le premier pape à l’avoir portée, en souvenir de son passé dans l’ordre des Dominicains.
Il existe également des boutons fixés au bout d’un galon en passementerie et que l’on attache, comme en Chine, à un autre galon en forme de boucle ou de passant. Ce sont les attaches des vêtements militaires, dites brandebourgs, du nom de la ville allemande où ils sont devenus courants et d’où ils se sont répandus dans toute l’Europe entre le XVIIIe siècle et la Première Guerre mondiale. Ils étaient appliqués en grand nombre sur les dolmans, ces vestes courtes très ajustées des hussards qui bénéficiaient ainsi d’un véritable corset facilitant leurs rapides chevauchées. Le dolman est à l’origine une robe boutonnée que portaient les Turcs. J’ignore s’il s’agit d’une invention turque imitée par les armées d’Europe centrale ou d’une influence européenne sur les Ottomans. Utilitaires, les brandebourgs sont également devenus décoratifs, en particulier lorsqu’ils étaient apposés sur la pelisse qui se portait sur l’épaule et ne s’enfilait donc pas. Elle était l’une des parties essentielles du diszmagyar, l’habit de cérémonie des nobles hongrois.
Le duffle-coat anglais, ce lourd manteau de laine à l’origine destiné à la Navy, se ferme également à l’aide de brandebourgs dont les lanières sont souvent en cuir. Il tire son nom de la ville de Duffel, en Flandre Belge, près d’Anvers, qui avait au XIXe siècle la spécialité de tisser d’épais draps de laine résistant à la pluie et au froid. À partir de 1863, la Navy a imaginé d’en confectionner des manteaux à capuche destinés à ses marins. Leurs brandebourgs, au nombre de trois à cinq sont souvent en cuir et les boutons, au lieu d’être petits et métalliques, sont longs, coniques et pointus, en cuir roulé ou bien en corne de bovin ou de cerf, faciles à enfiler dans le passant, même avec des gants (16). C’est aujourd’hui un classique de l’habillement masculin décontracté dans les pays à hiver froid de culture anglo-saxonne. L’équivalent germanique est le loden, manteau lui aussi très chaud, mais plus ample et souple. Le tissu qui sert à sa confection a été inventé à Bolzano, dans le Tyrol du Sud. Il était à l’origine destiné à des capes de bergers. Il se ferme avec des boutons plats à trous, parfois en cuir tressé, parfois en corne de cerf. Il a longtemps été porté par les militaires et les chasseurs avant de conquérir les villes. C’est aujourd’hui un marquer identitaire germanique et, en France, un marqueur social, voire politique.
Un autre type de vêtement chaud des Îles britanniques est la veste de tweed qui se ferme à l’aide de boutons à queue habillés de cuir tressé. Elle est l’habit classique des gentlemen farmers et des chasseurs britanniques, devenu aujourd’hui dans tout l’Occident un vêtement d’hiver chic et décontracté, plutôt destiné aux hommes d’âge mûr, mais aussi parfois aux femmes outre-Manche.
Progressivement, au tournant du XIXe siècle, les boutons se répandent hors des milieux de cour, des armées, des clercs, de la justice ou de l’enseignement. Dans toute l’Europe, sous l’influence de l’élite, les habits de fête reprennent et interprètent les canons de la mode aristocratique (17). Certains costumes identitaires régionaux portent même des rangées de boutons purement décoratifs ne correspondant à aucune boutonnière. C’est le cas des vestes bretonnes masculines, par exemple (18). Cette folie du bouton est simultanée de celle des rubans, dans un contexte d’augmentation de la demande générale de vêtements et de diversification des étoffes, des matériaux les constituant, des modes de tissage et d’impression. L’augmentation des revenus dans les campagnes, en rapport avec la révolution agricole, en est la principale raison. On peut dire que la mode, phénomène relevant des représentations et de la culture, est à l’origine d’une si forte demande adressée aux manufactures de textile et aux artisans spécialisés dans les accessoires, qu’elle a constitué un remarquable stimulant de l’innovation technologique et donc un accélérateur de la révolution industrielle. Il n’y a pas lieu de s’en étonner, puisque toutes les révolutions technologiques ont une origine culturelle. C’est le cas, par exemple, de l’avènement du Néolithique dans le Croissant Fertile qui a été précédé d’une révolution religieuse, le culte du taureau et celui des déesses-mères (19), symbolisant la compréhension de la vie et le désir de participer activement à sa transmission et à son foisonnement.
Le rôle de la demande sur la révolution industrielle est bien connu pour l’industrie textile, mais peu étudié pour les boutons. A la fin du XVIIIe siècle, l’essor de la navigation et du commerce transcontinental permet l’arrivée en Europe de ces grands coquillages nacrés des mers du Sud. D’abord simples objets rares destinés aux cabinets de curiosité ou à servir de bénitiers dans les églises, ils deviennent si communs que l’on imagine d’en faire des boutons confectionnés à la machine. C’est en 1828 que cette industrie se développe en France dans la région de Méru dans l’Oise où l’on visite aujourd’hui un musée de la nacre et de la tabletterie (dominos, éventails, jumelles, broches, etc.). En Angleterre, le passage de l’artisanat à l’industrie du bouton revient à Matthew Boulton (1728-1809) qui fabrique des boutons de diverses catégories dont les plus raffinés sont formés d’un socle en métal surmonté d’un décor en porcelaine de Wedgwood.
À la fin du XIXe siècle, un matériau nouveau parvient en Europe, le tagua ou corozo, tiré du fruit du palmier à ivoire, nom donné à diverses espèces du genre Phytelephas (éléphant végétal) parmi lesquelles Phytelephas macrocarpa (20). Originaire des forêts équatoriales d’Amérique du sud, il est depuis longtemps utilisé par les Indiens pour confectionner des bijoux, ce sont les Allemands qui découvrent l’intérêt de l’ivoire végétal dans la fabrication des boutons en 1865, à l’occasion d’une cargaison chargée à Esmeraldas en Équateur et débarquée en 1865 à Hambourg. L’Équateur demeure aujourd’hui l’un des premiers producteurs de ce matériau (100 000 tonnes) qui est un substitut de l’ivoire (pour recouvrir les touches de piano, par exemple), mais dont une infime partie est exportée à destination des fabricants de boutons .
Au XXe siècle, les matériaux traditionnels destinés à la fabrication des boutons seront remplacés par la bakélite, puis des matières plastiques les imitant plus ou moins bien ou permettant des fantaisies tout à fait nouvelles, tant dans les couleurs que les formes.
Pour achever cette fresque incomplète à travers l’espace et le temps, il faut évoquer la diffusion actuelle du vêtement boutonné à travers la terre entière, en particulier la chemise masculine et le chemisier féminin. En dehors du T-shirt (ou marinière) et du pull-over, les vêtements traditionnels enfilés sont entrés dans la sphère folklorique ou cérémonielle. Le dernier vêtement drapé à demeurer populaire est le sari, mais résistera-t-il à la croissance économique du subcontinent indien ? Il y a fort à parier qu’il subira le même sort que le kimono japonais qui n’est plus guère porté que par les femmes âgées ou à l’occasion de cérémonies familiales ou calendaires. Devenu ubiquiste, le bouton ne pourra bientôt plus faire l’objet d’une géographie.
Dans le même temps, il est battu en brèche par des fermetures plus commodes. En 1885-86, le bouton-pression est simultanément inventé dans trois pays d’Europe : par Bertel Sanders en Danemark, par Herbert Bauer en Allemagne et par Albert-Pierre Raymond à Grenoble. Ce dernier avait déjà inventé dès 1865 le bouton métallique à rivet, beaucoup plus résistant que le bouton cousu, à la condition que le support textile le soit lui-même (21). Grenoble étant avec Millau l’une des capitales françaises des gants, Raymond avait imaginé de les munir d’un bouton pression pour faciliter leur fermeture et leur ouverture. Le bouton à rivet séduira les fabricants de jeans, ce pantalon de toile créé en 1853 à San Francisco par un certain Levi Strauss et qui est en passe de devenir universel (22). D’abord cousu, le bouton-pression a bénéficié de la technique du rivet et l’a totalement adoptée. Le véritable concurrent du bouton est la fermeture à glissière, dite aussi à crémaillère, tirette en Belgique, zip dans les pays anglo-saxons. Elle a été inventée aux Etats-Unis par Gideon Sundbäck en 1914. Le nom de fermeture-éclair est breveté ; il désigne une marque déposée par la Société Éclair Prestil SN. Le plus récent mode de fermeture concurrent du bouton est le velcro, qui utilise les propriétés agrippantes de certains textiles synthétiques.
Le lecteur qui aura eu la patience de parvenir jusqu’à cette conclusion est en droit de s’étonner qu’il soit si peu question des « boutons de culotte » qui ont suscité ce texte. C’est tout simplement que les culottes ou les pantalons en comportent peu : trois ou quatre en général, à l’emplacement de la braguette, lorsqu’ils ne sont pas remplacés par une fermeture éclair. Ils en ont perdu entre 4 et 8 depuis que les bretelles sont devenues un accessoire rare –encore un marqueur social- remplacé par les ceintures, sauf dans le cas de la lederhose, la culotte de peau bavaroise qui est d’ailleurs à pont et non à braguette, par conséquent fermée de deux boutons seulement sur le devant. Avant même de disparaître, leur attache par un passant à des boutons avait d’ailleurs été remplacée par un système à pression, comparable à celui des porte-jarretelles.
« Bouton de culotte » est devenu une expression plaisante pour désigner un objet de peu, par exemple un petit fromage du Mâconnais. Jadis, à la messe, les pingres déposaient de vrais boutons de culotte dans les bourses, aumônières ou corbeilles de quête. La modestie de leur usage et de leur destin n’a eu longtemps d’équivalent que leur caractère indispensable pour assurer la fermeture ou le maintien des vêtements. On sait le rôle majeur que ces menus accessoires jouent dans La guerre des boutons, le célèbre roman de Louis Pergaud publié en 1912. C’était alors l’apogée du bouton, qu’il soit de culotte ou d’autre vêtement. Les temps changent et le bouton terminera peut-être sa longue histoire dans les vitrines des musées. Signe inquiétant : une phobie du bouton, la fibulanophobie, a même été recensée parmi les troubles psychologiques de notre époque ! Imaginons un instant qu’elle soit contagieuse. Je ne souhaite pas à Claude Bataillon de la contracter !
Notes :
1. Pitte Jean-Robert (dir.), 1995, Géographie historique et culturelle de l’Europe. Mélanges offerts à Xavier de Planhol, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 423 p.
2. Bataillon Claude, 1998, « Une géographie historique et culturelle », L’Espace géographique, Tome 27, n°3, p. 287-288.
3. Prévôt-Schapira M.-F. et Rivière d’Arc H. (dir.), 2001, Les territoires de l’État-nation en Amérique latine. À Claude Bataillon, Paris, IHEAL éditions. Les textes rassemblés dans ces mélanges évoquent, d’ailleurs, des sujets extrêmement variés tels que le développement, les découpages territoriaux, les identités, les pouvoirs, les mobilités… C’est ce que remarque Sébastien Velut qui aurait souhaité que ces contributions soient davantage en rapport avec les propres travaux de Claude Bataillon et forment un ensemble plus homogène. Cf. Sébastien Velut, 2003, « Un hommage à Claude Bataillon », L’Espace géographique, 3, p. 282-283. Gageons que, même si le volume n’est pas totalement conforme à son idéal, Claude Bataillon a tout de même accepté avec plaisir l’hommage de ses amis.
4. Labrot J. et Rondel G., 2001, Les boutons au Moyen Âge, Moyen Âge, 25, p. 44-47. Je dois cette référence à Martine Tabeaud.
5. Ce qui suit provient du Trésor de la Langue française.
6. Labrot J. et G. Rondel, op. cit., p. 45.
7. Ibid.
8. Pastoureau Michel, 1991, L’étoffe du diable, Paris Seuil.
9. À l’exception des chevaliers revêtant leur armure ou des souverains leur habit de cérémonie.
10. http://www.twikeo.com/pourquoi-les-chemises-d-hommes...
11. Il existe sur ces boutons précieux une très abondante bibliographie essentiellement destinée aux collectionneurs. Voici quelques titres : Fink Nancy and Ditzler Maryalice, 1994, Buttons: The collector’s Guide to Selecting, Restoring and Enjoying New and Vintage Buttons, Londres, Quintet Publishing, 1994, Epstein Diana, 1996, Le petit livre des boutons, Paris, Jeu d’Aujourd’hui, Primrose Peacock, Discovering old buttons, Princes Risborough, Shire books, 1996, Meredith Allan and Gillian, Cuddeford Michael J., 1997, Identifying buttons, Chelmsford, Mount Publications, Loïc Allio, 2001, Boutons, Paris, Seuil. Boutons, phénomène artistique, historique et culturel, catalogue d’exposition, Paris, Fondation Mona Bismarck, 2010.
12. On connaît, par exemple, une série de boutons ornés d’une aquarelle sous verre représentant les barrières du mur des Fermiers Généraux de Paris. Yvette Chupin, Boutons à visage découvert, Aladin, mars 2002, pp. 40-43. Certains boutons présentés dans cet article destiné aux collectionneurs sont estimés à plusieurs centaines d’euros pièce !
13. http://www.monabismarck.org/index_fr.html, p. 2.
14. 1e édition, Tome 2, 1751, p. 382-385.
15. Les réguliers portent des robes ou coules de facture archaïque qui se passent par la tête, comme d’ailleurs les vêtements liturgiques de tous les clercs : aube, rochet, chasuble, camail. La chape portée lors de certaines cérémonies, à plus forte raison la cappa magna des évêques et cardinaux, est jetée sur les épaules et est maintenue par un fermail unique. Les prêtres séculiers ont d’ailleurs toujours été autorisés à s’adapter aux modes de leur époque et du pays dans lequel ils vivent. En Europe occidentale, la plupart des prêtres catholiques ont adopté la chemise et le costume, avec ou sans cravate. La recommandation du col romain fait l’objet d’un suivi très variable. Néanmoins la soutane à boutons demeure davantage portée en Italie qu’ailleurs, peut-être en raison de la proximité de Rome.
16. Le caban est son pendant court et dépourvu de capuche. Il est pratique pour les pêcheurs et les skippers, mais se ferme avec de gros boutons plats à trous qui exigent de quitter les gants.
17. Lethuillier Jean-Pierre (dir.), 2009, Les costumes régionaux entre mémoire et histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009.
18. Ibid. Voir photo d’une veste de 1828, pl. couleurs I.
19. Cauvin Jacques, 1994, Naissance de l’agriculture, naissance des divinités. La révolution des symboles au Néolithique, Paris, CNRS-Editions.
20. Je remercie Micheline Hotyat de m’avoir éclairé sur cet arbre et sur les usages que l’on fait de ses fruits.
21. L’entreprise A. Reymond existe toujours et a diversifié ses activités. Un musée de ses fabrications peut être visité à Grenoble (Arhome Musée).
22. Marsh Graham et Trynka Paul, 2002, Denim : l’épopée illustrée d’un tissu de légende, Paris, éditions du collectionneur. Comme dans tant d’autres domaines de la culture, le jeans a pu pendant un temps être de facture stéréotypée. Depuis une trentaine d’années, il s’est extraordinairement diversifié, voire personnalisé grâce aux modèles innombrables fabriqués partout dans le monde, à l’usure naturelle ou artificielle, apparente dans la couleur du tissu et dans la taille et dans le nombre, la taille et la répartition des trous qui font de chaque pantalon un vêtement unique.
Editorial | Publié le 2013-06-03 13:57:11 |
Par Philippe Boulanger
La géographie historique est peu ou mal connue en France. Pourtant, nombreux sont les géographes français à en exploiter toutes les dimensions dans leurs travaux de recherche sans forcément la revendiquer. Depuis les années 1990, comme l’écrit Jean-Robert Pitte en 1994, dans un numéro d’Hérodote consacré à la géographie historique, dont les réflexions sont encore d’actualité, « on assiste aujourd’hui en France à un regain d’intérêt pour l’application de toutes les méthodes géographiques à l’analyse du passé » [J.-R. Pitte, 1994].
La question de l’utilité de la géographie historique aujourd’hui est devenue un faux-débat tant les publications collectives comme les monographies ont montré l’indispensable compréhension du passé dans l’étude des espaces et des hommes. Pour répondre aux problèmes de société en matière d’aménagement du territoire et des paysages, comprendre les évolutions politiques, économiques, sociales et culturelles des hommes sur leur territoire, la géographie historique s’est imposée comme une démarche nécessaire au risque de manquer d’une solide réflexion pour mesurer l’ensemble des enjeux, des paramètres et des acteurs. Jean-Robert Pitte en avait montré toute l’importance lors du colloque international « Où en est la géographie historique ? », organisé à l’Université Paris-Sorbonne en 2002 : « La géographie historique qui est toute la géographie conjuguée à toute l’histoire, dans les préoccupations et les méthodes les plus variées de ces disciplines, peut contribuer utilement à éclairer certains problèmes contemporains les plus cruciaux » [J.-R. Pitte, 2005].
La fondation de la Revue de géographie historique française vient répondre à cet objectif de mieux la faire connaître. Elle s’inscrit aussi dans la continuité de cette dynamique de développement de la géographie historique depuis plus de vingt ans, animée par un certain nombre de géographes tels Jean-Robert Pitte, Xavier de Planhol, Christian Huetz de Lemps, Paul Claval, Daniel Balland, Christian Grataloup, Jean-René Trochet, Jean-Pierre Husson, André Humbert et biens d’autres. Aujourd’hui, une nouvelle génération de géographes poursuit ces efforts entrepris voici deux décennies. Dans toutes les spécialités de la géographie, la géographie historique est dynamisée par une nouvelle énergie. Eric Fouache (géoarchéologie), Géraldine Djament (géohistoire de la ville), Michel Deshaies et Simon Edelblutte (géographie historique industrielle), Xavier Rochel et Jean-Yves Puyo (géographie historique de l’environnement et de la forêt), et biens d’autres géographes français, dont les noms ne peuvent être tous cités, y participent. Cette revue est naturellement l’un des lieux d’expression et de diffusion de la géographie historique, l’un des témoins et relais de transmission de savoir-faire entre toutes les générations de géographes qui s’intéressent à cette approche ancienne de la géographie.
Faut-il rappeler l’ancienneté de la géographie historique ? Yves Lacoste, dans l’introduction de ce même numéro d’Hérodote, en 1994, soulignait d’emblée ses origines dans la construction de la géographie française. Elisée Reclus comme Vidal de la Blache, à la fin XIXe siècle, appuyaient leur raisonnement dans la profondeur du temps, cherchaient à approfondir leurs analyses dans le « passé des territoires ». « La géographie n’est autre chose que l’histoire dans l’espace, de même que l’histoire est la géographie dans le temps » écrivait Elisée Reclus dans chacun des six volumes de L’Homme et la Terre [Y. Lacoste, 1994] Plus tard, Roger Dion, dans sa leçon d’ouverture prononcée le 4 décembre 1948 au Collège de France, exprime la même complémentarité des deux disciplines comme la singularité de la géographie historique. « Tout paysage humanisé est le reflet de l’histoire (…). Jusque dans la répartition géographique de nos industries modernes, concentrées et mécanisées, paraissent des traits qui resteraient inexpliqués si l’on ne se reportait à l’état des choses antérieur au machinisme (…) » [J.-R. Pitte, 1994]. La relation entre histoire et géographie n’a pas perdu de sa pertinence ; au contraire. Parallèlement à ce regain d’intérêt dans les différentes spécialités de la géographie, nous constatons qu’un certain nombre d’historiens manifestent aussi de leur côté un retour sur leur lien ancien avec la géographie.
Il existe ainsi une tradition française et un courant de pensée en géographie historique qui se maintiennent contre vents et marées, malgré le pessimisme ambiant de certains en géographie. L’une de ses spécificités réside dans la dimension fédératrice d’un ensemble de compétences et de savoirs en géographie physique et humaine, histoire, archéologie, sociologie, ethnologie, anthropologie. Elle se veut décloisonnée en embrassant l’ensemble des temporalités et des spatialités, ouverte sur les questions du temps présent, pragmatique et utile pour répondre aux questions de société, enrichie par l’apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il faut donc penser que la géographie historique a de beaux jours devant elle, non seulement parce qu’une nouvelle génération de géographes poursuit une œuvre commencée, innove et produit de nombreux travaux scientifiques, mais aussi du fait de l’existence de nouveaux moyens numériques de diffusion. Cette revue en ligne, gratuite et bi annuelle, en est un exemple aux côtés de certaines créations récentes tel le blog Carnet de géohistoire.
Dans d’autres pays européens, la géographie historique tend aussi à se redéployer. En Angleterre, le groupe de recherche en géographie historique publie régulièrement un bulletin d’informations, organise des manifestations annuelles, participe activement au congrès de géographie historique (voir la Note sur le Congrès de géographie historique à Prague en août 2012 par Jean Martin). En Italie, la géographie historique tend aussi aux mêmes efforts de diffusion, comme en témoigne la création récente, à la fin 2012, de la collection Transverse, chez l’éditeur Il melangolo, par le Centre d’études en géographie historique, animé par les professeurs Claudio Cerreti (Université de Rome 3), Massimo Quaini (Université de Gênes) et Luisa Rossi (Université de Parme). Les prochains numéros de la Revue de géographie historique prévoient justement d’être consacrés à cet essor dans plusieurs pays européens (Allemagne, Angleterre et Italie notamment).
Le premier numéro de cette nouvelle revue numérique, intitulé Regards sur la géographie historique, aborde un ensemble de sujets qui illustrent la spécificité de cette approche de la géographie. Plus personne n’en conteste aujourd’hui l’existence. Pourtant, il y a encore deux décennies, dans la période dite de la nouvelle géographie, il n’en fut pas ainsi. Jean-Robert Pitte, dans « Pour une géographie historique du bouton de culotte », nous fait part de son engagement, dans les années 1990, en faveur de cette reconnaissance. Son expérience témoigne ainsi des « réserves » que certains pouvaient manifester, à cette époque, sur les nouvelles études en géographie historique et culturelle. A travers l’étude de la conception, la fabrication et la diffusion des usages des boutons dans le monde, nous découvrons une véritable géographie historique des civilisations et des cultures, reflet d’un perfectionnement de l’évolution des vêtements variant selon les époques et les sociétés. Paul Claval, dans « La géographie historique, une courte histoire », montre comment la géographie historique est entrée progressivement dans une phase de maturité depuis le XVIIIe siècle. Celle-ci s’est émancipée progressivement de la cartographie et s’est développée en s’inspirant des mutations conceptuelles de la géographie anglo-saxonne au XXe siècle. Eric Fouache, dans « Les villes du passé face à leur environnement », aborde les dynamiques environnementales en relation avec l’archéologie. Il illustre toute l’utilité de la géographie historique pour comprendre et anticiper les risques urbains actuels pour l’aménagement et pour la mémoire patrimoniale. Nicola Todorov s’intéresse à la complémentarité de la géographie et de l’histoire dans l’enseignement secondaire à partir de plusieurs enquêtes menées sur le terrain. Alors que dans d’autres pays européens les deux disciplines sont enseignées par plusieurs professeurs, il en est autrement en France. Cette spécificité française est l’objet de son article intitulé « Histoire-géographie, géographie historique et histoire géographique dans l’enseignement secondaire ». L’auteur montre que les deux disciplines peuvent tirer profit de leurs différences et de leur complémentarité. Enfin, Philippe Boulanger, dans « La renaissance de la géographie historique en France depuis les années 1990 », tente de souligner ses spécificités temporelles et spatiales en insistant sur son utilité pour répondre aux grandes questions de société. Cet article apparaît complémentaire de celui de Paul Claval et met en évidence le regain d’intérêt pour la géographie historique aujourd’hui et la diversité de ses approches.
Références
Lacoste Y. (1994), « Le passé des territoires », Hérodote, n°74-75, p. 3-6.
Pitte J.-R. (1994), « De la géographie historique », Hérodote, n°74-75, p. 14-21.
Pitte J.-R. (2005), « La géographie historique au service des problèmes d’aujourd’hui », dans Où en est la géographie historique ?, sous la direction de Jean-René Trochet et Philippe Boulanger, L’Harmattan, 2005, 195-202.
Les hérauts d’armes et le savoir géographique (XVe-XVIe siècles) | Publié le 2020-11-05 13:52:18 |
Par Pіеrre Соuhаult (professeur agrégé, docteur en histoire, Centre Roland Mousnier, UMR 8596)
Résumé : Voyageurs invétérés, connaisseurs du monde et des hommes, les hérauts d’armes de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne ont laissé des œuvres dans lesquelles les notations géographiques abondent. Si elles ne forment qu’exceptionnellement des fragments où la description de l’espace est une fin en soi, elles ne laissent pas de rendre compte de la manière dont ces officiers et la société aristocratique de leur temps concevaient le monde qui les entourait. Polarisé par des logiques politiques en Europe, il se chargeait d’une dimension d’exotisme et de merveilleux dans le lointain (1).
Abstract: During the Late Middle Ages and early modern period, heralds were inveterate travellers and held a fine knowledge of the world and of men. As such, they left us works willed with geographical elements. Though they are seldom used per se, these notations suggest how these men and the aristocratic society of the time conceived the surrounding world. Their space had a strong political structuration when they thought about Europe, but became deeply exotic and marvellous about further lands.
Mots clés : Hérauts, armoriaux, descriptions de pays, savoirs géographiques.
Keywords: Heralds, rolls-of-arms, chorography, geographic knowledge.
Toute géographie est une représentation du monde, à la fois héritage des conceptions ou des représentations antérieures et reflet, plus ou moins conforme, des connaissances contemporaines (Abry, 2000, 84).
Comme le rappelait Josèphe-Henriette Abry, les écrits géographiques du passé ne sont pas seulement des corps de savoirs plus ou moins exacts ; ils traduisent un système de représentations. Étudier les savoirs et les textes géographiques permet en effet de saisir la façon dont les hommes envisageaient l’espace qui les entourait. L’ordre des éléments, leur description, le choix des territoires et celui des données considérées comme pertinentes donnent une idée de la grille à travers laquelle géographes et sociétés lisaient le monde dans lequel ils vivaient.
Mais que faire lorsqu’il n’existe pas de littérature géographique à proprement parler ? Une telle histoire des représentations du monde devient aisée à partir de l’essor de la cosmographie et de la cartographie, au xviesiècle. La situation se complique en revanche pour les textes plus anciens : qualifier ces descriptions du monde de géographies n’est pas toujours évident (Gautier Dalché, 2001, p. 132-133). Même à considérer qu’en la matière la Renaissance a pu commencer au xive siècle, la discipline n’en n’était qu’à ses balbutiements aux alentours de 1500. Les savoirs étaient pourtant bien présents, même s’ils étaient souvent disséminés dans des textes ayant apparemment d’autres finalités et ne formaient donc qu’exceptionnellement un corps autonome.
Parmi ces sources pré-géographiques, celles des hérauts d’armes ont un intérêt particulier. Léonard Dauphant avait souligné leur spécificité à propos des descriptions du royaume de France : ces officers furent peut-être les auteurs des premières véritables chorographies du royaume en langue vulgaire (Dauphant, 2012 et 2009).
Les écrits des hérauts présentent un autre intérêt : ils constituaient une sorte de corpus encyclopédique des savoirs de l’élite aristocratique et princière de la fin du Moyen Âge. Histoire, blason, religion et géographie s’y combinent pour dessiner un tableau assez complet de l’univers mental la société chevaleresque de l’époque. En cela, ces textes et leurs auteurs constituent « l’expression vivante d’une certaine vision du monde » (Stanesco, 1988, p. 184 ; voir aussi Hiltmann, 2004, p. 227-228 et 231), tout à fait propice à servir de matériau à une histoire des représentations de l’espace.
I. Un personnel bien placé et bien informé
A. Qu’est-ce qu’un héraut d’armes ?
Les hérauts d’armes constituèrent, au Moyen Âge et à l’époque moderne, un corps remarquable des entourages aristocratiques et princiers (Van Anrooij, 1990 ; Melville, 1992, 1995, 1998 et 2002 ; Pastoureau, 1997, p. 59-65 ; Contamine, 1994 ; Schnerb, 2006 ; Bock, 2015). Vraisemblablement apparus entre la Loire et le Rhin à la fin du xiie siècle, ces personnages étaient initialement chargés de tâches annexes dans le déroulement des tournois : reconnaître les participants, commenter les passes, noter les scores, proclamer les vainqueurs… Il s’agissait alors d’employés itinérants et relativement subalternes qui louaient leurs services au gré des festivités (Simonneau, 2010, p. 284-288).
Mais dans le cours du XIVe siècle, d’abord en France puis dans tout l’Occident, l’office connut un triple mouvement de développement, d’ascension et d’institutionnalisation.
Ses membres se sédentarisèrent au sein des maisonnées royales puis aristocratiques et nobiliaires. D’employés itinérants payés à la prestation, ils devinrent des officiers domestiques, gagés par les princes et les seigneurs, puis les villes et les républiques. À côté des tournois, ces nouveaux employeurs leurs confièrent de nouvelles missions : messageries en temps de guerre et de paix, information et communication, cérémonial et protocole…
Dans le même temps, le groupe se hiérarchisa sur le modèle des corporations, avec des sortes d’apprentis (poursuivants d’armes), de compagnons (hérauts d’armes) et de maîtres (rois d’armes). Ces derniers avaient autorité sur l’ensemble des officiers d’une province héraldico-féodale appelée la marche d’armes.
Ils se sentirent surtout obligés de justifier leur existence : ils commencèrent à rédiger des manuels et des traités, sans doute autant destinés à la formation d’un esprit de corps qu’à la promotion de l’office auprès des nobles. Ces recueils très composites, formés en grande partie de copies et d’adaptations d’autres textes, regroupaient des éléments plus ou moins légendaires sur l’origine et les privilèges des hérauts, des fragments historiques sur la noblesse et les princes, des passages didactiques ou techniques sur le blason et les cérémonies, des catalogues de nobles et de pays, et bien d’autres matières dont la cohérence n’est pas toujours évidente (voir Boudreau, 2006 et Hiltmann, 2011). La meilleure façon de les appréhender est sans doute de les comparer à de petites encyclopédies chevaleresques et nobiliaires.
À la jointure des xve et xvie siècles, l’office d’armes était à son apogée et bénéficiait d’une reconnaissance à peu près générale en Europe. Poursuivants, hérauts et rois d’armes formaient un réseau international, commun à l’ensemble des cours d’Occident (Nadot, 2008). Cette position, ainsi que leurs missions, faisaient d’eux des voyageurs professionnels, particulièrement à même de constituer un savoir géographique de première main (Bresc et Tixier, 2010).
B. Des voyageurs professionnels
Les expériences de prosopographie menées sur le personnel de la cour de Bourgogne ont en effet montré que le quotidien des hérauts était avant tout fait de déplacements (Hiltmann, 2006, p. 507). Itinérance du prince, des seigneurs et des armées, messageries, ambassades et voyages d’information formaient l’ordinaire de ces officiers. Deux éléments les rendaient particulièrement propres à cela. D’une part, on leur reconnaissait une forme d’immunité qui leur permettait de circuler librement et sans risque de molestation à travers tout l’Occident – en temps de guerre comme de paix. D’autre part, ils recevaient de leur employeur un habit à ses armoiries et un nom d’office – nom de fief ou de devise – qui les désignaient comme des doubles emblématiques de lui-même et authentifiait leur parole (Hablot, 2006).
De ce fait, jusqu’au développement des postes au début du xvie siècle, les hérauts formèrent un des principaux moyens de communication à distance, à côté des chevaucheurs et des ambassadeurs (Spitzbarth, 2006). Les premiers servaient pour les messages les plus communs, généralement sur de courtes distances. Les seconds, au contraire, avaient la charge de missions souvent plus lointaines et engageant la politique ou le prestige du prince. Les officiers d’armes étaient à mi-chemin entre ces deux groupes.
Les poursuivants étaient plus ou moins interchangeables avec les chevaucheurs : ils portaient des lettres de leur maître, assuraient les communications entres les armées, annonçaient les fêtes et les célébrations, accompagnaient les ambassadeurs étrangers (Spitzbarth, 2006, p. 564-566). Les hérauts et, surtout, les rois d’armes se voyaient confier des missions plus importantes. On pouvait les envoyer auprès de cours parfois éloignées, le plus souvent pour accompagner les plénipotentiaires, mais parfois aussi avec de véritables pouvoirs de négociation. En 1448, Gilles le Bouvier (héraut Berry du roi de France) accompagna ainsi Jacques Cœur à Rome pour solenniser le soutien de Charles vii à Nicolas v dans son conflit avec l’antipape Félix (de Boos, 1995, p. 6). Au cours de la seule année 1451, Jean Lefèvre de Saint Rémy (roi d’armes Toison d’or du duc de Bourgogne) fut dépêché en Aragon et à Naples, pour resserrer les liens d’amitié entre son maître et les souverains de ces deux pays (de Gruben, 1997, p. 268). Au XVIe siècle, encore, malgré le développement des postes, un héraut comme Jean Glannet (roi d’armes Bourgogne de Charles Quint) reçut des missions auprès des rois d’Angleterre, de Pologne, de France, d’Écosse et de Portugal en à peine une douzaine d’années de carrière.
Envoyés à courte ou longue distance, ces officiers étaient des agents écoutés des princes, qui en attendaient généralement des rapports détaillés. Chroniqueurs et historiographes s’adressaient également à eux pour obtenir des informations (Stanesco, 1988, p. 183-196). Les hérauts devaient donc être attentifs à tout lors de leurs voyages. À l’occasion, leurs employeurs les dépêchaient tout simplement pour se renseigner sur un événement ou sur un lieu. En 1415, Jean Ier de Portugal envoya ainsi un de ses officiers d’armes au concile de Constance pour effectuer une mission à mi-chemin entre le journalisme et le renseignement (Paravicini, 2008). Philippe le Bon, de même, envoya à plusieurs reprises des hérauts en Orient pour faire des repérages en vue de ses divers projets de croisade. En 1421, le roi d’armes Artois accompagna Gilbert de Lannoy et Jean de Roe en Égypte et au Levant. En 1438, ce fut Hollande qui partit pour la Terre Sainte, suivi de Bourgogne, aux côtés de Jean de Créquy, en 1448. En 1457, Montréal partit pour les marches de la Turquie, sans doute dans la perspective d’une future expédition navale. Dans le même temps, Toison d’or fut également envoyé à Grenade repérer les « destrois du pays » pour une éventuelle expédition espagnole (Paviot, 2003, p. 64-65, 86, 113, 153 et 115).
Les « visitations héraldiques » constituaient également un motif, au moins théorique, de voyage sur le terrain : à partir du xve siècle, les souverains anglais ordonnèrent régulièrement à leurs officiers d’armes de visiter le royaume, les villes et les villages pour recenser les nobles et les armoiries et corriger les abus en ces matières (Ailes, 2006). Ailleurs, la réalité de ces enquêtes n’est pas établie, même si des hérauts français et bourguignons les évoquent dans leurs traités. En France, cette exigence apparaît pour la première fois dans le traité du roi d’armes Montjoie, dans le premier quart du xve siècle, mais les deux seules commissions royales ordonnant aux hérauts de visiter les provinces datent de 1487 et 1535 (Mathieu, 1946, p. 64-67). Aux Pays-Bas, des traités et règlements intérieurs du corps des hérauts évoquent également ce devoir, mais aucun ordre du souverain ne les confirme avant le xviie siècle (Simoneau, 2010/b).
Ces nombreux déplacements amenaient les officiers d’armes à accumuler des connaissances – davantage vernaculaires que savantes – sur les pays traversés. En France, le héraut Berry composa même un livre complet de descriptions de pays, à partir de ses voyages :
Comme j’ay fait le temps passé à veoir le monde, et les diverses choses qui y sont, et aussi pour cc que plusieurs en veullent savoir sans y aler, et les aultres veullent veoir, aler, et voyager, j’ay comrnencé ce petit livre , selon mon petit entendement, afin que ceulx qui le verront puissent savoir au vray la manière, la forme et les propriétés des choses qu’ilz sont en tous les royaulmes crestiens et des autres royaulmes où je me suis trouvé (Le Bouvier, 1908, 29).
Nous reviendrons plus en détail sur ce document fondamental.
C. La géographie : un savoir nécessaire aux hérauts ?
Cet état de fait se traduisait dans le choix et la formation des jeunes officiers d’armes. Tout théoriques qu’ils aient étés, les traités compilés par les hérauts déclarent en chœur qu’un poursuivant devait connaître le monde. Les récits sur la fondation légendaire de l’office d’armes sont explicites à cet égard. L’Épître devant Carthage, un fragment du début du xve siècle assez commun dans cette littérature (Hiltmann, 2011, p. 442), affirme ainsi que les premiers hérauts furent désignés par Scipion, « principal victorieux de tout le monde », parmi les soldats qui l’avaient suivi dans ses différentes campagnes. Au nombre de douze, ils devaient être envoyés
Par le monde ès trois parties universelles qui tout comprendent en la nostre congnoissance, dont les quatre yront en Europe, les aultres quatre en Asie, et les quatre aullres en Affricque (Courtois, 1867, 42).
Un autre texte du même genre et de même époque, le Traité selon les dits (Hiltmann, 2011, p. 240-262 et 441), précise davantage pourquoi ces voyages étaient nécessaires dans la formation du futur héraut. Un règlement de l’office, supposément accordé par César, y déclarait :
Si doivent iceulx roix et princes dessusditz eslire et choisir jones gens de l’eaige de vingt ans ou en dessus, bien doctrinés et de bonne condition, et les envoyer par le monde ès ditz royaulmes, provinces et cités, pour veoir, aprendre et congnoistre les grans fais, battailles, honneurs, estats, noblesses et magestés des grans seigneurs de par le monde (Courtois, 1867, 52).
Le but de ces voyages initiatiques n’était donc pas tant de connaître l’espace et les territoires que d’avoir vu les cours et leurs usages, le monde et ses gloires. Le Nobiliario Vero de Feran Mexia, repris par le roi d’armes Aragon à la fin des années 1510, confirme cette vision en rapportant l’idée que
Si quelque homme vertueux s’est rendu ou a été dans sept royaumes chrétiens et a vu plusieurs tournois et joutes, batailles et rencontres, parce qu’il en aura vu autant [qu’un poursuivant], il pourra être idoine et digne de parvenir au noble office de héraut sans avoir été poursuivant (BNE, ms. 3258, f°68v).
Dans ces traités théoriques et ces légendaires, c’était là le seul moyen pour devenir héraut sans avoir été au préalable poursuivant : il fallait avoir voyagé et vu le monde, connu la guerre et les fêtes.
De fait, l’étude des carrières réelles des officiers d’armes du xve siècle montre que les poursuivants étaient prioritairement choisis parmi un groupe d’employés qui répondait à cette attente : les chevaucheurs (Simonneau, 2010, p. 48). Ces domestiques servaient de messagers et sillonnaient en permanence les routes pour porter les lettres de leur maître à ses vassaux ou à ses pairs. La proximité de cette fonction avec les missions diplomatiques confiées aux poursuivants explique sans doute cette prépondérance. On comprend dès lors l’insistance des traités sur la nécessité de connaître les pays et les grands : de telles connaissances étaient souhaitables, chez un officier qui allait être amené à se déplacer régulièrement pour porter les messages de son maître et le représenter auprès d’un vassal ou d’un potentat.
Au xvie siècle, la situation évolua peu à peu, signe de l’ascension sociale des officiers d’armes, mais aussi de l’élévation progressive des petits offices de cour. Des lettrés et de petits seigneurs firent leur apparition parmi les hérauts. Le milieu de recrutement se déplaça progressivement de l’écurie au personnel des bureaux et au milieu des artistes (Couhault, 2020, p. 134 sqq.). Après 1530, la culture humaniste fit également des progrès dans le métier. Surtout, à partir des années 1540, une proportion étonnante des hérauts au service des Habsbourg allait avoir une activité plus ou moins durable de cartographe.
II. Les productions géographiques des hérauts
Cette importance du voyage, ce devoir de connaître le monde expliquent sans doute la présence fréquente d’éléments témoignant d’un réel savoir géographique dans les écrits et productions diverses des hérauts.
A. Armoriaux et listes de fiefs
Depuis le xviie siècle et la création du terme « héraldique » pour désigner la science du blason, les hérauts sont indissolublement associés aux recueils d’armoiries connues sous le nom d’armoriaux. La situation semble en fait avoir été bien plus complexe (Hiltmann, 2012), mais il est certain que de nombreux officiers d’armes sont à l’origine de telles compilations. La recherche distingue ordinairement trois grands types d’armoriaux – généraux, occasionnels et institutionnels (Pastoureau, 1997, p. 223-224). Ces deux derniers types ne nous intéresseront pas ici, puisqu’ils recensent les personnes présentes à une occasion particulière ou les membres d’une institution. Le premier, en revanche, témoigne d’une connaissance organisée du monde et de l’espace. Dans un armorial général, en effet, le compilateur recense les armoiries qu’il connaît ou qu’il a relevées sur un territoire donné : une ville, un pays ou une province, parfois même sur l’ensemble du monde. Originellement, ces blasons étaient ceux de personnes, puis des fiefs, des villes ou des institutions s’y sont ajoutées voire substitués.
Derrière leur façade armoriée, ces documents renvoient en fait à la forme par excellence de l’érudition géographique médiévale et de la première modernité : celle de la liste (Genet, 1977, p. 105 ; Gautier Dalché, 1992 ; Guerreau, 1996, p. 86, n. 6). La plupart du temps organisés selon un classement régional, les armoriaux généraux fonctionnent comme des catalogues de pays. Celui du héraut Gelre, composé au tournant des xive et xve siècle, par exemple, compte une cinquantaine de chapitres régionaux (Popoff et Pastoureau, 2012). Ils commencent systématiquement par le nom et les armes de la contrée ou de son prince, suivis des écus (plus petits) des fiefs, seigneurs et seigneuries du pays. Au total, près de 1700 entrées décrivent un espace européen dans lequel des noms de lieux et de personnes sont répartis en unités géographiques régionales – permettant d’en dessiner l’étendue et le contour. À plusieurs reprises dans le recueil, les chapitres concernant des régions voisines s’enchaînent. La série la plus longue est celle qui concerne les Pays-Bas et la Basse-Rhénanie : Brabant, Limbourg, Flandre, Hollande, puis les pays de Juliers, de Gueldre, de Berg, de Clèves de Cologne et de Liège s’égrènent l’un à la suite de l’autre entre la marche de Bretagne et celle de Savoie. Pour le cœur de l’Empire, le classement est un peu différent, puisqu’il commence par les régions des sept électorats. C’est donc un principe hiérarchique qui s’impose – les pays étant classés en fonction du rang de préséance de leur prince à la diète. Le sud de l’Allemagne revient en revanche à un classement spatial, avec la succession de la Bavière, de la Souabe et de la marche de Nuremberg. Par moments, à l’inverse, la répartition des chapitres se fait plus erratique. Les royaumes du Nord et ceux de la péninsule ibérique alternent ainsi sans rapport avec leur prestige ou leur localisation : le Danemark, l’Angleterre, la Castille, l’Aragon, l’Écosse, la Suède, la Navarre, la Norvège puis le Portugal.
Ces traits se retrouvent dans de nombreux armoriaux. Au milieu du xvie siècle, encore, le grand armorial peint pour Alexandre le Blancq – vraisemblablement sous la direction du héraut Jacques le Boucq ou de son collègue Guillaume Rugher – fait de même en découpant une soixantaine de régions, régulièrement classées par proximité géographique ou par allégeance politique, qui regroupent 3900 noms et armes de seigneurs et de seigneuries (Popoff, 2018).
Document 1 : Marches d’armes représentées dans quelques armoriaux généraux (carte de l’auteur)

À côté de ces catalogues armoriés, on trouve aussi dans plusieurs traités de hérauts des xve et xvie siècles des listes de fiefs et de pays plus classiques. Celle qui décrit la composition du royaume de France est sans doute la plus fréquente. Elle date vraisemblablement du milieu du xve siècle (Hiltmann, 2011, p. 378-394 ; Dauphant, 2012, p. 151 sqq.) mais figure encore dans les traités des hérauts Franquevie (BL, Egerton 1644, f° 77 et sqq.), Castille (RAH, Salazar y Castro, ms. C-48 (9/271), f° 30 sqq.) et Navarre (BNE, ms. 3346, f° 76 sqq.) dans les années 1520. Elle comprend une première série regroupant les fiefs du royaume : duchés et comtés immédiats de la couronne puis comtés vassaux d’autres fiefs. La seconde série est consacrée aux villes, classées cette fois-ci par marche d’armes, c'est-à-dire par régions héraldico-féodales. La troisième série recense les diocèses du royaume, ordonnés par province ecclésiastique. L’ensemble fonctionne donc comme un dénombrement des entités constitutives de l’espace français. Il dessine, un peu comme les armoriaux, le royaume à partir des régions qui le composent.
B. Les descriptions de pays
À rebours de ces différents types de listes, les écrits des officiers d’armes recourent également à une autre forme classique de l’érudition géographique : la chorographie ou, selon les mots de Berry, la « description de pays ». Les listes se contentaient d’énumérer de façon plus ou moins hiérarchisée et localisée des noms de contrées, de seigneurs et de seigneuries ; ces descriptions s’arrêtent en particulier sur un ou plusieurs lieux pour en dresser un portrait. Au sein de ce genre, un texte s’impose d’emblée par son ampleur et son originalité : le Livre de la description des pays du héraut français Gilles le Bouvier dit Berry (Le Bouvier, 1908, p. 29-132). C’est lui, en particulier, qui avait attiré l’attention de Léonard Dauphant sur les écrits de l’office d’armes pour son étude sur les représentations du territoire français au xve siècle.
Le Livre du héraut Berry est – selon ses propres dires – une présentation des lieux où il a voyagé au cours de sa carrière. Dans certains cas, cette affirmation est un peu douteuse, puisqu’on voit mal pourquoi Charles viiiaurait envoyé un émissaire en Afrique du Nord ou en Russie. Berry est, d’ailleurs, assez allusif sur ces pays. En revanche, ses venues en Italie et au Levant sont renseignées par d’autres sources. La difficulté est qu’il ne mentionne jamais ce qu’il est venu faire dans les contrées qu’il dépeint. C’est là l’intérêt et, en même temps, l’unicité de cette œuvre. La description géographique est ici une fin en soi, nullement parasitée par le prétexte d’un récit de voyage, d’une chronique ou l’insertion dans un texte de nature encyclopédique.
La partie consacrée au royaume de France constitue à elle seule le tiers de l’ouvrage. Berry commence par une présentation générale du climat et des dimensions du royaume :
Premièrement du Royaulme de France, pour ce que c’est le plus bel, le plus plaisant, le plus gracieux et le mieulx pourporcioné de tous les aultres, car il a six moys d'esté et six moys d’iver, ce que n’a nul aultre royaulme. C’est assavoir esté y commence en avril et dure jusques en octobre, que blez et vins sont recueillis. Et l’hiver dure d’octobre jusques en avril. Et n’est en ce dit royaulme l’esté trop chault, ne l’hiver trop froit, selon ce qu’il est chault et froit en aultres païs.
Ce dit royaulme a de long XXII journées : c’est assavoir depuis l’Escluse en Flandres jusques à Sainct-Jehan de Pié de Porc qui est l’antrée du royaulme de Navarre et a de large XVI journées : c’est assavoir depuis Saint Mahieu de fine poterne en Bretaigne jusques à Lyon sur le Rosne (Le Bouvier, 1908, p. 30-31).
Il poursuit cette description générale par les principales productions agricoles et les frontières naturelles du pays : l’océan à l’Ouest, les Pyrénées et la Méditerranée au Sud, puis les quatre rivières (Rhône, Saône, Meuse, Escaut) à l’Est et au Nord. Il dresse ensuite un catalogue des fleuves et rivières navigables avec les villes établies sur leurs rives, avant de conclure sa présentation générale par une évocation de la forme générale du royaume, qu’il qualifie de « lausange, car il n’est ne long ne quarré », coupé en son milieu par la Loire (Le Bouvier, 1908, p. 38).
Il entre alors plus précisément dans le détail des différentes régions du royaume dont il décrit les productions et le climat particuliers, les éventuels reliefs ou plans d’eau notables, la noblesse, les villes, les sources thermales, les lieux saints, etc.
Les descriptions des pays étrangers sont de même nature, quoique souvent plus courtes. De Gênes et Venise, Berry évoque la richesse fondée sur le commerce et la navigation. De Milan, il a retenu l’industrie de guerre. À plusieurs reprises, il présente les mœurs du pays et se laisse tenter parfois par à des commentaires presque ethnologiques sur les pays arabes, slaves et scandinaves. Dès son édition, au début du xxe siècle, leLivre des pays de Gilles le Bouvier fut logiquement considéré comme un authentique manuel de géographie, mêlant des observations de première main et des représentations héritées de la tradition et du légendaire des récits de voyage.
À mi-chemin entre cet ouvrage unique et les listes de blasons évoquées plus haut, l’armorial du héraut bourbonnais Guillaume Revel dit Auvergne (de Boos, 1998) mérite lui aussi un examen attentif. À ce qu’il semble, Revel a dirigé la réalisation de ce manuscrit pendant près de trois décennies. Il entendait l’offrir à son maître Charles Ier de Bourbon mais le dédia finalement à Charles VII, après la mort du duc. L’ampleur et le luxe de l’entreprise pourraient indiquer que Charles Ier avait chargé Auvergne de compiler ce tableau de ses États, dans le cadre d’une de ces fameuses visitations qui apparaissaient alors en France et, surtout, en Angleterre.
Concrètement, le registre de Revel est organisé en trois ensembles successifs. Le premier est consacré au duché d’Auvergne, le second au duché de Bourbon et le troisième au comté de Forez. Chacun est subdivisé en une série de chapitres locaux, consacrés à une baronnie, une châtellenie ou une abbaye. À chaque fois, le chef-lieu puis les places fortes sont dessinés ou peints en tête et accompagnés des armoiries des notables et seigneurs de la région. Toute l’originalité de ces paysages est qu’il ne s’agit pas de représentations symboliques. L’archéologie a montré qu’on avait bien là affaire à des images de l’architecture et de la topographie des villes et places fortes la principauté, vraisemblablement prises sur le vif avec une intention descriptive (Fournier, 1973, p. 2).
Sur le portrait de la ville de Montbrison (BNF, fr. 22297, p. 437 ; de Boos, 1998, t. 1, p. 443-448), pourtant situé dans la série la plus stéréotypée de l’armorial, on reconnaît sans difficulté le site : la rivière Vizézy – qui traverse la cité d’Ouest en Est – et le relief, avec la colline volcanique originelle sur laquelle les comtes de Forez avaient construit leur château et le talus qui borde la cité au Sud et à l’Ouest à la rencontre de monts et de la plaine alluviale. La forme des enceintes, qui a laissé sa marque dans l’urbanisme actuel, est, elle aussi bien reconnaissable : une double muraille circulaire, autour du château et de sa motte, à cheval sur un long mur en ovale allongé du Nord-ouest au Sud-est qui ceint la ville. Au premier plan, la collégiale Notre-Dame-de-l’Espérance, avec son chœur plus bas et plus étroit que la nef et sa tour provisoire en bois, est représentée de façon presque naturaliste, tout comme les vergers et la campagne qui entourent la cité. Seuls l’énorme girouette aux armes des comtes de Forez sur la tour de Notre-Dame et les penons aux armes de France sur celles du château semblent trancher avec cet aspect descriptif et renvoyer à une imagerie plus symbolique de la ville.
Document 2 : Ville et château de Montbrison dans l’armorial du héraut Guillaume Revel (milieu du xvesiècle), BNf, fr. 22297, p. 447. Cette vue a manifestement été prise de l’emplacement de l’actuel couvent Sainte-Claire.
Ces deux témoignages du milieu du xve siècle se distinguent par leur ampleur et leur originalité au milieu de notices et de descriptions plus courtes. L’un comme l’autre montrent que les voyages et les fonctions des hérauts leur permettaient d’accumuler un savoir géographique de première main, susceptible d’être utilisé pour décrire des pays ou des principautés par d’autres voies que le simple catalogue des terres et seigneuries qui les composaient. Ici, il s’agit de dépeindre et portraire – au sens métaphorique ou réel – des espaces ou des lieux selon une logique qu’on pourrait qualifier de chorographique (Besse, 2004), même si la démarche n’est pas exprimée dans ces termes.
C. Au XVIe siècle : le passage à la carte
Au xvie siècle, le recrutement de hérauts issus du milieu des peintres ou de celui des lettrés humanistes fit évoluer cette volonté de portraire l’espace et ses régions. À côté des armoriaux et descriptions de pays – qui sont loin de décliner dans leurs recueils – les officiers d’armes se tournèrent vers un autre support du savoir géographique, alors en plein essor : la carte.
En la matière, le Portugal semble avoir été précurseur, grâce aux commandes luxueuses de la couronne. La collection de cartes aujourd’hui connue sous le nom d’Atlas Miller en est sans doute l’exemple le plus connu. Il s’agit d’un ensemble de cartes nautiques richement enluminées, précédées d’une vue de l’hémisphère portugais délimité par le traité de Tordesillas. L’illustration se compose de vues symboliques de villes, de forêts et de paysages, de navires, d’animaux et de personnages. Çà et là des écus et de petites bannières signalent les puissances européennes et les possessions portugaises. La vue de l’hémisphère portugais reprend le type classique de la carte ronde entourée des quatre vents.
Au dos du planisphère, la page de titre indique le maître d’œuvre, le commanditaire, la date et le lieu de fabrication : l’ensemble a été réalisé pour Manuel le Fortuné en 1519 à Lisbonne, sous la conduite de Lopo Homem. Le cartographe s’associa deux collègues – Pedro et Jorge Reinel – et au moins un enlumineur. Le consensus actuel identifie ce peintre à Antonio de Holanda. Vraisemblablement néerlandais et beau-frère de Homem, il était devenu poursuivant d’Emanuel le Fortuné sous le nom de Tavira à la fin de l’année 1518 ou au début de 1519, en replacement de Francisco Henriques, un autre peintre d’origine flamande qui avait tenu cet office jusqu’alors (Pinhero Marques 1994 et 2011). Par la suite, il fit dans l’office d’armes une brillante carrière qui allait le mener au rang de roi d’armes Algarve en 1538 (Deswarte-Rosa, 2005, p. 203). Entretemps, il utilisa le motif de la carte dans deux autres travaux, au moins. La première est une petite représentation de l’hémisphère portugais sur le frontispice de la chronique du roi Alphonse Henriques vers 1520. La seconde est une carte d’Afrique pour l’archevêque-infant Martin de Portugal, vers 1525 (Pinhero Marques, 2011, p. 412-415).
Manifestement, Holanda était avant tout un peintre, enluminant un dessin cartographique conçu par des techniciens de cette discipline. Ce n’était pas tant le héraut que l’enlumineur qu’on était venu chercher. Pourtant, à partir de la fin des années 1530, un nombre surprenant de ces officiers allait avoir une activité de cartographe. À la cour des Habsbourg, le premier fut Liévin Algoet, héraut Flandre de Charles Quint à partir de 1538. Ancien secrétaire d’Érasme, il était bien introduit parmi les cartographes et amateurs de cartes de son temps : on compte parmi ses correspondants, amis et protecteurs des personnages comme Jean Dantiscus, Nicolaus Olahus et Gemma Frisius. Charles Quint, grand connaisseur en la matière, appréciait visiblement beaucoup son employé pour sa collection de « chartes géographiques » (Henne, 1860, v. 10, p. 230). Dans la décennie 1530, juste avant de devenir officier d’armes, Algoet avait eu une activité assez soutenue dans ce domaine. Dès 1530, il composa une carte marine universelle pour le prélat polonais Jean Dantiscus. L’année suivante, il fut consulté par le doyen de Saint-Donat, Marc Laurin, à propos d’un grand globe terrestre qu’il faisait réaliser par le cosmographe, astrologue et prédicateur Franciscus Monachus (de Smedt, 2011, p. 487 ; Hallyn, 2008, p. 63-64). C’est vraisemblablement aussi à cette époque qu’il conçut sa carte de la Scandinavie, aujourd’hui connue par la copie qu’en a donnée Gerard de Jode en 1570 (Karrox, 1993, p. 35).
On pourrait s’imaginer qu’il ne s’agit là que de hasards de recrutement, mais il y eut, au cours de ce siècle, un tropisme convergeant tout à fait notable entre hérauts et cartographes, notamment au service des Habsbourg :
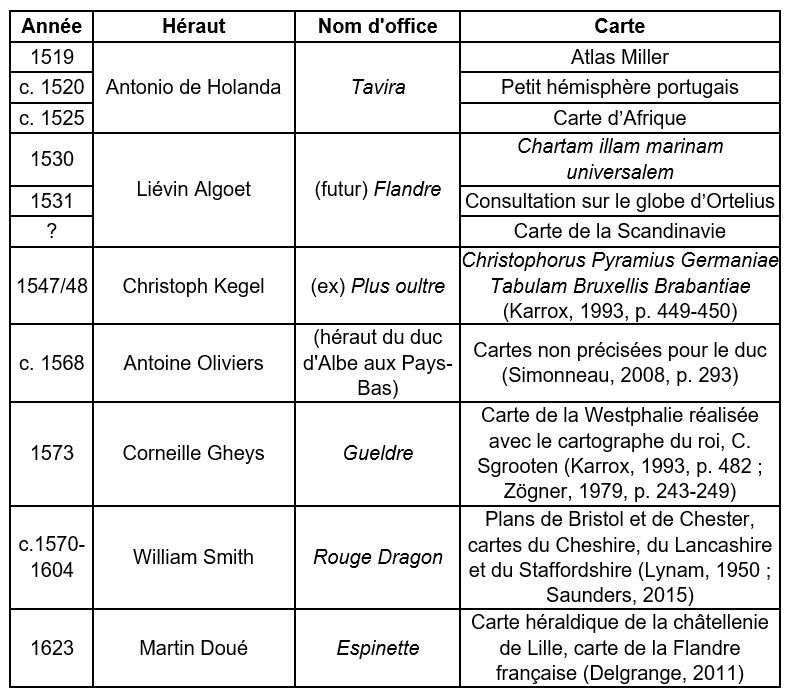
À l’inverse, on doit aussi un grand armorial – assez laid, il faut en convenir – au chroniqueur et cosmographe de l’empereur, Alonso de Santa Cruz (BNE, ms. 11860).
III. Quelle géographie ?
Dans ces différents écrits et travaux, une connaissance du monde et de l’espace s’exprime. Elle se révèle sous des formes plus ou moins autonome et de façon plus ou moins diffuse, mais elle est bien présente. En même temps – et c’est peut-être là leur grand intérêt – ces savoirs géographiques sont profondément marqués par un certain nombre de représentations qui permettent de qualifier la façon dont les hérauts – et les seigneurs qu’ils tentaient de séduire dans leurs ouvrages – concevaient et saisissaient l’espace et le monde autour d’eux.
A. Pour l’essentiel : une géographie politique et féodale
Sans grande surprise, l’image du monde qui transparait dans les listes des hérauts – armoriées ou non – est une celle d’un espace polarisé par des logiques essentiellement politiques, seigneuriales et féodo-vassaliques.
Dans ces documents, la cellule de base est presque toujours la seigneurie. L’armorial déjà évoqué d’Alexandre Le Blancq est un bon exemple. Au niveau élémentaire, on trouve à plusieurs reprises des groupes d’armoiries très ressemblantes les unes à la suite des autres. Dans la marche de France, on trouve ainsi à la suite trois écus d’or à la bande d’azur. Le premier est en l’état, sans altération, le second a la bande chargée de trois coquilles d’argent, le troisième ajoute un lambel de gueules aux coquilles (Popoff, 2018, p. 15). L’héraldique permet de comprendre qu’on a là trois seigneurs appartenant à un même lignage (les Trie) : l’ainé, un cadet et un fils de ce dernier. Pourtant, la légende ne donne aucun nom ni aucun prénom. Elle se concentre sur le titre de dignité : « le seigneur de Trye », « le seigneur de Mouchy » et « le seigneur de Fontannies » (Fontanay). À la marche de Champagne, le même phénomène se répète avec un groupe d’une vingtaine de membres de la famille de Châtillon, tous identifiés par leur titre plutôt que par leurs noms ou prénoms (Popoff, 2018, p. 23). Le procédé n’est pas systématique, mais demeure largement majoritaire : moins de 4% des entrées de l’armorial sont désignées par un prénom.
Document 3 : Armorial Bellenville, début de la marche de France : Le roi, le comte de Dammartin, le comte de Dreux, le baron de Montmorency, le vicomte de Melun, le seigneur de Trie. BNF, fr. 5232, f° 5.

La primauté de la dignité sur l’individu se retrouve aussi au niveau supérieur : les marches de Champagne, de Normandie, de Bourgogne… sont toutes identifiées par les armes de leurs anciens comtes et ducs. Tous ces fiefs étaient pourtant vacants et réunis au domaine royal au milieu du xvie siècle quand l’armorial fut composé (Hiltmann, 2011, p. 379). En large part, son propos semble donc bien de cataloguer des fiefs plutôt que de recenser des individus – même si cette dimension n’est pas totalement absente. Comme l’inventaire d’une seigneurie, l’armorial organisait le monde comme une série de sujétions (Boucheron, 1998). La mise en relation des deux niveaux confirme cette idée : le chapitrage inscrivait les seigneuries dans leurs ressorts féodaux, c'est-à-dire dans le grand fief ou la province auquel leur détenteur devait hommage. La logique devient évidente dans les listes de fiefs du royaume de France citées plus haut : après les duchés et comtés immédiats de la couronne, se trouve une série de dignités mouvantes de ces fiefs immédiats. Les comtes d’Harcourt, de Mortain, d’Aumale, etc. sont désignés comme étant « sous le duc de Normandie », ceux de Saint Pol, de Guînes et de Boulogne « sous le comte d’Artois » et ainsi de suite. À cela, s’ajoutent ici les divisions des deux autres ordres. Concrètement, l’espace était pensé comme un triple réseau hiérarchisé de seigneuries tenues les unes des autres, de villes extraites de ce système mais sises dans les mêmes régions et de diocèses réunis en provinces ecclésiastiques. Ces listes construisent donc le territoire en s’appuyant sur le modèle des trois États politiques du royaume : le clergé, la noblesse et les villes, avec leurs hiérarchies internes.
On pourrait opposer que cette vision est biaisée par le choix de ces exemples précis. Certains armoriaux généraux n’hésitent pas, en effet, à personnaliser les feudataires en les désignant par leur prénom – comme des individus assimilables aux personnages historiques ou mythiques qui figurent souvent en tête d’ouvrage. Berry confirme néanmoins que cette interprétation est pertinente, à défaut d’être exclusive : il construit son espace de façon assez similaire dans son livre de la description des pays. Son énumération repose principalement sur les divisions féodales, dont il évoque régulièrement les vassaux. Le nord-est du royaume de France est ainsi décrit principalement par ses fiefs :
Puis y est la conté de Champaigne, qui est beau païs et bon et plain païs, et y a peu bois et assez blez et vins, bestial blanc, et labourent à chevaulx, et y a assez vaches et petites rivières, et y a de bonnes toilles et y a cinq cités. C'est assavoir Sens, qui est archevesché, Langres, Troies, Chaallons et Reins archevesché. Le peuple de cest païs sont bonnes gens, et gens de bonne foy. Et est une grant conté, la plus grande de France. Et a le conte de Champaigne xiii contes, ses hommes.
Puis y est la duché de Bar, qui joint audit païs, qui est très bon païs de blez, de vins, de bestial et de poissons, assez bois ct petites rivières. Et passe au loing d'icellui païs entre Loraine et ledit païs la rivière de Meuse, qui départ le royaulme de France et l’Empire. Les gens d'icellui païs sont de la condition de ceulx de Champaigne, et n’a guères que icelle duché n’estait que conté, tenue du conte de Champaigne. En ce païs a de belle noblesse, de beaulx chasteaulx fors, et est plain païs.
Puis y est la conté de Retel, le païs de Lannois et la conté de Guise et le païs de Vermendois qui sont très bons païs et plains, sans montaignes (Le Bouvier, 1908, 45-46).
Les grandes divisions correspondent toutes à des fiefs, même les deux « païs » que sont le Laonnois, dont l’évêque est duc, et le Vermandois, qui est un comté. La fin des entrées consacrées à la Champagne et au Barrois renvoie par ailleurs aussi à cette construction de l’espace en un réseau hiérarchisé de seigneuries, tenues les unes des autres, en dénombrant les vassaux. La représentation ne correspondait plus à la réalité du gouvernement, mais elle continuait à structurer la vision qu’on se faisait du monde. La mention répétée des villes et des établissements religieux complète cette grille de lecture en introduisant les deux autres ordres de la société d’Ancien Régime.
C’est ainsi qu’on peut comprendre la cohérence d’un document comme l’armorial Revel. Avec ses portraits de villes, de châteaux et d’abbayes fortifiés entourés des armoiries des seigneurs et des dignitaires religieux de la région il constitue l’image idéale d’une principauté (Dauphant, 2012, p. 180-182) : un territoire quadrillé de seigneuries organisées par le lien vassalique, de villes florissantes d’où s’exerce l’autorité et d’établissements religieux bien pourvus de clercs. La conclusion de Berry à son tableau du royaume de France reprend précisément cet imaginaire :
Ainsy ay nommé tous les païs de ce royaulme. En ce royaulme a xviii duchés, sans les évesques et arcevesques dont il y a quatre-vings et quatorre cités, comprins dix archeveschés, qui sont audit royaulme. Et y a moult de contes et de barons et moult grande noblesse, plus que en deux autres royaulmes crestiens (Le Bouvier, 1908, 51).
Aux Pays-Bas, les hérauts du xvie siècle développèrent une représentation symbolico-cartographique de cette conception de l’espace : les jardins d’armoiries et les cartes héraldiques. Ils formaient des images idéales d’une province organisée autour de son prince, avec ses trois ordres, ses grands seigneurs et officiers féodaux, ses villes et ses établissements religieux (van den Bergen-Pantens, 1996 et 1997-1998 ; Flamang et van Eeckenrode, 2011).
B. L’ailleurs : un espace aux logiques différentes
Cette grille de lecture politique de l’espace prévaut surtout pour les régions proches et bien connues des hérauts et de leurs lecteurs. Les représentations qui structurent la description des espaces plus lointains sont quelque peu différentes. On y retrouve une dimension politique certes, mais elle se double d’une recherche des curiosités et des merveilles du monde. L’enluminure de l’Atlas Miller – avec ses dessins de singes et de perroquets, d’éléphants et de dromadaires typiques de la cartographie de luxe – n’est que la traduction graphique d’un goût de l’exotisme et du légendaire également présent dans les textes des officiers d’armes.
Miguel Angel Ladero Quesada, dans ses travaux sur les nobiliaires de langue espagnole (Ladero Quesada, 1993, 1995 et 2006), avait analysé cette dimension fabuleuse de la description des royaumes lointains en Europe et au Proche-Orient. Il estimait que ces ouvrages, parmi lesquels on compte plusieurs grands traités de hérauts, constituaient une sorte de géographie des mythes originels et des légendes des différents peuples, ainsi que des représentations que leurs auteurs se faisaient d’eux (Ladero Quesada, 2006, p. 143). La description de l’Inde du prêtre Jean, chez Castille (RAH, Salazar y Castro, ms. C-48 (9/271), f° 262), montre bien la façon dont les structures de pensée de l’espace évoquées pour l’Europe se mêlent à cet imaginaire merveilleux des territoires lointains.
Dès les premiers mots de sa notice, le roi d’armes de Charles Quint se place sur ce double terrain en affirmant vouloir décrire les origines de ce royaume, sa religion, sa puissance et des « maravillosas cosas y diversidades de las gentes » qui le peuplent. On retrouve donc l’habituel dénombrement des provinces ecclésiastiques et de leurs diocèses, celui de la cour et de l’ost du roi-prêtre, ainsi que le nom de quelques villes. Mais une bonne partie de la notice est consacrée à la peinture des « nombreuses et diverses natures d’hommes (humains et de diverses formes corporelles), et des nombreux monstres, serpents et autres animaux » (RAH, Salazar y Castro, ms. C-48 (9/271), f° 263). Femmes aux innombrables bijoux d’or et abondance de pierres précieuses, dragons volants et ânes assez courageux pour faire fuir les lions forment un décor digne d’un roman dans lequel la surpolarisation de l’antagonisme entre chrétiens et ennemis de la Foi (Ladero Quesada, 2006, p. 143-151) semble pouvoir donner à toute occasion l’argument à des aventures chevaleresques.
Cette différence dans la description de l’espace proche et de l’espace lointain tient peut-être à un élément signalé par Ladero Quesada. La présence des mythes et des merveilles dans la description historico-géographique des contrées lointaines tenait, affirmait-il, au caractère non scientifique – ou du moins non critique – de ce corpus. Les sources y sont en effet souvent recopiées en l’état (Ladero Quesada, 2006, p. 143). Lorsque les hérauts connaissaient personnellement le terrain, en revanche, ils étaient plus enclins à utiliser leur expérience. Ajoutons également que cela recoupe une perception du monde typique de la civilisation courtoise, dans laquelle l’ailleurs est, par nature, le lieu du merveilleux (Ferlampin-Acher, 2003, p. 240-241 ; Joukovsky, 1974, p. 36).
Conclusion
Ces éternels voyageurs que furent les hérauts étaient sans doute à bon droit les guides des ambassadeurs et les informateurs des princes. Ils nous ont légué un grand nombre de textes dans lesquels la description du monde n’est peut-être pas l’enjeu essentiel, mais où elle advient au détour d’un fragment. Ce qui agit dans leurs écrits n’est peut-être pas à proprement parler une géographie constituée et autonome. On y trouve pourtant bien une série de savoirs géographiques qui exprime clairement la façon dont les élites de cour se représentaient l’espace qui les entourait. Les hérauts et leurs protecteurs percevaient le Monde comme un ensemble de terres, d’entités politiques et de dignités territoriales, organisées en un réseau hiérarchisé par les relations vassaliques. Et pourtant, les portraits des contrées lointaines rappellent que pour ces hommes, l’inventaire du monde ne devait pas se limiter aux logiques politiques : pour décrire un pays – a fortiori lointain – il fallait aussi en décrire les merveilles.
Ces représentations s’expriment sans complexe dans les écrits des hérauts du xve et du xvie siècle. De ce point de vue, l’hégémonie croissante des cartes et l’objectivation des savoirs a plutôt été un appauvrissement pour leurs productions géographiques, en lui retirant cette façon de dire franchement l’imaginaire de ceux qui l’avaient produite.
Références :
Abry J.-H., 2000, « Une carte du monde à l'époque d'Auguste : Manilius, Astronomiques IV, 585-817 », dans Bonnafé A., Decourt J.-C., Helly B. (éd.), L’Espace et ses représentations, Lyon, Maison de l’Orient et de la Mediterranée, 83-106.
Ailes A., 2006, « Le développement des ‘visitations’ de hérauts en Angleterre et au Pays de Galles (1450-1600) », Revue du Nord, tome 88, n° 366-367, 659-679
Besse J.-M., 2004, « Vues de ville et géographie au xvie siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions », dans Pousin F. (dir.), Figures de la ville et construction des savoirs. Architecture, urbanisme, géographie, Paris, CNRS, 9-30.
Bock N., 2015, Die Herolde im römisch-deutschen Reich: Studie zur adligen Kommunikation im späten Mittelalter, Ostfilden, Thorbecke.
Boucheron P., 1998, « Représenter l'espace féodal : un défi à relever », Espace Temps, t. 68-70, 59-66.
Boudreau C., 2006, L’héritage symbolique des hérauts d’armes, dictionnaire encyclopédique de l’enseignement du blason ancien, Paris, Léopard d’or.
Bresc H. et Tixier E., 2010, Géographes et voyageurs au Moyen Âge, Paris, PUPO.
Contamine P., 1994, « Office d’armes et noblesse dans la France de la fin du Moyen Âge » Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, p. 310-323.
Couhault P., 2020, L’étoffe des hérauts. L’office d’armes dans l’Europe des Habsbourg au xvie, Paris, Classiques Garnier.
Courtois J., 1867, Parties inédites de l’œuvre de Sicile, F. Roland (éd.), Mons.
Dauphant L., 2009, « Le royaume de France vu par les hérauts d’armes. Représentations de l’espace à la Cour de Charles VII (1453-1461) », dans Cioba M. (pub.), Espaces et mondes au Moyen Âge, Bucarest, Presses de l'Université de Bucarest, 398-407.
Dauphant L., 2012, Le royaume des quatre rivières : l’espace politique français (1380-1515), Seyssel, Champ Vallon.
de Gruben F., 1997, Les chapitres de la Toison d'or à l'époque bourguignonne (1430-1477), Louvain,Leuven University Press.
de Smet A., 2011, « Géographes », dans Kuchner E. (dir.), L’époque de la Renaissance : t. III, maturation et mutation (1520-1560), Amsterdam, John Benjamins, 486-491.
Delgrange D., 2011, « Martin Doué (Rijsel 1572-1638) Vlaams heraut en wapenschilder », Heraldicum disputationes, t. 16/3, 96-110.
Deswarte-Rosa S., 2005, « Enlumineurs à Évora dans les années 1530 : Jan Ruysch, António de Holanda, António Fernandes », dans García García B. J. et Grilo F. (dir.), Ao Modo da Flandres. Disponibilidade, inovação e mercado de arte na época dos Descobrimentos (1415-1580), Madrid, 197-209.
Ferlampin-Acher, C., 2003, Merveilles et topique merveilleuse dans les romans médiévaux, Paris, Champion.
Flammang V. et Van Eeckenrode M., 2011, « Le jardinet de Hainaut : essai de typologie et clés d’interprétation (xive-xviiie siècles). Mises en scène d'un comté lors des inaugurations princières en Hainaut », Bulletins de la commission royale d’histoire, t. 177, 54-80
Fournier G., 1973, Châteaux, villages et villes d’Auvergne au xve siècle d’après l’armorial de Guillaume Revel, Paris, Arts et métiers graphiques.
Gautier Dalché P., 1992, « De la liste à la carte : limite et frontière dans la géographie et la cartographie de l'Occident médiéval », dans Castrum, t. vi, 19-29.
Gautier Dalché P., 2001, « Sur l’originalité de la "géographie" médiévale », dans Zimmer M. (dir.), Auctor et auctoritas : invention et conformisme dans l'écriture médiévale, Paris, ENC, 131-143.
Genet J.-P., 1977, « Cartulaire, registres et histoire : l'exemple anglais », dans Guenée B. (dir.), Le métier d’historien au Moyen Âge. Études sur l'historiographie médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 95-138.
Guerreau A., 1996, « Quelques caractères spécifiques de l’espace féodal européen », dans Bulst N., Descimon R. et Guerreau A. (éd.), L’État ou le Roi, les fondations de la modernité monarchique en France, Paris, MSH, 5-101.
Hablot L., 2006, « Revêtir le prince : le héraut en tabard, une image idéale du prince », Revue du Nord, t. 88, n° 366-367, 755-803
Hallyn F., 2008, Gemma Frisius, arpenteur de la terre et du ciel, Paris, Champion.
Henne A., 1860, Histoire du règne de Charles Quint en Belgique, Bruxelles, Flatau.
Hiltmann T., 2004, « Information et tradition textuelle, les tournois et leur traitement dans les manuels des hérauts d’armes au xve siècle », dans Boudreau C., Fianu K. et Gauvard C. (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne, 219-231.
Hiltmann T., 2006, « Vieux chevaliers, pucelles, anges. Fonctions et caractères principaux des hérauts d’armes d’après les légendes sur l’origine de l’office d’armes au XVe siècle », Revue du Nord, tome 88, n° 366-367, 503-525.
Hiltmann T., 2011, Spätmittelalterliche Heroldskompendien: Referenzen adeliger Wissenkultur in Zeiten gesellschaftlihen Wandels (Frankreich und Burgund, 15. Jahrhundert), Munich, Oldenburg.
Hiltmann T., 2012, « La paternité littéraire des hérauts d'armes et les textes héraldiques. Héraut Sicile et le Blason des couleurs en armes », dans Metello de Seixas M. et de Lurdes Rosa M. (dir.), Estudos de heráldica medieval, Lisbonne, Carminhos romanos, 59-83
Joukovsky, F., 1974, Paysages de la Renaissance, Paris, PUF.
Karrox R., 1993, Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps: Bio-Bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570, Chicago, Speculum Orbis.
Le Bouvier G., 1908, Le livre de la description des pays, E. T. Hamy (éd.), Paris, Leroux.
Le Bouvier G., 1995, Armorial de Gilles Le Bouvier. Héraut Berry, publ. par Emmanuel de Boos, d'après le manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France (ms fr 4985), Armorial de Gilles Le Bouvier, héraut Berry, Paris, Ed. du Léopard d’or.
Ladero Quesada, M. A., 1993, « El pasado histórico-fabuloso de España en los 'Nobiliarios' castellanos a comienzos del siglo xvi », Lecturas sobre la españa histórica, Madrid, RAH, 55-80
Ladero Quesada, M. A., 1995, « El preste Juan de las Indias y los Reyes de Armas castellanos del siglo xvi », dans Medievo hispano. Estudios in memoriam del prof. Derek K. Lomax, Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 221-234.
Ladero Quesada, M. A., 2006, « Los orígenes y la geografía política de Europa vistos hacia 1500 por los 'reyes de armas' castellanos », En la España medieval, H. S. n°1, 131-156
Lynam E., 1950, « English Maps and Map-Makers of the Sixteenth Century », The Geographical Journal, vol. 116, n° 1/3, 7-25.
Mathieu R., 1946, Le système héraldique français, Paris, Janin.
Melville G., 1992, « Hérauts et héros », dans Duchhardt H., Jackson R. et Sturdy D. (dir.), European monarchy: its evolution and practice from Roman antiquity to modern times, Stuttgart, 81-97.
Melville G., 1995, « Der Brief des Wappenkönigs Calabre, sieben Auskünfte über Amt, Aufgaben und Selbstverständnis spättmittelaltericher herolde », Majestas, III, 137-161.
Melville G., 1998, « Le roy d’armes des François, dit Montjoye – Quelques observations critiques à propos du chef des hérauts de France au xve siècle », dans Hoareau-Dodinau J. et Texier P. (dir.), Anthropologies juridiques : mélanges Pierre Braun, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 587-608.
Melville G., 2002, « Un bel office. Zum Heroldswesen in der spätmittelalterlichen Welt des Adels, der Höfe und Fürsten », dans Moraw P. (dir.), Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späten Mittelalter, Stuttgart, Thorbecke, 291-321.
Nadot S., 2008, « Des voyageurs de l’ombre : le rôle des hérauts d’armes dans les combats chevaleresques du XVe siècle », dans Bresc H. et Menjot D. (dir.), Les voyageurs au Moyen Âge, Paris, CHTS, 50-60.
Paravicini W., 2008, « Signes et couleurs au Concile de Constance : le témoignage d'un héraut d'armes portugais », dans Turrel D., Signes et couleurs des identités politiques du Moyen Age à nos jours, Rennes, PUR, 155-187.
Pastoureau M., 1997, Traité d’héraldique, Paris, Picard.
Paviot J., 2003, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (xive siècle – xve siècle), Paris, PUPS.
Pinhero Marques A., 1994, « L’Atlas Miller, un problème résolu. L’art dans la cartographie portugaise », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n°4, 52-57.
Pinhero Marques A., 2011, Os descobrimientos e o ‘Atlas Miller’ – These de doutoramento na universidade de Coimbra, Figueira da Foz de Mondego
Popoff M., 2018, Armorial Le Blancq, Paris, Le Léopard d’or.
Popoff M. et Pastoureau M., 2012, Armorial de Gelre, Paris, Le Léopard d’or.
Revel G., 1998, L'armorial d'Auvergne, Bourbonnois et Forestz de Guillaume Revel, publ. par Emmanuel de Boos, Nonette, Créer.
Saunders I. J., 2015, « The Mapping of Lancashire by William Smith », Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, vol. 67, n° 2, 200-214
Schnerb B. (dir.), 2006, « Le héraut d’armes, figure européenne », Revue du Nord, tome 88, n° 366-367.
Simonneau H., 2008, « Antoine Olivier, officier d’armes et agent double au sein de la Toison d’or (1567-1573) », Publications du centre européen d’études bourguignonnes, n°48, 291-306.
Simonneau H., 2010, Grandeur et décadence d’une institution aulique, Grandeur et décadence d’une institution aulique, les hérauts d’armes dans les Pays-Bas bourguignons, entre 1467 et 1519, thèse de doctorat inédite sous la direction de Bertrand Schnerb, Université Lille III Charles de Gaulle.
Simonneau H., 2010/b, « Le roi d'armes dans les Pays-Bas bourguignons d’après une ordonnance de 1497 », dans Hiltmann T. (dir.), Les ‘autres rois’, Études sur la royauté comme notion hiérarchique dans la société au bas Moyen Âge et au début de l'époque moderne, Munich, Oldenbourg, 44-64.
Spitzbarth A. B., 2006, « La fonction diplomatique des hérauts : l’exemple de la cour de Bourgogne au temps de Philippe le Bon (1419-1467) », Revue du Nord, tome 88, n° 366-367, 559-576.
Stanesco M., 1988, Jeux d’errance du chevalier médiéval, aspects ludiques de la fonction guerrière dans la littérature du Moyen Age flamboyant, Leyde/Brill.
van Anrooij W., 1990, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam, Prometheus.
van den Bergen-Pantens C., 1996, « armoiries des personnes, des villes, et des institutions religieuses dans les albums de Croÿ », dans Gahid R. (dir.), Albums de Croÿ, t. 26, Recueil d’études sur les albums de Croÿ, Bruxelles, Crédit communal, 179-196.
van den Bergen-Pantens C., 1997-1998, « L’héraldique dans les albums de Croÿ et l’armorial général », Revue française d’héraldique et de sigillographie, n° 67-68, 81-84.
Zögner L., 1979, The Map librarian in the modern world : Essays in Honour of Walter W. Ristow, Munich,K. G. Saur.
(1) Depuis la rédaction de ce texte, est parue la contribution de Blanchard J.-C., 2019, « L’armorial Wijnbergen est-il un reflet de la communauté du royaume de France ? », dans Barthélemy D., Guyot-Bachy I., Lachaud F., Moeglin J.-M. (dir.), Communitas regni. La "communauté de royaume" de la fin du xe siècle au début du xive siècle (Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie), Paris, PSU, p. 219-234, qui présente des résultats similaires sur certains points.
Editorial | Publié le 2020-05-16 10:53:23 |
Par Brice Gruet (Maître de conférences Habilité à diriger des recherches, Université de Créteil)
Pourquoi parler des « grands » pèlerinages ? Après tout, on aurait tout aussi bien pu parler des pèlerinages en général, qu’ils fussent grands ou petits. D’autre part, le fait de considérer un pèlerinage comme « grand » est avant tout lié à une expérience qui reste somme toute subjective, personnelle. Néanmoins, les articles rassemblés dans ce numéro renvoient à des sites qui, tous, ont drainé ou drainent encore un grand nombre de visiteurs. Mais il est évident qu’il existe des milliers de pèlerinages, dans la mesure où cette pratique semble à la fois universelle et pratiquée depuis la plus haute antiquité. Cette universalité ne semble guère remise en cause par la sécularisation ou la relégation, relative et partielle, de la pratique religieuse. Cette persistance du pèlerinage ne peut que nous interpeler, car elle prouve l’importance, pour nombre de sociétés actuelles, de rechercher des hauts lieux, capables de transformer, d’émouvoir, voire de guérir. Comme l’indique Marie-Hélène Chevrier, les lieux saints procèdent d’une « hiérophanie » qui va conférer à un lieu auparavant indifférent des qualités telles qu’il devient dès lors capable d’attirer des visiteurs, visiteurs qui ne savent pas toujours très clairement ce qu’ils viennent chercher. Le laïc et le religieux se retrouvent ainsi entremêlés, et subvertis par le tourisme moderne.
Le mot même de pèlerin dérive du latin peregrinus, la personne itinérante, voire l’étranger, qui ne se fixe pas et est en mouvement. C’est dire que la pratique du pèlerinage s’enracine dans une double pratique, à la fois fixe et mobile : se déplacer jusqu’au sanctuaire, le long d’un itinéraire improvisé ou bien connu, alors que ce sanctuaire est lui-même fixe et repérable, comme un centre, ou un axe, en somme un pôle qui attire.
Mais notons dès à présent qu’un lieu de pèlerinage intègre par essence une double qualité : il possède des vertus éminentes qui le rendent différent d’autres lieux, car il est lié au surgissement du sacré, surgissement surnaturel qui transforme radicalement les qualités du lieu concerné, et qui parfois, le fondent. Et il s’inscrit dans le temps, c’est-à-dire que son caractère sacré tend à se développer et s’affirmer à travers des pratiques de fréquentation particulières. Une lente sédimentation temporelle tend également donc à conférer au « haut lieu » ses caractéristiques et son épaisseur humaine et historique.
Cette qualification de l’espace produite par la présence du sacré, quelle qu’en soit la forme, procède presque toujours d’une reconnaissance d’abord collective, plus que d’une volonté politique, fût-elle très puissante. L’exemple de Knock, développé par M.-H. Chevrier, est à cet égard éclairant. Souvent, l’institution ecclésiale suit le mouvement et l’encadre plus qu’elle ne l’engendre.
De fait, les pèlerinages ont joué et jouent encore un rôle structurant à différentes échelles. Comme le montre Pierre-Gilles Girault, les chemins médiévaux vers Saint-Gilles s’inscrivent dans un ensemble d’itinéraires extraordinairement denses et complexes, soumis à des influences contradictoires, mais qui toutes tissent un réseau de sacralités à la fois rivales et complémentaires. Et surtout, les conséquences de ces sacralités émergentes sur l’espace sont toujours importantes.
On pourrait supposer que l’époque actuelle correspond à une forme d’affaiblissement, voire d’effacement ou de marginalisation de ces sacralités. Or, il n’en est rien. Le sacré semble capable de se métamorphoser sans cesse, perpétuellement reformulé par les communautés humaines qui y sont liées. La plupart des articles de ce numéro démontrent l’extraordinaire inventivité déployée autour des différents sites évoqués. Le tourisme, la culture au sens général, le patrimoine, voire la politique, apportent leur coloration à des sites plus ou moins anciens. Le cas de Nadjaf, évoqué par Gérard-François Dumont, est à cet égard significatif : mainte fois détruit ou détérioré, récupéré par différentes puissances politiques, le sanctuaire de l’imam Ali n’en a pas moins conservé sa force et sa capacité d’attraction. La colline de Sion, présentée par Jean-Pierre Husson, exprime quant à elle la rencontre entre le sentiment patriotique et le sentiment religieux, à travers toute sorte de vicissitudes, qui pourtant n’entament pas l’aura du lieu, au contraire. L’article de Katerina Seraïdari, de son côté, analyse de manière convaincante l’entrelacs complexe des nationalités et des diasporas présentes en certains lieux reconnus comme saints par différentes communautés, dessinant ainsi une sorte de géopolitique de la sainteté parfaitement actuelle. Le site d’Angkor, enfin, cristallise des enjeux religieux, identitaires et mémoriels cruciaux pour les populations locales, qui entrent aussi en contradiction avec la fréquentation touristique étrangère.
On l’aura compris : cette livraison de la RGH ne peut qu’effleurer un sujet extraordinairement vaste et divers, qui mériterait de plus longs développements. Mais nous espérons que ces articles sauront stimuler et alimenter la réflexion sur des lieux et des itinéraires bien particuliers, capables d’attirer des personnes parfois venues du monde entier, animées par des motifs très divers, et parfois contradictoires. On ne saurait être autrement surpris par ce mélange constant de considérations profanes et sacrées, qui doivent composer ensemble en permanence, dans une dialectique aussi complexe que riche d’enjeux forts. Mais ce que ces articles démontrent tous, c’est l’actualité brûlante de ces pèlerinages, qui apparaissent bien comme un pont lancés entre passé et avenir.
Editorial | Publié le 2019-05-21 17:13:42 |
Par Alain Devos (Professeur de géographie à l'Université de Champagne-Ardennes)
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la production éditoriale fut pléthorique avec de très nombreux ouvrages principalement traités par l’approche historique alors que la place de la géographie et des géosciences dans le conflit reste longtemps marginale voire absente.
Les atlas récents de la Grande Guerre représentent généralement, les dimensions géopolitiques, l’évolution des batailles et des lignes de front, sans compréhension de leurs structures spatiales et de leurs héritages dans le paysage.Les approches géographiques et environnementales sont longtemps délaissées, voire méprisées par la communauté scientifique.
Pourtant, durant le conflit, la guerre de position engendre une véritable prise en compte de l’importance des paramètres environnementaux dans l’organisation des lignes de défense, dans les contraintes à la manœuvre, la traficabilité, l’efficacité des tirs d’artillerie, les potentialités d’accès aux ressources en eau ou au creusement dans le cadre de la guerre des mines. Les géologues sont utilisés de manière hétérogène par les belligérants. Au sortir de la guerre, dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Unis, en Allemagne, aux USA, on assiste à la naissance d’une véritable discipline, « la géoscience militaire » où la « Wehrgeologie » s’exprime particulièrement alors qu’en France, l’approche spatiale se cantonne aux « conditions géographiques de la guerre de Robert Vilatte en 1925 ».
Depuis une vingtaine d’année, l’approche géographique et scientifique passe par l’analyse environnementale post-conflit. Cette approche novatrice se manifeste particulièrement dans les pays anglo-saxons avec la création de l’International Society of Military Sciences(ISMS)l’international Association of Military Geosciences (IAMG), avec de multiples publications,ouvrages et articles scientifiques.
En France, les géosciences et la géographie physique, s’intéressent tardivement à la grande Guerre suite à l’apparition de contaminations « émergentes » avec les perchlorates dans les nappes souterraines, aux risques géotechniques associés aux cavités de la Grande Guerre, à la démocratisation de l’outil lidar et bien sûr au centenaire. L’approche archéologique depuis la fouille de la sépulture multiple d’Alain Fournier en 1991, s’affirme en véritable discipline autour des conflits armés qui se structure au sein des services archéologiques (SRA, INRAP),des associations comme l’Association Française de Recherches en Archéologie Contemporaine (AFRAC) en 2015. Les colloques de Péronne en 1997, de Suippes et d’Arras en 2007, de Strasbourg en 2013, de Verdun en 2018 et de Caen en 2019 témoignent de la vitalité de cette discipline.
C’est dans cette dynamique que le programme de recherche IMPACT 14-18 s’inscrit, porté par l’EA 3795 du GEGENAA, d’une durée de 4 ans (2015-2018) et financé par la région Grand-Est. Labellisé par la mission Centenaire en 2017, il regroupe un consortium d’universitaires de Reims (GEGENAA, CERHIC), d’Amiens (EDYSAN) et de Beauvais (Institut La Salle Beauvais), de collectivités locales (Reims Métropole), d’établissements publics faisant l’objet de convention (INRAP, Musée de Meaux) et d’associations (Main de Massiges, Correspondance Cote 108, Le Souvenir de Sommepy-Tahure, GEACA, Groupe Mémoire et Commémoration).
Le programme IMPACT 14-18 a produit 4 rapports de stage de master 2, et la thèse de Pierre Taborelli (soutenue le 2 juillet 2018). Les principaux résultats sont publiés dans l’ouvrage « La Terre et le Feu, Géologie et géologues sur le front occidental », porté par un groupe de travail associant l’Association des Géologues du Bassin de Paris (AGBP), la Société Géologique du Nord (SGN) et le Comité Français pour l'Histoire de la Géologie (COFRIGEO). Les travaux sont également valorisés par 8 articles dans des revues scientifiques, par 10 interventions dans des colloques nationaux (Paris, Chambéry, Versailles, Verdun) et internationaux (Afrique du Sud, Inde), par 15 conférences de vulgarisations scientifiques dans le Grand Est, par des expositions (frise de 13 m, 20 roll’up) et enfin des interventions télévisuelles et radiophoniques.
Ce programme de recherche fédérateur a également fait naître une dynamique scientifique autour de la Grande Guerre sur les impacts environnementaux avec de nombreux montages de projets (POLEMOFOR, CRATER, ANR-SPACE WW1) et le programme de recherche PERCHL’EAURIGINE, sur la contamination de la nappe de craie de Champagne en ions perchlorates géré par le GEGENAA de 2017 à 2019, en collaboration avec le BRGM, L’ARS, l’AESN et le Grand Reims. Il a été valorisé par un colloque à Reims, le 20 et 21 septembre 2018 qui fut une belle opportunité d’échanger les principaux résultats des récentes recherches sur l’apport de l’approche spatiale, de l’archéologie et des géosciences, notamment dans l’évaluation environnementale post-conflit au terme du Centenaire de la Grande Guerre. Il a fait l’objet d’actes distribués aux participants et proposés à la Revue de Géographie Historique dans ce présent numéros. Les héritages morphologiques et archéologiques de la Grande Guerre sont traités, ainsi que les traces d’ordre taphonomique ou indices phytographiques. Les conditions géologiques et géographiques de la zone de front synet postconflit font aussi l’objet de contributions originales.
Bonne lecture !
Alain Devos
Editorial : La géographie d'un événement aux répercussions mondiales - la Révolution française | Publié le 2018-11-24 03:34:49 |
Même si elle s’inscrit dans un contexte révolutionnaire que l’on a appelé la Révolution atlantique, initiée par les mouvements d’émancipation de certaines colonies britanniques d’Amérique du Nord, la Révolution française par l’ampleur des bouleversements politiques et sociaux provoqués en France aussi bien que par l’ampleur des retombées qu’elle a eues sur d’autres pays a été certainement un événement singulier. Elle a certainement constitué une rupture profonde dans nombre de domaines, comme celui du politique et du social, en dépit des lignes de continuités qui ont été soulignées par certains auteurs. Ne fut-elle cependant qu’un épisode d’enthousiasme et d’élan visant à créer une société nouvelle et meilleure, amplifiée par le discours idéologique, qui, une fois la paix revenue en 1815, aurait laissé les hommes désenchantés ? Les articles rassemblés dans ce numéro nous semblent démontrer plutôt le contraire.
En France, elle détruit d’abord l’ancienne société d’ordre. Par la vente des biens nationaux de première et seconde origine, que certains ont qualifié d’événement le plus important de la Révolution, les révolutionnaires s’assurent une assise sociale d'individus et de groupes attachés aux acquis des politiques révolutionnaires. Dans son article, Cédric Andriot montre bien qu’un pan entier de la société, minoritaire, mais officiellement appartenant au premier ordre, a été transmuté, celui des réguliers. Surtout dans une région marquée par la reconquête catholique après la Réforme protestante – la dorsale catholique – l’emprise spatiale du clergé, notamment régulier dans une ville comme Nancy était particulièrement importante. Si les réguliers s’adaptent déjà avant la Révolution aux demandes d’ouverture de la société urbaine, la Révolution provoque un profond changement des usages des bâtiments, alors que des destructions sont peu importantes et beaucoup plus le fait du siècle de l’industrialisation.
Mais, comme on le sait, la Révolution déborde sur les frontières de la France et provoque des migrations, des circulations d’une nouvelle ampleur : d’abord, l’émigration de ceux qui sont hostiles à la Révolution ou qui se croient, à tort ou à raison, menacés par cette irruption du peuple dans la sphère politique ; ensuite par le déferlement des armées françaises victorieuses sur d’autres pays. Comme le montre Elisa Baccini à l’exemple de la correspondance de Jacques Boucher de Perthes, les administrateurs envoyés dans les pays conquis établissement un contact d’une plus grande intensité avec les populations étrangères que les voyageurs du Grand Tour et acquièrent, sans doute par leur séjour plus long, une perception plus fine des mœurs et des pratiques de ces populations. Son article nous livre des informations précieuses sur la géographie linguistique de l’Italie à l’époque de la domination française, notamment sur les pratiques orales, qui ne sont souvent que difficile à saisir à travers les sources écrites. La Révolution induit donc des circulations d’hommes qui modifient profondément les représentations que l’on se fait de l’autre.
Mais la Révolution fut bien un événement à portée mondiale, car les Européens, depuis les Grandes Découvertes avaient acquis une emprise sur d’autres continents et notamment l’Amérique. La présence de puissances coloniales concurrentes fait apparaître des angles morts, des espaces périphériques des empires, qui s’avèrent particulièrement réceptifs aux idées révolutionnaires, telle la Louisiane espagnole étudiée par Soizic Croguennec. Comme en Espagne et d’autres pays d’Europe, avant la conquête napoléonienne, les gouvernements mettent en place une censure renforcée pour empêcher la contagion révolutionnaire, ici par le moyen de l’Inquisition. Le choix de l’appartenance à telle ou telle souveraineté peut refléter un positionnement politique conscient envers l’événement révolutionnaire fondateur. Ainsi, malgré la paix entre la France et l’Espagne, se déclarer sujet du roi d’Espagne peut être vu comme le fruit d’une attitude contre-révolutionnaire.
Mais ces circulations se répercutent sur l’évolution même de la science géographique. Cela est illustré par les deux articles suivants. Les bouleversements de la période révolutionnaire au sens large (1789-1815) ont influencé et structuré la pensée de la science géographique, soit par la confrontation de visions, soit par la nécessité de s’approprier ou de réapproprier l’espace.
Dans la mesure où la politique d’expéditions d’exploration du XVIIIe siècle est poursuivie à l’époque révolutionnaire, la compétition entre pays européens pour la cartographie et l’appropriation des territoires s’entend à des espaces encore incomplètement dominés, comme l’Australie et plus généralement l’espace océanique indo-pacifique, comme le montre Dany Bréelle. Les conceptions universalistes des Lumières apparaissent ici à côté d’une conception plus nationale de la géographie, tout en mettant au point une nouvelle approche zonale et multiscalaire de l’espace océanique. Les géographes français ont légué à l’Australie un grand nombre de toponymes français sur une partie de ses côtes.
Enfin, les bouleversements de la période semblent aussi introduire la géographie dans les savoirs des écoles élémentaires, mais d’une manière spatialement très inégale, ce qui peut être dû aux effets particuliers de l’occupation française, notamment en Allemagne ou à des héritages plus anciens, liés aux inégales progrès de l’alphabétisation, comme le montre Nicola Todorov.
Editorial | Publié le 2018-05-22 07:50:03 |
La géographie historique de l’Afrique de l’Ouest à l’océan Indien constitue une approche ambitieuse pour ce nouveau numéro de la Revue. Entre l’océan Atlantique et l’océan Indien, elle aborde plusieurs grandes aires de civilisations millénaires : africaine, hellénique, perse, malgache. La dimension politique constitue le lien directeur entre l’ensemble des articles. Quels sont les enjeux géopolitiques et géohistoriques de ces territoires ? Nul doute que tous les sujets ne sont pas épuisés. Mais ce numéro nous offre un regard enrichi de recherches récentes menées par des chercheurs confirmés.
Pierre Palhavi (Professeur au Collège des forces canadiennes de Toronto), donne une vision éclairante sur les enjeux géohistoriques et géopolitiques de l’Iran à travers les siècles. Dans « l’Iran au travers du prisme géopolitique », il nous montre à quel point les représentations territoriales et spatiales nous conduisent à comprendre une vision géopolitique de ce pays. Sa représentation de pivot est omniprésente dans la conception géohistorique occidentale comme « pays charnière, verrou stratégique, carrefour de communication, nœud de pèlerinage et d'échange commerciaux ». L’auteur nous révèle les contradictions de ces représentations qui apparaissent entre les « fonctions » géopolitiques attribués par les Etats et les propres perceptions de l’Iran quant à son rôle dans les affaires mondiales. Syrus Ahmadi (Université de Tarbat Modares de Téhéran) aborde, dans "Les grandes évolutions des divisions territoriales de l'Iran depuis l'Antiquité", la manière dont l'Etat iranien s'est inspiré des structures territoriales anciennes, remontant à l'Empire Mède, pour diviser son espace politique. A travers cette approche de géographie historique et politique, il fait découvrir les continuités territoriales dans le temps long.
Dans le contexte géopolitique de ce printemps 2018, le troisième article donne à comprendre une autre réalité autour du Golfe arabo-Persique à travers la question de la mise en place de la conscription aux Emirats arabes unis. Face à l’Iran, toujours considéré comme un « géant du Golfe », par sa superficie, son histoire, sa capacité militaire et son influence culturelle, les Emirats arabes unis tentent de se préparer à des bouleversements stratégiques régionaux en organisant, pour la première fois dans leur histoire, un recrutement militaire qui concerne tous les jeunes Emiriens. Mis en place en 2014, la conscription n’est pas sans rappeler la loi de 1905 qui institue un service militaire obligatoire et universel pour renforcer les effectifs de l’armée française. En fait, comme nous le montre Léa Fabre (Institut français de géopolitique), ce n’est pas tant la dimension militaire qui importe que la nécessité de renforcer la nation émirienne, âgée à peine d’une cinquantaine d’année, qui se construit depuis l’indépendance du pays acquise en 1971, et de manifester une quête de crédibilité et de puissance.
En mer Méditerranée où les représentations données à la confrontation des puissances régionales sont tout autant importantes. Εfthymia Panagiotou (Centre des affaires européennes et internationales de l’Université de Nicosie) aborde toutes les dimensions géopolitiques dans le temps au sujet de Chypre. En s’appuyant sur le raisonnement en géographie historique et politique, elle met en évidence la construction du caractère stratégique de l’île et sa stabilité incertaine aujourd’hui.
Plus à l’Est, à Madagascar, Mathilde Cocoual (Université Côte d’Azur, Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine) et Pascal Danthu (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), UPR HortSys, Université de Montpellier) nous apprennent l’importance acquise par la culture du giroflier à Madagascar depuis la fin du XIXesiècle. Le pays est actuellement le second producteur mondial après l’Indonésie et le premier exportateur mondial de clous et d’essence de girofle. La culture du giroflier se développe sur la côte Est de la Grande-Île et à Sainte-Marie au dépend d’autres cultures de rente ou vivrières (riz, café, culture maraîchère). Ce développement n’est pas sans conséquence sur la biodiversité malgache. Encouragé par l’administration française dans les années 1890, le giroflier constitue un aspect important de l’économie nationale. Les auteurs nous conduisent à comprendre les enjeux économiques et politiques dans le temps et à analyser les bouleversements environnementaux.
A l’autre extrémité de notre aire géographique, Alexis Vastra (Doctorant au Centre d'Étude et de Recherche sur la Diplomatie, l'Administration Publique et le Politique, Université de Grenoble) traite de l’importance accrue de la surveillance de la frontière par la Tunisie face à la Lybie. Dans « Sécurité et conflits d’une région périphérique : les enjeux de gouvernance à la frontière libyenne dans la Tunisie d’après 2011 », il met en évidence les enjeux géopolitiques de confins frontaliers en considérant les stratégies d’acteurs dans la durée. Bien avant les bouleversements régionaux de 2011, il replace les réseaux d’échanges et les pôles de pouvoirs traditionnels dans le contexte mouvementé actuel. En Afrique de l’Ouest, d’autres enjeux sont aussi pris en compte par Selma Mihoubi (doctorante au Centre de recherche et d’analyse géopolitiques, Université Paris 8) à travers la question de l’implantation de Radio Chine Internationale. Elle montre comment le média chinois organise sa stratégie d’influence à travers ses structures matérielles et les messages radiophoniques diffusés. Si cette influence médiatique commence dès la naissance de la République populaire de Chine depuis 1949 dans le monde, la RCI se fait entendre surtout depuis 2010 dans une dizaine de pays sahéliens.
Philippe Boulanger
Directeur de la Revue de géographie historique
La production d'un espace : débuts lotharingiens et pratiques de la frontière (IXe-XIe siècle) | Publié le 2017-11-14 12:05:55 |
Par Jens Schneider, ACP, Université Paris-Est Marne-la-Vallée et Tristan Martine, ACP, Université Paris-Est Marne-la-Vallée / HISCANT-MA, Université de Lorraine.
Résumé : S’il est un espace problématique, compliqué à définir, difficile même à nommer, c’est bien la Lotharingie. Nous présentons tout d’abord la dénomination de cet espace politique qui est créé au IXe siècle, en distinguant notamment Francia Media, Lotharingie et Lorraine. Nous détaillons ensuite les différents changements territoriaux du royaume de Lothaire II jusqu’au XIe siècle, ce qui nous amènera à soulever l’épineuse question de la délimitation de cet espace aux frontières complexes à appréhender et à cartographier. Enfin, nous nous demanderons quelles furent les conséquences spatiales de ces changements de frontière en Lotharingie sur les aristocraties de cet espace de l’entre-deux.
Mots clefs : Lotharingie ; Francia Media ; Lorraine ; Lothaire II ; Ricuin ; Meersen ; Verdun ; espace ; frontières ; traités de partage ; politique territoriale.
Abstract : If there is a space that is problematic, complicated to define, and difficult even to name, it is Lotharingia. We begin by presenting the terms used for this political space created in the ninth century, distinguishing in particular between Francia Media, Lotharingia and Lorraine. We then detail its territorial changes, from the kingdom of Lothar II through to the eleventh century, which raises the thorny question of the delimitation of this space whose frontiers are so complex to perceive and to map. Finally, we consider what the consequences of these changes of frontier were for the aristocracy of this space ‘in-between’.
Key words : Lotharingia ; Francia Media ; Lorraine ; Lothar II ; Ricuin ; Meersen ; Verdun ; political spaces ; borders ; partition treaties ; territorial politics.
Quand il est question d’identités, les historiens accordent une grande importance à la distinction entre les dénominations propres et les dénominations adoptées. Les mots « Lotharingie » et « Lotharingiens » entrent selon toute vraisemblance dans la dernière catégorie puisqu’on les trouve pour la première fois chez un auteur d’origine italienne, Liudprand de Crémone. Il faisait partie des grands nobles de la cour des empereurs ottoniens au Xe siècle et semble avoir forgé le mot latin Lotharingia dans les années 960 pour désigner un espace qui n’était plus un royaume spécifique à cette période-là mais qu’on continua, faute de mieux, d’appeler « le royaume de Lothaire » (regnum Lotharii) d’après le roi Lothaire II pour lequel il avait été créé en 855. Il est donc difficile de prêter une qualité identitaire à la dénomination « Lotharingie ».
Dans cette contribution au numéro thématique de la « Revue de géographie historique » nous essayons d’esquisser sur la base de quelques cartes la production d’un espace politique ex nihilo, c’est-à-dire qui ne repose sur aucune tradition ancienne, qui sera remanié sans cesse par de nombreux accords ou traités de partage et qui va se fondre dans l’espace de l’Empire. Dans un deuxième temps nous allons nous interroger sur les pratiques frontalières dans ce « royaume de Lothaire » à travers l’exemple d’une famille importante de l’aristocratie lotharingienne. Suivant le principe que la frontière, en particulier au haut Moyen Âge, n’est pas une barrière stable mais plutôt une zone fluide qui invite à l’accès (Turner, 1947) et qui peut être animée par des lieux limitrophes (Dion, 1979, p. 24-26), on cherchera à savoir comment les hommes se sont adaptés aux réalités mouvantes de frontières politiques qui ont pu changer plusieurs fois pendant une génération.
I. La Francia Media
C’est essentiellement à Michel Parisse que nous devons une définition nette de la terminologie (Parisse, 2011). Il convient de distinguer trois entités spatiales : la grande Francia Media créée en 843 (carte 1), la Lotharingie étant la partie septentrionale de la Francia Media (cartes 2 et 3), et la Lorraine, choronyme comprenant les actuels départements français de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.
Carte 1 : La Francia Media

Cartographie : Martin Uhrmacher, extrait de M. Gaillard et al. (dir.), De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia Media, une région au cœur de l’Europe (c. 840–c. 1050), Luxembourg, CLUDEM, 2011, p. 600.
Michel Parisse a forgé le mot de l’axe lotharingien pour la Francia Media en insistant sur la communication et l’échange à l’intérieur de ce vaste espace notamment par la circulation le long des grandes routes fluviales formées par l’Escaut, la Meuse, le Rhin et la Moselle ainsi que le Rhône et la Saône. Cette image d’une « grande zone de passage » a été confirmée par l’analyse des facteurs économiques (Racine, 1987, p. 218). Il s’agit d’un ensemble géographique étendu entre la mer du Nord et la Méditerranée qui était une création artificielle, bien que Janet Nelson nous ait mis en garde contre une vision téléologique d’un royaume éphémère (Nelson, 2011, p. 254). Il est vrai que lors du partage de Verdun nul ne pouvait savoir que la division en trois de l’empire franc rassemblé par Charlemagne n’allait pas durer : le détail du traité de partage a été négocié par une commission de plus d’une centaine d’hommes qui étaient experts dans la matière, les partages de royaumes étant une coutume franque. Ils ont bien fait leur travail et le résultat peut être considéré comme une division équilibrée, autant au niveau économique et fiscal que par rapport à la distribution des « lieux de pouvoir » de cités épiscopales, abbayes et palais royaux (Nelson, 2011 ; Schieffer, 1961).
Le royaume médian échu à Lothaire Ier et ses grands rassemblait des terres entre l’embouchure des grands fleuves appelée Rhine-Meuse delta aujourd’hui (Cohen et al., 2012) jusqu’au-delà de Rome puisque le duché de Spolète faisait théoriquement partie de la Francia Media. Cette dernière comprenait des sites économiques importants à l’époque tels que Dorestad et Walcheren dans la zone du delta évoqué, des sièges épiscopaux prestigieux comme Milan, Pavie, Trèves et Cologne, et enfin d’importants palais comme Aix-la-Chapelle, Thionville, Gondreville ou Nimègue. La Francia media enjambait en quelque sorte le Patrimonium petri, territoire sous l’autorité papale garanti par les rois francs depuis Pépin le Bref au VIIIe siècle, et incluait la ville de Rome qui était liée à la dignité impériale transmise de père en fils de Charlemagne à Louis le Pieux, puis à Lothaire. Cela s’applique dans une moindre mesure à Aix-la-Chapelle, palais préféré par Charlemagne, et Metz, haut lieu de mémoire de la famille carolingienne, même si on a tendance à relativiser l’importance de ces deux sites pour les contemporains du IXe et Xe siècle depuis quelques années (McKitterick, 2008, p. 157-171).
Cette Francia Media artificielle qui durait de 843 à 855, année de la mort de Lothaire Ier, n’a pas connue de dénomination propre dans les textes de l’époque. Michel Parisse a signalé la formule in media Francia dans une énumération de quelques pagi sous l’autorité de Lothaire en 830 et dans la Vie de l’évêque Aldéric du Mans vers 840 (Migne, PL 115, col. 92 et PL 97, col. 647 ; Parisse, 2011). Cette absence de dénomination pour un si vaste espace n’est pas aussi surprenante que cela puisse paraître. Certes, pendant la douzaine d’années qu’il a existé on n’a pas trouvé de mot particulier pour désigner la Francia Media, mais on n’en avait peut-être pas forcément besoin. Il ne faut pas oublier que les auteurs contemporains avaient l’habitude de désigner les parties résultant des partages de l’empire franc – toujours perçu comme une structure unie – par des expressions du type Francia orientalis ou occidentalis. Toujours est-il que la dénomination qui s’est imposée pour le royaume du fils de l’empereur Lothaire Ier, regnum Lotharii, rappelle son premier roi, Lothaire II, et que ses habitants apparaissent comme « Lothairiens » à partir de 912 (Parisot, 1898, p. 747-753). Il y a là une particularité terminologique propre à la Lotharingie comparé aux Francs (devenu Français), Alamans ou Danois des royaumes voisins.
II. La Lotharingie : du regnum Lotharii aux deux duchés
Une des sources qui nous renseignent le mieux sur cette période sont les Annales de Saint-Bertin. C’est sous la plume de l’évêque Prudence de Troyes que nous apprenons que Lothaire Ier se retire au monastère de Prüm (diocèse de Trèves) en 855, qu’il y mourut le 29 septembre et qu’il partagea son royaume avant sa mort entre ses fils Lothaire et Charles (Annales de Saint-Bertin, p. 71 ; carte 2). Ce partage témoigne d’un consensus entre le père, Lothaire, ses deux fils présents et leurs conseillers. Si la répartition n’est pas mise en cause immédiatement, elle sera revue dans les années qui viennent à plusieurs reprises (Annales de Saint-Bertin, p. 77, 82, 96 ; Parisot, 1898, p. 223-227 ; Kaschke, 2005). Il faut savoir que Louis, le fils aîné de Lothaire Ier, avait déjà été couronné co-empereur en 850 et qu’il régna depuis de façon indépendante sur l’espace italien de la Francia Media. En 855, Lothaire Ier destina la partie désignée comme Francia dans le récit des Annales de Saint-Bertin à Lothaire II tandis que Charles qui avait une dizaine d’années reçut la Prouincia, une Provence élargie jusqu’au Lac Léman. On peut donc s’interroger sur les modalités du partage de la division de 855, qui semble être avant tout un succès des conseillers du troisième fils ayant obtenu la mise en place d’un véritable royaume sous l’autorité théorique du jeune Charles.
Carte 2 : Austrasie et Lotharingie
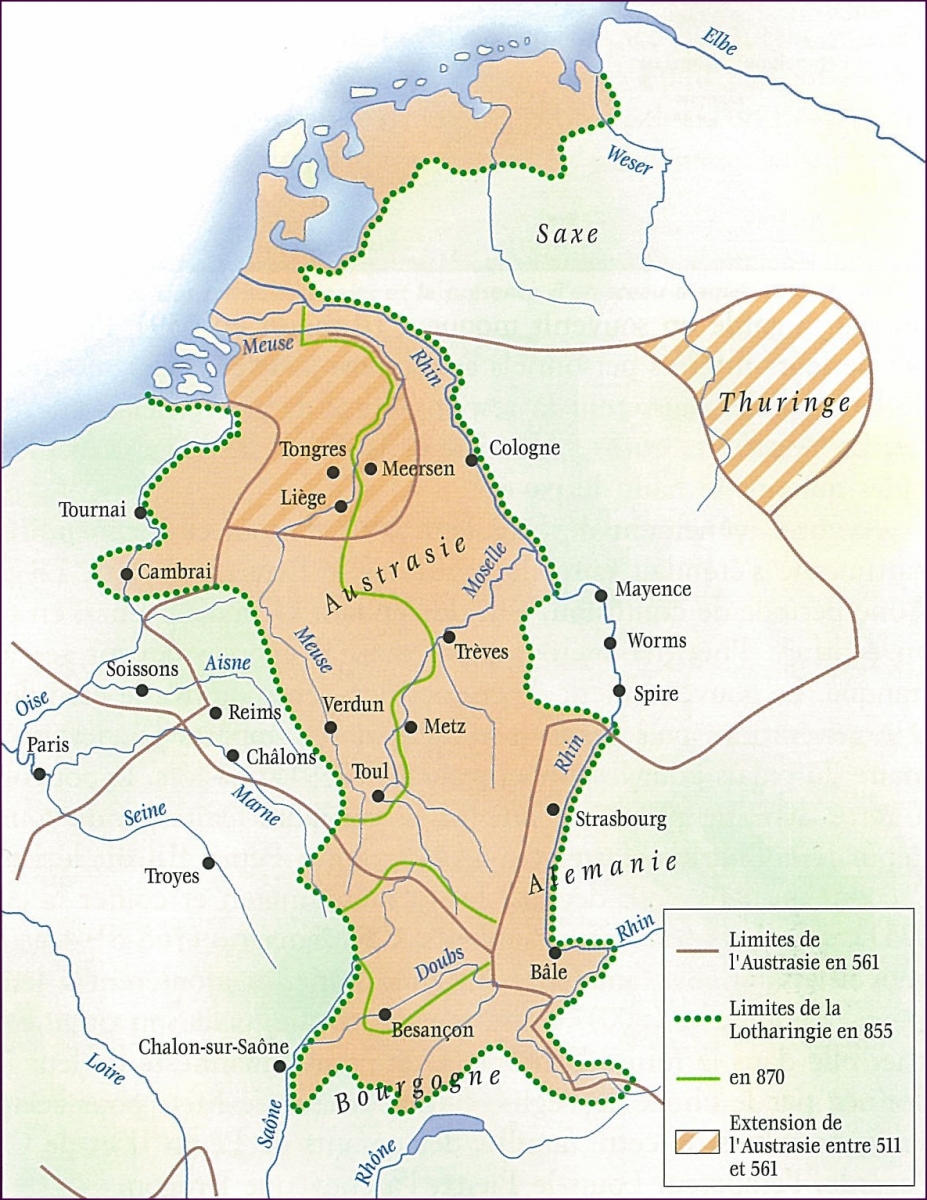
Cartographie : Patrick Mérienne, extrait de M. Parisse, Histoire de Lorraine, Rennes, Éditions Ouest-France, 2005, p. 7.
Le royaume de Lothaire II connaîtra de nombreux changements territoriaux depuis sa création jusqu’au XIe siècle (Parisot, 1898 ; Schneider, 2010, p. 95-114). Lothaire va céder des parties à ses deux frères et en récupérera d’autres après la mort de Charles en 863. Ces changements se passent au niveau du Rhône, de l’Isère et de la Saône. La seule cartographie complète et correcte de toutes les modifications territoriales jusqu’au Xe siècle reste celle proposée par Robert Parisot (2 cartes dépliantes : « La Lorraine de 843 à 888 » et « La Lorraine de 888 à 923 »). Après la mort de Lothaire survenue à Plaisance en 869, sur la route qui le ramenait d’Italie, son royaume fut partagé en deux par ses oncles Louis et Charles, rois en Francie orientale et occidentale (carte 1). Ce partage qui annihila la Lotharingie après un quart de siècle fut l’objet d’un véritable traité conclu près de Meersen, actuellement aux Pays-Bas, qui est entièrement conservé (carte 2 ; Boretius, Krause, 1897, no 251, p. 193-195). Il n’empêche que, comme tant d’autres traités de partage du IXe siècle, ces dispositions furent rapidement caduques. Pendant les 70 ans qui se déroulent entre 855 et l’intégration définitive de la Lotharingie dans l’Empire ottonien, on compte non moins de treize partages, cessions ou annexions concernant cet espace. Pour notre propos on mentionnera, après la disparition du royaume suite à la mort de son premier roi en 870, l’an 895 où la Lotharingie « renaissait » (Parisot, 1898, p. 513) avec comme roi Zwentibold, le fils du futur empereur Arnulphe, et l’an 900 qui fut marqué par la mort de Zwentibold.
S’il faut voir une césure dans l’histoire de l’espace lotharingien du haut Moyen Âge, elle est en 900. C’est l’année de la fin du royaume de Lotharingie. Désormais, elle fera partie du royaume oriental sous le frère de Zwentibold, Louis l’Enfant, puis du royaume de Charles le Simple avant d’intégrer de nouveau le royaume de l’Est sous son premier roi ottonien, Henri l’Oiseleur. A trois reprises, l’aristocratie lotharingienne a décidé de passer sous l’autorité d’un autre roi : en 900, bien avant la mort de Zwentibold, en 911 en prêtant hommage à Charles le Simple et en 923/925 en se ralliant à Henri l’Oiseleur. À chaque fois, c’est une famille de première importance dans l’aristocratie de cet espace, les Régnier, qui a initié ce changement d’allégeance (Le Jan, 1995b ; Dierkens, Margue, 2004). On reviendra sur cet aspect.
C’est en ce début du Xe siècle qu’apparaissent les premières appellations du royaume et de ses habitants. Dans un diplôme original conservé au monastère de Saint-Gall est mentionné Gebhard qui était parmi ceux à s’être débarrassé de Zwentibold, en tant que dux regni quod a multos Hlotharii dicitur, « duc du royaume que de nombreuses personnes appellent celui de Lothaire » (Schieffer, 1960, no 20). Ce diplôme du 24 juin 903 est la première attestation de la formule regnum Lotharii, « royaume de Lothaire ». Une dizaine d’années plus tard, en 912, on rencontre la première dénomination des hommes de ce royaume comme Hlutharingi, « Lothairingiens » ou, un peu plus tard encore, Lotharienses, « Lothairiens » dans les sources narratives (Annales Alamannici, p. 188 ; Reginon, p. 155-161). Il faudra attendre les années 960 pour la première attestation sûre dans les sources diplomatiques : deux chartes lorraines conservées par les abbayes de Saint-Mihiel et de Bouxières-aux-dames parlent de Lotharienses (Lesort, 1912, no 27 ; Chartae Galliae, no 223070), les diplômes d’Otton Ier avec des mentions gentiliques étant suspects ou faux (Sickel, 1884, nos 6, 70, 106, 210 ; Parisse, 2006). C’est à ce moment que Liudprand de Crémone, qui parle aussi de Lotharingi, qualifie Giselbert († 939), fils de Régnier au Long Cou, de dux in Lotharingia, « duc en Lotharingie » (Liudprand, II.18, p. 45 et II.24, p. 49). Le constat que le choronyme Lotharingia a été calqué sur la dénomination des hommes ne peut cependant pas être compris comme un indice pour la formation d’une entité, voire d’une identité gentilique (Pitz, 2005 ; Schneider, 2010, p. 258-273). Le « souvenir austrasien » invoqué par Michel Parisse ne peut s’appliquer sur la partie lorraine devenant la Haute-Lotharingie (Parisse, 1989, p. 170-171 ; carte 2).
Le mot s’imposera dans les actes et chroniques pour être repris par les historiens du XXe siècle et ce n’est peut-être pas un hasard si les premiers à l’utiliser semblent avoir été Wilhelm Levison et Franz Steinbach, tous deux professeurs à l’université de Bonn qui était dotée d’un institut pluridisciplinaire d’histoire rhénane (Levison, 1925 ; Steinbach, 1939). « Lotharingie » s’est depuis établie comme le terme technique pour désigner l’espace du royaume de Lothaire II, bien que l’historiographie moderne, notamment allemande, a continué pendant longtemps à employer « Lorraine » ou « Lothringen » comme synonyme du mot médiéval duquel ils sont issus (Pitz, 2005).
La Lotharingie politique connut plusieurs fins. La fin d’un royaume lotharingien spécifique est survenue à deux reprises en 869 et en 900. Dans les années 920, Giselbert († 939) qui était parmi ceux qui ont quitté Charles le Simple pour rejoindre Henri l’Oiseleur a réussi à obtenir le titre ducal du roi Henri devenu aussi son beau-père. D’autres grands nobles seront nommés duc par Otton Ier, parmi eux le frère cadet du roi, Henri, et Otton de la famille des Ricuin († 944), sans qu’une continuité successive aux mains d’une famille n’ait pu s’établir. Force est donc de constater l’absence d’un pouvoir central continué en Lotharingie hormis l’autorité royale ottonienne (Schneidmüller, 1987, p. 93).
À partir de quel moment peut-on appeler duché cet espace ? (Goetz, 2011) Quelques chartes avec des mentions ducales pour Frédéric ou Ferry Ier († 978) et Godefroid († 964) dans une même période ont laissé penser que Brunon, autre frère du roi Otton, archevêque de Cologne et duc lui aussi, avait partagé en deux la Lotharingie. Par conséquent, on a vu dans l’année où Ferry fut nommé duc (959) ou bien dans l’année de la mort de Brunon (965) la naissance de deux duchés, haut- et bas-lotharingiens, alors que le pouvoir de Godefroid et de Ferry semble avoir été limité respectivement au Hainaut et aux Ardennes. De plus, la célèbre charte dans laquelle Ferry se serait intitulé duc pour la première fois, à l’aide d’une formule empruntée aux diplômes royaux, qui constitue l’une des pièces majeures pour défendre l’an 959 comme point de départ de deux duchés, est pour le moins fort problématique (Chartae Galliae, no 222515 ; Barth, 1990, p. 133-141 ; Schneider, 2010, p. 126-129). La question a été largement débattue mais on convient aujourd’hui qu’on ne peut pas concevoir une division en deux duchés avant le milieu du XIe siècle (Barth, 1990, p. 168-178 ; Boshof, 1987, p. 149-153 ; carte 4). On sait que Gozélon († 1046) et son fils Godefroid le Barbu († 1069), descendants du comte Wigéric et de Cunégonde exerçaient l’autorité ducale sur l’espace des deux duchés (Bresslau, Kehr, 1931, no 74), à l’exclusion toutefois de l’Alsace et la Frise.
III. Quelles frontières pour la Lotharingie ?
Les historiens ont parfois du mal à envisager une frontière autre que comme un tracé linéaire ou un phénomène naturel supposé former une barrière nette. La plupart des cartes qui ont été dessinées pour visualiser la situation politique suite aux nombreux partages du haut Moyen Âge montre des frontières linéaires ce qui invite à imaginer des délimitations précises dans le paysage. Cela rappelle l’ouvrage pionnier de Friedrich Ratzel paru à la fin du XIXe siècle et le problème de la frontière naturelle (Ratzel, 1891). Ce n’est pas ici le lieu de développer ce débat aux nombreuses implications idéologiques. On insistera seulement, dans le contexte de notre propos lotharingien, sur l’exemple du Rhin qui montre bien qu’un cours d’eau ne représentait pas forcément une barrière mais plutôt une zone d’échange, un « interface » comme l’a démontré Geneviève Bührer-Thierry à travers l’exemple de l’Elbe (Bührer-Thierry, 2011, p. 75).
À Cologne, l’archevêque Brunon mentionné ci-dessus, fonda au milieu du Xe siècle une collégiale sur un îlot du Rhin. Le site de cette collégiale de Saint-Martin dont il subsiste une église du XIIe-XIIIe siècle fait partie aujourd’hui de la vieille ville de Cologne, sur la terre ferme (Engels, 2006, p. 52). Plus au Sud, en Alémanie, Liudprand de Crémone nous renseigne sur le fait que le site de Brisach se trouve dans une position protégée sur une île du Rhin (Liudprand, IV.27). Les géographes du XXe siècle ont confirmé le caractère mouvant du Rhin qui se présentait sous forme de plusieurs tracés et boucles comprenant des zones inondables (Wolfram, Gley, 1931, p. 4 et cartes 1 et 7 ; Henze, 1939, p. 219). Dans les deux cas, le fleuve a perdu sa forme disloquée aujourd’hui ce que l’on observe également dans le cas du delta formé par le Rhin et la Meuse (Cohen et al., 2012 ; cartes 3 et 4). Ce phénomène n’est pas propre au Rhin : des recherches récentes ont bien mis en évidence les problèmes auxquels ont été confrontés les membres des comités de délimitation mis en place suite aux conflits sur les Balkans à la fin du XIXe siècle (Schneider, 2013, p. 133-134). Les cours d’eau du Danube, de la Drina et de la Morava ne se prêtaient guère à l’utilisation de tracé frontalier à cause de leur caractère imprécis.
Carte 3 : La Lotharingie au Xe siècle
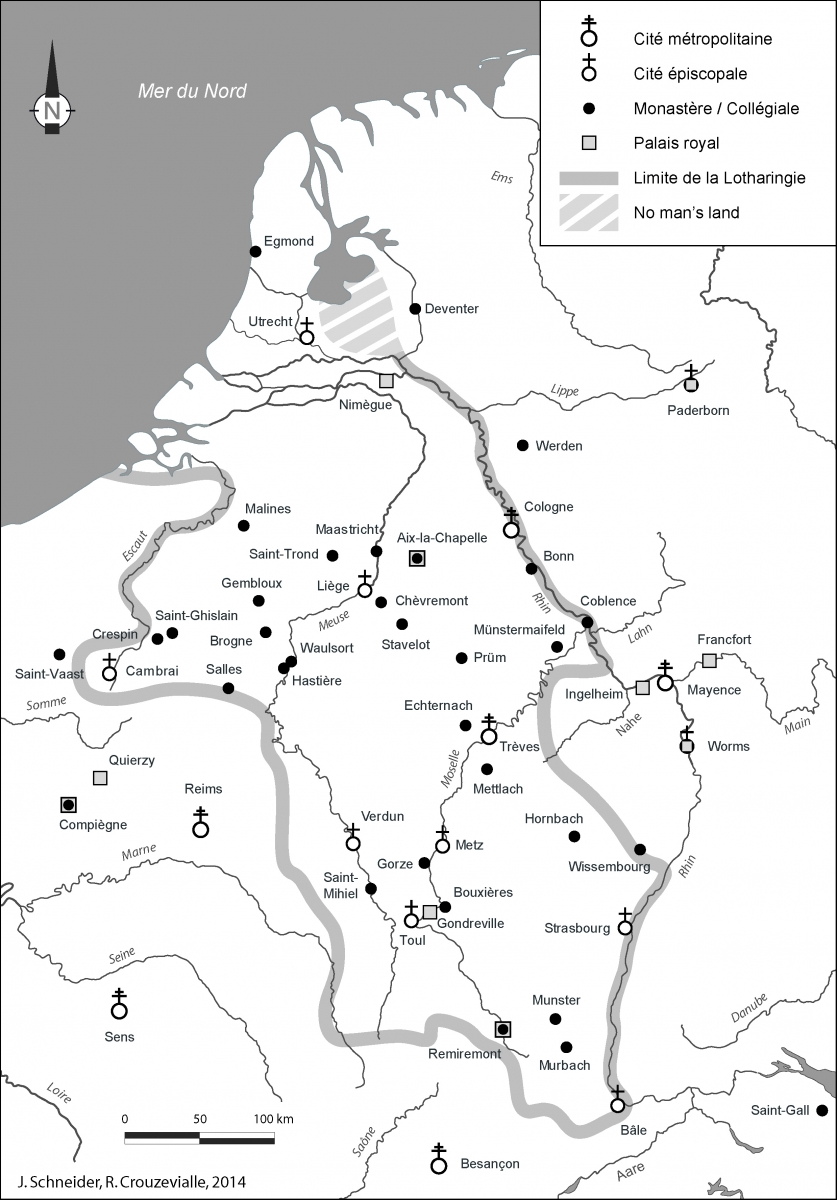
Cartographie : Rémi Crouzevialle, Université de Limoges, 2014.
Les différentes représentations cartographiques de la Francia media de 843 et de la Lotharingie montrent qu’il y avait quelques régions dont l’appartenance politique ne ressort pas très clairement des informations fournies par les sources contemporaines. Cela concerne notamment l’Alsace, la Frise, le royaume de Bourgogne, mis en place à la fin du IXe siècle, et le duché de Spolète. Pour ce dernier il est difficile à dire à quel point il faisait partie de la Francia Media, puis du royaume de Louis II. Dans le cas de l’Alsace on a contesté qu’elle fasse partie du royaume de Lothaire qui l’aurait promise à son oncle Louis le Germanique en 860 ou bien donnée à son fils illégitime Hugues en 867 ; au plus tard au début du Xe siècle l’Alsace aurait fait partie de la Francie orientale (Bauer, 1997, p. 3-5). Il est cependant impossible de trouver des indices de l’influence de Louis en Alsace avant 870, date du partage de Meersen, alors qu’on dispose bien des diplômes de Lothaire II (Schieffer, 1966, nos 28, 30 ; Henze, 1939, p. 235 ; Zotz, 1995, 60 ; carte 2). La question est plutôt de savoir si au moment du rétablissement du regnum Lotharii pour Zwentibold en 895 et plus encore au Xe siècle l’Alsace fut considérée comme lotharingienne. On sait que Zwentibold entra en conflit militaire avec Rodolphe, roi non-carolingien qui se fit couronner en 888 à Saint-Maurice-d’Agaune (carte 1) et une deuxième fois à Toul pour réclamer le pouvoir en Lotharingie, au moins dans ses parties méridionales. En effet, le statut de l’espace de l’ancien pagus Ultraioranus (Weber, 2011, p. 61-70) n’est pas clair entre 888 et 926. Les diocèses de Bâle et de Besançon, en d’autres mots le Sundgau alsacien et les contrées autour du Doubs et l’Aare (carte 2) ont été réclamés par les rois Zwentibold, Louis l’Enfant et Henri l’Oiseleur d’un côté et par Rodolphe de Bourgogne et son fils Rodolphe II de l’autre.
Citons une dernière fois Liudprand dont le récit nous éclaire sur la situation (Liudprand IV.25, p. 118-119). Selon toute évidence, Rodolphe II aurait amené lors de sa rencontre avec le roi Henri à Worms en 926 la « sainte lance », relique prestigieuse comportant un clou de la croix du Christ, pour recevoir en échange la confirmation de son pouvoir sur l’espace alémanique-haut-bourguignon au Sud de Bâle et de Remiremont, c’est-à-dire le diocèse de Besançon et le Sud du diocèse de Bâle. La Lorraine et l’Alsace restaient donc dans l’Empire et elles restaient lotharingiennes jusqu’à la fin du Xe siècle, quand s’esquissèrent les deux duchés haut- et bas-lotharingiens et le futur comté de Hollande tandis que l’Alsace allait rejoindre le duché de Souabe (Goetz, 2011, p. 127-128 ; Zotz, 1995, p. 67-69 ; carte 4).
De l’autre côté du Rhin, il n’y a pas d’unanimité en ce qui concerne le statut de quelques comtés situés en Rhénanie qui se situent à peu près en face de Cologne et font partie de son diocèse, pas plus qu’en ce qui concerne la Frise. Comme le montrent bien les cartes, pour certains historiens l’espace frison jusqu’au-delà de l’embouchure de la Weser aurait été compris dans les terres de la Francia Media et par conséquent de la Lotharingie (cartes 1 et 2 ; Bauer, 1997, cartes en annexe). Il faut évoquer ici une thèse de géographie rarement citée soutenue à Göttingen en 1920 et publiée en 1939 après la mort de son auteur (Henze, 1939). Il s’agit d’une analyse pointilleuse des frontières de l’époque carolingienne qui divisent les Francies, orientale et occidentale, donc les espaces devenant Empire et royaume de France. Henze discute déjà ces problèmes et propose des réponses très convaincantes.
Le texte du traité de Meersen mentionne in Ribuarias comitatus quinque, « cinq comtés en Rhénanie », dans la partie qui revint désormais à Louis le Germanique (Boretius, Krause, 1897, no 251, p. 194). Rien n’indique que ces comtés qui étaient forcément lotharingiens avant 870 aient été situés sur la rive droite comme l’a déjà fait remarquer Henze (Henze, 1939, p. 231-234). Au contraire, les sources narratives parlent bien du Rhin comme délimitation. Un indice important duquel on a déduit leur appartenance à la Francia Media et ensuite à la Lotharingie, se trouve dans les actes du monastère de Werden (cartes 3 et 4) qui continuent de dater d’après les années de règne de Lothaire Ier après le partage de 843, jusqu’en janvier 845 (Lacomblet, 1840, no 60). Ce phénomène, que l’on constate aussi dans d’autres cas, peut s’expliquer par l’autorité impériale qui est considérée comme supérieure à celle du roi de la nouvelle Francie orientale, surtout dans les premières années suivant le partage de Verdun (Henze, 1939, p. 231-232 ; Schieffer, 1938 ; Schneider, 2010, p. 91-94).
Carte 4 : Les duchés lotharingiens au XIe siècle
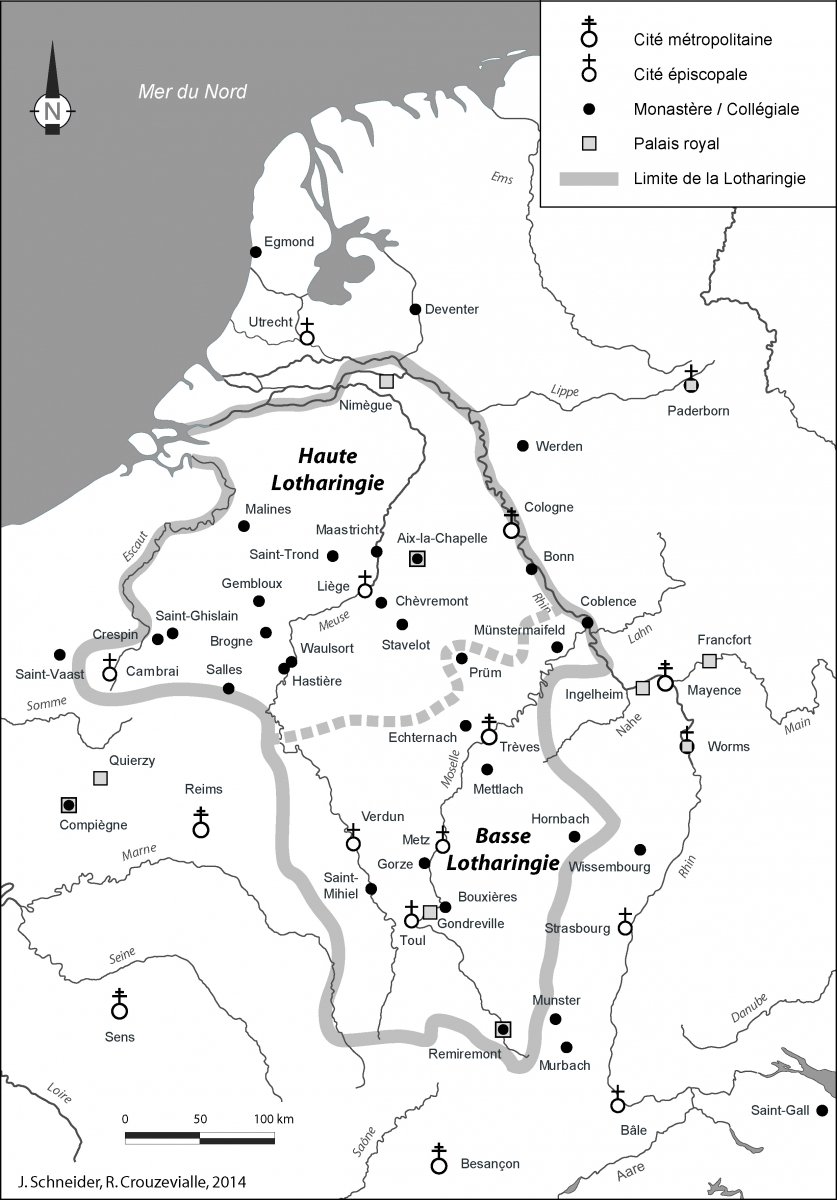
Cartographie : Rémi Crouzevialle, Université de Limoges, 2014.
Quant à la Frise, le traité de Meersen aurait été mal lu comme le met en avant Kaj van Vliet dans sa thèse publiée en 2002. Il rejoint les observations de Henze qui insistent sur le passage suivant de Frisia duas partes de regno quod Lotharius habuit, « deux parts de la Frise que tenait Lothaire » (Boretius, Krause, 1897, no 251, p. 194). Selon van Vliet, cette précision n’était pas anodine, surtout si l’on considère que les auteurs de ces traités étaient des professionnels des partages (Nelson, 2011, p. 248) ; elle signalerait que la Frise de Lothaire divisée en 870 n’était pas identique à l’espace occupé par les Frisons mais représentait seulement une partie, probablement la Frise occidentale. Par conséquent, il faut voir dans la Frisia telle qu’elle fut partagée à Meersen et dont Louis le Germanique reçut deux parts et Charles le Chauve la troisième partie, l’espace entre Sincfal et Vlie, de l’embouchure de l’Escaut à la mer d’Ijssel (Henze, 1939, p. 227-230 ; van Vliet, 2002, p. 133-138). C’est ici que le comte Dietrich ou Dirk fonda un monastère de femmes à Egmond dans les années 920.
Pour les raisons exposées, nos cartes 3 et 5 proposent une Lotharingie comprenant bien l’Alsace et une Frise limitée seulement à la zone de l’embouchure d’Escaut, Meuse et Rhin et au Kennemerland qui apparaît comme Kinnim dans les sources du IXe siècle. En l’absence d’informations précises sur la frontière au-delà du Rhin nous avons supposé une zone de No man’s land pour indiquer la délimitation de la Lotharingie vers le reste de la Frise.
IV. Ricuin de Verdun ou l’essor du pouvoir lorrain d’un soutien de Charles le Simple
Après avoir analysé les questions des frontières à l’échelle lotharingienne, étudions-les à un niveau plus restreint : celui de pratiques spatiales individuelles au début du Xe siècle. À cette période, la Lotharingie connut un revirement spectaculaire : à la mort du roi de Francie Orientale Louis l’Enfant, en 911, cet espace connut en effet, un important mouvement de bascule, relevant désormais de la Francie Occidentale et de son roi carolingien Charles le Simple jusque vers 923/925.
Les grands lotharingiens se rattachèrent donc durant deux décennies à un nouveau royaume, ce qui ne va pas sans poser problème et amène, entre autres, à s’interroger sur les politiques territoriales de l’aristocratie lotharingienne. Qu’ils aient subi ou provoqué ce revirement géopolitique, les grands lotharingiens ont-ils modifié leurs politiques territoriales durant les années 910 et 920 ? Leur horizon s’est-il tourné vers l’Ouest avec le rattachement à la Francie occidentale ?
Ricuin de Verdun était l’une des principales figures politiques lotharingiennes du règne de Charles le Simple, ce que Robert Parisot fut, étonnamment, l’un des seuls à souligner avec force (Parisot, 1898, p. 603). On le rencontre dans les sources dès les années 890, dans deux chartes du roi Zwentibold : le 14 août 895, ce dernier donne des terres dans la Meuse aux moines de Saint-Mihiel à Buxières-sous-les-Côtes, à Heudicourt-sous-les-Côtes, à Refroicourt (village ruiné, actuellement commune de Les Paroches) et à Bannoncourt et précise que toutes ces possessions sont situées dans le comté de Verdun dirigé par Ricuin ; le 23 janvier 899 Zwentibold évoque également le comte Ricuin, intervenu auprès du roi en faveur de l’église de Trèves (Schieffer, 1960, no 3, no 27).
On perd ensuite absolument toute trace de Ricuin durant l’intégralité du règne de Louis l’Enfant (900-911) pour ne le retrouver mentionné que le 12 février 912 dans un acte de Charles le Simple, dans lequel il intervient, conjointement avec l’évêque Drogon de Toul, dans les affaires de l’église de Toul. Peu après, le 11 juin 913, Ricuin profite de la présence de Charles à Metz pour lui faire confirmer des donations effectuées par Louis l’Enfant au profit de Saint-Mihiel (Lauer, 1949, no 71, no 73). Le 27 novembre 915, Charles III statue sur des aspects disciplinaires de Saint-Mihiel, là encore à la demande du comte Ricuin (Lauer, 1949, no 83). Enfin, l’année suivante, le 19 janvier 916, il est présent au palais de Herstal, où le roi a réuni les principaux aristocrates lotharingiens, pour trancher différents points litigieux (Lauer, 1949, no 84 ; carte 5). Or son nom apparaît, de manière significative, en deuxième position dans la liste des laïcs, juste après le comte du palais Wigéric et, surtout, avant Gislebert – que l’historiographie tient pourtant généralement comme l’aristocrate lotharingien le plus puissant de son temps, mais qui était alors néanmoins assez jeune.
De cette disparition totale des sources contemporaines de Louis l’Enfant puis de son apparition rapide et importante dans celles de Charles le Simple, on peut facilement conclure que Ricuin fut un opposant au pouvoir de Louis l’Enfant en Lotharingie ou, tout du moins qu’il ne le soutint pas de manière active. A l’inverse, la proximité de Ricuin avec Charles le Simple paraît si évidente que le comte de Verdun n’a pas seulement dû accepter rapidement la mainmise du Carolingien sur la Lotharingie mais qu’il a probablement joué un rôle actif en favorisant d’une manière ou d’une autre l’arrivée de Charles III sur le trône de l’ancien royaume de Lothaire.
Ceci expliquerait l’importance des récompenses qu’il reçut dans les années 912-920. On le retrouve ainsi abbé laïc du monastère vosgien de Moyenmoutier, très certainement nommé par Charles le Simple – de la même manière que le précédent abbé, le comte Hillin, avait été désigné par Zwentibold (Liber de sancti Hildulfi, p. 89). Il devint également au même moment abbé laïc de Saint-Pierre-aux-Nonnains, ce que Gordon Blennemann analyse comme une preuve évidente de reconnaissance royale, d’autant plus que cet abbatiat laïc, qui avait échu à la famille des Matfrid dans les années 880, leur avait été retiré en 896 par Zwentibold en raison de leur rébellion contre lui (Blennemann, 2011, p. 69 ; Parisot, 1898, p. 711). L’abbatiat laïc de ces deux abbayes devait conférer un pouvoir important à Ricuin, qui, par un acte du 17 janvier 918 (ARTEM, no 300), donne en précaire, en tant que comte et abbé laïc de Saint-Pierre-aux-Nonnains, des terres dépendant de cette abbaye en Meurthe-et-Moselle à Champey-sur-Moselle, à Bouillonville, à Essey-et-Maizerais, à Benney (Davillé, 1906, p. 24, 36) et à Mamey (Lepage, 1862, p. 84).
Cette liste de possessions ne constitue qu’une infime partie de l’ensemble des domaines de Ricuin, que l’on ne peut malheureusement pas reconstituer en détail faute de sources. La documentation qui nous est parvenue ayant quasi systématiquement transité par les abbayes, on ne peut en effet connaître les domaines des aristocrates lotharingiens que lorsqu’ils ont affaire aux abbayes ou évêchés, comme le souligne Robert Parisot : « La faveur dont jouissaient les seigneurs ne nous est attestée, le plus souvent, que par leur intercession en faveur d’un évêché ou d’une abbaye, non par les privilèges qu’ils ont reçus eux-mêmes et qui ne nous sont pas arrivés. Le crédit des évêques et des abbés nous est connu, au contraire, et par les actes où ils interviennent, et par ceux qui sont rendus pour leur église ou leur monastère. » (Parisot, 1898, p. 605) Tout cela lui permet d’« occupe[r] une situation importante, prépondérante même, dans le sud de la Lorraine » (Parisot, 1898, p. 604). On trouve un témoignage de sa puissance dans une source contemporaine sur Jean de Gorze qui « fréquenta durant plusieurs années la maison du comte Ricuin, un homme très important [prestantissimus] de l’époque, sage et très habile à mener les affaires en tout genre, et il en retira pour lui-même un très grand profit. En effet, c’est par une donation de ce comte qu’il détenait l’église de son village natal [Vandières] » (Jean de Saint-Arnoul, 1999, p. 51). Cet épisode se situe aux alentours de 920 et illustre les avantages que pouvait tirer un grand aristocrate de l’abbatiat laïc. En effet, Vandières (Meurthe-et-Moselle) appartenait à Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz et c’est en tant qu’abbé laïc de cette institution que Ricuin put en disposer librement (Jean de Saint-Arnoul, 1999, p. 7).
Carte 5 : L’ancrage spatial lotharingien du comte Ricuin de Verdun
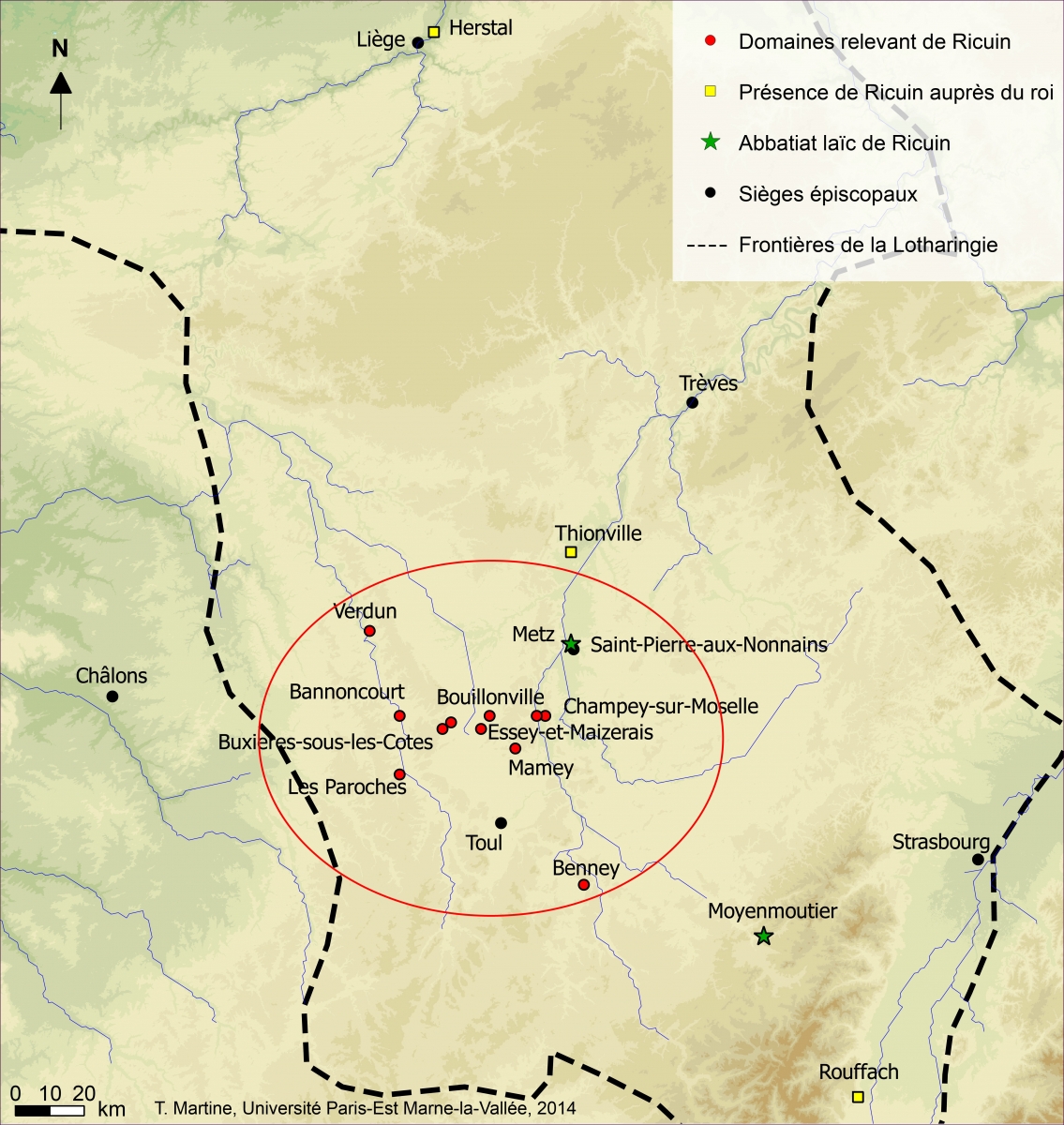
Cartographie : Tristan Martine, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 2014
La politique matrimoniale de Ricuin est un autre témoignage de son ascension. Il avait tout d’abord épousé la fille d’Engelram, comte en Flandre et en Frise qui perdit la faveur de Charles le Chauve dans les années 870 (Nelson, 1982, p. 213 et 240). C’est peut-être en raison de cette disgrâce ou d’une volonté de s’implanter davantage dans la région verdunoise que le comte de Verdun fit, en 883, décapiter sa femme (Reginon, p. 121), prétextant une affaire d’adultère (Le Jan, 1995a, p. 284). Son second mariage, conclu après 916, avec Cunégonde, veuve du très puissant comte Wigéric, va clairement dans le sens de cette analyse, puisqu’il s’agit là non seulement d’un mariage hypergamique pour Ricuin, mais également d’une alliance avec la famille dite « d’Ardenne », l’une des mieux ancrées dans le Sud de la Lotharingie et notamment dans le Verdunois (Evrard, 1981 ; Margue, 2013).
À côté de ses charges d’abbé laïque, Ricuin continue d’apparaître comme comte de Verdun (Chartae Galliae, no 222496) et il est même possible qu’il ait également été dans ces mêmes années 910-920 comte de Metz, information que rapportent différents historiens mais qui en réalité est fondée sur une mauvaise interprétation faite par M. Meurisse en 1634 de l’expression Riquinus misericordia Dei comes et abba monasterii Sancti Petri Apostolorum principis Metensis ecclesiae dans la charte déjà citée du 17 janvier 918 (Meurisse, 1634, p. 279 ; ARTEM, no 300). Comme le note à juste titre V. Chatelain, le simple fait d’être abbé laïc de Saint-Pierre-de-Metz ne suffisait pas à lui donner le titre comtal de la cité messine, et c’est très probablement à sa fonction de comte de Verdun qu’il est ici fait référence (Chatelain, 1898, p. 101). De même, de nombreux historiens font de lui le comte de Toul, supposant qu’il tenait donc entre ses mains les trois sièges épiscopaux qui formeront quelques siècles plus tard la province des Trois-Évêchés (Calmet, 1728, p. 335 ; Kalckstein, 1877, p. 135). Néanmoins, là encore, il faut raison garder : le diplôme du 12 février 912 déjà cité montre en effet que Ricuin était influent dans le Toulois mais ne suffit pas à lui attribuer avec certitude le titre comtal (Lauer, 1949, p. 160).
Enfin, un dernier titre est encore plus problématique : celui de duc. Dans le nécrologe B du Liber Memorialis de Remiremont, au folio 34 verso, un « dux » Riquinus est mentionné comme étant mort un 15 novembre (Liber memorialis, p. 76). Robert Parisot refuse d’identifier cette mention avec le comte de Verdun (Parisot, 1898, p. 604), notamment car aucun autre document n’atteste de l’attribution du titre ducal à Ricuin, tandis que pour Eduard Hlawitschka et Michèle Gaillard, il ne fait pas de doute que ce dux Riquinus est bien Ricuin de Verdun (Liber memorialis, p. 193 ; Gaillard, 2006, p. 304). Pour autant, cette mention isolée n’atteste pas tant que Ricuin était bel et bien, de jure, duc de Lotharingie, mais bien plutôt que son pouvoir était si important qu’un scribe de Remiremont a pu lui accoler ce titre au moment de sa mort. Parisot suppose ainsi que Ricuin « exerçait dans les bassins supérieurs de la Moselle et de la Meuse, une sorte d’autorité ducale, analogue à celle que possédait Régnier dans le nord-ouest de la Lorraine » (Parisot, 1898, p. 604). Très rares étaient les aristocrates à avoir droit à une inscription individuelle dans le nécrologe de Remiremont à la date de leur décès, et cette mention ne fait que confirmer l’importance du statut progressivement acquis par Ricuin (Gaillard, 2006, p. 300). Significativement, vingt ans plus tard, son fils, Otton, obtiendra ce titre ducal, de 940 à 942.
La puissance de Ricuin paraît donc s’être accrue de manière extrêmement conséquente dans le sillage de l’acquisition de la Lotharingie par Charles le Simple. Le Carolingien aurait pu récompenser ses soutiens par des terres situées en Francie occidentale, mais tel ne semble pas avoir été le cas, ce que l’exemple de Ricuin montre bien. Différents actes nous permettent de constater que le comte de Verdun ne reste pas uniquement dans son comté et cela en raison de ce que les historiens allemands nomment la Königsnähe, c’est-à-dire la proximité au roi. On le voit ainsi accompagner le roi dans trois anciens palais carolingiens : à Metz en 913, à Thionville en 915 et à Herstal, dans l’actuelle province de Liège, en 916 (Lauer, 1949, nos 73, 83, 84 ; carte 5). Il suit également le roi en Alsace, à Rouffach (Haut-Rhin) en 912 (Lauer, 1949, no 71). On le voit donc voyager aux côtés du roi, allant de l’extrême Nord à l’extrême Sud de l’espace lotharingien. Il faut néanmoins noter qu’il n’accompagne le roi que dans ses séjours lotharingiens et que l’on ne trouve aucune trace de sa présence aux côtés du roi à l’Ouest de la Meuse.
C’est là tout le paradoxe de ce changement politique, de ce rattachement au royaume de Francie occidentale qui semble avoir, finalement, renforcé l’horizon lotharingien de Ricuin, dont l’ensemble des possessions est restreint à un espace assez limité dans le Sud de l’actuelle Lorraine. Cette analyse va dans le sens des travaux de Régine Le Jan quand elle écrit : « Dans la Lotharingie carolingienne de la fin du IXe – début du Xe siècle, des regroupements territoriaux semblaient être en passe d’y réussir. » (Le Jan, 1995a, p. 416) Pour illustrer cette hypothèse, elle cite les Régnier, les Matfrid et la maison d’Ardenne. En reprenant le dossier des possessions de Ricuin, il semble que l’on puisse aboutir à une conclusion similaire (et cela serait encore plus évident en prenant en compte les possessions de son fils, Otton, duc de Lotharingie). Les Ricuin profitent clairement du rattachement à la Francie occidentale pour renforcer leur pouvoir local sans avoir l’ambition, ou tout simplement l’intérêt, d’aller s’implanter ailleurs.
Leur horizon n’est clairement que lotharingien et c’est justement parce qu’il l’est que les Grands prennent ombrage de la trop forte présence royale en Lotharingie. L’historiographie a longtemps insisté sur le sang carolingien de Charles le Simple, mettant en avant le légitimisme des aristocrates de la Francia Media, où le souvenir carolingien aurait été plus prégnant qu’ailleurs. Cette analyse n’est pas à remettre en cause, mais il faudrait la nuancer en soulignant l’avantage pour l’aristocratie de dépendre d’un roi lointain, occupé avant tout par ses affaires en Francie occidentale. Or c’est justement tout l’inverse qui arriva en Lotharingie, où Charles le Simple fut extrêmement actif, tenant de nombreuses assemblées et s’appuyant par exemple tout particulièrement sur Haganon, probablement un lotharingien. Présent en Lotharingie durant tout son règne, à l’exception des années 914 et 918, il semble avoir voulu être un roi lotharingien à part entière, comme l’indiquent l’intitulation rex Francorum et la formule largiore vero hereditate adepta qu’il fit figurer dans ses actes à partir de 911 et qui soulignent sa légitimité lotharingienne en tant que carolingien, le dernier à avoir utilisé de telles formules étant Charlemagne lui-même (Lauer, 1949, no 65, 67-70 etc., cf. p. LIV). C’est d’ailleurs ce trop grand attrait lotharingien qui lui fut reproché par les grands de Francie occidentale (Hope, 2005, p. 6 ; MacLean, 2013, p. 446-447).
La trop grande présence royale en Lotharingie pouvait non seulement aller à l’encontre de la volonté d’autonomie des aristocrates lotharingiens (Le Jan, 1995a, p. 417 ; Hope, 2005, p. 8), mais les voyages royaux avaient également un coût tout comme ils pouvaient provoquer des conflits concernant l’usage des forêts pour la chasse (Hennebicque, 1980, p. 52). « La forte présence royale suscita au sein de la noblesse lotharingienne une opposition qui alla en se renforçant » (Grosse, 2014, p. 134) et Ricuin se souleva alors contre son ancien allié. Lui dont on ne connaît absolument pas l’ascendance, et qui semble avoir joué un rôle secondaire en Lotharingie avant l’arrivée de Charles le Simple, revit manifestement ses ambitions à la hausse suite aux nombreux dons patrimoniaux que lui ont valu son soutien au roi carolingien. Mais, de même que les frères Régnier et Gislebert plus au Nord, son implantation dans le Sud de la Lotharingie semble avoir été gênée par l’ancrage local de Charles III : tout comme Gislebert, Ricuin changea donc de camp, soutenant désormais le roi de Germanie. En 921, Flodoard traite Ricuin de rebelle et indique que Charles le combat, lui reprenant par la force des fortifications (Flodoard, 1905, p. 6). Le mot latin utilisé, praesidium, n’est pas très explicite et peut désigner aussi bien un poste avancé qu’un château ou une simple tourelle, néanmoins, dans tous les cas, cela montre encore une fois l’importance des domaines de Ricuin, qui possédait donc différentes fortifications protégeant ses domaines lotharingiens.
C’est finalement sa trop grande réussite territoriale qui perdit Ricuin. En 923, Adalbéron, qui n’était pas encore évêque de Metz, fit assassiner le nouvel époux de sa mère, Cunégonde, par son allié Boson, dans son lit (Flodoard, 1905, p. 12-13). Il apparaît extrêmement probable que ce membre de la famille dite d’Ardenne ait voulu par ce geste empêcher la mainmise des Ricuin sur les domaines familiaux (Parisse, 1976, p. 21), comme le sous-entend d’ailleurs Boson lui-même, quand il s’adresse à l’abbé réformateur Jean de Gorze qui était venu lui demander de restituer des terres à l’Église: « Ton évêque Adalbéron, que j’avais décidé d’aider dans la mesure du possible, en tirant vengeance de son parâtre Ricuin pour défendre ses intérêts » (Jean de Saint-Arnoul, 1999, p. 135).
Conclusion
La Lotharingie du Haut Moyen-Age s’avère être un espace difficile à appréhender. Ce constat peut être fait aussi bien par l’analyse de la terminologie que par celle des délimitations qui changent très souvent selon la compétition géopolitique entre les rois du milieu du IXe au milieu du Xe siècle. Cela s’observe notamment dans le cas de l’Alsace et dans l’espace alémanique-bourguignon (franc-comtois) où se forme le royaume des rois Rodolphiens qui sera rattaché à l’Empire vers 1033/34. Il ne s’est pas imposé d’autre dénomination pour le « royaume de Lothaire » que regnum Lotharii, dans un premier temps, puis Lotharingia, qui s’est conservée jusqu’aujourd’hui dans le choronyme « Lorraine ». La Lotharingie créée en 855 se présente donc comme un espace produit dans le contexte des partages politiques et qui ne montre pas d’indices identitaires. Avec la dislocation du royaume et l’intégration de l’Alsace dans le duché de Souabe, la situation change au XIe siècle, période marquée par le début des manifestations identitaires dans l’espace de l’ancien empire franc.
En même temps, le cadre plus large de la Francia Media a mis en évidence que les problèmes observés ne sont pas propres à la Lotharingie : des dénominations qui semblent improvisées et l’absence de délimitations précises sont des phénomènes que l’on retrouve ailleurs durant la même période, comme le démontre bien l’exemple de la Frise. Nous nous sommes donc interrogés sur les stratégies spatiales des individus face aux frontières mouvantes.
Le changement de frontière et le rattachement à un nouveau royaume put en effet modifier l’implantation territoriale de certains nobles : on pense par exemple au comte Erlebold, qui rentra en conflit avec l'archevêque Hervé de Reims qui lui reprochait d'avoir construit un château à Mézières, en zone frontalière, sans en avoir le droit. Mais, dans l’ensemble, c’est plutôt l’inverse qui se produisit : les nobles profitèrent de ces changements politiques pour ancrer davantage leur pouvoir en Lotharingie. Restèrent fidèles à Charles les petits seigneurs, sur lesquels il s’appuya, tandis que les plus puissants, Régnier et Giselbert, mais aussi Ricuin, qui avaient rêvé de voir la Lotharingie devenir une marge du royaume de Francie occidentale, refusèrent de voir leur espace devenir l’un de ses cœurs. Ils se soulevèrent, espérant approfondir leur ancrage lotharingien et retrouver avec un nouveau roi une relation faite de compromis.
Bibliographie
Annales Alamannici, 1971, dans Lendi W., Untersuchungen zur frühalemannischen Annalistik. Die Murbacher Annalen. Mit Edition, Freiburg, p. 144-193.
Annales de Saint-Bertin, 1964, Grat F., Vielliard J., Clemencet S. (éd.), Paris, Klincksieck, 296 p.
ARTEM. Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France, Giraud C., Renault J.-B., Tock B.-M. (éd.), 2010, Nancy-Orléans, IRHT, http://www.cn-telma.fr/originaux/index (05/03/2014).
Barth R., 1990, Der Herzog in Lotharingien im 10. Jahrhundert, Sigmaringen, Thorbecke, 219 p.
Bauer T., 1997, Lotharingien als historischer Raum. Raumbildung und Raumbewußtsein im Mittelalter, Cologne-Weimar-Vienne, Böhlau.
Blennemann G., 2011, Die Metzer Benediktinerinnen im Mittelalter. Studien zu den Handlungsspielräumen geistlicher Frauen, Husum, Matthiesen, 388 p.
Boretius A., Krause V. (éd.), 1897, Capitularia regum Francorum, Tome 2 = M.G.H. Leges, Vol. 2.2, Hanovre, Hahn, 726 p.
Bornert R., 2009, Les monastères d’Alsace, Tome 1 : Les étapes historiques, VIe-XXe siècle ; les monastères primitifs, VIe-IXe siècle, Strasbourg, Éditions du Signe, 616 p.
Boshof E., 1987, « Lotharingien – Lothringen : Vom Teilreich zum Herzogtum », dans Heit A. (dir.), Zwischen Gallia und Germania, Frankreich und Deutschland. Konstanz und Wandel raumbestimmender Kräfte, Trèves, Verlag Trierer Historische Forschungen, p. 129-153.
Bresslau H., Kehr P. (éd.), 1931, Die Urkunden Heinrichs III = M.G.H. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, Vol. 5, Berlin, Weidmann, 705 p.
Bührer-Thierry G., 2011, « Des évêques sur la frontière : christianisation et sociétés de frontière sur les marches du monde germanique aux Xe-XIe siècle », Quaestiones Medii Aevi Novae, No 16, p. 61-79.
Burnes R. I., 1989, « The Signifiance of the Frontier in the Middle Ages », dans Bartlett R., McKay A. (dir.), Medieval Frontiers Societies, Oxford, 1989, p. 307-330.
Büttner H., 1991, Geschichte des Elsaß, Tome I : Politische Geschichte des Landes von der Landnahmezeit bis zum Tode Ottos III. und Ausgewählte Beiträge zur Geschichte des Elsaß im Früh- und Hochmittelalter, Sigmaringen, Thorbecke, 378 p.
Calmet A., 1728, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine…, Nancy, Cusson, 3 Vol.
Chartae Galliae. Les espaces de la charte, 2010, Giraud C., Renault J.-B., Tock B.-M. (éd.), Nancy-Orléans, IRHT, http://www.cn-telma.fr/chartae-galliae/index (05/03/2014).
Chatelain V., 1898, « Le comté de Metz et les origines de la vouerie épiscopale du VIIIe au XIIIe siècle », Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde, No 10, p. 72-119.
Clouet L., 1867, Histoire de Verdun et du pays verdunois, Verdun, 1867-1870, Tome I, 537 p.
Cohen K. M., K.M., Stouthamer E., Pierik H. J., Geurts A. H., 2012, Rhine-Meuse-Delta Studies. Digital Basemap for Delta Evolution and Palaeogeography, Digital Dataset, Université d'Utrecht, http://www.deltaportaal.nl/pro
Davillé L., 1906, « Le pagus Scarponensis », Annales de l'Est et du Nord, 2e année, p. 1-32 et 219-247.
Dierkens A., Margue M, 2004, « Memoria ou damnatio memoriae ? L’image de Gislebert, duc de Lotharingie († 939) », dans Gouguenheim S. et al. (dir.), Retour aux Sources, Mélanges offerts à Michel Parisse, Paris, Picard, p. 869-890.
Dion R., 1979, Les frontières de la France, Brionne.
Eckhardt K.A., 1963, Genealogische Funde zur allgemeinen Geschichte, Germanenrechte, Neue Folge, Deutschrechtliches Archiv, Vol. 9, Witzenhausen, Deutschrechtlicher Instituts-Verlag, 48 p.
Engels O., 2006, Klöster und Stifte von der Merowingerzeit bis um 1200 = Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Tome 9.2, Bonn, Habelt, 106 p.
Erchenbald, « Versus de episcopis Argentinensibus », dans Böhmer J. Fr. (ed .), 1853, Fontes rerum Germanicarum, Tome IV, Stuttgart, Cotta, p. 1-4.
Evrard J.-P., 1981, « Les comtes de Verdun aux Xe et XIe siècles », dans La Maison d'Ardenne. Xe -XIe siècles, Actes des Journées Lotharingiennes 24-26 octobre 1980, Luxembourg, Institut Grand-Ducal, p. 153-182.
Flodoard, Annales, 1905, Lauer P. (éd.), Paris.
Goetz H.-W., 2011, « La perception de l’espace politico-géographique de la Francia Media dans l’historiographie médiévale », dans Gaillard M. et al. (dir.), De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia Media, une région au cœur de l’Europe (c. 840–c. 1050), Luxembourg, CLUDEM, p. 111-129.
Grosse R., 2014, Du royaume franc aux origines de la France et de l'Allemagne, 800-1214, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 293 p.
Hennebicque [Le Jan] R., 1980, « Espaces sauvages et chasses royales dans le Nord de la Francie, VIIème-IXème siècles », Revue du Nord, No 62, p. 35-60.
Henze H., 1939, « Zur kartographischen Darstellung der Westgrenze des Deutschen Reiches in karolingischer Zeit », Rheinische Vierteljahrsblätter, No 9, p. 207-254.
Hope G. A., 2005, The political development of the Carolingian Kingdom of Lotharingia, 870-925, thèse de doctorat, Université de Glasgow.
Jean de Saint-Arnoul, La Vie de Jean, abbé de Gorze, Parisse M. (éd. et trad.), 1999, Paris, Picard, 166 p.
Kalckstein K. von, 1877, Geschichte des französischen Königthums unter den ersten Capetingern, Tome 1 : Der Kampf der Robertiner und Karolinger, Leipzig, Weigel.
Kaschke S., 2005, « Die dispositio regni Lothars I. von 855 », dans Nolden R. (dir.), Lothar I. Kaiser und Mönch in Prüm, Trèves, p. 89-98.
Lacomblet, T. J. (éd.), 1840, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden, Tome 1 : 779-1200, Düsseldorf.
Lauer P. (éd.), 1949, Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de France (893-923), Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France, Paris, Imprimerie nationale, 385 p.
Le Jan R., 1995a, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, 571 p.
Le Jan R., 1995b, « L’Aristocratie Lotharingienne : Structure interne et conscience politique », dans Herrmann H.-W., Schneider R. (dir.), Lotharingia. Eine europäische Kernlandschaft um das Jahr 1000. Une région au centre de l’Europe autour de l’an mil, Sarrebruck, SDV, p. 71-88.
Lepage H., 1862, Dictionnaire topographique du département de la Meurthe, Paris, Imprimerie Impériale, 213 p.
Lesort A. (éd.), 1912, Chronique et chartes de l’abbaye de Saint-Mihiel, Paris.
Levison W., 1925, « Der Sinn der rheinischen Tausendjahrfeier. 925–1925 », Elsaß-Lothringisches Jahrbuch, No 4, p. 1-34.
Liber Memorialis von Remiremont, Hlawitschka E., Schmid K., Tellenbach G. (éd.), 1970, M.G.H. Libri memoriales, Vol. 1, Zurich, Weidmann, 287 p.
Liber de sancti Hildulfi successoribus in Mediano Monasterio, dans Waitz G. (éd.), 1841, M.G.H. Scriptores, Vol. 4, Hanovre, Hahn, p. 86-92.
Liudprand de Crémone, « Antapodosis », dans Becker J. (éd.), 1915, Liudprandi Opera = M.G.H. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Vol. 41, Hanovre-Leipzig, Hahn, p. 1-158.
MacLean S., 2013, « Shadow Kingdom. Lotharingia and the Frankish World, C. 850–C. 1050 », History Compass, No 11, p. 443-456.
La Maison d'Ardenne. Xe-XIe siècles. Actes des Journées Lotharingiennes 24-26 octobre 1980, 1981, Luxembourg, 320 p.
Margue M., 2013, « Face à l’évêque, le comte. Politique ottonienne et pouvoir comtal en Lotharingie à l’époque de Notger », dans Wilkin A., Kupper J.-L. (dir.), Évêque et prince. Notger et la Basse-Lotharingie aux alentours de l’an mil, Liège, Presses Universitaires de Liège, p. 237-270.
McKitterick R., 2008, Charlemagne. The Formation of a European Identity, Cambridge University Press, 460 p.
Meurisse M., 1634, Histoire des évêques de l’Église de Metz, Metz, Anthoine.
Migne J.-P. (éd), 1844-1879, Patrologiae cursus completus. Series secunda, in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque latinae, 221 vol., Paris.
Nelson J. L., 1982, Charles the Bald, Londres-New York, Longman, 349 p.
Nelson, J. L., 2011, « Le partage de Verdun », dans Gaillard M. et al. (dir.), De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia Media, une région au cœur de l’Europe (c. 840–c. 1050), Luxembourg, CLUDEM, p. 241-254.
Parisot R., 1898, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843–923), Paris.
Parisse M., 1976, La noblesse lorraine, XIe-XIIIe siècle, Lille, Service de reproduction des thèses - Paris, Champion, 2 Vol., 1104 p.
Parisse M., 1989, « Noblesse et monastères », dans Kottje R., Maurer H. (dir.), Monastische Reformen im 9. und 10. Jahrhundert, Sigmaringen, Thorbecke, p. 167-196.
Parisse M., 2006, « Les faux diplômes ottoniens pour la Lorraine. Essai de critique horizontale », dans Arend S. et al. (dir.), Vielfalt und Aktualität des Mittelalters, Mélanges offerts à Wolfgang Petke, Bielefeld, 2006, p. 575-589.
Parisse M., 2011, « Introduction. Quelques réflexions à propos de la terminologie et de la géographie », dans Gaillard M. et al. (dir.), De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia Media, une région au cœur de l’Europe (c. 840-c. 1050), Luxembourg, CLUDEM, p. 1-7.
Pitz M., 2005, « En passant par la Lorraine … Considérations sur la genèse d’un choronyme », Revue de linguistique romane, No 69, p. 97-130.
Puhl R. W. L., 1999, Die Gaue und Grafschaften des frühen Mittelalters im Saar-Mosel-Raum. Philologisch-onomastische Studien zur frühmittelalterlichen Raumorganisation anhand der Raumnamen und der mit ihnen spezifizierten Ortsnamen, Saarbruck, SDV, 609 p.
Racine P., 1987, « La Lorraine au haut Moyen Age. Structures économiques et relations sociales », dans Heit A. (dir.), Zwischen Gallia und Germania, Frankreich und Deutschland. Konstanz und Wandel raumbestimmender Kräfte, Trèves, Verlag Trierer Historische Forschungen, p. 205-218.
Ratzel F., 1891, Anthropo-Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte, Tome 2 : Die geographische Verbreitung des Menschen, Stuttgart, 1891.
Reginon, 1890, Chronicon cum continuatione Treverensi, Kurze F. (éd.), M.G.H. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Vol. 50, Hanovre, Hahn, 196 p.
Rhine-Meuse delta studies, 2007, site web du Fluvial Research Group, Université d’Utrecht, http://www.geo.uu.nl/fg/palaeogeography (05/03/2014).
Schieffer T., 1938, « Zu einem Briefe der späten Karolingerzeit », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, No 2, p. 193-204.
Schieffer, T. (éd.), 1960, Die Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des Kindes = M.G.H. Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, Vol. 4, Berlin, Weidmann, 332 p.
Schieffer T., 1961, « Die Rheinischen Lande an der Schwelle der deutschen Geschichte », dans Born K. E. (dir.), Historische Forschungen und Probleme, Mélanges offerts à Peter Rassow, Wiesbaden, p. 17-31.
Schieffer, T. (éd.), 1966, Die Urkunden Lothars I. und Lothars II. = M.G.H. Diplomata Karolinorum, Vol. 3, Berlin-Zurich, Weidmann, 591 p.
Schneider J., 2010, Auf der Suche nach dem verlorenen Reich. Lotharingien im 9. und 10. Jahrhundert, Cologne-Weimar-Vienne, Böhlau, 671 p.
Schneider U., 2013, « Le politique dans la cartographie. Tracé des frontières, carte et territoire lors du Congrès de Berlin en 1878 », Revue d’histoire du XIXe siècle, No 46, p. 119-135.
Schneidmüller B., 1987, « Regnum und Ducatus. Identität und Integration in der lothringischen Geschichte des 9. bis 11. Jahrhunderts », Rheinische Vierteljahrsblätter, No 51, p. 81-114.
Sickel T. (éd.), 1884, Die Urkunden Konrad I, Heinrich I. und Otto I = M.G.H. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, Vol. 1, Hanovre, Hahn, 740 p.
Steinbach F., 1939, « Gibt es einen lotharingischen Raum ? », Rheinische Vierteljahrsblätter, No 9, p. 52-66.
Turner F. J., 1947, The Frontier in the American History, New York.
Weber K., 2011, Die Formierung des Elsass im Regnum Francorum. Adel, Kirche und Königtum am Oberrhein in merowingischer und frühkarolingischer Zeit, Ostfildern, Thorbecke, 262 p.
Werner K. F., 1993, « Il y a mille ans, les Carolingiens : Fin d’une dynastie, début d’un mythe », Annuaire-bulletin de la Société de l’Histoire de France, Années 1991-1992, p. 17-89.
Wolfram G., Gley W. (dir.), 1931, Elsass-Lothringischer Atlas. Landeskunde, Geschichte, Kultur und Wirtschaft Elsass-Lothringens, Francfort/Main.
van Vliet K., 2002, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695–1227, Zutphen.
Zotz T., 1995, « Das Elsaß – ein Teil des Zwischenreiches ? » dans Herrmann H.-W., Schneider R. (dir.), Lotharingia. Eine europäische Kernlandschaft um das Jahr 1000. Une région au centre de l’Europe autour de l’an mil, Sarrebruck, SDV, p. 49-70.
Editorial : La géographie historique militaire, une autre approche de la recherche dite stratégique | Publié le 2017-05-18 13:49:55 |
Par Philippe Boulanger (Professeur et directeur de la Revue de géographie historique)
La relation entre la géographie et la guerre n’a jamais été autant d’actualité. Au-delà des colloques et manifestations universitaires qui abordent ce sujet, ce sont les autorités militaires qui soulignent son importance aujourd’hui. Guerre de montagnes en Afghanistan, guerre du désert au Sahel, guerre urbaine en Syrie, les exemples sont nombreux. Il est vrai que l’étude du facteur géographique, à travers ses composants physiques et humains, au cours des opérations militaires semble aller de soi, du moins a priori. En réalité, sa prise en compte représente toujours un défi pour les armées qu’elles que soient les époques.
La nécessaire connaissance géographique du théatre d’opérations pour le militaire
Si Sun Tsé mentionnait la contrainte du terrain pour le militaire, dans L’Art de la guerre (VIe siècle avant J.C.), nous ne savons rien ou trop peu sur sa réelle prise en compte dans la planification et le déroulement de la bataille pour le chef militaire chinois. La connaissance géographique a souvent été empirique dans le déroulement des guerres. A l’exception de quelques grands stratèges de l’histoire, comme Napoléon à la veille de la bataille d’Austerlitz (décembre 1805), qui partait observer le terrain à la veille de l’affrontement, il est bien rare que son analyse soit réalisée au préalable. « De quoi s’agit-il ? » s’exclame le général prussien Verdy du Vernois (1832-1910) en arrivant sur le champ de bataille de Nachod face à l’armée autrichienne le 27 juin 1866. Il faut attendre surtout le XVIIIe et le XIXe siècle pour que la géographie devienne une science non seulement académique mais aussi militaire. L’essor des différentes écoles de géographie militaire en Europe, entre 1810 et 1945, traduit cet intérêt sinon ce besoin de connaissances géographiques avant le grand dénouement de la bataille et de la guerre (Coutau-Bégarie, 1999 ; Boulanger, 2002).
En France, les Livre Blanc sur la Défense et la sécurité nationale de 2008 et 2013 érigent la connaissance géographique comme une priorité stratégique à travers la formulation du pilier connaissance et anticipation. « La connaissance des zones d’opérations potentielles est un élément déterminant pour toute forme d’action militaire. La France, par sa géographie et du fait de ses responsabilités internationales, accorde une attention particulière à cette dimension » précise déjà le Livre Blanc en 2008 (p. 144). Celui-ci mentionne toute la nécessité de connaître les zones d’opérations potentielles dans l’arc de crises (de l’Afrique de l’Ouest à l’Afghanistan), de collecter des données socio-culturelles de ces aires auprès des instituts de recherche et des universités, d’acquérir les informations géophysiques de l’environnement pour l’emploi des systèmes d’armes. Après la Guerre froide, nombreux sont les nouveaux théâtres d’opérations qui sont parfaitement méconnus tant l’attention des géographes militaires et des stratèges s’était concentrée sur l’Ouest du continent européen pendant près de 40 ans. Lorsque la guerre d’Afghanistan commence à l’automne 2001, seules les cartes de l’ex-URSS constituaient la base du savoir géographique sur le plan opérationnel et tactique (Merchet, 2008). Il est en de même avec les théâtres d’opérations yougoslaves en 1991, africains (Centrafrique dans les années 2000, Nord-Mali au début des années 2010 par exemples), du Levant (Syrie, Nord de l’Irak) plus récemment. Les sociétés et les territoires étant évolutifs, il apparaît cohérent de disposer de mises à jour permanentes des informations géographiques dont la plupart remontent aux dernières années de la colonisation française pour les cas africains. Ce défi de la connaissance géographique à des fins militaires demeure l’un des grands problèmes actuels pour tout décideur militaire qui dispose d’un délai réduit pour engager des forces sur un terrain et répondre aux attentes du pouvoir politique et de l’opinion publique. Parallèlement, les services de défense, en France comme dans d’autres armées nationales, dédiés à l’impérative connaissance géographique pour le militaire afin de préparer, conduire et exploiter une opération militaire, doivent s’adapter aux nouvelles exigences opérationnelles et aux nouvelles formes de conflits.
Les défis de la géographie militaire
Si les nouvelles technologies géospatiales et numériques tendent à améliorer le processus et la qualité de cette information, la synthèse et l’analyse restent une affaire de spécialistes de haut niveau d’expertise. Toutes les armées modernes ont opéré cette révolution de la connaissance et du savoir depuis les années 2000 en fonction de ces nouvelles technologies et des nouvelles exigences opérationnelles. L’armée américaine, suivie de celles de l’Allemagne et de l’Angleterre, de la France et de bien d’autres pays européens ainsi que des puissances émergentes (Russie, Inde, Chine, Japon en particulier) ont restructuré leurs services géographiques pour les moderniser. En outre, les services de renseignement se sont aussi emparés de cette dynamique pour faciliter leur réactivité. La création de la National Geospatial Agency en 2003, issue de la fusion de plusieurs services d’imagerie spatiale et de cartographie, emploie aujourd’hui près de 14 000 personnes dédiées à l’analyse spatiale des zones d’intérêt des Etats-Unis. L’intérêt de cette mutation en cours consiste à produire une géographie militaire de grande qualité devenant une information à haute valeur ajoutée. Les défis de cette nouvelle géographie à des fins de défense sont donc nombreux. Ils sont d’abord technologiques et techniques en améliorant la cohérence et l’interopérabilité des systèmes d’information géographiques au profit de l’ensemble des acteurs de la Défense comme des systèmes d’armes. Ils sont également capacitaires en valorisant la place de l’analyse géographique, souvent peu prise en compte, et qui demande des savoir-faire de haut niveau et des formations en amont adaptées à des besoins évolutifs selon les crises géopolitiques. Ils sont enfin culturels en accordant une place croissante à la géographie, véritable domaine d’expertise, qui n’est pas traditionnellement envisagée comme un pilier de l’action militaire.
Dans ce contexte d’évolution de la géographie militaire, qui s’accélère tant par la nature des informations géographiques à acquérir (terrorisme, zones grises, etc.) que par la modernisation des technologies numériques, l’intérêt de la géographie historique militaire consiste justement à englober les expériences passées pour en retenir un intérêt pragmatique pour le temps présent. Etudiant les relations entre le militaire et son espace à des périodes données, elle mérite une attention particulière qui se distingue de l’histoire militaire en prenant en compte les territoires et les espaces sous un angle tactique, opérationnel et/ou stratégique. Les expériences passées des opérations dans le désert, en milieu urbain, en milieu forestier ou en milieu montagnard ont suscité ainsi une nouvelle réflexion dans la doctrine militaire française, mais aussi de bien d’autres armées comme en témoignent les doctrines de l’US Army, du Marines Corps ou de l’armée russe pour le combat en zone urbaine. Il n’est pas anodin que la doctrine américaine s’appuie constamment sur des expériences passées remontant jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. En France, les récents textes doctrinaux produits par le Centre de la doctrine et de l’emploi des forces (Centre de doctrine et d’enseignement du commandement depuis 2016) et du Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations commencent à s’inspirer de cette démarche. Si l’expression de géographie historique n’est jamais employée, son approche bien identifiée montre un intérêt pour la connaissance des territoires dans le déroulement des faits militaires passés.
Penser et pratiquer l’espace dans les guerres
Penser l’espace et le territoire dans les opérations militaires est un champ de la recherche académique peu connu d’une manière générale. Lorsque l’analyse spatiale d’une bataille ou d’une guerre est abordée, elle apparaît trop souvent comme un cadre général tel un décor de théâtre où entrent en scène les acteurs. La géographie historique se veut plus profonde et donne tout son sens à l’ensemble des facteurs géographiques. Ce double numéro de la Revue de géographie historique tente d’apporter un approfondissement dans l’approche des questions militaires dans la continuité d’un premier numéro publié en mai 2016. Deux grandes catégories de thèmes relient les différents articles : l’importance de la connaissance géographique pour le militaire, la pratique du territoire pour le militaire.
L’importance de la connaissance géographique pour le militaire est une constante depuis l’Antiquité comme le soulignait Sun Tsé. Nombreux sont les théoriciens de la stratégie qui le reconnaissent avec une approche plus ou moins empirique. Christophe Furon (doctorant en histoire médiévale à l’Université Paris4-Sorbonne) nous démontre comment les capitaines de compagnies dans le Royaume de France aux XIVe et XVe siècles se sont appropriés les connaissances géographiques à des fins militaires. Leur culture géographique essentiellement livresque apparaît finalement empirique comme nous le constaterions aussi dans d’autres cadres militaires dans d’autres régions et d’autres périodes jusqu’au XVIIIe siècle en Occident. Jean-Pierre Husson (Université de Lorraine) nous montre justement cette période de basculement vers une représentation de l’espace lorrain à des fins militaires. La cartographie qui évolue grâce aux nouvelles techniques et aux nouvelles conceptions est souvent l’œuvre des militaires, surtout dans les marches ou les zones tampons hautement stratégiques pour les puissants. Frédéric Saffroy (chercheur associé à l’Irhis, Lille 3) aborde également la manière dont le littoral français est envisagé par le militaire. Il nous explique que cet espace a été longtemps source de discussion entre les ministères de la Guerre et de la Marine non seulement pour en assurer la défense mais aussi pour le cartographier depuis le XVIIe siècle. A partir du XIXe siècle, la mise en place d’une géographie militaire qui se veut plus rationnelle conduit à élaborer une méthodologie et une conception plus élaborées. Jean-Noël Grandhomme (Université de Lorraine) revient sur une des grandes figures de la géographie militaire française de la fin du XIXe siècle. Gustave-Léon Niox (1840-1921), professeur à l’Ecole supérieure de guerre une grande partie de sa carrière, a contribué au rayonnement de cette nouvelle discipline académique. Nous en comprenons l’influence grâce à l’article de Frédéric Dessberg (Ecoles militaires de Saint-Cyr) à travers la conception de l’espace balkanique dans les rapports des attachés militaires français, formés justement à l’Ecole française de géographie militaire.
Une autre partie thématique forte de ce numéro porte sur l’emploi de la géographie à des fins militaires à partir de différents exemples significatifs. Nicola Todorov (académie de Rouen) nous explique comment Napoléon pouvait concevoir le franchissement de la Manche pour débarquer en Angleterre durant la période impériale. Jean-Yves Puyo (Université de Pau) donne à comprendre une approche similaire dans un autre contexte en s’intéressant à la stratégie française et le milieu naturel mexicain lors de l’expédition militaire (1862-1867). Denis Mathis et et Emmanuel Chiffre (Université de Lorraine-Nancy) nous souligne l'importance des aménagements militaires dans la région de Langres-Dijon en soulignant les empilements des systèmes défensifs et leur devenir jusqu'à aujourd'hui. Hubert Heyriès (Université de Montpellier) nous rappelle la manière dont les troupes alpines italiennes se sont appropriées l’espace montagnard durant la Grande Guerre (« la Guerre blanche ») au point d’en devenir le symbole national d’une lutte héroïque. François Cochet (Université de Lorraine), à partir des témoignages des combattants de différentes guerres, nous livre une analyse inédite de « l’espace vécu en guerre ». L’approche géographique de la Grande Guerre ne cesse de nous en apprendre encore sur les traces qu’elle a pu laisser derrière elle. Pierre Taborelli, Alais Devos, Yves Desfosse, Jérôme Brénot et Sébastien Laratte (Université de Reims) nous exposent leur analyse de ces traces sur le terrain bouleversé par la guerre à partir de l’outil Lidar (observation radar). Alors que l’aviation militaire se développe à partir de la Grande guerre, la pensée géographique liée à la maîtrise de cet espace commence à apparaître. Mickael Aubout (Docteur de l’Université Paris4-Sorbonne) nous apprend qu’il existe une réelle spécificité de la géographie militaire aérienne depuis le début du XXe siècle.
Notes :
Boulanger Ph., 2002, Géographie militaire française, Paris, Economica.
Boulanger Ph. (dir.), 2016, Géographie et guerres, Paris, Société de géographie de Paris.
Boulanger Ph. (dir.), Histoire militaire et géographie historique, Cahiers du Centre d’études d’histoire de la défense, n°36, 2008.
Couteau-Bégarie H., 1999, Traité de stratégie, Paris, Economica, Institut de stratégie comparée.
Défense et sécurité nationale, Le Livre Blanc, 2008, La documentation française.
Merchet J.D., 2008, Mourir pour l’Afghanistan, Jacob-Duvernet.
Editorial | Publié le 2016-11-25 11:13:28 |
Par Nicolas Baumert (Maître de Conférences à l'Université de Nagoya) (1)
Pendant plus de deux siècles, de 1633 à 1853 lors de la période dite d’Edo (1603-1868), le Japon s’est fermé au monde extérieur, retiré d’une histoire globale qui se mettait en place sous l’impulsion des Etats européens. Par une série de mesures politiques limitant les échanges avec l’extérieur (interdiction d’émigrer, de construire des bâtiments de haute mer, interdiction aux étrangers de pénétrer dans l’archipel sauf dans les enclaves prévues à cet effet,…), le Japon a assuré son indépendance autant qu’il a permis la maturation de pans entiers de sa culture. Ce choix historique, à la longévité exceptionnelle dans l’histoire, a été favorisé par l’insularité du pays et par sa localisation à l’extrémité des routes commerciales, mais aussi par la récente unification politique de l’archipel faisant suite aux guerres féodales qui avaient marqué l’ensemble du XVIe siècle. Il a permis une longue ère de paix et de stabilité, des progrès techniques et préscientifiques dans tous les domaines, mais il a aussi entraîné une diminution de la connaissance du monde qui continue, d’une certaine manière, à caractériser la société japonaise actuelle. Car, malgré les changements radicaux de l’ère Meiji, bien des aspects de la culture d’Edo ont continué à vivre et à se diffuser dans l’ensemble des couches de la société au point d’être aujourd’hui considérés comme traditionnels. Edo correspond pour le Japon à une mise en retrait mais certainement pas à une mise entre parenthèses de son histoire. Ses héritages géographiques restent importants : la double polarité entre la Kantō et le Kansai née du choix d’une nouvelle capitale à l’Est, le réseau urbain ainsi qu’une grande partie des limites administratives actuelles.
Au regard d’une lecture de l’histoire mondiale basée sur toujours plus d’ouverture et de circulation, la période d’Edo est une anomalie, et l’historiographie japonaise depuis Meiji a souvent traité le règne des Tokugawa sous cet angle, transposant la vision occidentale du monde et ses jugements de valeur afin de justifier le changement de régime. Cependant la recherche historique récente est plus nuancée et redécouvre depuis une vingtaine d’années les formidables possibilités de la période (Macé, 2006, p. 9). Les historiens cherchent des axiomes, en parlant de senkakuteki kaikoku (ouverture sélective) en lieu et place de sakoku (pays fermé) (2), là où il est surtout question pour le géographe du rôle politique d’une frontière qui, comme une porte, peut être plus ou moins ouverte ou fermée en fonction des circonstances. Ainsi que le note avec justesse Régis Debray dans son Eloge des frontières, redigé presque comme une évidence après une conférence à la Maison franco-japonaise de Tokyo, la mer dans l’histoire du Japon est « à la fois mur et porte, obstacle à l’accueil et incitation à l’échange, (…) sas ou valve » (Debray, 2013, p. 37). Et le Japon d’Edo est avant tout un pays terrien dont la vision agrarienne basée en particulier sur la riziculture s’est justement systématisée à ce moment de l’histoire, instaurant une hégémonie croissante de la partie sédentaire de la société (les guerriers et les paysans) sur la partie non sédentaire (hiteijūnin), composée de marchands, de religieux et de marins (Ohnuki-Tierney, 1993, p.78). Pendant Edo, les enclaves des marchands étrangers comme Dejima au sud, ou les marges sibériennes d’Ezo au nord, jouent le rôle de filtre avec le monde (Batten, 2003), tandis que la majeure partie de la population vit dans un monde fonctionnant de manière quasi continentale où la mer intérieure et le cabotage le long du Pacifique assurent le rôle qu’ont pu jouer les grands fleuves dans d’autres civilisations (Pelletier, 1995).
Derrière le rapport à la mer et à l’outre-mer, la question de l’insularité se profile, même si ce thème, central pour un archipel, est bien peu abordé dans sa complexité tant au Japon qu’à l’étranger. Bien peu utilisent le terme si juste de Japonésie, et l’île-pays ou l’île absolue (3) du pays de Yamato présuppose souvent de manière directe l’Etat-Nation. La pluralité des îles et des identités s’efface devant l’apparente unité de la culture sans que celle-ci ne soit vraiment questionnée (Pelletier, 1997, p.13-14). Pour le géographe, l’étude du pays fermé des Tokkugawa pousse à repenser les causalités, à dépasser le déterminisme insulaire et renvoie parfaitement au binôme encore trop peu utilisé de cloisonnement et de circulation de Jean Gottmann pour qui « le facteur psychologique est essentiel pour la compréhension du compartimentement du monde, les cloisons étant bien plus dans les esprits que dans la nature » (Gottmann, 1952, p. 67).
Au Japon, le choix de la fermeture intervient au moment où le cloisonnement de l’insularité cesse en partie de fonctionner, au moment où le Japon se retrouve en relation avec l’extérieur et le réactive pour plus de deux siècles par une mesure politique, alors qu’il aurait pu se connecter à un monde plus fluide marqué par la puissance maritime. Les possibilités étaient là, et son rôle dans cette première mise en réseau à l’échelle mondiale qui avait débuté dès le début du XVIe siècle avec l’arrivée des Portugais en Asie aurait pu s’affermir (de Castro, 2013). Mais le pays se retourne sur lui-même, sur sa culture et son destin. Il se forge ainsi une unité qu’il n’aurait peut-être pas eue. Les seigneurs de la guerre de l’époque Momoyama (1573-1603), dont les représentations étaient avant tout terrestres, avaient tous le projet de l’unité et les Tokugawa le maintiennent pendant 265 années, pour le meilleur et pour le pire, en particulier par les mesures de fermeture du troisième shōgun Iemitsu (1604-1651).
Si le Japon s’isole volontairement, il le fait sous l’influence d’un système politico-culturel confucéen qui, il faut bien le reconnaitre, va s’essouffler et se figer au cours du temps, laissant le pays passer, entre autres, à côté de la révolution industrielle. On le verra dans les articles de ce numéro, la rigidité du système d’Edo va conduire à des erreurs d’appréciation, autant dans la mise en valeur du territoire que dans les choix géopolitiques. Mais l’histoire de l’ouverture forcée après 1853 donne tout de même en partie raison aux choix d’Iemitsu et de ses conseillers : malgré la guerre civile, les républiques éphémères, le jeu des puissances et les alliances improbables qui ont marqué les années précédant la restauration de Meiji, les deux siècles d’unité sous la main de fer du Bakufu avaient assez unis cette culture pour qu’elle ne cède pas aux tentations étrangères et lui permette de s’ouvrir au monde sans se perdre (4). Edo a véritablement joué le rôle de matrice de la culture nippone et c’est à cette période paradoxale aux héritages ambigus de l’histoire du Japon que s’intéresse ce numéro spécial de la Revue de Géographie Historique, en présentant dans leurs aspects géopolitiques, démographiques, alimentaires, agricoles, économiques ou juridiques, les logiques des territoires et de la vie du Japon d’Edo.
Dans un premier article, Noémi Godefroy se penche sur les rapports complexes de la rencontre entre le Japon et la Russie dans l’ère culturelle Aïnou. Les deux puissances vont chercher à se connaitre et s’affronter sur leurs marges extrêmes dans un espace pionnier de frontier qui continue de les opposer puisque la question des îles Kouriles n’est toujours pas résolue. Cette rencontre, que nous pourrions presque qualifier d’aiguillon de découverte, a permis au Japon d’Edo de progresser dans une connaissance du monde extérieur auquel son système de production des savoirs ne le prédisposait pas.
Fréderic Burguière montre ensuite que loin des théories économiques faisant l’apologie des systèmes ouverts, la réussite spectaculaire du Japon tire ses sources justement dans la période d’Edo. Il l’explique à partir de l’étude de deux textes : Le Testament de Shimai Sōshitsu (1610) et la « Constitution » de Mitsui de 1722. Les conséquences géographiques sont immenses, car l’essor des marchands explique aussi l’essor des villes et se retrouve dans la période d’Edo les racines de la géographie économique du Japon actuel : l’inertie des territoires expliquant l’importance de Tokyo et d’Osaka et celle du Japon de l’endroit faisant face au Pacifique. Dans un système ouvert sur le monde, les provinces du sud, mieux connectées au reste de l’Asie, auraient certainement été au cœur des échanges, inversant toute la dynamique territoriale de l’archipel.
Nicolas Baumert, Yuki Hata et Nobuhiro Ito étudient pour leur part l’alimentation et les pratiques agricoles en se basant sur le paradoxe de l’application d’une science agricole chinoise venue de l’empire Ming (1368-1644) à la réalité japonaise. On peut parler d’aberration géographique dans cette application de savoirs biaisés non adaptés au climat et qui auront des effets néfastes, augmentant la vulnérabilité du nord du pays. Ainsi, malgré les progrès réalisés en matière agricole pendant la période d’Edo, l’uniformisation des productions et des mesures adoptées sous l’influence d’un système confucéen épris d’une science chinoise dont les conditions d’élaboration avaient été faites pour des milieux géographiques complètements différents a paradoxalement accentué la gravité des crises dans les régions de l’est et du nord de l’archipel.
Tsunetoshi Mizoguchi s’intéresse aux évolutions démographiques à travers l’étude du cas d’un village côtier du sud du pays. Il montre à la fois les dynamiques démographiques de la fin de la période d’Edo, et les dynamiques économiques, en particulier liés au fret maritime par le cabotage le long des côtes et sur la mer intérieure. Son étude renseigne aussi sur la difficulté du travail sur les sources de nos collègues géographes japonais effectuant leurs recherches sur des registres bouddhistes souvent incomplets et obligés à un travail complexe d’archive et de retraduction.
Au travers d’un article sur les lieux des exécutions publiques, Maki Fukuda s’intéresse à la mort. Son travail sur la ville de Nagoya montre que, dans cette ville qui souhaitait se démarquer de la capitale shogunale, le supplice est demeuré tout au long de la période d’Edo étroitement lié avec la vie quotidienne et lié à l’affirmation concrète des lieux de pouvoir. La prison était située dans un des lieux les plus animés et socialement diversifiés de la ville et, contrairement à la capitale Edo, les exécutions se déroulaient après une procession festive des condamnés à travers les quartiers populaires. Le parallèle avec la France d’Ancien Régime montre des conclusions similaires à celles de Michel Foucault dans Surveiller et Punir (1975) et à celles de René Girard sur le rapport à la violence, au sacré et à la fête (Girard, 1972).
Enfin, Sylvie Guichard-Anguis insiste sur les héritages d’Edo à l’échelle locale et à celle de la vie quotidienne en étudiant la spécificité des entreprises artisanales et la culture des douceurs. Elle montre autant la longévité de ces maisons que leur insertion dans la culture alimentaire actuelle car la plupart sont nées pendant la période Tokugawa. Elles constituent des lieux de mémoire, non seulement sur le plan architectural et paysager, mais aussi parce qu’elles jouent aussi un rôle important sur le plan touristique, perpétuant de génération en génération la continuité de la culture alimentaire d’Edo et alimentant les représentations traditionnelles du Japon actuel.
Ces permanences de la culture d’Edo et ses héritages géographiques montrent à quel point le Japon peut être pensé comme un Extrême-Occident (5) autant qu’il est un Extrême-Orient. Sa géographie historique avec des choix souvent opposés, mais obéissant pourtant à des logiques similaires est la confirmation de la symétrie de ce « monde en miroir » que Claude Lévi-Strauss reconnait dans L’autre face de la Lune (Lévi-Strauss, 2011, p.131). La période d’Edo et ses presque deux siècles et demi d’ « ouverture sélective » en est certainement la matrice autant qu’elle en est l’empreinte quasiment indélébile.
Références bibliographiques
Batten, B., To the Ends of Japan, Honolulu, Hawaii University Press, 2003.
de Castro, X. (Ed.), La découverte du Japon par les Européens (1543-1551), Paris, Chandeigne, 2013.
Debray R., Eloge des Frontières, Paris, Folio, 2013.
Girard R., La Violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972.
Gottmann J., La Politique des Etats et leur géographie, Paris, A Collin, 1952.
Hamashita T. & Kawakatsu H. (dir.), Ajia kōeki ken to Nihon kōgyōka 1500-1900 [La sphère commerciale du commerce asiatique et l’industrialisation du Japon 1500-1900], Tokyo, Liburo, 1991.
Lévi-Strauss C., L’autre face de la Lune, Paris, Seuil, 2011.
Macé F., Le Japon d’Edo, Paris, Les Belles Lettres, 2006.
Ohnuki-Tierney E., « Nature et Soi primordial : la nature japonaise dans une perspective comparative », Géographie et Cultures, n°7, 1993, p.73-92.
Pelletier P., L’insularité dans la mer intérieure japonaise, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, Coll. Îles et Archipels, 1995.
Pelletier P., La Japonésie, Paris, CNRS Editions, 1997.
Notes
(1) Le directeur du numéro voudrait remercier le Département de Géographie de l’Université de Nagoya, la Maison Franco-japonaise et Kyle Nuske (Nagoya University Writing Center) pour l’aide apportée à la préparation de ce volume spécial sur le Japon.
(2) Hamashita T. & al., 1991. Voir l’article de N. Godefroy dans ce numéro.
(3) Ile-pays est la traduction de l’expression de Nakano H. (1986) et île absolue renvoie au titre de l’ouvrage de Thierry de Beaucé, L’île absolue, essai sur le Japon (Paris, Editions Olivier Orban, 1979). Cités par Pelletier, 1997, p. 11 et 14.
(4) Voir sur cette question l’ouvrage à paraître de Pierre Sevaistre, Le Japon face au monde extérieur (Paris, Les Indes savantes, dec. 2016).
(5) L’expression est de Robert Guillain dans un article du Monde de 1962. Elle est aussi le titre d’une revue d’études comparées sur l’Asie créée par François Jullien.
Editorial : Le besoin de géographie militaire | Publié le 2016-05-20 08:06:42 |
Par Philippe Boulanger (Professeur à l’Institut français de géopolitique-Université Paris VIII et directeur de la Revue de géographie historique)
Le facteur géographique est toujours considéré comme l’un des composants principaux de la tactique et de la stratégie dans l’histoire des guerres, de la Défense et de la sécurité dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme international. De tout temps, les batailles, les campagnes et les guerres ont incliné les faits dans un sens, non seulement en raison de l’audace des hommes mais aussi des conditions météorologiques, physiques et humaines du milieu. Nombreuses sont les armées ou les flottes défaites avant même le combat pour des raisons naturelles et moins militaires.
Le facteur géographique, élément essentiel de l’approche militaire
En 1274, le Mongol Kubilay Khan (1216-1294), qui dirige un vaste empire s’étendant de la Mer Noire à la Chine, décide l’invasion du Japon à partir du Sud de la Corée. Une flotte de 1 000 vaisseaux pouvant transporter une armée de 40 000 hommes est ainsi construite en 1273 et 1274. La force d’invasion part de Tsushima à la conquête de l’île Kuyshu en novembre. Le 24 novembre, l’affrontement près d’Hakosaki conduit les Mongols à battre en retraite de nuit au cours d’une tempête. Celle-ci détruit en grande partie la flotte mongole et provoque la mort de 13 200 hommes par noyade. Malgré cet échec, Kubilay Khan ne s’avoue pas vaincu et décide dès la fin 1274 la préparation d’une nouvelle invasion. En juin 1281, la flotte mongole de 3 500 navires quitte son port d’attache de Masampo et progresse rapidement : conquête de l’île de Tsushima, prise de l’île d’Iki le 10 juin, pillage et attaque de cibles faciles sur l’île de Kuyshu à partir du 23 juin. Une attaque massive contre les défenses de Mizuki est envisagée le 15 août alors que l’armée reste à bord des navires ancrés au large de Takashima (1).
Au même moment commence à se former un phénomène naturel rare et désastreux pour les Mongols connu sous le nom de « vent divin » (kamikaze). La formation de vapeur à la surface de l’océan Pacifique surchauffé conduit à créer de vastes bancs de nuages qui tournent autour d’un « oeil mort ». Or les courants de la haute atmosphère projettent cette tempête vers les détroits de Corée et atteignent le Japon le 14 août. A cet instant, des centaines de navires mongols sont rassemblés dans une crique pour se protéger de l’agitation de la mer, encombrant de fait l’entrée de la baie. Malgré les avis des marins chinois, les seigneurs mongols décident de maintenir leur position pour effectuer le débarquement le lendemain. La force du typhon finit par paralyser et détruire l’intégralité de la flotte. Au sol, les troupes débarquées sont prises dans un mouvement de panique et happées par les rouleaux qui déferlent sur les plages. Lorsque le typhon prend fin le 16 août, les navires restants se télescopent et sont ramenés par les courants vers le littoral, la mer est jonchée de cadavres tandis que les survivants sont massacrés sur l’île de Takashima. Ces conditions naturelles exceptionnelles ruinent de nouveau ce plan de campagne militaire de plusieurs années. En 1588, à la suite d’une forte tempête, la destruction d’une grande partie de l’Invincible Armada, flotte espagnole partie à la conquête de l’Angleterre, dans la Manche, en est un autre exemple significatif. Le désastre de la flotte française par une tempête en Mer Noire en 1854 est lié directement aux très mauvaises conditions météorologiques qui incitent à créer le premier Service météorologique français. Outre les conditions atmosphériques, les paysages agraires, les villes, les formes du relief, les cours d’eau, les forêts entre autres facteurs, sont autant d’éléments auxquels le militaire doit songer avant de mener une opération et qui ont une influence décisive.
Le bocage est ainsi considéré comme un obstacle redoutable pour les armées américaines dans le Cotentin en juin et juillet 1944, malgré une préparation intensive aux techniques de combat rapproché dans le Sud de l’Angleterre où le paysage est alors presque similaire. La péninsule du Cotentin, qui comprend un objectif de débarquement à Utah Beach (Sud-Est) et plusieurs zones de largages des parachutistes (régions de Sainte-Mère-Eglise et Sainte-Marie-du-Mont), est un milieu bocager depuis les XI-XIIe siècles. Les haies sont hautes de plusieurs mètres, les parcelles de terrain de taille moyenne ou petite, les chemins sont nombreux et sinueux. Dans la nuit du 5 au 6 août 1944, les parachutistes, la plupart atterrissant en dehors de la zone de largage prévue, rencontrent la première difficulté de leur mission : se répérer dans l’espace, les haies cachant les villages et les grands axes de passage. Paradoxalement, ce paysage fermé favorise la dissimulation contre les défenseurs allemands mais complique leur sens du repérage en pleine nuit (malgré une lune lumineuse) dans un contexte de stress intense de combat. Quand le général Taylor, commandant la 101e division aéroportée, atterrit seul dans une prairie entre quatre haies, il se croit complètement perdu. Il parvient dans les heures suivantes à rassembler 40 hommes au lieu des 600 prévus du 501e régiment. Les combats en milieu bocager dans la nuit et la matinée qui a suivi se sont déroulés le plus souvent au corps à corps, au carrefour des chemins, entre les haies. La guerre en milieu bocager dure deux mois environ après une progression lente des soldats américains et non sans mal.
D’une pensée empirique aux Ecoles de géographie militaire
La géographie a toujours été considérée comme un composant, théorique et pratique, de la culture militaire. De tout temps, elle intervient dans la pensée des grands théoriciens de la stratégie et de la tactique. Le plus ancien témoignage connu est celui de Sun Tse, dans l’Art de la guerre (Ve siècle avant J.C.) qui définit, selon des types de manœuvres, différents types de terrain (marécages, montagnes, etc.). Au Ie siècle avant J. C, le magistrat romain Frontin, auteur des Stratagèmes, recommande à son tour certains procédés tactiques selon le type de relief. A toutes les époques et dans toutes les grandes civilisations, il y eut des théoriciens militaires pour mesurer toute l’importance de la connaissance géographique dans la conception et la réalisation d’une opération militaire. Dès la fin du XVIIIe siècle, le génie de Napoléon se caractérise tout autant par son audace dans le commandement que par la précision qu’il accorde à la connaissance du terrain, à ses formes topographiques, à ses ressources économiques et aux populations. Il a ainsi réformé le corps des ingénieurs géographes du dépôt de la guerre pour accroître son champ d’action et de compétences. Le Maréchal Foch, avant la Première Guerre mondiale, rappelle la place décisive que la connaissance géographique apporte au militaire. Il n’est de bon stratège et tacticien sans la connaissance et la maîtrise du milieu. La géographie est ainsi ancrée profondément dans la culture militaire française, de manière consciente ou empirique. Elle est une forme de comportement, sensible à la notion d’espace, soucieuse de l’enjeu de maîtriser un environnement pour mener une opération. Le capitaine de Gaulle, dans un article consacré à la doctrine française et publié en 1925, en souligne la portée culturelle. Tout en préconisant, pour les officiers français, une pensée militaire souple et sans dogme dans le contexte de l’après-guerre, il rappelle le rôle primordial de la géographie dans la tactique : « Suivant une direction dont l’attrait est égal au péril, on pourrait en venir à penser que, dans la conception de l’idée de manœuvre, le problème se ramène à donner aux moyens de feu dont on dispose l’efficacité maximum et par suite à faire effort là où l’on peut tirer le plus commodément. Or, les formes du terrain commandent la portée, la rasance, la convergence des feux d’infanterie, la capacité d’observation de l’artillerie et la précision du tir de la plupart de ses pièces (…). C’est aussi de cette seule étude qu’on s’inspirerait pour concevoir la forme d’une attaque » (2).
La pensée du capitaine de Gaulle s’inscrit dans une continuité culturelle. Dès le début du XIXe siècle, des écoles de pensée en géographie se sont développées contre l’armée napoléonienne. Dans les années 1800 en Espagne et en Italie, puis dans les années 1810 en Prusse et en Autriche, ces mouvements de pensée font de la géographie une base fondamentale de la culture militaire (3). Ils inventent une discipline nouvelle dont la démarche existait déjà dans l’Antiquité. Ils élaborent des raisonnements et des théories qui permettent de gagner la guerre future, en étudiant les formes physiques de l’espace dans la tactique et les aspects humain (économique, politique, statistiques) dans la stratégie.
En France, une pensée géographique militaire française émerge lentement au XIXe siècle. Théophile Lavallée, professeur de géographie à Saint-Cyr entre 1832 et 1869, auteur de Géographie physique, historique et militaire (1832), en devient le précurseur. Il faut attendre le choc de la défaite française de 1870-1871 pour qu’une véritable école de géographie militaire se développe. De grands théoriciens, dont fait partie le colonel Gustave-Léon Niox, se font les défenseurs de la géographie dans la formation des officiers et dans la pratique militaire. Celui-ci, auteur d’ouvrages de géographie militaire et professeur de géographie à l’Ecole supérieure de guerre à Paris, entre 1874 et 1895, écrivait ainsi que « La géographie n’est pas un but, c’est un moyen. La géographie est dans un tout. Tout est dans la géographie. C’est la science mère, indispensable, sans laquelle toutes les autres, histoire, art militaire, littérature, philosophie même, manquent de base et ne peuvent acquérir leur entier développement » (4).
La création du Service géographique de l’armée en 1887, remplaçant le bureau cartographique au dépôt de la guerre, issu lui-même du groupe des ingénieurs géographes du roi (1744), en est un des éléments révélateurs. La multiplicité des ouvrages de géographie militaire jusqu’à l’Entre-deux-guerres, près de 150 ouvrages d’auteurs différents, révèle une effervescence pour une géographie à la fois théorique et pragmatique. Si ce courant de pensée, généralement restreint au milieu militaire, tend à s’affaiblir dès les années 1930, puis à disparaître dans les années 1950 au profit de la géopolitique et de la géostratégie, il n’en demeure pas moins que la géographie reste un caractère dominant de cette culture militaire. Au moment où l’Ecole de géographie militaire décline, la géographie du militaire commence à occuper un autre champ de réflexion et de diffusion. En France, les théoriciens de la doctrine commencent à prendre en considération certaines dimensions de la géographie comme en témoignent les nombreux textes doctrinaux dédiés au désert, à la montagne et la ville, aux espaces littoraux ou à l’aménagement du terrain (dont la première édition est publiée en mars 1917). De fait, l’influence omniprésente de la géographie dans l’art de la guerre depuis l’Antiquité suscite la création d’écoles de géographie militaire en Europe aux XIXe et XXe siècles. Celles-ci amènent, à leur tour, la pensée militaire officielle à considérer cet élément dans la synthèse des expériences passées et dans la conception des guerres futures. Le phénomène se produit au cours de la Première Guerre mondiale et n’a jamais cessé de prendre de l’ampleur depuis. Ainsi, le cadre d’expression change et évolue, celui de la réflexion s’adapte aux mutations technologiques et à la géopolitique de la Guerre froide et post-Guerre froide. L’essor du Geospatial Intelligence, synonyme de « fusion de données », intégrant l’imagerie spatiale, les sources ouvertes, les informations issues du cyberespace et du renseignement électro-magnétiques, aux Etats-Unis depuis les années 1990 et en France dans les années 2010, caractérise ce besoin de géographie et d’analyse spatialisée pour la Défense et la sécurité.
L’approche géographique, un composant essentiel des questions de Défense et de sécurité
La géographie constitue un outil décisif pour la sécurité nationale et la gestion des crises. Elle est aujourd’hui considérée comme un facteur de connaissances et d’anticipation pour le décideur afin de répondre aux risques et aux menaces qui se sont diversifiés depuis la fin de la Guerre froide. Par définition, elle forme une discipline de synthèse qui intègre à la fois des éléments physiques et humains et s’appuie sur une diversité d’outils. Ceux-ci sont composés d’analyses, comme les études milieux, et de représentations cartographiques dont la qualité s’améliore grâce aux nouvelles technologiques numériques de l’information. Depuis la fin de la Guerre froide, puis les attentats de New York du 11 septembre 2001, la diversification des menaces et des risques (lutte contre le terrorisme international et les trafics illicites mondialisés par exemple) conduit à valoriser son utilisation. Mais bien d’autres raisons peuvent aussi conduire à l’exploiter de manière plus rigoureuse comme la gestion du maintien de l’ordre public, la prévention contre les incendies, les catastrophes naturelles et technologiques de grande ampleur. Depuis la fin des années 2000, il en résulte non seulement une prise de conscience de sa nécessaire exploitation dans un champ d’action plus étendu par le décideur politique et militaire, mais aussi un renouvellement des moyens d’acquisition de la connaissance et une tendance à améliorer la qualité des analyses.
La géographie occupe une place toujours plus importante dans les services étatiques spécialisés. Elle apporte une analyse et une réflexion dans la planification de crise permettant de réduire les incertitudes et d’organiser les modalités d’action. D’après le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale (2008), réédité en 2013, la stratégie de sécurité nationale a « pour objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation », de défendre la population et le territoire et d’assurer la contribution de la France à la sécurité européenne et internationale. Elle doit contribuer à la mise en œuvre de la politique de défense face aux risques d’agression, la politique de sécurité intérieure et la politique de sécurité civile pour la protection de la population et des biens, la politique étrangère et la politique économique (p. 62). La création d’un cinquième pilier stratégique « connaissance et anticipation », considérée comme la « première ligne de défense » (p. 66), reconnaît ainsi la nécessaire exploitation des outils et de l’analyse géographique pour répondre aux impératifs de la sécurité nationale. Ce nouveau pilier considère que la « bataille du XXIe siècle se joue d’abord sur le terrain de la connaissance et de l’information, des hommes comme des sociétés » qui couvrent le champ du renseignement, la connaissance des zones d’opérations, l’action diplomatique, la démarche prospective et la maîtrise de l’information. La connaissance des liens entre les sociétés et les territoires, dans leurs dimensions physiques et humaines, représente « l’une des clefs de l’autonomie stratégique » pour le décideur politique et militaire. Comment la connaissance géographique contribue-t-elle à analyser les risques et les menaces dans une dynamique prédictive et à mettre en œuvre de nouveaux moyens technologiques pour les anticiper ?
Penser la géographie historique des questions militaires
Le facteur géographique reste présent jusqu’à aujourd’hui par des moyens différents dans la culture militaire. La recherche de la connaissance des terrains et de l’environnement humain, par des analyses spatialisées ou des représentations cartographiques, pour le décideur politique ou militaire, confirme cet intérêt pour la connaissance géographique dans le cadre de la préparation, la conduite et l’exploitation des opérations militaires sur le territoire national ou sur les théâtres extérieurs.
Ce numéro, le premier sur cette thématique avant un autre annoncé pour mai 2017, de la Revue de géographie historique révèle la grande diversité de la recherche universitaire sur le rapport entre la géographie et les questions militaires alors que la communauté universitaire en géographie, voici encore quelques décennies, ne tendait guère à la valoriser. Comment ne pas citer l’ouvrage d’Yves Lacoste dont la récente réédition (2012) rappelle, par son auteur, la difficile prise en compte des études militaires dans le savoir géographique. Dans La géographie, çà sert, d’abord, à faire la guerre, publié en 1976, il révélait déjà l’importance de la géographie par et pour le militaire comme savoir stratégique au même titre que pour le dirigeant politique (souvent le commandant des armées dans l’histoire) et le chef d’entreprise commerciale. Quarante ans après son édition, qui a suscité tant de débats dans la communauté universitaire en géographie, une nouvelle génération de chercheurs s’est appropriée ses concepts et valorise la connaissance du territoire dans la tactique et la stratégie. Cette tendance explique, en grande partie, le succès rencontré des formations en géopolitique, au niveau master, qui ont intégré les questions de Défense et de sécurité dans leurs enseignements. Il faut espérer que cette tendance se poursuive de sorte que les géographes soient pleinement reconnus dans les centres de recherche sur la Défense.
Ce numéro aborde plusieurs aspects de la relation entre la géographie et les questions militaires à partir de recherches récentes et innovantes. Un premier ensemble d’articles aborde la place du facteur géographique dans les opérations débarquement des Iles Britanniques, la conception et l’aménagement du Morvan dans la défense du territoire français avant 1914, les manœuvres tactiques en Argonne durant la Première guerre mondiale. Dans « L'Invisible Armada : la géographie des menaces d'invasion française des Îles Britanniques (XIIIe-XIXe siècles) », Damien Bruneau (agrégé de géographie dans l’Académie de Rennes) traite d’un sujet jusqu’alors méconnu. Il considère que l'analyse géographique du choix des lieux de départ des expéditions françaises et des lieux de débarquement ainsi que la prise en compte des composants du milieu naturel permettent de mieux comprendre l'organisation maritime des deux puissances navales. Ces analyses ont non seulement provoqué l’organisation de systèmes de défense spécifiques mais aussi entraîné, du XIIIe au XIXe siècle, des évolutions entre fortifications côtières, théorie des wooden walls et formation d'une milice locale. Denis Mathis (Université de Lorraine) nous apprend un cas significatif d’appropriation territoriale à des fins défensives par les militaires. Dans « Les hydrosystèmes militaires défensifs de Basse-Alsace », aux XVIIe-XVIIIe siècles, le Nord de l’Alsace fait l’objet, dans un contexte de pression géostratégique entre puissances, d’un maillage défensif original qui complètent ou s’opposent au réseau de places fortes établi par Vauban. Enfin, Emmanuel Chiffre (Université de Lorraine) et Jean-Christophe Sauvage (Université de Lorraine) analysent un autre exemple régional de l’usage de la géographie à des fins de défense dans « La géographie au service de la défense du territoire : le cas du projet de réduit du Morvan (1872-1899) ». Face à une invasion allemande, après la défaite française de 1870-1871, les théoriciens de la défense territoriale, en particulier les généraux Séré de Rivières et Froissard, dans le cadre des réflexions du Comité et des sous-commissions de Défense, envisagent des espaces naturels d’arrêt sinon de résistance pour l’armée française. Le « réduit du Morvan », avec des projets de villes fortifiées et de camps retranchés, est alors considéré comme un de ces éléments que les géographes militaires français, comme Gustave-Léon Niox et Anatole Marga dans les années 1870-1880, reprendront dans leur analyse de géographie militaire de la France jusqu’au début du XXe siècle. Le troisième article aborde également la manière dont le facteur géographique pouvait être exploité par les militaires. Pierre Taborelli (Université de Reims), Alain Devos (Université de Reims), Mylène Dodoci (Université de Reims), Yves Desfossés (Drac Champagne-Ardennes) et Nicolas Bollot (Université de Reims) analysent l’apport de trois plans directeurs au 1/20 000e du secteur de l’Argonne, réalisés par les Groupes de Canevas de Tirs des Armées en 1918, sur la compréhension de l’organisation spatiale du front durant la Grande Guerre. Cet article dont l’approche demeure innovante en la matière, grâce à des représentations cartographiques inédites, s’intéresse à la qualité des travaux cartographiques qui révèlent à la fois l’impact des reliefs sur le front et permettent de quantifier les réseaux de défense. Il met en évidence surtout le rôle primordial de la couverture forestière dans la manœuvre tactique, son impact dans l’organisation des rideaux de défense et sur la guerre des mines.
Le deuxième ensemble d’articles aborde le rapport entre les nouvelles technologies et l’exploitation de l’analyse spatiale à des fins militaires. André Louchet (Université Paris-Sorbonne), dans « Imagerie, aérospatiale, géographie et renseignement », présente, de manière détaillée, tous les aspects techniques que le géographe est amené à prendre en compte pour obtenir une connaissance du territoire à partir des outils géospatiaux. Il annonce le concept actuel de Geospatial Intelligence qui s’appuie justement sur la relation entre le renseignement et l’imagerie spatiale. L’article suivant s’inscrit dans cette approche mais en s’intéressant spécifiquement au cyberespace. Dans « Cyberguerre et géographie », François Pernot (Université de Cergy-Pontoise) et Philippe Wolf (Ingénieur général de l’armement, Institut de Recherche Technologique SystemX, Paris-Saclay), posent la question de l’existence de la dimension géographique à l’heure de la cyberguerre. En s’appuyant sur les conceptions géographiques des milieux physiques et des sources numériques (de l’affaire Snowden en particulier), les auteurs montrent les continuités géohistoriques pour comprendre les usages militaires de cet espace immatériel. Ils théorisent une nouvelle géographie militaire du cyber, jusqu’alors peu explorée, qui s’appuie sur sept dimensions spatiales qui sont autant d’interfaces avec les espaces physiques.
Enfin, le dernier ensemble d’articles traite de l’apport de la réflexion géographique dans l’emploi des forces, plus particulièrement de l’aviation militaire. Ivan Sand (doctorant à l’Institut français de géographie-Université Paris VIII et Centre d’études stratégiques aérospatiales), traite d’un sujet méconnu de géographie militaire. En s’intéressant au rapport entre appropriation territoriale et capacités militaires de projection de forces, il souligne la rupture et le paradoxe géostratégiques des premières années de la Guerre froide pour l’Aviation militaire. Dans « Les territoires qui fondent la projection aérienne des armées françaises (1945-1949) », il met en évidence la naissance du concept de projection de forces (l'expression apparaîtra plus tard) dans un conexte de manque de moyens aériens lourds pour relier la métropole à l’Indochine et Madagascar, devenus des théâtres d’opérations à plus de 8 000 km, et le nécessaire usage d’un réseau de points d'appui militaires qui suscite des débats de la part des théoriciens de la stratégie aérienne. Les bases de la projection de forces apparaissent à cette époque et se développeront, en tenant compte des expériences malgache et indochinoise, tout au lond des décennies suivantes jusqu'à aujourd'hui comme le montre l'adoption du récent avion de transport A400 M par l'Armée de l'Air française. La géographie militaire aérienne, dans le contexte actuel, suscite aussi des questionnements dans l’article d’Alexandre Chauvel (Institut français de géopolitique, Université Paris VIII). Dans « Le Ciel Unique Européen : Quelle place pour l’aviation militaire française dans les 20 prochaines années ? », celui-ci analyse l’impact de la réforme lancée par la Commission européenne en 1999, toujours en cours, des espaces de trafic aérien civil sur l’activité aérienne militaire. Ce travail issu d’une recherche inédite sur le sujet révèle les contraintes imposées par cette réforme pour l’Armée de l’Air. Il met en évidence la réduction des espaces aériens réservés aux entraînements des pilotes et les enjeux de la conception des espaces aériens militaires pour la défense et la sécurité du territoire national.
Notes :
(1) Boulanger Ph., 2006, Géographie militaire, Paris, Ellipses.
(2) Capt. Charles de Gaulle, « Doctrine a priori ou doctrine des circonstances », Revue militaire française, janvier-mars 1925, pp. 306-328.
(3) Boulanger Ph., 2002, Géographie militaire française, Paris, Economica ISC.
(4) Colonel Niox, Géographie militaire, La France, tome 1, Delagrave, 1893, p. VII. Voir Philippe Boulanger, « La Géographie militaire (1876-1895) de Gustave-Léon Niox », Stratégique, Institut de stratégie comparée, 4/2000, n°76, 2001, pp. 95-126.
Editorial | Publié le 2015-05-04 19:12:15 |
Par Philippe Boulanger (Professeur à l’Institut français de géopolitique-Université Paris VIII et directeur de la Revue de géographie historique)
Ce double numéro de la Revue de géographie historique aborde un sujet si commun dans notre quotidien qu’il fait finalement l’objet de peu de recherches et de publications en géographie. Global Information, Media Diplomaty et Nation branding, Affaire Wikileaks, Révolution Facebook dans les révoltes arabes, affaire Snowden... les médias sont devenus essentiels pour comprendre la géopolitique du monde contemporain. Ils sont des outils d’intelligence collective et collaborative, mais aussi des instruments d’influence et de rivalités de pouvoir dans les relations internationales. Si l’approche géopolitique peut nous paraître évidente pour comprendre les enjeux et les rapports de force entre les sociétés et les Etats, il en est différemment dans une approche géohistorique.
Le rapport au temps long semble plus difficile à appréhender sur des espaces et à des échelles variables. Pourtant, les médias ont une histoire déjà ancienne qui peut remonter à l’Antiquité avec l’utilisation du papier (Ie s. av. J.C.) en Chine. Leur essor apparaît évidemment à une date plus récente en Europe avec le développement de la presse à partir du XVIIe siècle, de la transmission des informations par les câbles de télégraphie, des premiers moyens de télécommunication et de la radiophonie à partir du XIXe siècle, de la télévision et des médias numériques à partir du XXe siècle. Cette pluralité de médias qui existent aujourd’hui pose cependant une première question. Comment définir le mot média ? Le terme semble tellement chargé de sens que le sociologue Rémy Rieffel, dans Que sont les médias ? (2009), s’interroge sur sa définition : « les médias existent-ils ? ». Issu de l’expression anglo-saxonne « Mass Média », utilisée à partir des années 1950, le mot Media s’impose à partir des années 1970 pour désigner une diversité de comportements d’utilisateurs et un éventail de techniques de communication qui ne cesse de se moderniser. Avant la diffusion des outils numériques, le dictionnaire Le Petit Robert [1990] met en avant l’idée de supports de diffusion de l’information au plus grand nombre, liés notamment à la radiophonie et à la télévision. Média désigne « tout support de diffusion massive de l’information (presse, radio, télévision, cinéma, publicité, etc.) ». Plus récemment, pour Christine Leteinturier et Rémy Le Champion (2009), le terme renvoie à « l’ensemble des dispositifs techniques permettant l’expression de la pensée et assurant la médiation entre un ou plusieurs émetteurs et (ou les) récepteurs(s), individus particulier ou public de masse ». Il est considéré, en ce début xxie siècle, que les médias sont caractérisés comme des supports de communication et des usages liés à ces supports. Le mot a pris une nouvelle dimension avec le développement de la mondialisation des échanges depuis la fin du xxe siècle. Pour le philosophe Francis Balle, dans Médias et sociétés (2011, 13e édition), le mot est popularisé par l’essayiste canadien Marshall Macluhan (1911-1980) à la fin des années 1960 et début années 1970 pour désigner un moyen de communication à travers un « outil, une technique ou un intermédiaire permettant aux hommes de s’exprimer et de communiquer à autrui cette expression ». Il se définit aussi comme un usage par le rôle ou la fonction. A l’heure de la révolution des outils numériques, le mot Media ne cesse de se réinventer et d’apparaître comme le reflet d’une nouvelle ère de l’information et de la communication. Il témoigne de mutations permanentes qui amènent à s’interroger sur son étude en géographie historique et en géopolitique.
Existe-t-il une approche géohistorique et géopolitique des médias ?
L’approche géohistorique des médias reste une dimension naissante, à peine abordée dans les nombreux travaux des experts en information-communication. La raison est liée principalement au faible nombre de géographes qui se sont intéressés directement à l’étude des médias. Ceux-ci ont porté leur intérêt sur les réseaux de télécommunication, surtout à partir des années 1950. Leurs travaux sont principalement de nature statistique tel celui de François Cusey sur la cartographie des flux téléphoniques en Lorraine entre 1957 et 1959 (Essai de délimitation régionale : l’exemple lorrain, 1959). D’autres études sont menées jusqu’à aujourd’hui en s’interrogeant sur leur place dans la mondialisation des échanges économiques ou sur l’analyse spatiale des nouveaux liens sociaux que crée le cyberespace. Henry Bakis, depuis les années 1990, a largement contribué à faire connaître cette approche de la géographie des médias et invente la notion de géocybergéographie. Exposée en 1997 au colloque de Palma de Majorque (UGI), cette notion tend à reconsidérer l’espace géographique à partir des nouvelles activités sociales liées à l’interconnexion internet. Gabriel Dupuy, dans Internet, géographie d’un réseau (2002), analyse l’essor d’internet à partir des itinéraires des flux, de la structure des réseaux, des centres et des périphéries, des nouvelles frontières et de l’aménagement du territoire. Plus récemment, ce sont également les réseaux de télécommunications en rapport avec l’aménagement du territoire que le géographe Bruno Moriset aborde en mettant en évidence la fracture numérique et les territoires privés d’accès à internet à haut débit en France (2010). Un courant de pensée en géographie s’est ainsi développé à partir de cette conception des médias fondée sur les réseaux de communication.
En revanche, aussi bien dans une approche géohistorique que géopolitique, l’étude des médias reste à découvrir tant la production scientifique demeure secondaire. Les travaux de Jacques Barrat et de Francis Balle (Institut français de presse à l’Université de Paris2-Assas) ont contribué, par exemple, à valoriser cette dimension spatiale et politique des médias. Comme le souligne Jacques Barrat, « (…) la prise en considération des phénomènes de communication et d’information, et des outils qui sont utilisés à cet effet (médias) est tout à fait primordiale dans la démarche de la géopolitique. De même, la géopolitique s’intéresse d’autant plus aux médias qu’ils sont souvent des éléments fondamentaux dans l’explication des rapports entre l’Homme et son milieu politique » [Barrat, 2009]. Pour celui-ci, les médias sont à la fois acteurs et reflets des mutations géopolitiques. Mais, paradoxalement, peu de géographes se sont investis dans une démarche géopolitique et/ou géohistorique des médias.
La géographie historique et la géopolitique des médias sont pourtant nécessaires à la compréhension des mutations de notre environnement caractérisé par la part croissante des progrès des technologies de l’information et de la communication. Ces mutations géopolitiques sont représentées dans les médias, accélérées ou provoquées par les médias comme le rappelle Jacques Barrat. Le rôle joué par les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, durant les soulèvements dans les pays arabes (Egypte, Tunisie, Libye, Bahreïn, Maroc, Syrie) en 2011 en témoigne. Toutefois, leur étude montre qu’il n’a pas existé de véritable Révolution Facebook ou Twitter au même titre que la télégraphie par câbles à la fin du XIXe siècle n’a pas révolutionné la diplomatie ou l’art de la guerre en Occident. La géographie historique offre cette possibilité de prendre un certain recul sur des phénomènes géopolitiques hâtivement annoncés.
Pour une approche géohistorique et géopolitique des médias
Comment définir l’approche géohistorique et géopolitique des médias ? La géographie analyse les lieux, les territoires, les relations dynamiques tissées entre les hommes et leur environnement à des échelles variables. La géohistoire et la géopolitique des médias s’inscrivent dans cette approche sous l’angle des rivalités de pouvoirs à l’échelle locale, régionale, continentale et planétaire. Au début du XXIe siècle, elles montrent que les technologies de l’information et de la communication accentuent les dynamiques spatiales planétaires à travers plusieurs phénomènes que sont la mondialisation, l’internationalisation, la globalisation et la transnationalisation. La mondialisation est synonyme de rapprochement des cultures et d’un nouvel état du monde grâce à des nouveaux moyens et usages liés aux médias. La globalisation des médias, dont le mot est d’origine anglo-saxonne, renvoie à la domination des États-Unis dans tous les secteurs des médias, aussi bien économiques (les grands groupes de médias) que politiques et culturels. L’internationalisation se définit par une ouverture aux influences extérieures, au moins depuis le xixe siècle, grâce à la modernisation des moyens de communication et de l’information, par la concurrence des influences et la complémentarité des échanges de toute nature (politique, économique, sociale, culturelle). Enfin, la transnationalisation renvoie au développement de la place des médias dans le monde, où la frontière entre les États tend à s’effacer dans les échanges, notamment ceux des programmes radiophoniques ou télévisés aux échelles régionale comme planétaire.
L’approche géohistorique et géopolitique des médias s’inspire, dans un premier temps, de la définition même de la géopolitique. Yves Lacoste, père fondateur de l’école de géopolitique française dans les années 1970, la considère comme l’étude des discussions et controverses entre citoyens d’une même nation [Lacoste, 1991]. Frédéric Lasserre et Emmanuel Gonon, dans Manuel de géopolitique (2008), la définissent comme l’analyse des enjeux de pouvoirs sur des territoires. Pour Jacques Barrat, cette définition n’est pas simple. La géopolitique a « pour but d’étudier les projets politiques, des grands acteurs de notre planète par rapport à leurs relations entre la géographie, les grands acteurs et les institutions politiques » [Barrat, 2009]. Stéphane Rosière met en évidence les stratégies de l’espace, les rapports de pouvoir (plan interne) et de puissance (plan externe), les éléments matériels et immatériels comme l’importance de la représentation [Rosière, 2008]. Ces définitions se rejoignent surtout sur l’idée de rivalités de pouvoirs, de luttes d’influence entre différents acteurs sur un territoire donné et à des échelles géographiques variables. La géopolitique des médias consisterait ainsi en l’étude des rivalités entre les acteurs médiatiques, de la représentation de ces luttes d’influence par les médias. Pour Jacques Barrat, elle permet de comprendre les grands déséquilibres du monde actuel puisqu’ils en sont les acteurs et les reflets. Surtout, les sources d’information, les outils d’information, la captation des audiences sont à la fois des enjeux de domination de l’opinion comme des moyens privilégiés de comprendre les stratégies de contrôle, les tensions et les rivalités entre les acteurs [Boulanger, 2014].
Cette approche des médias s’inscrit aussi dans une dimension propre à la géographie historique. Elle inclue des temporalités et des rythmes variables, des continuités ou des ruptures historiques : le temps long et le temps court, le temps passé et le temps présent. La géohistoire et la géopolitique des médias s’inscrivent dans une temporalité variable s’échelonnant de plusieurs siècles à quelques jours. L’analyse d’Alvin et Heidi Toffler, dans Guerre et contre guerres, en 1994, s’inscrit dans ce temps long pour désigner l’émergence d’une ère de l’information. Après les progrès de l’agriculture et ceux de la Révolution industrielle, une troisième ère s’imposerait grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les rivalités mondiales se caractériseraient par la maîtrise de l’information et par les affrontements dans le champ de l’influence au xxie siècle. Les expériences issues de la guerre du Vietnam américaine (1965-1973), avec l’immédiateté de l’information de guerre auprès de l’opinion publique américaine, auraient marqué une vraie rupture et participé à l’émergence de ce nouvel âge sociétal. L’information devient dès lors un enjeu d’ordre stratégique, bouleversant ainsi les rapports entre les États comme ceux entre les individus, aussi bien dans le champ militaire à travers la Révolution dans les affaires militaires à partir des années 1990, qui prend en compte les NTIC dans la stratégie opérationnelle, que dans les champs politique, économique et socio-culturel.
En somme, l’approche géohistorique et géopolitique des médias se définit par des critères d’analyse spécifiques et propres au domaine des médias, des concepts fondamentaux propres à la géopolitique, une combinaison d’échelles spatiales (du local à la planète) et des temporalités différentes selon l’objet étudié. Sa finalité consiste à comprendre les rivalités de pouvoirs exercés par les médias, soit qu’ils sont le reflet des mutations géopolitiques, soit qu’ils en sont les acteurs [Boulanger, 2014].
Les médias, reflets et acteurs des mutations géopolitiques et géohistoriques
Les différents articles réunis dans ce numéro de la Revue de géographie historique s’articulent autour de trois grands thèmes. Le premier met en évidence la géographie historique des principaux centres de développement et de rayonnement des médias sur le temps long (Philippe Boulanger). Depuis la fin du Moyen-Age, qui voit la naissance de l’imprimerie en Europe, trois grands centres de gravité se distinguent en fonction de conditions générales (politiques, économiques, technologiques, socio-culturelles) favorables : le continent européen du XVe au début du XXe siècle, les Etats-Unis au XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, l’Asie orientale depuis la fin du XXe siècle. L’approche géohistorique des médias montre ainsi ces dynamiques spatiales successives traduisant aussi des rivalités d’influence et des rapports de forces entre les grands groupes des médias et entre les Etats. Au début du XXIe siècle, l’émergence d’un nouveau centre de gravité des médias en Asie, depuis les années 1990, vient bouleverser une géohistoire surtout occidentale des médias. La Chine et l’Inde participent à créer une nouvelle dynamique planétaire qui concurrence de plus en plus le centre de gravité des médias américains. L’article de Chloé Larcher (IFP) s’inscrit dans cette mutation des dynamiques géopolitiques dans la zone Asie. Intitulé « Une représentation médiatique des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), entre engouement et craintes face aux puissances émergentes (2000-2010) », il montre que les journalistes des magazines Géo et National Geographic valorisent la montée en puissance économique et politique de ces pays ainsi que leurs différents atouts (qualité des paysages, traditions culturelles, représentation du rêve, exotisme). Leur regard journalistique, qui se veut une vulgarisation des mutations géopolitiques pour le plus grand public, traduit aussi le déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale des pays développés vers des pays principalement asiatiques. Il apparaît aussi critique en soulignant les dérives des modèles de développement (pollution de l’environnement, conflits des minorités par exemple).
Un deuxième ensemble d’articles montre que les médias sont des acteurs géopolitiques à part entière. Ceux-ci participent à accélérer ou à réduire des mutations politiques, économiques, socio-culturelles plus larges. Shuang He (Institut français de géopolitique-Université Paris VIII), dans « Le soft power et les médias peuvent-ils servir l’ambition chinoise de séduire les pays africains ? », aborde précisément cette relation. La doctrine d’influence de l’Etat chinois valorise l’emploi des médias en Afrique depuis la fin des années 2000. L’auteur montre toutefois que leur efficacité reste relative pour des raisons diverses liées autant à la réception par les populations locales que par les moyens encore limités mis en œuvre. Les médias peuvent ainsi être des acteurs d’influence au service de la diplomatie des Etats. Ils peuvent être aussi à l’origine de scandales politiques impliquant les grandes puissances. Laure Marsac (IFP, GroupExpression), dans « L’affaire du Cablegate », nous rappelle l’une des affaires qui a bouleversé l’opinion publique mondiale au début des années 2010 lorsque cinq journaux occidentaux révèlent une partie des dépêches diplomatiques américaines, normalement confidentielles, que Julian Assange leur a procurées. Cette affaire, souligne l’auteur, est une innovation radicale et témoigne de la place des médias comme acteurs géopolitiques. La diplomatie internationale, et d’abord américaine, doit désormais s’adapter aux nouveaux modes de communication et à leur utilisation par des acteurs civiles dans les relations internationales.
Un troisième ensemble d’articles porte sur la représentation géopolitique d’un phénomène donnée par les journalistes qui construisent un message destiné aux opinions publiques comme aux décideurs. Adeline Tissot (IFP, Imediapp), dans « L'accord nucléaire entre le Brésil, l’Iran et la Turquie vu par New York Times et Le Monde (11/2009-06/2010) », analyse le traitement médiatique de deux grands quotidiens occidentaux sur un fait géopolitique majeur du printemps 2010. Entre autres conclusions, elle démontre que ces deux quotidiens adoptent une ligne éditoriale alignée sur le point de vue des membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et celui des grandes puissances. Olivia Charpentier (Analyste géopolitique au Ministère de la défense) donne à comprendre la perception que les journalistes nous présentent de l’une des zones grises les plus significatives dans l’aire post-soviétique. Dans « La Transnistrie, couverture médiatique d’une zone grise par la presse quotidienne française (1989-2011) », elle souligne la spécificité de cette zone grise, notamment le recul de l’Etat, depuis la chute de l’URSS en 1991, dans cette région orientale de Moldavie, à la fois frontalière de l’Ukraine et aux portes de l’Union européenne, tel que les journalistes le développent. Elle constate que le traitement médiatique demeure marginal alors que la qualité des analyses permet d’aborder les véritables enjeux géopolitiques régionaux. L’article de Denise Apestegui (IFP), intitulé « La guerre des Malouines : la médiatisation du 30e anniversaire en 2012 », montre toute l’importance de la représentation géopolitique d’un événement commémoratif à travers La Nacion et The Times. Il révèle encore la mémoire vive des faits militaires dans le traitement médiatique de ces deux quotidiens nationaux entre le 1e janvier et le 30 juin 2012. A partir de trois thèmes essentiels (le litige territorial, l’exploitation pétrolière et la portée symbolique de la guerre), cette dimension commémorative fortement opposée entre les médias s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu en 2012. Enfin, Ivan Sand (IFG), dans « Le traitement médiatique de la péninsule du Sinaï : étude comparée de trois titres de presse écrite au cours de l’année 2013 », aborde également la manière dont une autre région, au Moyen-Orient, évolue vers la situation de zone grise à travers les articles des journalistes français, égyptiens et israéliens. Sous contrôle d’Israël entre 1967 et 1982, la péninsule est considérée par l’Etat hébreu et par l’Egypte, comme une zone tampon entre les deux pays, peuplés traditionnellement de Bédouins mais fragilisée par un ensemble de facteurs géopolitiques. L’auteur nous amène ainsi à comparer les différentes représentations des acteurs pour le contrôle et la stabilité de la région : les populations locales, les entités voisines (Israël, Territoires Palestiniens) et les grandes puissances internationales. Il en conclut que le Sinaï constitue une région essentielle dans les relations internationale en raison de sa forte dimension symbolique (militaire, commercial et religieuse).
Références bibliographiques
Balle F., 2011, Médias et sociétés, Paris, Mont Chrestien Lextenso éditions, 876 p.
Bakis H., 2007, « Le « géocyberespace » revisité : usages et perspectives », Netcom, n°3-4, p. 285-296.
Barrat J., 2009, « La géopolitique des médias » dans Médias, information et communication, sous la direction de Christine Leteinturier et Rémy Le Champion, Paris, Ellipses, 463 p.,
Boulanger P., 2014, Géopolitique des médias, Acteurs, rivalités et conflits, Paris, Armand Colin, coll. U, 310 p.
Lacoste Y., 1991, « L’Occident et la guerre des Arabes », Hérodote, n°60-61.
Lasserre F. et Gonon E., 2008, Manuel de géopolitique, enjeux de pouvoir sur des territoires, Paris, Armand Colin, 346 p.
Leinturier C. et Le Champion R. (dir.), 2009, Médias, information et communication, Paris, Ellipses, 463 p.
Moriset B., 2010, « Réseaux de télécommunication et aménagement du territoire, vers une fracture numérique territoriale 2.0 », Cybergéo, n°489.
Rieffel R., 2009, Que sont les médias ?, Paris, Folio-actuel, 539 p.
Rosière S., 2008, Dictionnaire de l’espace politique, Armand Colin, 318 p.
La revue européenne des médias, Irec-Université Panthéon-Assas, trimestrielle.
Editorial: La géographie d'une nouvelle civilisation européenne? - La géographie de l'époque de Napoléon | Publié le 2015-01-02 11:57:55 |
La géographie d’une nouvelle civilisation européenne? La géographie de l'époque de Napoléon
Par Nicola Todorov - Centre d'histoire du XIXe siècle (EA 3550)
Associée pendant longtemps à l’histoire événementielle, l’époque napoléonienne et la domination française sur une partie de l’Europe furent considérées, en raison de leur courte durée, comme des « épisodes » de l’histoire européenne, qu’il convenait de replacer dans des évolutions plus longues.
Aussi plébiscitée qu’elle n’a jamais cessé de l’être par le grand public, l’histoire de l’époque napoléonienne, peut-être parce qu’elle paraissait trop réduite à l’histoire politique, et donc exposée au reproche d’être une histoire trop passionnelle, fut assez délaissé par la recherche scientifique.
Depuis presqu’un quart de siècle cependant, l’époque de Napoléon, connaît un regain d’intérêt de la recherche scientifique, même si celui-ci ne s’est pas manifesté dans tous les pays au même moment. En France, le bicentenaire de l’épopée, qualifié encore il y a quelques années de bibliographiquement pauvre (Petiteau, 2006), aurait provoqué, plus récemment, une véritable « déferlante » de publications (Bertaud, 2014). Si en France, la spécialisation scientifique dans cette période, jamais abandonnée (Boudon, 2000; Petiteau, 2008), devenait minoritaire. À l’étranger, l’ouvrage de Stuart Woolf, Napoleon’s integration of Europe, fondé sur une vaste synthèse de travaux antérieurs, semble avoir donné l’impulsion à ce qu’il est convenu maintenant d’appeler la New Napoleonic History. L’auteur a en effet postulé que les administrateurs envoyés par l’Empereur dans les pays conquis avaient l’ambition de façonner l’Europe à l’image de la France, transformée par la Révolution, et la conviction ferme qu’une telle entreprise pouvait réussir. D’autres historiens, comme Michael Broers, ont poursuivi ces réflexions en appliquant des concepts des post colonial studies au contexte européen, comme celui de l’impérialisme culturel français. L'Europe napoléonienne est devenue un objet fécond de la recherche scientifique d'un intérêt croissant, ce dont témoigne la réédition d'ouvrages comme celui de M. Broers, Europe under Napoleon (Broers, 2014). L’Atlas de l’empire napoléonien, publié par Jean-Luc Chappey et Bernard Gainot en 2008, tente de prendre la mesure spatiale de cette nouvelle civilisation, que Napoléon et ses serviteurs auraient ambitionné de forger.
Le cadre de réflexion s’est davantage élargie à l’Europe entière, ce qui se manifeste par la parution de nombreux ouvrages issus de colloques internationaux (Dwyer, Forrest, 2007; Bourguinat, Venayre, 2007), comme celui dirigé par Annie Jourdan, Jean-Pierre Jessenne, Antoine François et Hervé Leuwers, L’Empire napoléonien, une expérience européenne ? (Paris, 2014), celui dirigé par Natalie Petiteau, Jean-Marc Olivier et Sylvie Caucanas, Les Européens dans les guerres napoléoniennes (Toulouse, 2012) et celui publié par Michael Broers et Peter Hicks et Agustin Guimerá, (Basingstoke, 2012). Alors que le premier rassemble une trentaine de contributions en suivant un plan thématique en s’interrogeant sur les visions d’Europe, l’ampleur de l’uniformisation administrative, les communications et la culture ainsi que le poids de la guerre, qui pouvait diviser mais aussi rapprocher, le dernier suit un plan géographique. Répartir les études selon des aires géographiques – la France, l’Europe de la Suisse à l’embouchure du Rhin, pour finir avec la péninsule ibérique, répondait sans doute aussi à la spécialisation géographique des différents contributeurs, mais correspondait bien à la volonté de prendre en compte les différences spatiales de l’expérience napoléonienne, et de les comprendre.
L’un des apports les plus stimulants de cette New Napoleonic History est en effet l’application de certains concepts et de problématiques venus de la géographie à cette histoire napoléonienne. À l’aide d’une grille de lecture, peut-être plus abstraite, mais moins passionnelle – du moins pourrait-on le croire - que celle proposée par l’historiographie nationale et nationaliste du XIXe siècle, elle permet de repenser des récits nationaux et locaux de l’histoire des années 1800-1815. S’interroger sur les conséquences durables de la conquête napoléonienne à l’échelle de l’Europe signifie poser la question des effets spatiaux de cet « événement ». Sans vouloir jongler avec les mots, on pourrait se demander dans quelle mesure « l’épisode » napoléonien a constitué un événement spatial, entendu, selon une définition proposée par Philippe Gentelle, comme « une liaison forte et courte entre un temps et un espace, qui modifie durablement l’organisation d’un territoire dans le cours de sa dynamique » (Gentelle, 2000). L’ambition réelle ou supposée de créer une nouvelle civilisation à l’image de celle née en France avec la Révolution à l’échelle de l’Europe (Chappey, Gainot, 2008) pouvait mettre en cause la diversité et le polycentrisme européen interprétés comme un facteur expliquant la puissance de cette partie du monde depuis la fin du XVe siècle (Grataloup, 2007). La volonté de faire de Paris le centre de l’Europe n’en est que l’un des aspects. D’un autre côté, comme l’a souligné Michael Broers, l’empire napoléonien a eu un espace central, épousant plus ou moins les contours de ce qu’on a appelé la Lotharingie (Cf. le numéro 4 de notre revue et l’éditorial de François Pernot), la dorsale européenne, mais qui en tous cas transcendait les territoires délimités par les frontières nationales actuelles. Et cette centralité ne pouvait se mettre en place que grâce à une certaine prédisposition à accueillir le nouveau régime favorablement. L’entreprise napoléonienne était donc tributaire d’une certaine structure spatiale préexistante, caractérisée par un espace central où la greffe a bien pris et des périphéries récalcitrantes. Cette structure s’observerait d’ailleurs aussi à l’échelle régionale, comme dans l’Italie napoléonienne où des villes situées dans les plaines s’opposaient à des espaces montagneux périphériques (Broers, 2002). Parfois, le pouvoir napoléonien se voyait confronté à une situation paradoxale, comme dans le royaume de Westphalie, où le centre politique et administratif, la ville de Cassel, se situait dans une région, l’ancien électorat de Hesse, qui selon la classification de Michael Broers, devrait être qualifié de périphérie.
La connaissance de l’espace était donc vitale pour le pouvoir napoléonien et non seulement pour la conduite de la guerre comme le montre la campagne de Russie (Boudon, 2012), mais aussi pour inscrire sa domination dans la durée. Admettre l’existence d’un tel centre, hérité du passé et susceptible de devenir le cœur d’une organisation territoriale à l’échelle européenne semble indiquer que l’entreprise napoléonienne ne fut pas complètement chimérique. Cela devrait être gardé en mémoire à l’heure où des forces centrifuges, à la faveur d’une crise économique et de ses séquelles, de tensions liées à des restrictions budgétaires, semblent de nouveau favoriser le renforcement de sentiments identitaires s’inscrivant dans des territoires d’échelle nationale et régionale.
Si Stuart Woolf estimait que la vitalité des sociétés européennes jouait contre ce projet unificateur, de nombreuses résistances ne s’y opposèrent ouvertement qu’à la faveur des défaites françaises. Le problème qui est ouvertement posé ici est celui de la diversité européenne. Le XIXe siècle vit en effet apparaître ou se renforcer des entités territoriales à un autre niveau d’échelle, inférieur à celui d’un espace impérial ou continental, celui des Etats-nations. Si l’idée d’un éveil des nationalismes européens en réaction à la conquête napoléonienne est aujourd’hui de plus en plus contestée – et à notre avis à juste titre – car les motivations nationales dans l’engagement dans les combats contre la France napoléonienne étaient minoritaires et la mobilisation politique ou spontanée « des masses » d’un intérêt militaire secondaire – l’expérience des années napoléoniennes a fourni un thème chère aux historiographies nationales. Les guerres dites de libération allemandes de 1813 ou de la guerre patriotique russe de 1812 en fournissent des exemples. Or, les idées peuvent devenir une force matérielle quand elles saisissent les masses. Cela semble avoir été le cas avec l’émergence des couches sociales dont le l’ascension était liée à l’instruction au courant du XIXe siècle, même si tous leurs représentants n’adhéraient pas aux idéologies nationalistes.
Indépendamment de l’intérêt que présente l’étude d’héritages spatiaux, la géographie de l’Europe napoléonienne est d’une certaine utilité pour l’historien et surtout fournit une documentation exceptionnelle. En considérant la production d'une géographie historique qui s'entend comme une reconstitution de géographies du passé, on se rend vite compte que non seulement la date mais aussi l'échelle d'observation choisie est imposée par l'état de la documentation. La reconstitution de la géographie de l’Angleterre de la fin du XIe siècle n’a ainsi été que possible que grâce au Domesday Book de 1086. Des cartes à l’échelle de l’Angleterre entière ne furent dessinées que pour des époques postérieures de plusieurs siècles à la géographie du Domesday Book, grâce aux sources fournies par des recensements comme celui réalisé pour la levée de la poll tax de 1377. Selon le phénomène auquel on s'intéresse, on en est réduit à l'étude aux échelles nationales, voire régionales. Cette restriction scalaire s'oppose à la nature de la méthode géographique elle-même qui a pour spécificité de jouer sur l'articulation des échelles. Prendre de la hauteur de vue permet d'ailleurs de relativiser l’ampleur des phénomènes et de mettre à distance des effets de sources, c’est-à-dire du risque de généraliser des phénomènes apparaissant, au hasard des trouvailles archivistiques, dans les sources administratives.
Les grandes conquêtes, l'apparition d'empires éphémères, malgré le cortège de difficultés qu'apporte généralement la guerre, ont ceci de bon qu'elles homogénéisent souvent la documentation à une échelle largement supranationale. La conquête napoléonienne nous fournit un exemple de la production d'une telle documentation relativement uniforme permettant d'envisager une géographie européenne du début du XIXe siècle. Les nouveaux maîtres s'approprient l'espace en prenant d'abord un grand nombre d'informations sur les domaines les plus divers. Les mémoires descriptifs, répondant à des questionnaires de plus en plus uniformisés, rédigés par les intendants ou gouverneurs militaires de chaque province occupée, contiennent aussi un nombre d'informations d'intérêt militaire. Différents corpus documentaires permettent aujourd’hui, à des degrés divers, des territoires, avec leurs sociétés, leurs économies et leurs cultures, à une échelle supranationale, au regard des entités politiques actuelles. A son apogée, l’Empire français comprenait 134 département couvrant, outre le territoire de la France dans les frontières de 1792, les territoires de l’actuelle Belgique, des Pays Bas, de l’Allemagne à l’ouest du Rhin, puis de l’Allemagne du Nord jusqu’à la Baltique. La documentation rassemblée par les intendants de l’armée au-delà des frontières de l’Empire français, conservée en partie dans les archives privées accessibles aux Archives nationales, comme celles laissées par Pierre Daru, permettent d’étudier la géographie de cette Europe traversée par les armées et décrites par des administrateurs et ingénieurs-géographes français.
Mais alors que l'engouement pour la statistique à l'époque impériale a intéressé les historiens depuis la fin des années 1970 (Bergeron , 1981), la production de données cartographiables qui a résulté de ce travail de recueil d'informations a relativement peu donné lieu à des reconstitutions de géographies dépassant le cadre national. Cependant une documentation relativement homogène, synchrone et assez centralisée existe pour une bonne partie des territoires occupés par les armées de l'Empereur, en particulier pour les territoires réunis directement à l'Empire ou gouvernés par des parents de Napoléon. Utilisées pour mesurer par exemple l'écart dans la taille moyenne des communes entre le territoire de l’ancienne France et les territoires annexés (Dunne, 2002), la documentation volumineuse rassemblée par l’administration centrale de l’Empire français a été exploitée plus récemment dans le cadre de la vaste étude d’Aurélien Lignereux sur les rébellions et l’emprise de la gendarmerie, adoptant le cadre de cet Empire français des 130 départements (Lignereux, 2012). Emboîtant, dans sa démarche de donner une vision panoramique, le pas à Michel Vovelle (Vovelle, 1992), sa cartographie fondée sur l’analyse quantitative des rébellions et de leurs motivations fait apparaître des ensembles géographiques qui transcendent les frontières nationales actuelles, tant pour les aires de résistance à la conscription que pour celles de sa relative acceptation.
Les contributions de ce numéro s’inscrivent dans ces problématiques et apportent des éclairages nouveaux sur ces thèmes en proposant des regards sur des territoires où certains de ces thèmes méritaient une étude approfondie.
D’abord, la question de l’unification. Culturelle et économique, sa dimension la plus palpable par le chercheur fut administrative. Si l’exportation du modèle administratif français fut loin d’être linéaire et uniforme, un certain nombre de réformes territoriales furent réalisées. Ainsi, Maria-Luisa Sturani met en lumière, d'une façon très précise et fondée sur une cartographie précieuse, la réorganisation territoriale du Piémont à l’époque napoléonienne, illustrant à merveille cette révolution territoriale initiée en France au début de la Révolution et transposée dans les territoires annexés et, dans une certaine mesure, dans les Etats organisés à la française. Si l’on suit l’auteur, l’apport durable de cette réorganisation fut moins la permanence des circonscriptions territoriales, comme les départements, les districts ou arrondissements, les cantons et les communes, et des limites précises qu’elles reçurent au début du XIXe siècle, que l’héritage d’un principe d’organisation fondée sur la cohérence des unités administratives, faisant table rase des structures émiettées de l’Ancien Régime.
L’étude d’Aurélien Lignereux s’inscrit dans la géographie des perceptions en s’interrogeant sur l’effet qu’eurent les bouleversements successifs et les revirements politiques et militaires sur la perception de l’espace des Français. À la vision d’empire et d’Europe des dirigeants politiques, étudiée plus récemment, il propose d’ajouter celle des populations. A cet effet, appuyé sur sa connaissance fine des sources d’archives administratives et policières, il suggère un certain nombre de pistes de recherche très stimulantes pour appréhender l’apprentissage de l’espace impérial par les populations intégrées à la mouvance française. Interroger le contenu des rumeurs et de leurs circulations sur ce qu’elles nous apprennent sur la connaissance de l’espace des Français s’avère un domaine de recherche fécond. Surtout, il comble une lacune importante en étudiant l’enseignement de la géographie à l’époque du Premier Empire, non seulement selon les textes reglementaires mais aussi dans ses pratiques, montrant comment la vision impériale de Napoléon se diffusait parmi les couches sociales moyennes.
Hansjoerg Küster montre dans son article que les guerres de 1813/14 influencèrent durablement les conceptions de la foresterie allemande. Sans négliger l’histoire des forêts allemandes antérieure à Napoléon, il explique que le sentiment national allemand, renforcé par la gallophobie consécutive aux guerres de 1813/14, ait à long terme influencé la conception de la sylviculture allemande. D’abord, l’époque napoléonienne aurait donné naissance à l’idée de créer des forêts le long de la frontière française afin de servir de rempart à l’envahisseur, ensuite l’augmentation des surfaces boisées a été motivée en partie par la conviction que les Français – un peuple « latin », comme les Romains – auraient les mêmes difficultés à pénétrer la forêt allemande que les légions de Varus. La forêt – et notamment la forêt de conifères – occupait ainsi une place particulière dans l’imaginaire allemand et l’enrésinement aurait ainsi des causes bien spécifiques, liées, à côté des considérations économiques, à l’expérience des guerres napoléoniennes. Hansjörg Küster nous rappelle que l’utilisation des statistiques historiques et des cartes anciennes est souvent difficile, en raison de définitions variables de la forêt. En effet, le taux de couverture et la hauteur des arbres pris en compte aujourd’hui pour définir une forêt nous obligeraient sans doute de classer bien des taillis qualifiés à l’époque de forêt dans la catégorie des formations végétales basses et ouvertes, à moins de ne disposer d’études précises que celle de Xavier Rochel, qui permettent de se faire une idée de la physionomie des forêts anciennes.
Napoléon et ses administrateurs ont pourtant eu l’ambition d’appréhender l’empire à l’aide de statistiques répondant à certaines exigences d’uniformité et qui permettent de saisir, dans une certaine mesure, la géographie du moment napoléonien, de même que la volonté de Guillaume le Conquérant, soucieux de faire décrire son royaume nous fournit une source extraordinaire pour connaître la géographie de l’Angleterre du XIe siècle. Utilisée par les géographes à l’échelle régionale (Husson, 1988), la statistique des bois propres à la marine, étudiée à l’échelle de l’Empire français par Nicola Todorov, permet de comprendre les contraintes que faisait peser la répartition des ressources sur les décisions stratégiques de Napoléon dans son programme de reconstruction de la marine après Trafalgar, à l’exemple des arbres de chêne.
Bien d’autres aspects mériteraient d’être éclairés par des enquêtes systématiques, notamment sur les effets régionalement très inégaux de la guerre économique qui opposait l’Europe napoléonienne à l’Angleterre qui était en train d’impulser une nouvelle phase de la mondialisation. L’histoire du monde aurait-elle évolué différemment si l’unification napoléonienne relative de l’Europe avait duré ? Si les empires conduisant à l’uniformisation et à la perte de la diversité, et donc de richesse, ils libèrent aussi les forces économiques. Hécatombe linguistique, l’empire romain des premiers siècles de notre ère fut aussi une période de croissance économique que l’Europe mettra longtemps à recouvrer après la chute de Rome.
Que cette diversité européenne n'ait pas disparu est certain. Mais cela rend aussi l’étude de géographies du passé plus difficile en raison de la dispersion de la documentation. Cela est illustré à merveille par la contribution de Haik Thomas Porada, dans la rubrique des varia, mais qui appuie l’idée énoncée plus haut du moment privilégié que représente l’époque napoléonienne pour une étude à l’échelle continentale. Dans certains territoires ayant appartenu à l’empire de Napoléon, le centralisme céda la place au fédéralisme, comme en Allemagne. Haik Thomas Porada nous éclaire sur le développement d’outils précieux pour effectuer une géographie historique sérielle à l’échelle régionale. Une étude à l’échelle « nationale », c’est-à-dire à l’échelle de l’Allemagne fédérale est une affaire quasi impossible. L’inventaire et la collecte d’informations géographiques se sont développés essentiellement dans le cadre des Länder et les structures institutionnelles aussi bien que la forme et le contenu des enquêtes différaient, parfois même au sein d’un même Land. L’histoire de l’Allemagne après 1945 semble aussi expliquer la structuration et l’avance accomplie dans les Länder ayant appartenu à l’ancienne RDA. Ces données spatiales ne concernent pas que la géographie historique, mais montrent bien que l’échelle d’analyse imposée au géographe du passé est largement tributaire des décisions politiques et administratives et partant des ambitions des régimes politiques, fussent-ils de courte durée. Le géographe du passé devrait donc profiter de l'ambition unificatrice de Napoléon et de ses serviteurs.
Références bibliographiques
Bergeron, L. (dir.), 1981, La statistique en France à l'époque napoléonienne, Courtrai, J. Touzot, 194 p.
Bertaud, J.-P., 2014, Napoléon et les Français, Paris, Armand Colin, 344 p.
Boudon, J.-O., 2000, L'Histoire du Consulat et de l'Empire, Paris, Perrin, 512 p.
Boudon, J.-O., 2012, Napoléon et la campagne de Russie 1812, Paris, Armand Colin, 333p.
Broers, M., 2005, The Napoleonic Empire in Italy, 1796-1814, Cultural Imperialism in a European Context ?, New York, Macmillan,
Broers, M., 2003, « The Myth and Reality of Italian Regionalism ; A historical Geography of Napoleonic Italy, 1801-1814 », The American Historical Review, 108, p. 688-709.
Broers, M., 2014 (2e édition), Europe under Napoleon, New York, Tauris, 291 p.
Broers, M., Hicks, P., Guimerá, A. (dir.), 2012, The Napoleonic Empire and the New European Political Culture, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 332 p.
Bourguinat, N., Venayre, S., 2007, Voyager en Europe de Humboldt à Stendhal. Contraintes nationales et tentations cosmopolites, 1790-1840, Paris, Nouveau monde éditions, 546 p.
Chappey, J.-L., Gainot, B., 2008, Atlas de l’empire napoléonien. 1799-1815. Ambitions et limites d’une nouvelle civilisation napoléonienne, Paris, Editions Autrement, 80 p.
Dwyer, P.G., Forrest, A. (dir.), 2007, Napoleon and his empire. Europe, 1804-1814, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 228p.
Dunne, J., 2002, « L’Empire au village : les pratiques et le personnel de l’administration communale de l’Europe napoléonienne », in : Martin, J.-C. (dir.), Napoléon et l’Europe. Colloque de la Roche-sur-Yon, Rennes, PUR, p. 45-54.
Gentelle, P., 2000, « La Chine ou le malaise en périphérie », L’information géographique, vol. 64, p. 193-219
Grataloup, C., 2007, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du Monde, Paris, Armand Colin, 265p.
François, A., Jourdan, A., Jessenne, J.-P., Leuwers, H., 2014, L’Empire napoléonien, une expérience européenne ? Armand Colin, 492 p.
Lignereux, A., 2012, L’Empire des Français, 1799-1815, Seuil, 419p.
Lignereux, A., 2012, Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814), Champ Vallon, 398p.
Petiteau, N., Olivier, J.-M., Caucanas, S., 2012, Les Européens dans les guerres napoléoniennes, Toulouse, Privat, 287 p.
Petiteau, N., 2008, Les Français et l'Empire, 1799-1815, Paris, La boutique de l'histoire - éditions de l'université d'Avignon, 278 p.
Petiteau, N. (dir.), 2006, Conflits d’Empire, Cahiers du GERHICO, n° 9, textes rassemblés par Natalie Petiteau.
Vovelle, M., 1993, La découverte de la politique. Géopolitique de la révolution française, Paris, éditions de la découverte, 368 p.
Woolf, S., 1991, Napoleon’s integration of Europe, Londres, Routledge, 319 p.
Editorial : la forêt et ses marges. Autour de la biogéographie historique : outils, résultats, enjeux. | Publié le 2014-01-17 22:00:42 |
Par Jean-Pierre Husson et Xavier Rochel, Université de Lorraine
1. Forêt et espaces dits naturels : des enjeux forts pour la géographie historique
La biogéographie historique a parmi ses objectifs celui de tenter de restituer des paysages anciens, de tisser du continuum entre le passé et l’actuel, de modéliser des scénarios d’évolution de la végétation. Ceux-ci s’avèrent presque toujours heurtés et incomplets si les sources archivistiques et de terrain manquent, ou sont trop peu explicites. Néanmoins, cette posture scientifique se révèle souvent utile pour replacer dans un cadre temporel large la gestion actuelle des espaces dits naturels ; elle se place par exemple en amont des investigations entreprises en écologie du paysage, autour des questions de trame verte.
Longtemps restée en marge et discrète, cette spécialité concernait peu les auteurs francophones, à l’exception presque exclusive des chercheurs qui travaillaient à l’échelle du massif forestier, bel objet géographique s’il en est. Gérard Houzard (1) avait été un des pionniers les plus en vue parmi ceux qui tracèrent le chemin de cette quête assez délicate à problématiser, à la croisée de différentes disciplines (géographie, histoire, écologie du paysage, phytosociologie, botanique, etc.). Outre-Manche, l’approche des massifs forestiers, de leur histoire et des paysages associés était le fait d’un autre grand pionnier, Oliver Rackham (2), dont les recherches allaient rapidement prendre un écho considérable.
Les chercheurs concernés avaient alors trop peu l’habitude de se rencontrer, d’échanger des points de vue et des résultats, enfin de confronter leurs outils, leurs méthodes, leurs objectifs. La fondation du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (G.H.F.F.) en 1980, à l’initiative commune de l’historien Denis Woronoff et du géographe Georges Bertrand notamment, apporta aux chercheurs concernés la structure de soutien et la tribune de publication qui leur manquaient. Le jubilé du G.H.F.F. en février prochain sera d’ailleurs l’occasion de célébrer ce moment fort de l’étude pluridisciplinaire des milieux dits naturels en France. Sur un terreau devenu fertile dans les années 1980, études et publications poussèrent avec vitalité autour du domaine de la forêt, des marges et lisières, et également des objets associés : bosquets, linéaires arborés, ripisylves ; en somme, tout ce qui entre désormais sous le vocable « trame verte » (3). La démarche n’était pas purement académique ; elle répondait à des interrogations fortes. Elle était portée par des enjeux actuels tels que les effets attendus des variations climatiques ou le problème des tempêtes ; elle fut portée également, un peu plus tard, par les gains de productivité scientifique apportés par l’usage des SIG. Les questions posées s’affinèrent, s’orientèrent en particulier vers les territoires flous, d’entre-deux, qui bénéficiaient des recherches théoriques et appliquées des précurseurs quantitativistes.
2. La forêt, le saltus, deux notions antagonistes ou imbriquées ?
Ce numéro de la Révue de Géographie Historique offre une tribune à ce thème désormais entré dans une approche mature, partagée et comprise de tous. La forêt, sylvosystème largement anthropisé, ne se comprend que dans le cadre des liens ou synapses qui relient les espaces forestiers, les marges floues, et les terres du finage définies par une occupation agricole plus ou moins continue. On voit là apparaître la très (trop ?) traditionnelle trilogie ager, saltus, sylva.
Espace flou et concept incertain, le saltus se conçoit de deux façons. La définition traditionnelle, probablement toujours la plus courante, y voit d’abord une réalité agronomique. Cette acception est dans la droite ligne de l’utilisation historique du terme par les Latins. Le saltus est une sorte d’entre-deux ni abandonné à l’arbre, ni totalement intégré au finage cultivé, et dont la vocation est surtout, mais non exclusivement, pastorale, comme l’établit Georges Bertrand dans sa contribution à l’Histoire de la France rurale : « Le saltus et l’espace pastoral ne se recouvrent pas exactement. Le saltus représente l’ensemble des terrains qui ne sont pas régulièrement cultivés et qui n’ont pas de couvert forestier continu et fermé ». Parfois écobué, pour éviter l’embroussaillement ou pour permettre la mise en place épisodique de cultures de marge, il est « le royaume du feu ». Le saltus est d’abord un lieu de pâture, de cueillette, de prélèvements divers, où les apports améliorants sont inexistants ou rares ; il est donc appauvri, voire oligotrophe. Logiquement, Georges Bertrand n’intègre donc pas les prairies (dans le sens agronomique du terme) au saltus.
D’autres chercheurs ont tenté d’actualiser le terme de façon à le faire correspondre au mieux à certaines questions contemporaines (4). Ceci les mène à intégrer au saltus les prairies, les prés-bois, ainsi que certaines parcelles arborées. L’acception large ainsi défendue se justifie par les problématiques actuelles en matière de biodiversité et d’écologie du paysage, et leurs prolongements dans les politiques publiques. Le saltus rassemble alors non plus ce qui est en réserve, pastoral, exploité extensivement, appauvri, mais plutôt ce qui, dans l’espace agricole, semble suffisamment biodiversifié, hétérogène en termes de structures paysagères. L’approche est plus écologique et paysagère qu’agronomique. Dans cette acception, le saltus rassemble finalement les catégories d’occupation du sol que les politiques publiques souhaitent défendre face aux dangers supposés de la grande culture. Dans une société qui fait ce qu’elle peut pour sauver ses surfaces enherbées, peut-on encore grouper la prairie dans la même catégorie que l’orge, le colza ou le maïs ?
Aujourd’hui comme autrefois, beaucoup d’espaces rentrent donc avec difficulté dans une catégorie bien définie d’occupation du sol. Les hésitations sur les seuils statistiques définissant la forêt dans différentes régions du monde devraient pourtant faire réfléchir, montrer que les climats et les sols comme l’activité des hommes génèrent des paysages d’entre-deux où se mêlent le boisé, l’arboré, le buissonnant, l’herbacé ; le naturel, l’anthropique ; l’agricole, le pastoral, le sylvestre. En (bio-) géographie historique, la question de la place du saltus vaut d’être posée car elle est incertaine dans l’espace et mouvante dans le temps. Par le passé, la connivence entre les différentes composantes du finage était forte, inscrite dans les pratiques agraires, avec des lisières effilochées, du vide et du plein mêlés que l’Ordonnance de 1669 peina à séparer malgré la ténacité du corps forestier à faire appliquer ce texte. Les pratiques agraires en forêt étaient multiples ; le sartage ardennais en est un exemple emblématique.
Le caractère incertain de la délimitation dans l’espace se doublait d’évolutions constantes qui font des forêts et de leurs marges des paysages mouvants, bien loin du caractère « naturel » immuable qu’on leur attribue parfois. Dans sa définition habituelle d’entre-deux, le saltus était un espace de respiration. Par le jeu de forces opposées, il était menacé sans cesse par le défrichement (et donc son intégration à l’ager) ou par le reboisement. Ce dernier pouvait s’opérer par reconquête naturelle débutée à partir de lambeaux de haies, de bosquets, d’espaces envahis par des peuplements frutescents. Plus souvent, la reconquête était faite par reboisement artificiel.
Les missions LIDAR, la mise en SIG des cartes et plans anciens font donc découvrir des configurations de massifs et d’espaces ouverts fort différentes de l’actuel, et très dynamiques dans le temps (5). Aujourd’hui, le saltus semble ne plus avoir plus de sens dans nos systèmes agricoles dominants peu économes, qui font peu de cas du principe de réserve foncière, et qui achèvent de bannir l’extensif. Néanmoins, dans le contexte de la reconnaissance portée aux marges des mosaïques (les unités agro-physionomiques des agronomes), un intérêt renouvelé se porte sur ces territoire reconnus dans les textes du Grenelle.
3. De la diversité des approches sur le lien entre les forêts, leurs lisières et les marges
Ce numéro thématique est organisé autour de cinq articles centrés sur la problématique principale, un article en varia, un compte rendu de thèse et la présentation de trois ouvrages en rapport avec le sujet. Ce contenu tend à démontrer la complexité du lien qui associe les forêts, leurs lisières et les marges dessinées en espaces bien identifiés ou à l’inverse flous. Le texte de Jean-Pierre Husson invite à cadrer ce sujet et nous éclaire sur les évolutions prises par ces typologies de contacts établis dans des approches multiscalaires. Il s’agit d’une suite de propos liminaires confirmant la nécessité à travailler ensemble, en réseau, en maintenant un même cap pour des disciplines qui désormais se connaissent et utilisent des outils disponibles complémentaires autour de cette question des marges. Celle-ci a du sens et elle offre des argumentaires pour travailler sur le lien entre le foncier et son occupation, sur les dynamiques spatiales, sur les expositions aux regards des zones de contacts positionnées entre des lieux ouverts et fermés.
Xavier Rochel montre comment les forestiers de l’Epoque Moderne eurent l’obsession de cadrer territorialement un espace forestier qui leur semblait trop mal défini pour être bien défendu et bien géré. Lors des opérations de reprise en main des bois communaux, ils établirent des limites fixes et matérialisées, ainsi qu’un parcellaire destiné à être le cadre immuable d’un véritable aménagement forestier. A côté des coupons affouagers, régulièrement exploités, le « quart en réserve » était le lieu d’une accumulation de capital en bois destiné à parer les éventuels coups durs matériels ou financiers subis par la communauté. L’examen des registres de martelages nuance l’image de cette belle idée qui ne fut qu’imparfaitement réalisée.
Les trois auteurs suivants déclinent le sujet des marges du finage dans des études de cas régionalisées. Tout d’abord, Sylvain Olivier approche sur un pas de temps de quatre siècles les oscillations entre infield et outfield dans le Lodévois à propos de l’exploitation du genêt d’Espagne, plante spontanée ou cultivée qui permettait de produire des fibres textiles rustiques. Alexandre Verdier étudie le magnifique terrier de l’abbaye de Gorze (Moselle) dressé entre 1746 et 1749 dans le but de faire l’inventaire d’un vaste temporel foncier. La précision et l’exhaustivité du dossier ouvrent de nouveaux champs d’investigation sur l’évolution des systèmes d’openfield et leurs marges, en particulier avec ce qu’il subsiste des pelouses sèches situées sur les hauteurs des fronts de cote. Ensuite, Stéphane Blond analyse, à partir des cartes routières de l’atlas de Trudaine dédiées à l’ancienne généralité de Metz (Trois-Évêchés), les liens qui unissent les routes et les espaces boisés au XVIIIe siècle.
Enfin, Jérôme Froger apporte une note d’exotisme à ce numéro en donnant un témoignage original : l’affichage par Thomas-Etienne Boldgerd d’un début de conscience écologique dans les écrits que cet homme d’affaire nous laisse à propos de l’équilibre agro-forestier à l’île Maurice à l’extrême fin du XVIIIe siècle.
Notes :
HOUZARD Gérard. 1980. Les massifs forestiers d’Andaines et Ecouves. Alençon, Société Historique et Archéologique de l’Orne, 2008 (réédition), Mémoires et documents N° 6, 2 tomes, 208 p. + plans hors texte
RACKHAM Oliver. 1976. Trees and Woodlands in the British Landscape. Londres : Phoenix Press, 2002 (réédition), 234 p. RACKHAM Oliver. 1989. The last Forest : the story of Hatfield Forest. Londres : Dent & sons, 301 p.
Il faut également signaler l’existence plus récente du G.H.Z.H. (Groupe d’histoire des zones humides) qui affiche des objectifs proches de ceux poursuivis par le G.H.F.F.: aborder de façon systémique un espace à la croisée de l’histoire et l’écologie.
POUX X., NARCY J-B., RAMAIN B. 2009. Le saltus : un concept historique pour mieux penser aujourd’hui les relations entre agriculture et biodiversité. Courrier de l’environnement de l’INRA n° 57, juillet 2009. POUX Xavier, NARCY Jean-Baptiste, RAMAIN Blandine. 2009. Réinvestir le saltus dans la pensée agronomique moderne : vers un nouveau front eco-politique ?, L'Espace Politique [En ligne], 2009-3, consulté le 16 avril 2012. URL : http://espacepolitique.revues.org/index1495.html
HUSSON Jean-Pierre, ROCHEL Xavier (sous la direction de). Le massif forestier objet géographique. Revue géographique de l’Est, 2009, vol. 49, [en ligne], consulté le 16 avril 2012. URL : http://rge.revues.org/1914.
Editorial: la géographie historique des paysages de l'Allemagne | Publié le 2013-06-05 11:03:48 |
Par Michel Deshaies (Professeur des universités en géographie à l'Université de Lorraine) et Nicola Todorov (enseignant dans l'académie de Rouen, docteur de l'Université, chargé de cours à l'Université de Rouen)
En choisissant de consacrer notre deuxième numéro à la géographie historique des paysages allemands, nous pensions attirer l’attention sur une tradition de géographie historique bien ancienne et plus solidement structurée qu’en France. Ainsi, à côté du rôle pionnier de la géographie historique anglo-saxonne, l’étude de l’Allemagne était l’objet de plusieurs communications au colloque de 2002 « Où en est la géographie historique ?» se proposant pour objectif une refondation de la géographie historique française (Boulanger, Trochet, 2005).
La genèse des paysages constitue incontestablement un centre d’intérêt essentiel de la géographie historique. En Allemagne, ce souci d’explication des paysages actuels à travers la compréhension de l’évolution historique a acquis précocement une dimension quasiment existentielle dans la mesure où, dans ce pays tardivement unifié, la question de la définition des contours de l’Allemagne est restée longtemps un problème insoluble. Dès la dernière décennie du XIXè s. et plus encore durant les années précédant la première guerre mondiale, différents savants allemands recherchent les origines de la dense trame de villages qui se déploient à travers l’Europe centrale. Scrutant les formes de ces villages, tantôt linéaires ou arrondis, tantôt groupés en tas, ils cherchent à établir des liens entre les caractéristiques des paysages ruraux et les groupes ethniques ou culturels qui les ont façonnés. Ainsi pensent-ils pouvoir délimiter un territoire anciennement germanique et le différencier des territoires occupés par leurs voisins slaves. Si cette approche a pu parfois être instrumentalisée, à l’image de la géopolitique, elle n’a pas été autant discréditée que celle-ci dans la mesure où l’étude de la genèse des paysages a continué à répondre à des questions essentielles pour la société allemande.
Il ne faut en effet pas sous-estimer l’ampleur des bouleversements survenus en Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale : les villes et leur patrimoine historique anéantis par les bombardements, le territoire bouleversé et réduit, le pays divisé en deux États rivaux, des millions d’Allemands chassés de leur Heimat pour se réfugier sans espoir de retour. Tout ceci compose le tableau d’une société de déracinés, pour laquelle il est d’autant plus nécessaire de se rattacher à un passé que l’on cherche à reconstituer, à l’image des reconstructions des villes médiévales ou baroques et des monuments historiques les plus symboliques. Dans ce contexte, la recherche du passé à travers l’analyse de la genèse des paysages comme produits d’une culture et d’une évolution historique conserve sa pertinence. C’est pourquoi, même contestée à la fin des années 1960 par l’irruption des préoccupations sociales, la compréhension de la genèse des paysages est restée un sujet d’intérêt majeur, quitte à ce que les travaux de recherche soient réalisés en partie en dehors de la géographie, notamment par des archéologues et des historiens.
A y regarder de près, on s’aperçoit en effet que la recherche allemande en géographie historique est confrontée en partie aux mêmes problèmes que la nôtre. Les contributions à ce numéro fournies par les chercheurs allemands en témoignent. Comme le souligne Winfried Schenk, la géographie historique allemande s’est vue exposée aux critiques portant sur l’utilité de sa démarche. D’où l’orientation délibérée vers une géographie historique appliquée. Mais Jean-Robert Pitte, fervent défenseur d’une approche historique en géographie, n’écrit-il pas à juste titre en 2005 : « Elle [la géographie historique] doit aussi se préoccuper de son utilité sociale contemporaine au même titre que les autres démarches scientifiques. Si elle n’aboutit pas, directement ou indirectement, à un mieux-être pour l’humanité, elle disparaîtra, d’ailleurs comme toute la géographie » ? (Pitte, 2005)
Ce deuxième numéro de la revue de géographie historique rassemble cinq contributions qui proposent des éclairages variés sur la géographie historique des paysages de l’ Allemagne. Deux articles sont proposés par des chercheurs allemands et deux autres par des chercheurs français, tandis que le cinquième article est le fruit d’une collaboration franco-allemande ; si bien qu’il y a parité entre les chercheurs des deux pays ayant participé à ce numéro.
Il nous a semblé heureux de commencer ce numéro par un article de Winfried Schenk qui est actuellement le chercheur allemand ayant eu la plus grande activité en géographie historique. Il brosse un tableau de la genèse et de l’évolution de la géographie historique germanique, particulièrement centrée sur l’explication de la genèse des paysages en tant que produits d’une histoire et reflets d’une culture. Winfried Schenk montre aussi comment cette géographie historique traditionnelle a dû s’adapter à la suite de la remise en cause de l’utilité de sa démarche, notamment lors du congrès national de géographie (Geographentag) à Kiel en 1969. La géographie historique germanique a ainsi développé deux stratégies qui lui ont permis de préserver son champ de recherche. D’une part, elle s’est insérée dans des recherches pluridisciplinaires rassemblant des archéologues et des historiens travaillant au sein d’un groupe intitulé ARKUM (Arbeitskreis für historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa/groupe de recherche sur l’histoire du paysage en Europe centrale). D’autre part, elle est restée au sein de la géographie en développant des recherches appliquées qui trouvent leur utilité dans les préoccupations contemporaines d’aménagement et de préservation des paysages. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’a été réalisée l’étude sur le cours de la rivière Unstrut dont Mathias Deutsch et Tobias Reeh rendent compte dans leur article. Observant minutieusement les différents aménagements réalisés depuis le Moyen-âge, les auteurs montrent l’importance des transformations effectuées dès la fin du XVIIIè s., notamment pour rendre le cours d’eau navigable. Mais c’est surtout pour gagner de nouvelles terres agricoles dans le lit majeur du cours d’eau et pour les protéger des inondations que les principaux ouvrages sont réalisés au cours des XIXè et XXè s. Plusieurs phases d’aménagements se succèdent au gré des catastrophes générées par les inondations qui révèlent à plusieurs reprises l’insuffisance des ouvrages de protection contre les crues. Il en résulte un cours de l’Unstrut considérablement simplifié et enserré de levées, physionomie devenue commune pour la plupart des cours d’eau en Allemagne, comme l’a montré l’historien américain, David Blackbourn dans son ouvrage The conquest of the nature (1).
C’est bien d’une conquête de la nature dont il s’agit avec le paysage des polders de la mer du Nord étudiés par Lydie Goeldner-Gianella et Martin Döring. Ce paysage construit de toutes pièces par l’homme grâce à un patient travail d’endiguement, a ceci d’original qu’il semble être immuable et figé, alors que le trait de côte a connu de considérables changements jusqu’à l’époque contemporaine. Les surfaces conquises sur la mer sont ainsi à plusieurs reprises submergées par de grandes tempêtes qui, en l’espace d’une journée, anéantissent des siècles d’effort. Pourtant, après chaque catastrophe, les surfaces perdues sont reconquises avec une remarquable persistance. En fait, ce n’est qu’à la fin du XXè siècle que cet effort séculaire de conquête s’interrompt et que se pose alors la question de laisser la nature et en l’occurrence la mer reconquérir certains polders. Les efforts des hommes sont dirigés vers une autre forme de conquête, celle de l’énergie récoltée par les très nombreuses éoliennes, dont les polders sont devenus au cours de la dernière décennie, la plus grande zone de concentration en Allemagne. Ce développement massif de l’éolien semble marquer une rupture profonde avec les paysages de polders aux vastes horizons et aux lignes horizontales, dans la mesure où des machines dépassant 100 m de hauteur imposent des lignes verticales devenues presque omniprésentes. Une autre lecture permet d’y voir une certaine continuité dans un paysage entièrement façonné par la technique, puisqu’aucun élément de ce paysage n’aurait pu exister sans l’emploi des techniques d’endiguement.
La technique est aussi omniprésente dans la genèse des paysages des Monts métallifères présentés par Michel Deshaies. Comme beaucoup de massifs de moyenne montagne (le Mittelgebirge) en Allemagne, les Monts métallifères ont attiré le peuplement grâce à la découverte au Moyen-âge de richesses minières, en particulier l’argent. Celles-ci, très importantes dans ce massif qui y a gagné son nom, n’ont pu être exploitées que par la mise au point de techniques de plus en plus élaborées pour extraire le minerai et surtout évacuer l’eau, toujours susceptible d’inonder les puits et les galeries de mine au fur et à mesure qu’elles s’enfonçaient en profondeur. C’est en définitive tout un paysage qui a été façonné directement ou indirectement par l’exploitation minière et les activités proto-industrielles de fonte et de transformation des métaux. Ce paysage devenu fossile depuis l’arrêt complet de l’exploitation minière est aujourd’hui considéré comme un patrimoine à protéger et à mettre en valeur à travers la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Comme le souligne Winfried Schenk, la géographie historique allemande est restée assez réfractaire à la reconstitution des géographies sociales du passé, ce qui montre bien le poids des cultures scientifiques nationales et ceci en dépit des circulations scientifiques anciennes qui ont contribué elles-mêmes à façonner les paysages. Mathias Deutsch et Tobias Reeh insistent bien sur le transfert des savoirs dans le domaine du génie hydraulique entre la France et l’Allemagne, que l’on pourrait facilement retrouver dans le domaine militaire ou encore forestier. La richesse et l’originalité de la recherche allemande se sont aussi manifestées dans le développement de la géomorphologie, qui demeure un élément essentiel de l’explication des paysages. Etudiant le sort réservé aux théories d’Albrecht et Walther Penck sur la genèse du relief de la Forêt Noire, Christian Giusti, montre comment des chercheurs allemands proposent des théories alternatives respectivement à celles des pénéplaines soulevées et du geographical cycle, mais aussi comment leurs idées sont rejetées par les partisans de la théorie de Davis. Le contexte historique est ici encore essentiel pour comprendre ce rejet, mais il pose d’une manière plus générale la question des enjeux du débat scientifique et du développement des disciplines, influencé largement par les pressions exercées par les sociétés. La « réhabilitation » implicite des théories des Penck, dont certaines idées se trouvent au cœur de la hillslope geomorphology et de la tectonic geomorphology, peut cependant apparaître comme source d'optimisme, car elle prouve bien que des concepts féconds, rejetés au moment de leur élaboration pour des raisons au moins en partie extrascientifiques et les préoccupations parfois trop utilitaires du moment, peuvent prendre leur revanche et occuper la place qui leur revient. Nous espérons que tel sera le sort de la géographie historique paysagère et générale.
Michel Deshaies et Nicola Todorov
Note :
(1) David Blackbourn (2006). - The conquest of nature. Water, Landscape and the Making of Modern Germany, Jonathan Cape (Random House), London, 590 p.
Penser le monde au XVIe siècle : acteurs, savoirs et projets | Publié le 2020-11-01 10:57:59 |
Par Carrio Cataldi (Newton International Fellow, Departmental office Foster Court, London)
Résumé : Au XVIe siècle, la cartographie a constitué une modalité privilégiée de production d’images du monde en Europe, et de représentation de l’extension universelle de monarchies, telles l’espagnole et la portugaise. En dialogue avec une historiographie qui a mis l’accent sur les nouvelles échelles géographiques de ces représentations, cet article souligne la dimension sociale et matérielle de la fabrique cartographique, pour mieux comprendre l’émergence, au moment de l'apparition des premiers atlas modernes, d’une cartographie régionale par laquelle saisir le Nouveau et le Vieux Monde.
Mots-clés : empires ibériques, cartographie, Benito Arias Montano, Juan de Ovando, Jerónimo de Chaves, Andalousie, Floride
Abstract: During the 16th century, cartographical knowledge was a privileged modality of producing images of the world in Europe, and representing the universal extension of the Spanish and Portuguese monarchies. In discussion with a historiography that has emphasized the new geographical scales of these representations, this article highlights the social and material dimension of cartographic knowledge production. By so doing, I argue, we can better understand the emergence, at the time of the first modern atlases, of regional maps depicting the New and the Old World.
Keywords: Iberian empires, cartography, Benito Arias Montano, Juan de Ovando, Jerónimo de Chaves, Andalusia, Florida
Introduction
L’historiographie en histoire moderne a mis en avant, ces dernières décennies, un ensemble de propositions théoriques et méthodologiques par lesquelles parvenir à rendre compte d’une « conscience de globalité » des acteurs du passé ainsi que des dynamiques historiques dites « globales » en cours depuis le XVIe siècle. Une historiographie très hétérogène s’était donné la tâche d’étudier depuis tout type de globe-trotters, de go-betweens et d’arpenteurs de cabinet capables de parcourir la Terre et de penser sa sphéricité, plume en main ou sur le pont d’un bateau. Sous forme d’interrogation, il a été également souligné l’écart possible et le péril d’une connexion linéaire entre penser le monde comme un globe au XVIe siècle et l’expérience du processus contemporain de globalisation : « “Penser le monde”. Mais qui le pense ? Les hommes du passé ou les historiens du présent ? » (Chartier, 2001).
Dans le sillage de l’élan insufflé par l’histoire atlantique, l’étude de l’expansion de l’empire espagnol au XVIe siècle a représenté un riche chantier de renouveau historiographique grâce auquel nous pouvons emprunter les routes du grand large. Les différences entre les Couronnes espagnole et portugaise ayant été reléguées à un deuxième plan, ce sont leurs points en commun – l’expérience sociale, culturelle et politique profondément transformatrice d’un empire d’outre-mer – qui sont davantage soulignés. Les empires « ibériques » peuvent être ainsi identifiés comme un « champ d’observation » (Gruzinski, 2001) de la modernité définie dorénavant par le développement d’une pensée et d’une expérience du globe.
Pour une historiographie en histoire des sciences tournée à l’origine vers l’Atlantique du monde hispanique, « science » a été le mot clé pour analyser comment — c’est-à-dire, par quels moyens intellectuels et matériels — les acteurs des deux Couronnes ont pensé le monde. En s’appuyant et en enrichissant une importante production historiographique de longue tradition en Espagne et au Portugal, les « Iberian science studies » ont proposé de questionner, ces dernières années, la chronologie et la géographie de l’ancien paradigme de la « Révolution scientifique ». L’article programmatique de Cañizares-Esguerra (Cañizares-Esguerra, 2004) pourrait être considéré comme une des premières références d’un effort collectif fortement ancré dans l’académie américaine, de plus en plus hétérogène (History of Science 2, 52, 2017), qui a revendiqué la réintroduction de l’espace « ibérique » dans les grands récits historiographiques de l’histoire des sciences.
C’est ainsi que, par le déplacement chronologique et spatial d’une enquête sur la Modernité, les empires ibériques peuvent être revisités comme un cadre fertile pour explorer une « nouvelle conscience spatiale » (Besse, 2005) dans son rapport au globe comme construction géographique et à la « première mondialisation » comme processus historique.
Le présent article s’inscrit dans un dialogue avec cette riche historiographie en proposant de discuter la construction des images du monde et la constitution du savoir cosmographique dans le cadre de la monarchie hispanique au XVIe siècle. Il n’endosse pas, cependant, le paradigme interprétatif d’une « Révolution scientifique » dont l’idée d’une progressive mathématisation de la représentation de l’espace a fortement orienté l’histoire de la cartographie. Il ne prend pas non plus pour acquis qu’une dimension « globale », se rapportant soit à l’expérience du monde comme un globe au XVIe siècle, soit à sa représentation cartographique, est une échelle d’analyse univoque des contextes du moment impérial étudié. En revanche, je souhaite discuter ici ces approches en me focalisant sur l’analyse des modalités de construction d’une cartographie du monde à partir de l’exemple des circulations entre deux espaces de la monarchie des Habsbourg — les Pays-Bas et la péninsule Ibérique — et de l’hétérogénéité d’approches en cours au XVIesiècle. Les questions d’une échelle régionale de la cartographie et du rapport entre représenter le Nouveau et le Vieux Monde retiendront mon attention1.
II. Sous la surface des cartes : circulations, échelles, projets
La cartographie a constitué une modalité cruciale, mais non exclusive, de représentation et d’exploration du monde du XVIe siècle. Dans le contexte de la monarchie des Habsbourg, cette construction de l’image du monde et de son expérience par la carte a été bâtie sur des circulations d’objets et d’informations. Celles-ci ont été motivées par des acteurs liés à des structures sociales et de pouvoir d’un empire ancré dans des dynamiques politiques et culturelles propres des sociétés d’Ancien régime. Le caractère composite des territoires de la monarchie (Elliott, 1992; Cardim et al., 2012), avec des fidélités qui se juxtaposent et des hiérarchies inscrites au cœur d’une société de privilèges, a été le cadre dans lequel un ensemble hétérogène de projets politiques et épistémologiques ont forgé des images du monde déclinées, à leur tour, en échelles différentes.
La correspondance entre deux figures cruciales de la politique, de la culture et des politiques culturelles de cette période, Benito Arias Montano (1527-1598) et Juan de Ovando (1514-1575), offre la possibilité de saisir les enjeux sociaux, matériels et techniques de cette construction tout comme son caractère conjoncturel, lié aux itinéraires personnels qui la rendent possible (Jiménez de la Espada 1891; Macías Rosendo 2008). Arias Montano, théologien chapelain du roi Philippe II, philologue renommé et bibliothécaire de l’Escorial (1576) (Rekers 1972 ; Portuondo 2019), entretient une riche correspondance avec le juriste Ovando, inspecteur (1567-1571) puis président du Consejo de Indias (1571). Ce dernier est également responsable des réformes du Consejo qui donneront lieu à la création du titre de cosmographe-chroniqueur des Indes(1571-1590), et à de grands projets de recompilation d’informations, entre autres, géographiques, comme les Relaciones geográficas de las Indias (Schäfer 1947; Stafford 2004 ; Portuondo 2009).
Depuis son arrivée aux Pays-Bas, où Arias Montano se rend pour développer le projet d’une Bible polyglotte avec Christophe Plantin (1520 ?-1589), le philologue écrit régulièrement à Ovando. Leur intense correspondance témoigne d’un important axe de circulation de divers objets entre les Pays-Bas et la péninsule Ibérique. Parmi ceux-ci, l’historiographie n’a pas manqué de signaler les instruments fabriqués par deux personnages considérés comme centraux par l’histoire de la cartographie : Gemma Frisius (1508-1555) et Gérard Mercator (1512-1594) (Villaverde, 1997, 76)2. Il importe ici, en revanche, d’explorer davantage les circuits, les péripéties et la nature de ces circulations humaines et matérielles. De ce point de vue, la lettre envoyée par Arias Montano lorsqu’il arrive en Flandre en 1568 est très riche en informations.
Parti de Laredo, ville au nord de la péninsule, le 22 avril 1568, Arias Montano n’arrive que le 16 mai dans le comté de Flandre. Une tempête, écrit-il, a compliqué ce court voyage et le bateau a dû accoster en Irlande. Arias Montano a traversé ce territoire en six jours, de « Yoghol » (Youghal,)3 jusqu’à Dublin, où il a repris la mer pour aller à « Cester » (Chester), en Angleterre. Puis, il a voyagé de Cester à « Dobla » (Dover), où il s’embarque vers Calais, port à partir duquel il continue par voie terrestre jusqu’à Anvers, sa destination finale. Les difficultés de voyager à l’époque moderne ne sont pas toujours proportionnelles à la distance parcourue. Pendant ce temps, écrit Arias Montano en mettant l’accent sur les nombreux ennuis de son périple, il a navigué sur trois mers et a été même forcé de remonter à contre-courant une rivière sur quinze lieues (Lettre 14 juin 1568).
Dès son arrivée à Anvers, Arias Montano prend contact avec Ovando. Il lui propose de lui envoyer des livres de théologie et d’astrologie, des descriptions géographiques, des peintures de paysages, des objets d’art ainsi que des instruments d’observation et de mesure. Il affirme qu’il aurait souhaité rédiger lui-même des « descriptions » de son voyage, car, écrit-il, peu d’Espagnols se sont déjà rendus dans les territoires que l’orage l’a obligé à sillonner. Quant aux cartes, quoique dans une lettre postérieure datant de 1569 il sera question d’une mappemonde, l’intérêt premier d’Arias Montano ne semble pas porter sur des descriptions de l’ensemble du monde. Comme il l’écrit, il s’intéresse aux « particularités des provinces ». Son intérêt pour la description et la représentation des territoires va de pair avec celui pour les moyens instrumentaux permettant d’en rendre compte. Arias Montano semble avoir acheté, très rapidement après son arrivée à Anvers, des globes célestes et terrestres fabriqués par Gemma Frisius et Gérard Mercator. Mais dans son courrier, il porte également son attention sur un astrolabe qu’il a acquis chez un artisan de Louvain. De très grande taille et de qualité, explique-t-il à Ovando, le seul problème de cet instrument est qu’il n’a de tables que pour des « régions septentrionales » et une « générale pour toute la terre ». Le philologue souhaite, en revanche, l’employer pour des régions précises de l’Espagne. C’est pourquoi il a demandé de dresser des tables pour l’Andalousie et l’Estrémadure, afin de rendre l’instrument opérationnel dans ces régions et à ces échelles. En effet, comme la plupart des instruments de mesure et d’orientation dépendant du calcul des latitudes pour leur fonctionnement, les astrolabes aussi doivent être calibrés et adaptés à leur contexte d’utilisation — en changeant leur « tympan », notamment (Maroto et Piñeiro 2006, 244).
Ces questionnements d’ordre technique sont, dans l’échange entre les deux hommes, aussi centraux que la question du prix, de la matérialité et des circuits choisis pour faire parvenir les objets des Pays-Bas en Espagne. De ce point de vue, livres, cartes, instruments, pièces d’art et articles de luxe font l’objet du même traitement. De cette correspondance émerge également de façon claire la raison qui explique le sens de ces circulations, principalement des Pays-Bas vers l’Espagne. Aux yeux d’Arias Montano, le rapport qualité-prix est définitivement plus avantageux à Anvers et ses alentours qu’en Espagne. Concernant les livres, dans cette même lettre de juin 1568, le rôle de Plantin, qui lui permet de trouver ce dont il a besoin et au meilleur prix, est décrit clairement. Les livres sont très bon marché, explique Arias Montano à partir d’exemples précis de certains volumes en papier — la reliure n’est pas prise en compte —, en comparaison avec les prix des livres en Espagne. Il en va exactement de même pour les instruments cités dans la lettre (l’astrolabe, une sphère de métal, un anneau astronomique) qu’Arias Montano achète ou demande de fabriquer à Louvain.
La manière de faire parvenir ces objets en Espagne est, à grands traits, la suivante. Arias Montano dresse et envoie à Ovando une liste de prix de livres, d’instruments et d’autres objets qui pourraient l’intéresser. Une fois que ce dernier a exprimé ses préférences et qu’Arias Montano en a fait l’achat, ces objets sont envoyés par mer, jusqu’à Laredo, Biscaye ou directement au sud de la péninsule « grâce aux nombreuses urcas qui de Flandres abordent Séville » (Lettre du 31 mars 1570 ; Macías Rosendo, 2008, 204‑9). Parmi les points reliés et mentionnés dans l’échange épistolaire, on trouve Anvers, Medina del Campo, Madrid, Séville, Salamanque ou, encore, la foire de Francfort. La correspondance met également en lumière un ensemble d’intermédiaires qui permet d’acheminer ces produits ainsi que les frontières et douanes à franchir ou à essayer d’éviter. Si Arias Montano conseille à Ovando de demander un « passeport » (pasaporte) pour que ses commandes circulent sans problème, il pense également qu’elles ne seront pas taxées au port s’il indique bien qu’elles sont pour lui. Ovando, dans le même esprit, propose une solution pour éviter le paiement de droits, de dîmes ainsi que de l’enregistrement de ses commandes. Sur le brouillon d’une lettre d’Ovando à Arias Montano on peut lire que ses « caisses » devront être marquées avec une croix grecque, symbole par lequel on reconnaîtra Ovando comme le destinataire. Quant au paiement, Arias Montano suggère qu’il pourrait se faire par différents agents de la monarchie comme Jerónimo de Curiel, des membres de la cour ou par le biais des Sévillans ou des Génois qui sont sur place (Lettre 14 juin 1568 ; Jiménez de la Espada, 1891).
Une description plus étendue et une analyse détaillée de cette correspondance ne pourraient qu’enrichir la diversité de détails que fournissent ces quelques éléments cités en amont, tirés principalement d’une des premières lettres d’Arias Montano à Ovando. L’observation lors des voyages — de longue ou courte distance —, la description, ainsi que la circulation et l’accumulation d’informations, de livres et d’instruments sont autant d’opérations, mécanismes et outils qui se côtoient dans une réflexion et mise en image du monde au XVIe siècle. Par-là même, l’éventail d’acteurs et d’intermédiaires différents qui sont engagés dans cette construction, l’hétérogénéité des projets déployés ainsi que la labilité des savoirs dans lesquels ils s’inscrivent sont des éléments à retenir dans l’analyse.
Comme l’échange entre Arias Montano et Ovando le suggère, la production cartographique qui saisit l’empire des Couronnes ibériques est construite par et pour des circuits d’acteurs qui opèrent à l’intérieur ou en rapport à des structures de patronage et de pouvoir de la monarchie des Habsbourg. Ces circulations articulent une multiplicité d’échelles qu’il faut mettre en exergue. Celles-ci sont à comprendre ici comme un enjeu technique et épistémologique de représentation de l’espace sur la surface d’un livre ou d’un parchemin, alors que l’écoumène s’étale, pour la monarchie espagnole et portugaise, jusqu’aux limites du globe. Mais toute échelle comporte également un enjeu social et politique dans la mesure où ce rapport entre l’espace et sa représentation repose sur une expérience humaine du monde et sur la capacité des acteurs à la transformer en connaissance cartographique.
Cette tension entre le « tout » à représenter et les moyens techniques et sociaux pour le faire parcourt les différents projets et réflexions sur le monde et ses parties en tant qu’espaces géographiques à l’époque moderne. La mappemonde de Mercator, à laquelle Arias Montano fait allusion dans sa lettre du 23 décembre 1569 en est un bon exemple. Malgré la description succincte que le philologue en fait, il s’agit très probablement d’une copie de la carte Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emendate accomodata (dont un exemplaire est conservé à la Bibliothèque Nationale de France, Paris, GE A-1064 RES), parue la même année à Duisbourg, dans le duché de Clèves, où Mercator s’est installé depuis 1552. L’exploit technique de cette carte, souvent souligné par l’historiographie (Alves et Leitão, 2013), est de proposer une projection pour représenter l’ensemble du monde sur une surface plane en gardant une déformation constante de ses parties de telle sorte que toute courbe tracée sur la sphère devient une ligne droite sur le plan (D’Hollander 2005). Mais au-delà de cet aspect technique et formel, la carte est un véritable collage d’informations et de sources médiévales et modernes qui font preuve de l’insertion de Mercator dans un réseau intellectuel et politique lui permettant de mobiliser une vaste quantité de ressources. Comme il est indiqué dans les cartouches, la mappemonde est le résultat d’un effort pour vérifier les positions, les dimensions et les distances grâce à une comparaison des « cartes marines des Espagnols et des Portugais » avec « la plupart des récits de navigation, tant imprimés que manuscrits » (trad. Bureau hydrographique international, 1932).
Malgré l’apparence d’homogénéité que l’application du réticule des coordonnées géographiques dessine sur les cartes, et dont la mappemonde de Mercator représente un aboutissement, toute image cartographique du monde se construit par des fragments annexés ou juxtaposés, articulés les uns aux autres grâce à un ajustement des échelles. C’est ainsi que peut s’opérer le passage de l’expérience et de l’information géographique, toujours locales et localisées, à l’expérience cartographique des parties du monde, et du monde comme un globe. Les rapports entre l’une et l’autre redéfinissent constamment tout jalon intermédiaire, telle l’idée de « province » ou de « région », européenne ou non, qui s’installe dans la cartographie européenne du XVIe siècle. La maîtrise de la géographie et de la nature de certains territoires, mers ou montagnes de l’Europe reste, de fait, aussi complexe que celle des lointaines terres outre-mer (Bourdon, 2011).
III. Les fabriques cartographiques du Vieux et du Nouveau Monde
Dans le sillage des entreprises culturelles de l’humanisme, la renaissance de différentes traditions géographiques, telles celles représentées par Ptolémée et Strabon, qui donnent un nouveau souffle à la cosmographie au XVIe siècle, constitue un cadre commun pour l’exploration du « vieux » continent. Cet aspect est mis également en relief dans les échanges épistolaires entre Arias de Montano et Ortelius. Le 10 avril 1591, Arias Montano répond à Ortelius en lui remerciant pour l’envoi des cartes de l’Espagne, de la Chine, de Valence et de la Floride. Il lui propose, en échange, de lui faire parvenir une « méditation » (mediationem) d’un ami chanoine qui pourrait servir pour la carte de l’Espagne. Arias Montano contactera également cet ami au sujet des noms des lieux de « Celtiberia » que Ortelius lui a demandé (Morales, 2002). Le processus et les mécanismes de sa mise en image et en récit sont concomitants à ceux du Nouveau Monde. Ils redéfinissent ainsi la place et les dimensions — comme Mercator l’indique dans sa carte — de chacune de ces masses de terre sur l’orbe. Les références aux cartes et aux astrolabes régionaux dans la correspondance d’Arias Montano-Ovando doivent être comprises dans ce sens. L’intérêt explicite du premier pour des instruments adaptés à la tâche de cartographier l’Andalousie et l’Estrémadure est un autre indice pour soutenir l’hypothèse, suggérée par l’historiographie, que ce serait son retour dans la région de Séville qui aurait permis l’impression de la première carte de l’Andalousie dans le Theatrum orbis terrarum d’Abraham Ortelius (Rica 1988, 248).
Preuve de l’existence des circulations dans le sens inverse, c’est-à-dire, de la péninsule Ibérique vers les Pays-Bas, la carte de l’Andalousie est signée par Jerónimo de Chaves. Jerónimo et son père, Alonso, obtiennent, en 1552, deux des plus importants titres à la Casa de la Contratación, celui de responsable de la chaire de cosmographie et de pilote majeur, dont les fonctions de correcteur des cartes et examinateur des pilotes varient au long du siècle. Ils les acquièrent grâce à la capitalisation de leurs connaissances et de leur expérience dans la production de cartes et d’instruments que l’expansion impériale de la Couronne a transformée en opportunité économique ouverte à une hétérogénéité d’acteurs aux profils sociaux et intellectuels très divers. C’est ainsi le résultat d’un rapport de forces sociales entre différentes factions du microcosme sévillan pour contrôler une partie de ce marché (Carrió Cataldi, 2015).
Depuis cette position privilégiée, Jerónimo de Chaves s’adonne à la rédaction de plusieurs traités et cartes. Sa carte de l’Andalousie est répertoriée dans le catalogue d’auteurs collaborant au travail d’Ortelius dès l’édition de 1573 du Theatrum, pour n’être publiée que six ans plus tard, dans l’édition de 1579, ou peut-être pour être insérée en 1580 dans l’Additamentum II (Rica, 1988, 248). C’est dans la même édition que paraîtra une deuxième carte du cosmographe sévillan, celle de la Floride, accompagnée d’une carte de la région du Pérou (Peruvviae auriferae regiones typus), signée par Diego Hurtado de Mendoza et du « Huasteca » (Guastecan), partie orientale de la Nouvelle Espagne.
Le réseau Séville-Anvers et le projet cartographique d’Ortelius s’inscrivent, de fait, dans un contexte d’efforts multiples de représentation du Vieux et du Nouveau Monde en cours tout au long de l’époque moderne. Depuis le début de l’expansion maritime de la Couronne espagnole, des voyageurs d’autres royaumes européens parcourent ou publient sur la géographie de la péninsule ibérique, les différences des peuples, les particularités des terres et de la flore et de la faune. Parmi d’autres exemples, on peut citer le voyage d’Hieronymus Münzer en Espagne et Portugal (1494-1495) à partir duquel Münzer rédige son Itinerarium, ou celui de Charles de l’Écluse (1564-65) qui lui servira pour rédiger son Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia (Anvers, Plantin, 1576). À la même époque, des cosmographes comme Alonso de Santa Cruz travaillent sur la correction des tables anciennes et de la cartographie des régions péninsulaires (Domingo Cuesta, 2004). C’est dans ce sens qu’un chroniqueur royal comme Juan Páez de Castro (1515-1570) (Cortijo Ocaña, 2000) conseille, dans son Memorial de las cosas necesarias para escribir la Historia, d’entreprendre une description de l’Espagne :
Il sera nécessaire de parler des choses de l’Espagne, faire une description de son ensemble, en suivant la mer, le mont, les rivières et les langues. Après [il faudra] les diviser dans ses parties principales selon la mémoire la plus ancienne […]. Jusqu’à arriver aux temps bienheureux de VM [Votre Majesté] quand ce sera ouvert un très grand champ en sortant de l’Espagne […] et par sa grandeur on s’étendra non seulement sur une bonne partie de notre Europe et de l’Asie et de l’Afrique où les armes et les étendards de VM sont arrivés, mais [aussi] sur les Mondes découverts auxquels les anciens n’ont pas crus. On dessinera un nouveau ciel jamais vu auparavant, une nouvelle terre jamais imaginée, avec toute l’extravagance [« extrañeza »] qu’elle a. Où on ne trouvera pas de choses semblables aux nôtres. De nouveaux arbres, des herbes et des terres, des oiseaux et des poissons. Nouveaux hommes, coutumes et religions. De grands événements de la conquête et de la possession de ce qui a été conquis.
“Sera necesario hablar de las cosas de España, hacer una descripcion de toda ella siguiendo la marina, y monte, y rios y lenguas. Despues dividirlas en las partes principales segun la memoria mas antigua [...] hasta que vengamos a los bienaventurados tiempos de VM donde se nos abrira un grandisimo campo saliendo de España […] y por su grandeza dilataremos nos no solo a mucha parte de nuestra Europa y Asia y Africa donde han llegado las armas y estandartes de VM, pero a los mundos descubiertos no creidos de los antiguos […] Pintaremos nuebo cielo nunca visto de nuestros pasados, nueba tierra nunca imaginada con la extrañeza que tiene. Onde no hallaremos cosa que parezca a las nuestras. Nuevos arboles, hierbas tierras, abves y pescados. Nuevos hombres, costumbres y religion. Grandes acontecimientos en la conquista y en la posesion de lo conquistado”. (Juan Páez de Castro, Memorial de las cosas necesarias para escribir la Historia, Archivo privado del Prior del Real Monasterio del Escorial, ms. Q-18. J’utilise ici la copie tardive du XVIIIe siècle de la BNE, MSS/18637/1, Sala Cervantes, fol. 18v-19r.)
La proposition de Páez de Castro d’une inscription des espaces impériaux dans une géographie (historique) et une histoire naturelle dans la lignée de Pline et de Strabon fait de l’Espagne et de ses parties le préambule de la connaissance de l’Asie, de l’Afrique et du Nouveau Monde. La démarche implique, précise Páez de Castro plus loin, de fouiller activement des registres de notaires, de bibliothèques de collèges, de monastères et d’abbayes, ou encore une recherche généalogique sur les gouverneurs de ces empires, ce que différents acteurs mèneront dans les territoires de la monarchie tout au long du XVIe siècle (Ibid, fol., 20r). C’est par ce même geste que ces territoires sont inscrits dans le temps et dans l’espace d’une monarchie qui pense et ambitionne l’universalité de son extension en parallèle à celle du christianisme.
Suite à l’initiative de Páez de Castro, le lancement du grand projet des Relaciones geográficas de Indias (1569) (Clinton, 1969) pour compiler une grande diversité d’informations sur le Nouveau Monde aura comme conséquence l’enrichissement des « archives géographiques » que la monarchie est en train de construire. Cet élargissement se place dans la continuité par rapport aux Relaciones topográficas du territoire, des villes et de l’histoire péninsulaire mis en place auparavant et sur laquelle l’historiographie n’a guère insisté (Campos y Fernández de Sevilla, 1994). La « nouveauté » des Indes et de l’image du monde comme un globe formé de quatre parties que cette diversité d’acteurs et projets construisent ne se produit pas en rupture avec les nombreuses modalités, déjà existantes, du saisissement du monde. Elles s’installent dans le prolongement, l’adaptation et le remaniement d’anciens modèles qui travaillent également la cartographie du Vieux continent.
Les différences résident cependant dans le rapport entre les espaces représentés et des dynamiques impériales qui sont, bien entendu, distinctes. Les cartes de la Floride et de l’Andalousie de Jerónimo de Chaves n’ont pas, au XVIe siècle, la même connotation étant donné leur différent degré d’intégration à la structure de la monarchie et à son histoire. L’Andalousie se situe aux limites d’une Méditerranée explorée depuis l’Antiquité alors que la Floride représente une porte ouvrant sur un nouveau continent encore à conquérir. Toutefois, les deux territoires se placent dans la succession, non linéaire, d’une logique de conquête territoriale et spirituelle où l’Andalousie est l’ancienne frontière religieuse et politique de la « Reconquista » et la Floride une nouvelle « saltwater frontier » (Turner Bushnell, 2012), au cœur de nouvelles logiques impériales.
Tout en prenant en compte ces asymétries historiques et les difficultés pour déterminer avec précision les sources de Jerónimo de Chaves pour la réalisation de ces deux cartes, il faut s’accorder sur le fait que la rapide circulation d’informations géographiques sur le Nouveau Monde est concomitante à une reconnaissance du Vieux Monde encore en cours au XVIe siècle. L’Archivo Gerenal de Indias et celui de Simancas conservent des manuscrits témoignant de ce processus d’exploration de la côte ibérique, notamment de sa partie sud, vers la moitié du siècle. Rédigés avec un caractère technique et descriptif — probablement pour une circulation et utilisation interne —, ils répondent à différents besoins et situations : essentiellement, à un contexte défensif face à la peur des révoltes des morisques et des corsaires barbaresques (, à une volonté de synthétiser la connaissance des accidents géographiques et des ports lors du siège de la cité de Calvi par les troupes françaises et ottomanes, ou encore à la nécessité d’améliorer la connaissance de la côte entre le cap São Vicente et Gibraltar (Muñoz Gómez, 2014)4.
Ce qui dans le Vieux Monde relève d’une stratégie défensive vaut comme stratégie offensive dans le Nouveau Monde : la carte de la Floride est une cartographie d’exploration et d’occupation, fortement axée sur la possibilité de pénétration par les rivières, « couloirs » de tout continent (Benton, 2010). Aux publications disponibles sur les difficultés des expéditions en Floride telles celles menées par Pánfilo de Narváez (décrite en 1542 par Cabeza de Vaca), ou celle d’Hernando de Soto (Fidalgo de Elvas, 1557), il faut ajouter d’autres sources cartographiques qui permettent d’intégrer ces nouveaux espaces pour les sociétés européennes dans une réflexion plus générale sur les proportions et les parties du monde (González, 1979 ; Williams et Lewis, 1993Cumming et De Vorsey, 1998 ; González Díaz et Lázaro de la Escosura, 2008). Les études sur la cartographie de la région ne permettent pas cependant de préciser avec exactitude les sources de cette carte signée par Chaves et publiée par Abraham Ortelius (Delanglez, 1944, 1945 ; True, 1954 ; Cumming, 1963 ; Kelley, 1990). Les possibilités sont nombreuses : la carte « Mapa de Golfo y Costa de la Nueva España », connue comme « Mapa de Soto » et attribuée à Alonso de Santa Cruz (Archivo General de Indias, MP-MEXICO,1, [1544]), par exemple, ou celle du père de Jerónimo de Chaves, Alonso, aujourd’hui perdue, mais mentionnée par Gonzalo Fernández de Oviedo (Delanglez, 1945, 2). Michael Gannon semble suggérer également que de Soto aurait pu se baser sur un manuscrit d’Alonso de Chaves pour déterminer le meilleur endroit pour débarquer (Gannon, 1996, 26). Enfin, demeure l’hypothèse d’une juxtaposition et d’un réaménagement de plusieurs de ces sources à la fois.
Ici, il est sans doute intéressant de souligner que dans le Theatrum d’Ortelius les deux cartes de Chaves participent à l’installation de l’idée de « région » au sein d’un dispositif visuel qui s’ouvre par une image de ce nouveau « tout » qu’est la Terre pour se décomposer aussi vite page après page, en ses parties. De l’autopsie du voyage à l’espace de l’érudition, en passant par cet espace de création qu’est le réseau d’informations (Besse, 2013), la Floride et l’Andalousie font partie d’une même expérience cartographique.
Conclusion
L’historiographie a accordé une primauté presque exclusive à la dimension spatiale de la réflexion sur le monde au XVIe siècle et aux représentations cartographiques du globe, avec l’intégration, dans les cartes et les imaginaires, d’un continent inconnu des sociétés européennes. Parmi les raisons les plus importantes qui expliquent cette perspective se trouvent, certainement, le changement radical qu’a impliqué, pour certains groupes sociaux, l’élargissement spatial de leur horizon de vie, ainsi que le défi de placer cette extension sur des représentations en parchemin ou en papier.
Une analyse des mécanismes sociaux et intellectuels de la fabrique cartographique du monde, comme celle que cet article propose autour des figures de Benito Arias Montano, Juan de Ovando et Jerónimo de Chaves, met en évidence plusieurs éléments fondamentaux qui sont à rappeler. D’une part, l’étude des circulations qui rendent possible la construction des savoirs sur le monde, et la cartographie, parmi ses nombreuses expressions, ne peut que s’inscrire dans les dynamiques hiérarchisées des sociétés d’Ancien régime. D’autre part, l’émergence de nouvelles échelles de représentation s’est réalisée en parallèle de la redéfinition de jalons intermédiaires permettant d’osciller du local au global par l’annexion, la juxtaposition ou le réaménagement de fragments du monde. La correspondance entre Arias Montano et Ovando ainsi que les deux cartes de Jerónimo de Chaves publiées dans le Theatrum d’Ortelius permettent de souligner les dynamiques des réseaux participant à ce type de projets au sein de la monarchie des Habsbourg. L’importance des cartes régionales et les défis d’adaptation des instruments permettant leur réalisation sont des aspects à reconsidérer dans une historiographie sur les empires ibériques prise par les récits du global.
La diversité des acteurs impliqués dans cette entreprise ainsi que leurs formations premières (respectivement un juriste, un théologien, un maître en arts dans le cas d’Ovando, d’Arias Montano et de Jerónimo de Chaves) nous préviennent des difficultés de toute généralisation sur ceux-ci et sur les liens entre « savants » et « savoirs ». Si la cosmographie a pu porter une proposition de description de la totalité du cosmos en regroupant des connaissances et des pratiques – cartographiques, entre autres –, c’est en partie grâce au profil social et intellectuel de ses pratiquants qui reste très ouvert tout au long du XVIe siècle.
L’analyse de ces éléments invite à une double réflexion historiographique finale. Tout d’abord, sur le clivage entre l’histoire coloniale et l’histoire européenne que la montée de l’histoire globale, ces dernières années, n’a pas réussi à dissoudre complétement. Cela explique, entre autres, l’attention asymétrique que l’historiographie a portée aux cartes de Jerónimo de Chaves. La nouveauté de sa carte de la Floride a été retenue comme celle d’un projet isolé, sans lien possible avec sa carte de l’Andalousie et le reste de son travail. Deuxièmement, elle incite à continuer à questionner le rapport entre cartographie et cosmographie, dont l’historiographie a longuement assumé que la première pouvait couvrir, au moins dans le cas des empires ibériques au XVIe siècle, le périmètre intellectuel de la deuxième.
Notes :
1. Une première version de cet article a été soumise en 2017. Il est basé sur des recherches menées dans le cadre d’une bourse de séjour à la John Carter Brown Library, en 2016, et sur une partie mon travail de thèse doctorale, en cours de publication (Carrió Cataldi, 2015)
2. Pour une discussion plus large sur la circulation de produits culturels à l’intérieur de la monarchie hispanique voir (Aram et Yun-Casalilla, 2014).
3. Marcos Jiménez de la Espada identifie cependant « Yoghol » avec Galway. Macías Rosendo confirme qu’il doit s’agir de Youghal (Jiménez de la Espada 1891 ; Macías Rosendo 2008, 165‑82)
4. Memoria de los puertos y calas que ay desd’el cabo de Palos hasta la punta del Carnero que es junto con Gibraltar y el Estrecho, adonde se pueden abrigar navíos de rremos, fustas y galeras où est décrite la géographie, les ports, les vents, entre autres éléments liés à la navigation, de la côte de Murcia à Grenade ; Relación de los puertos y cavos de la costa de España desde el cavo de Ysuer en Fuenterravía al estrecho de Gibraltar y adelante (ca. 1554) ; Relación de los puertos y barras que ay en la costa dende el cabo de Sant Vicente hasta el cabo de Trafalgar (Documents cités par Muñoz Gómez, 2014).
Bibliographie
Alves, G. et Leitão H., 2013, « Squaring the Circle: How Mercator Constructed His Projection in 1569 », Imago Mundi : The International Journal for the History of Cartography, 66 (1), p. 1‑24.
Aram B. et Yun-Casalilla B. (éd.), 2014, Global goods and the Spanish Empire, 1492-1824: circulation, resistance and diversity, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, Palgrave Macmillan.
Benton Lauren A., 2010, A search for sovereignty : law and geography in European Empires, 1400-1900, Cambridge University Press.
Besse J.-M., 2005, « La géographie de la Renaissance et la représentation de l’universalité », Rivista geografica italiana (5), p. 147‑62.
Besse J.-M., 2013, « Sui passi di Sebastian Münster. Pratiche dello Spazio e Scriturra Geografica nel Rinascimento », Quaderni Storici 142(1), p. 167‑96.
Bourdon Étienne, 2011, Le voyage et la découverte des Alpes : histoire de la construction d’un savoir, 1492-1713, Paris, PUPS.
Bureau hydrographique international (éd.), 1932, Texte et traduction de légendes de la mappemonde originale de Gérard Mercator, publiée en 1569, Monaco, Bureau hydrographique international.
Campos y Fernández de Sevilla F. J., 1994, « Las Relaciones Topográficas de Felipe II : perspectivas de unas fuentes históricas monumentales sobre Castilla la Nueva en el siglo XVI », F. J. Campos y Fernández de Sevilla (éd.), La ciencia en el Monasterio del Escorial, actas del Simposium, 1/4-IX-1993, [Madrid], Ediciones Escurialenses, p. 381‑430.
Cañizares-Esguerra J., 2004, « Iberian Science in the Renaissance: Ignored How Much Longer? », Perspectives on Science 12(1), p. 86‑124.
Cardim Pedro T. H., Ruiz Ibáñez J. J., et Sabatini G. (éd.), 2012, Polycentric monarchies : how did Early Modern Spain and Portugal achieve and maintain a global hegemony?, Eastbourne ; Portland, Sussex Academic.
Carrió Cataldi L. A., 2015, « Temps, science et empire. Conceptions du temps au XVIe siècle dans les monarchies ibériques », Thèse dirigée par Antonella Romano et François Hartog, et soutenue le 16 octobre 2015 à l’EHSS-SNS.
Chartier R., 2001, « La conscience de la globalité », Annales Histoire, Sciences Sociales 56(1), p. 119-123.
Clinton E., 1969. « Mapping by Questionnaire: an Early Spanish Attempt to Determine New World Geographical Positions », Imago Mundi (23), p. 17‑28.
Cortijo Ocaña A. (éd.), 2000, Teoría de la historia y teoría política en el siglo XVI : Sebastián Fox Morcillo, De historiae institutione dialogus. Diálogo de la enseñanza de la historia (1557), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares.
Cumming W. P., 1963, « The Parreus Map (1562) of French Florida », Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography, 17, p. 27‑40.
Cumming W. P. et De Vorsey L., 1998, The Southeast in early maps, University of North Carolina Press.
D’Hollander R., 2005, Loxodromie et projection de Mercator, Paris, Monaco, Institut océanographie.
Delanglez J., 1944, « El río del Espíritu Santo », Mid-America. An Historical Review 26(1), p. 62‑85.
Delanglez J., 1945, El Rio del Espíritu Santo; an essay on the cartography of the Gulf Coast and the adjacent territory during the sixteenth and seventeenth centuries, édité par T. J. McMahon, New York, United States Catholic Historical Society.
Domingo Cuesta M., 2004, « Alonso de Santa Cruz, cartógrafo y fabricante de instrumentos náuticos de la Casa de Contratación », Revista Complutense de Historia de América 30, p. 7‑40.
Elliott J., 1992, « A Europe of composite monarchies », Past and Present 137, p. 48‑71.
Fidalgo de Elvas, 1557, Relaçam verdadeira dos trabalhos q[ue] ho gouernador do[m] Ferna[n]do d[e] Souto [e] certos fidalgos portugueses passarom no d[e]scobrime[n]to da prouincia da Florida [sic]… [Evora], Andree de Burgos.
Gannon M. (éd.), 1996, The new history of Florida, Gainesville, Fla., University press of Florida.
Gautier Dalché P., 2007, « The Reception of Ptolemy’s Geography (End of the Fourteenth to Beginning of the Sixteenth Century ) », D. Woodward (éd.), The History of Cartography, vol. 3‑1, Chicago, Chicago University Press, p. 285‑364.
Gautier Dalché P., 2009, La géographie de Ptolémée en Occident (IVe-XVIe siècle), Turnhout, Brepols.
González J., 1979, Catálogo de mapas y planos de la Florida y la Lusiana, Madrid, Ministerio de Cultura.
Gruzinski S., 2001, « Les mondes mêlés de la Monarchie catholique et autres “connected histories” », Annales, Sciences Sociales (1), p. 85‑117.
Jiménez de la Espada M., 1891, « Correspondencia del Doctor Benito Arias Montano con el licenciado Juan de Ovando », Boletín de la Real Academia de la Historia 19, p. 476‑98.
Kelley J. E., 1990, « The Map of the Bahamas Implied by Chaves’s “Derrotero.” What Is Its Relevance to the First Landfall Question? », Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography 42.
Macías Rosendo B., 2008, La corrrespondencia de Benito Arias Montano con el Presidente de Indias Juan de Ovando : cartas de Benito Arias Montano conservadas en el Instituto de Valencia de Don Juan, Huelva, Universidad de Huelva.
Morales E., 2002, « Las cartas de Benito Arias Montano a Abraham Ortels: edición crítica y traducción a español », Humanistica Lovaniensia: Journal of Neo-Latin Studies 51, p. 153‑205.
Nuñez Cabeza de Vaca Á., 1555, La relacion y comentarios del governador Alvar Nuñez Cabeça de Vaca, de lo acaescido en las dos jornadas que hizo a las Indias [1re éd. Saragosse, 1542], Valladolid, Francisco Fernández de Córdoba.
Muñoz Gómez V., 2014, « “Palabra de marino”: el conocimiento de la costa meridional ibérica a la luz de la práctica de la navegación en la Era de los Descubrimientos (siglos XV-XVI) », En la España Medieval 37, p. 333‑62.
Páez de Castro J., XVIIIe siècle, Memorial de las cosas necesarias para escribir la Historia, Archivo privado del Prior del Real Monasterio del Escorial, ms. Q-18 (copie tardive à la BNE : MSS/18637/1).
Portuondo M., 2009, Secret Science. Spanish Cosmography and the New World, Chicago, University of Chicago Press.
Portuondo M., 2019, The Spanish disquiet : the biblical natural philosophy of Benito Arias Montano, Chicago, Chicago University Press.
Rekers B., 1972, Benito Arias Montano, 1527-1598, London, Leiden, The Warburg Institute, University of London, Brill.
Rica A. H., 1988, « The contribution of Ortelius’ Theatrum to the Geographical Knowledge of Spain », M. van den Broecke, P. van der Krogt, et P. Meurer (éd.), Abraham Ortelius and the First Atlas, Utrecht, HES, p. 239‑62.
Schäfer E., 1947, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, Sevilla, Escuela de estudios hispano-americanos de Sevilla.
Stafford P., 2004, Juan de Ovando : governing the Spanish Empire in the reign of Phillip II, Norman, University of Oklahoma Press.
True D. O., 1954, « Some early maps relating to Florida », Imago Mundi 11(1), p. 73‑84.
Turner Bushnell A., « The Saltwater Frontier: Specialists in Survival », communication dans le cadre de la conference Culturally « La Florida : Spain’s Legacy in the New World », St. Augustine, Floride, Mai 2012.
Vicente Maroto M. I. et Esteban Piñeiro M., 2006, Aspectos de la ciencia aplicada en la España del siglo de oro, 2e éd. Valladolid, Junta de Castilla y León.
Villaverde F. (éd.), 1997, Instrumentos científicos del siglo XVI. La corte española y la escuela de Lovaina, Exposición, fundación Carlos de Amberes, Madrid 26 de noviembre de 1997 a 1 de febrero de 1998, Madrid, Fundación Carlos de Amberes.
Williams J. et Lewis R. E., (éd.), 1993, Early images of the Americas : transfer and invention, Tucson, University of Arizona Press.
Des capitaines de compagnie géographes au XVe siècle ? | Publié le 2020-10-16 17:06:27 |
Par Christophe Furon (agrégé et doctorant en histoire médiévale à l’Université de Paris IV-Sorbonne)
Résumé : L’objectif de cet article est de comprendre, à partir d’exemples, le rapport des capitaines français du xve s. à la géographie. Leur culture géographique est rarement livresque et essentiellement empirique, issue de leurs nombreux déplacements qui les amènent à avoir des connaissances dépassant largement le cadre guerrier. En raison de leur activité militaire, la géographie des capitaines de compagnie est avant tout utilitaire : la connaissance d’un espace sert à remporter une bataille, à prendre une place ou à contrôler une région. Leurs actions et l’usage qu’ils font des territoires et de leur organisation montrent une capacité d’analyse de leur géographie politique, économique, démographique et symbolique. Mais l’impact de leurs pratiques spatiales est très limité dans le temps : l’activité des capitaines consiste essentiellement à s’approprier les territoires avec leurs ressources, ne serait-ce que le temps d’un pillage. L’on est donc loin de la géographie humaniste qui se développe à cette époque.
Mots-clés : France, Moyen Age, capitaine de compagnie, cartographie, humanisme, territoire, frontière, géopolitique, renseignement militaire, pratiques spatiales.
Abstract : The goal of this article is to understand, on the base of examples, the relation of French captains with geography during the 15th century. Their geographical culture is rarely bookish and is primarily empirical, coming from their numerous journeys which induce them to be very knowledgeable beyond their warlike duties. Because of their military activity, the geography of the captains of company is above all utilitarian : the knowledge of a space is useful for winning a battle, taking a place or controling an area. Their actions and their use of the territories and their organization show us an ability to analyse their political, economical, demographical and symbolical geography. But the impact of their spatial practices is very restricted in time : the captains’ activity primarily consist in appropriating territories whith their ressources, sometimes just during a pillage. So we are far from the humanistic geography which is developping at this time.
Keywords : France, Middle Ages, captain of company, cartography, humanism, territory, frontier, geopolitics, military intelligence, social practices.
Dans La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Yves Lacoste insiste sur l’importance du fait militaire dans le développement de la discipline géographique (Lacoste, 1976). Pourtant, en dehors du cas des frontières, les médiévistes se sont peu intéressés au rapport entre guerre et géographie, alors que cette célèbre formule aurait pu stimuler leur réflexion : si la géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, quelle culture géographique avaient ceux qui faisaient la guerre – et non pas seulement ceux qui la décidaient ? C’est à cette question que cet article tente de fournir des éléments de réponse en se concentrant sur les capitaines de compagnie du royaume de France au xve siècle. Il ne prétend pas à l’exhaustivité, le sujet étant vaste et largement inexploré.
Les capitaines de compagnie sont des chefs de guerre exerçant des fonctions de commandement sur un groupe d’hommes – la compagnie – qu’ils doivent payer et loger. Au xve siècle, leur milieu connaît une importante mutation dans le contexte du renforcement de l’emprise royale sur l’armée, notamment avec les réformes militaires de Charles VII dans les années 1440 : la diminution de leur activité de mercenaires au profit d’un service royal de plus en plus exclusif (Contamine, 1972). Les capitaines sont donc des exécutants au service de puissants décideurs mais, lorsqu’ils sont sans emploi, ils se livrent au pillage pour subvenir aux besoins de leurs hommes. Même s’ils appartiennent à la noblesse, ils sont généralement de basse extraction et beaucoup ne savent ni lire ni écrire (Contamine, 1980). Par conséquent, leur culture géographique était certainement différente de celle des rois de France, qui avaient un accès facilité aux livres et étaient dans la nécessité de bien connaître la géographie de leur royaume (Dauphant, 2012). Elle l’était également de celle des humanistes qui, avec la redécouverte d’œuvres antiques, les Grandes Découvertes et la cartographie, permettent à la géographie de devenir une discipline autonome (Gautier Dalché [dir.], 2013, p. 121-158). Il existe donc, à la fin du Moyen Âge, différentes cultures géographiques : Patrick Gautier Dalché a récemment démontré que le développement de la cartographie militaire à cette époque est antérieur à celui de la culture humaniste et n’en est donc pas une conséquence. De même, les nombreux exemples qu’il utilise montrent que les cartes sont, dans le cas français, des commandes royales ou princières et ne disent rien de leur utilisation sur le terrain par les capitaines de compagnie (Gautier Dalché, 2015).
Le développement de la discipline géographique, notamment de la cartographie, et le rôle essentiel du capitaine dans l’organisation militaire au xve s. amènent à s’interroger sur le contenu de la culture géographique de ces capitaines de compagnie qui, pour mener à bien leurs opérations militaires et de pillages, devaient être capables d’appréhender les lieux et les territoires à traverser, à ravager et/ou à conquérir. Il ne faut donc pas limiter l’étude, comme cela est généralement fait pour cette période, à l’histoire des représentations graphiques d’un espace donné (Contamine, 2000 – Gautier-Dalché, 2015) ou aux connaissances sur le monde (Claval, 2001) mais il faut l’étendre aux pratiques spatiales (1) des capitaines de compagnie : il s’agit de tenter de comprendre comment ils percevaient, analysaient et exploitaient les caractéristiques des différents théâtres d’opérations qu’ils étaient amenés à fréquenter, ainsi que l’impact que leur activité pouvait avoir sur l’organisation des territoires.
I. Aux sources du savoir géographique
A. Un savoir livresque limité
Lorsque l’on tente de reconstituer le savoir géographique des capitaines de compagnie, un premier obstacle peut faire renoncer à la tâche : le manque de sources écrites. Très peu nous ont laissé un inventaire de bibliothèque qui pourrait fournir des indications sur leur culture livresque. La principale explication en est l’illettrisme de beaucoup de ces hommes de guerre, qui savent souvent à peine signer (Contamine, 1980). Une deuxième explication tient au coût des livres : même s’il tend à diminuer à la fin du Moyen Âge, il reste élevé. Par conséquent, les capitaines, souvent issus d’une noblesse de basse extraction, ne sont pas en mesure d’en acquérir et, lorsqu’ils le sont, préfèrent montrer leur ascension sociale par l’acquisition de terres plutôt que par la constitution de bibliothèques. Enfin, les hommes de guerre lettrés ne devaient pas disposer de beaucoup de temps libre pour s’adonner au plaisir de la lecture, étant presque continuellement en mouvement.
Toutefois, certains se constituent une bibliothèque, à l’instar de l’amiral Prigent de Coëtivy. Parmi la douzaine de manuscrits dont la possession est assurée, aucun ouvrage de géographie ni récit de voyage : comme c’est généralement le cas pour les bibliothèques nobiliaires, on y trouve des livres d’histoire, des œuvres littéraires, avec une prédilection pour les romans arthuriens, ainsi que des livres d’heures (Harrouët, 1999 – Fourcade, 2015). Certains de ces ouvrages fournissent des indications géographiques mais celles-ci relèvent davantage de l’idéalisation d’un monde antique prestigieux – biblique ou gréco-romain – ou, pour les romans, de la création d’un monde littéraire : il s’agit donc d’une géographie largement fictive qui imprègne l’esprit du lecteur et influence ses représentations du réel. En ce qui concerne Prigent de Coëtivy, il n’a sans doute pas beaucoup consulté ses manuscrits richement décorés, qui avaient principalement une fonction d’ostentation, marquant la réussite d’une carrière militaire au service du roi. Il n’est d’ailleurs par exclu que certains de ces manuscrits aient été des butins de guerre (Harrouët, 1999).
Les ouvrages de géographie sont donc rares dans les bibliothèques de capitaines. Mais ils ne sont pas inexistants, notamment lorsqu’il s’agit de l’Orient. Au xve siècle, l’idée de croisade reste vivante et les projets sont nombreux pour accomplir cet idéal chevaleresque, notamment à la cour du duc de Bourgogne. Ainsi Jean de Wavrin possède-t-il un Recueil d’Orient, qui contient surtout des récits de voyage (2). Le capitaine devenu chroniqueur et diplomate est concerné personnellement par les projets bourguignons de croisade : en 1463, il fait partie de l’ambassade envoyée par le duc auprès du pape Pie II pour discuter d’une croisade contre les Turcs. De plus, son neveu Waleran de Wavrin est en 1444-1445 le chef d’une expédition navale en Méditerranée contre les Infidèles (Naber, 1990). La possession de ce manuscrit est donc liée autant à un intérêt personnel qu’à une volonté de se renseigner pour préparer une croisade contre les Turcs, véritable obsession bourguignonne. Rapporté au total de douze volumes assurément détenus par Jean de Wavrin, ce manuscrit pourrait refléter un intérêt limité pour le sujet mais il ne doit pas être considéré comme sa seule source de renseignements : en 1418, le chroniqueur, qui n’était alors qu’un jeune écuyer, a peut-être fait un voyage en Terre sainte ; de plus, il a eu l’occasion de discuter des affaires orientales avec son neveu.
Outre les romans, les livres d’histoire et les récits de voyage, une autre source d’information géographique peut être constituée par la propagande. Dans un contexte de guerre quasi-permanente, les libelles et traités polémiques sont produits en grande quantité pour soutenir la cause française : ils diffusent des stéréotypes sur l’adversaire, que l’on peut considérer comme une forme de savoir géographique. Au début du xve siècle, le propagandiste Jean de Montreuil dépeint ainsi les Anglais comme des gens cruels et agressifs, attaquant les personnes désarmées et menant « guerre mortele » à tous leurs voisins. Mais le contexte militaire n’explique pas seul cette haine de l’Anglais puisque d’autres peuples, qui ne sont pas ennemis de la France, ne trouvent pas plus grâce à ses yeux : les Allemands ont des mœurs barbares et les Italiens sont fourbes (Grévy-Pons, 1980). Parfois, ce sont de véritables analyses géopolitiques qui sont convoquées pour défendre la cause nationale, comme dans le Débat des hérauts de France et d’Angleterre, composé vers 1455 : pour rabaisser les Anglais, le héraut français met en avant l’échec des Anglais à soumettre l’Écosse, royaume plus petit que celui d’Angleterre, et l’Irlande, pays de « sauvaiges » incapables de « faire resistance de guerre » (Le débat des hérauts d’armes de France et d’Angleterre, p. 22). Cette connaissance des peuples est ainsi teintée de xénophobie et, même si peu de capitaines français ont lu ces textes, ils ont certainement à l’esprit ces stéréotypes forgés et diffusés par la propagande royale. La haine de l’étranger participe ainsi de la construction d’un sentiment d’appartenance à une communauté de destin. C’est ce que l’on décèle dans cette chanson bourguignonne de 1408 sur la levée du siège de Maastricht par le duc Jean Sans Peur :
« S’estoient de no part Flamens,
Henuyers, Picars, Allemans
Et la gent de Bourgongne.
Et sy estoient Champegnois,
Viennois, Artois ensement,
Brabenchons sans eslonge. » (Le Roux de Lincy, 1857, p. 13)
Cette énumération de peuples mobilisés par le duc peut donner le sentiment d’appartenir à une puissance militaire s’appuyant sur un vaste territoire et capable d’employer des hommes d’armes étrangers (Marchandisse et Schnerb, 2015). La propagande, qu’elle soit diffusée par l’écrit ou par l’oral, peut donc être une source d’informations géographiques en ce sens qu’elle véhicule des représentations sur les peuples étrangers et le territoire à défendre et/ou à étendre.
Plutôt qu’un savoir géographique, les capitaines de compagnie ont donc un imaginaire géographique sur le monde, acquis par les rares livres qu’ils possèdent et plus souvent par la propagande. Ne correspondant souvent pas à la réalité et s’appuyant sur une anthropologie teintée de xénophobie, il n’en demeure pas moins un système de représentations sur lequel les capitaines s’appuient pour appréhender le monde et se situer dans celui-ci, en tant que chrétien ou en tant que membre d’une communauté nationale ancrée sur un territoire à défendre.
B. Le renseignement militaire
En revanche, il est nécessaire pour eux d’avoir des connaissances précises sur les territoires qu’ils fréquentent. Les traités militaires insistent sur la nécessité du renseignement avant de mener une opération, surtout pour connaître le nombre et l’état des forces ennemies mais également pour étudier le terrain « car la guerre se faict à l’ueil ; et selon que l’on veoit il se fault gouuerner », comme l’écrit Bérault Stuart en 1502 (Stuart B., 1976 [1502], p. 7). Par conséquent, les traités militaires recommandent de procéder à une collecte de renseignements pour éviter d’être surpris par l’ennemi et anticiper toutes les situations possibles. Pour Christine de Pisan, après la reconnaissance du terrain, le capitaine « le plus secretement quil porra envoiera mettre embusches aux passaiges et par ce sil peult il les [les ennemis] surprendra » (3) : il s’agit de tirer parti des avantages que peuvent procurer les routes étroites, le relief, les cours d’eau, la végétation…
Pour ce faire, les capitaines emploient des espions de tous âges, de tous sexes et de tous états : en 1418, deux valets sont arrêtés à Châlons-en-Champagne après s’être « ventez d’avoir esté audit Chaalons et alez aval la ville, en abis dissimulez, et veu, et sceu l’estat d’icelle » (Registre des délibérations du conseil de ville de Châlons-en-Champagne, p. 58-59). Dans ce cas, la collecte d’informations concerne surtout les défenses et leurs points faibles mais aussi l’organisation des rues pour faciliter les déplacements de troupes à l’intérieur de la ville. À ce propos, Jean de Bueil, auteur du Jouvencel dans les années 1460, recommande de « boucher » les yeux d’un prisonnier quand on le conduit dans une ville (Bueil, t. II, 1889 [1461-1466], p. 13) : à sa libération, il pourrait fournir des informations précieuses sur l’état des défenses et la topographie urbaine. Le recours aux populations locales est un gage de fiabilité des informations de par leur connaissance du territoire, à condition qu’elles soient rémunérées : Jean de Bueil écrit que « ces guides sont vraies espies, qui estoient à ses gaiges, demourans en l’obeissance de ses ennemis » (Bueil, t. I, 1887 [1461-1466], p. 151). En plus de renseignements sur les défenses, ils peuvent guider les troupes en territoire inconnu (Allmand, 1992 – Lethenet, 2013 et 2014 – Beaulant, 2014).
Les informations collectées peuvent aboutir à la réalisation d’une carte, comme le conseillent Robert de Balsac et Bérault Stuart, dans le but d’aider à la prise de décision stratégique et tactique. En 1422-1423, Ghillebert de Lannoy accompagne son rapport d’une mission de reconnaissance en Orient pour le duc de Bourgogne de cinq cartes afin de préparer une croisade. En 1498, le maréchal Jean-Jacques Trivulce envoie à Louis XII une carte de la Lombardie pour préparer la récupération du duché de Milan. Le siège d’une place est également l’occasion d’établir cartes, plans et vues, comme la peinture que commande le duc de Bourgogne Philippe le Bon avant d’entamer les opérations devant Calais en 1436, sans que l’on ait plus de détails (Contamine, 2000). Mais ces représentations graphiques sont avant tout destinées aux chefs de l’armée et il n’est pas fait mention de leur usage par les capitaines. D’ailleurs, ce sujet n’est pas évoqué par l’un d’eux, Jean de Bueil, ce qui montre que l’usage de cartes et de plans n’est pas encore systématique dans les années 1460, alors qu’il s’était banalisé en Italie dès le xive s. (Gautier-Dalché 2015).
C. Un savoir empirique issu des voyages
Avec les conflits du xve siècle, les capitaines parcourent de nombreux territoires et nul doute que beaucoup se sont forgés une connaissance approfondie du royaume de France, à l’instar de Poton de Xaintrailles. Originaire de Gascogne, il opère dans les années 1420 dans le nord-est de la France, notamment en Thiérache, puis dans le Maine et en Beauce. Il défend Orléans contre les Anglais en 1428-1429 puis participe à la campagne du sacre qui le conduit à Reims. Ensuite, à partir de Beauvais, il lutte contre les Anglo-Bourguignons dans le nord de l’Île-de-France et en Picardie et mène des expéditions contre la Normandie anglaise. En 1438, après l’avoir nommé bailli de Berry, Charles VII l’envoie lutter contre les écorcheurs qui ravagent les régions situées au sud de la Loire : finalement, il les utilise pour piller, avec le capitaine castillan Rodrigue de Villandrando, la Guyenne anglaise, le Comminges, le Roussillon puis la région toulousaine en 1439. Dans les années 1440, il suit le roi dans toutes ses expéditions : aux sièges de Creil et de Pontoise en 1441, aux campagnes qui le mènent de la région parisienne à Tartas en 1442 et à Metz en 1444, à la reconquête de la Normandie en 1449-1450 et de la Guyenne en 1450-1453, ce qui lui vaut le titre de maréchal en 1454. Après ces derniers faits d’armes, il s’installe à Bordeaux, où il meurt en 1461. Bien en cour, il est souvent aux côtés du roi, comme à Poitiers en 1426, et joute à Nancy en 1445 et à Chinon en 1446. Poton de Xaintrailles a donc sillonné une grande partie de la France (Furon, 2016a). Les occasions de déplacements sont donc nombreuses et, même s’il n’a laissé aucun récit, nul doute qu’il a acquis une connaissance approfondie de la géographie du royaume.
D’autres capitaines au service du roi franchissent les frontières du royaume. De nombreux étrangers sont en effet à son service, comme des Écossais, des Gallois, des Italiens et finissent par s’installer dans le royaume et y faire souche (Contamine, 1972) : Bérault Stuart, seigneur d’Aubigny et de Beaumont-le-Comte et auteur du traité cité ci-dessus, est le petit-fils de l’Écossais John Stuart, connétable de France mort à Verneuil en 1424, et participe à deux campagnes en Italie pour Charles VIII et Louis XII. En plus de leurs talents militaires, ces capitaines étrangers mettent au service du roi de France leurs compétences linguistiques et les relations qu’ils ont conservées avec leur pays d’origine : Bérault Stuart est ambassadeur en Angleterre et en Écosse, dont le roi Jacques IV est son lointain cousin et où il meurt en 1508 ; Théaude de Valpergue, originaire de Lombardie, est ambassadeur auprès du duc de Milan dans les années 1440 (Carolus-Barré, 1982).
Enfin, d’autres capitaines se font explorateurs. Le Poitevin Gadifer de La Salle s’est rendu en Italie, en Prusse et à Rhodes avant de participer à la conquête des Canaries entre 1402 et 1406, dont le récit du Canarien a peut-être été rédigé à sa demande et décrit les paysages parcourus, les ressources naturelles que recèlent ces îles et les mœurs des habitants rencontrés (Keen, 1986 – Le livre nommé Le Canarien, 2008). Le Gascon Antoine de La Sale voyage également beaucoup : il joute à Bruxelles en 1409 et à Gand en 1414, participe à la conquête portugaise de Ceuta en 1415, mais sert surtout les ducs d’Anjou en Italie à plusieurs reprises. De ses explorations dans la péninsule, il tire plusieurs récits compilés entre 1442 et 1444 dans La Salade. Parmi eux, figure celui d’une expédition dans les îles Éoliennes au printemps 1407 : après une description des lieux, il y raconte son ascension du mont Volcano, dont les fumées avaient piqué sa curiosité, ainsi qu’une légende qui court chez les habitants de l’île (Knudson, 1928). Dans le Paradis de la reine Sibylle, il raconte une excursion faite en mai 1420 au Monte della Sibilla dans les Apennins : il décrit la montagne exposée à des vents forts, la flore qui la recouvre et la « cave » qu’il trouve en son sommet. Mais il n’y entre pas et préfère se contenter des récits plus ou moins légendaires des villageois à son propos (La Sale, 1983). Antoine de La Sale fait ainsi œuvre de géographe au sens étymologique du terme mais, ne se contentant pas de décrire les lieux, il rapporte les histoires qui y sont liées.
Les campagnes militaires, les joutes, les ambassades, les croisades, les conquêtes de contrées inconnues ou, tout simplement, la curiosité sont autant d’occasions pour les capitaines français de découvrir de nouveaux territoires. Tous ces voyages laissent penser que beaucoup de ces capitaines en perpétuel mouvement ont accumulé un savoir géographique qui n’est pas seulement destiné à la bonne exécution de leur mission mais qui relève également d’une curiosité intellectuelle que l’on peut déceler à travers leurs observations des territoires traversés et des populations y vivant et qui peut être déclenchée par un sentiment d’éloignement lié non seulement à la distance parcourue mais aussi à la confrontation avec l’inconnu.
II. Quels usages de la géographie ?
Pour la réussite de leurs opérations, les capitaines doivent également analyser les places et les territoires qu’ils veulent traverser, défendre et conquérir. À travers quelques exemples qui n’épuisent pas le sujet, il est possible de comprendre comment et dans quels buts ils se servent de la géographie.
A. Tirer parti de la situation géopolitique
L’évolution de la situation géopolitique a une grande influence sur leur activité. Entrepreneurs de guerre, les capitaines recherchent l’enrichissement et l’ascension sociale par les armes. De ce fait, certains monnayent leur fidélité non seulement au plus offrant mais également au puissant, qui leur paraît le plus à même de garantir la durabilité de leurs acquisitions, à l’image de Perrinet Gressart, roturier poitevin devenu riche et influant grâce aux armes et à un jeu de balance constant. Apparaissant au service du duc de Bourgogne en 1416, il prend par surprise La Charité-sur-Loire en 1423, place pour laquelle le duc Philippe le Bon le confirme comme capitaine et à partir de laquelle il mène des opérations pour agrandir la liste de ses possessions. Conscient de la confiance limitée que lui accorde le duc, il joue des désaccords entre ce dernier et le duc de Bedford, régent du royaume de France pour le roi d’Angleterre Henri VI, et rallie le parti anglais à partir de 1425. Ayant résisté à Jeanne d’Arc, qui tentait de prendre La Charité à la fin de l’année 1429, il est récompensé par le duc de Bedford. Mais les événements de l’année 1435 le poussent à changer d’obédience : la signature du traité d’Arras entre le roi Charles VII et le duc de Bourgogne, qui l’avait nommé capitaine de Nevers l’année précédente, ne rend plus aussi attractive la protection de ce dernier ; dans le même temps, la mort du duc de Bedford le prive de celle de l’Angleterre. Il ne reste donc plus que le roi de France qui, conscient de la puissance de ce capitaine et se souvenant de l’échec de la Pucelle d’Orléans, préfère s’assurer de sa fidélité en le nommant capitaine à vie de La Charité et en lui versant des gages de 400 livres (Bossuat, 1936). Ainsi, ce capitaine ne cherche-t-il pas seulement l’enrichissement par la guerre, les pillages et les rançons : il tente de garantir la pérennité de ses acquisitions par la recherche de protecteurs puissants. Ce faisant, il n’hésite pas à changer d’obédience au gré de l’évolution de la situation géopolitique. Pour cela, il a un avantage de poids : la situation frontalière de La Charité-sur-Loire. Cette place permet à la fois de défendre l’entrée dans le duché de Bourgogne et d’attaquer le Berry fidèle au roi de France. Pour celui-ci et le duc, le contrôle de cette place est donc essentiel tandis que, pour les Anglais, il représente une menace à l’arrière de l’armée française au cas où elle se dirigerait vers Paris. Ce « kyste » inséré entre deux ensembles territoriaux rivaux permet ainsi à Perrinet Gressart de vendre sa fidélité non seulement au plus offrant mais aussi et surtout au plus puissant du moment.
Cet exemple montre tous les avantages que peuvent présenter les frontières pour les capitaines, qui y voient une ressource à exploiter. C’est ce que fait Robert de Sarrebrück : sa seigneurie de Commercy et son château, insérés dans la mosaïque territoriale aux confins du royaume et de l’Empire, lui servent à la fois de refuge et de base pour ses ravages en Champagne, en Lorraine, dans le Barrois, dans les territoires bourguignons et contre des villes comme Metz et Toul. Partisan de Charles VII, la position géographique de sa seigneurie lui offre en réalité une certaine autonomie d’action, prenant part aux nombreux conflits de la région au mieux de ses intérêts. Il parvient ainsi à tirer profit de la multiplicité des frontières dans cette région instable (Toureille, 2014). Celle-ci attire également des capitaines en quête d’emploi et de rapines : les rivalités de pouvoirs et le caractère parfois flou et toujours complexe des tracés frontaliers offrent un terrain propice aux exactions des Écorcheurs, dont Robert de Sarrebrück fait partie (Tuetey, 1874 – Furon, 2016b). À la fois refuge et zone d’action, les dyades sont donc utilisées de manière privilégiée par les capitaines, qui savent jouer de la complexité des relations entre les différents pouvoirs rivalisant pour leur contrôle et leur extension.
Même au service de puissants, certains capitaines ne sont donc pas que des pions déplacés par la main d’un puissant sur l’échiquier géopolitique mais sont des acteurs de premier plan avec lesquels il faut compter : lorsque Charles VII confirme le capitanat de Perrinet Gressart sur La Charité en 1435 ou octroie une lettre de rémission à Robert de Sarrebrück en 1441, il ne souhaite pas seulement s’attacher la fidélité de capitaines remuants mais il veut également tirer parti des avantages stratégiques que leur position présente dans la géographie politique régionale et reconnaît ainsi leur influence géopolitique.
B. Utiliser l’organisation des territoires pour les contrôler
À une échelle plus fine, la topographie était un facteur déterminant dans la prise de décision. Si les plaines offrent de vastes espaces de circulation et de manœuvre, la présence de forêts peut constituer un obstacle ou un entonnoir propice aux embuscades et inciter les capitaines à les contourner. Traverser une chaîne de montagne peut également s’avérer dangereux, notamment en hiver avec le froid, le gel et la neige. Ainsi, durant l’hiver 1439, les Pyrénées enneigées constituent pour l’Aragon et la Navarre une barrière de protection contre les incursions de Villandrando, qui ne peut pousser plus au sud que Perpignan et Salces (Quicherat, 1879, p. 167-168).
De même, les villes, avec leurs fortifications et leurs gardes, pouvaient constituer des obstacles à la progression des troupes : c’est pourquoi elles ne constituaient pas des cibles privilégiées lors des raids. Mais, pour contrôler une région, elles sont essentielles. De ce fait, les sièges de villes sont souvent le fait des armées françaises, anglaises et bourguignonnes car celles-ci disposent de ressources humaines et financières autrement plus importantes qu’une simple compagnie d’hommes d’armes : même s’il commande des milliers d’hommes, Villandrando ne parvient pas à prendre Perpignan, si tant est qu’il l’ait envisagé. Les capitaines de compagnie préfèrent s’attaquer à des places de moindre importance et donc moins bien défendues. Mais, dans un cas comme dans l’autre, l’organisation des lieux est à prendre en compte pour la réussite des opérations : pour prendre une place, il ne faut pas seulement se servir des faiblesses des fortifications mais également du réseau et de la largeur des rues pour la progression des troupes, des flux de personnes et de marchandises entrant et sortant de la place, des rythmes de la vie urbaine qui amènent parfois une moindre vigilance (par exemple lors de manifestations religieuses) et conduisent donc à une résistance plus faible et désorganisée face à l’attaquant. C’est ce dont profitent Jean, bâtard d’Orléans, et d’autres capitaines pour prendre Chartres, tenue par les Anglais, en 1432. Pour préparer leur opération, ils bénéficient de l’aide de deux habitants et un prédicateur, qui leur fournissent des informations et participent à l’élaboration de leur plan. Celui-ci consiste à cacher des soldats dans des tonneaux transportés par des charretiers, qui leur permettent ainsi de neutraliser les gardes de la porte de Blois et les font entrer, tandis que le prédicateur distrait une grande partie de la population avec un sermon de l’autre côté de la ville. Par conséquent, lorsque l’alarme est donnée, plusieurs centaines d’hommes sont déjà entrés et la population comprend qu’il est trop tard pour résister. Les Français avancent ainsi presque sans coup férir jusqu’à la place du marché, au cas où de nombreux habitants se seraient regroupés pour les affronter. Puis ils décident d’assurer le contrôle de la ville en inspectant chaque rue (Chartier, t. I, p. 141-143 – Monstrelet, t. V, p. 21-25). Ainsi, grâce à des renseignements précis, les capitaines ont une analyse claire et une utilisation fine de la topographie urbaine : la prise de contrôle d’une porte permet d’investir prioritairement un lieu central – la place du marché – à partir duquel rayonnent les hommes dans les rues pour s’assurer la maîtrise totale de la ville.
Le repérage et la maîtrise des voies de communications sont également essentiels pour le déplacement des troupes. Les capitaines devaient avoir une idée plus ou moins précise des temps de déplacement, qui variaient en fonction du relief, de la météo, des effectifs, de l’artillerie transportée, de la résistance des populations. Pour cela, il fallait connaître à l’avance le trajet à suivre et notamment les points de passage qui pouvaient ralentir l’avancée des troupes, comme les routes étroites et escarpées en montagne, les gués et les ponts. Ainsi, Bérault Stuart recommande : « qu’il se garde bien de passer ung mauluais passaige, s’il n’est contrainct de ce faire, qu’il ne puisse bien estre luy et toute sa compaignie delà le passaige, et avoir mys son ordre, auant que les ennemys le puissent venir assaillir » car ces points de passage sont propices aux embuscades (Stuart B., 1976 [1502], p. 6). Toutefois, d’autres passages ne sont pas « mauluais », comme le gué de Blanchetaque sur la Somme, près d’Abbeville, qui voit souvent passer des troupes : en 1421, lors des opérations du siège de Saint-Riquier et de la bataille de Mons-en-Vimeu, Français et Bourguignons le traversent (Monstrelet, t. IV, p. 57 et 73) ; en 1435, les Français le franchissent pour attaquer les Anglais logeant à Rue (Monstrelet, t. V, p. 117) ; en 1436, c’est au tour des Anglais de l’utiliser pour piller les territoires bourguignons à partir de Calais (ibid., p. 264 et 265) ; en 1437, les Écorcheurs partis de Normandie le traversent pour aller ravager le Hainaut (ibid., p. 316). C’était donc un point privilégié pour franchir le fleuve, d’autant qu’il ne semble pas avoir fait l’objet d’une mise en défense particulière de la part des ducs de Bourgogne.
Le contrôle des voies de communication permet aussi de perturber les flux de marchandises. Le 29 janvier 1434, La Hire intercepte à Saint-Denis un convoi transportant 2000 porcs, ainsi que des bovins et des ovins, destinés à Paris, alors aux mains des Anglo-Bourguignons (Journal d’un bourgeois de Paris, p. 297). Une partie de ce bétail a pu servir à nourrir les hommes de sa compagnie tout en gênant l’approvisionnement de la capitale. Les villes étant très fortement dépendantes des campagnes environnantes, les capitaines essaient de les asphyxier par le pillage, l’interception des convois de marchandises et la capture de marchands, ajoutant un sentiment d’insécurité physique permanent à la précarité de l’approvisionnement. Dans la première moitié des années 1430, Blanchefort et La Hire perturbent ainsi le commerce d’Amiens à partir du château de Breteuil, situé à une trentaine de kilomètres au sud, le contrôle d’une position forte leur permettant d’exercer une pression durable sur la ville (Murphy, 2012).
Afin de maîtriser un vaste territoire et les réseaux de communication qui le drainent, certains capitaines profitent de la centralité des villes. C’est le cas de La Hire à Beauvais à partir de 1433. Tenant la ville et sa région pour le compte de Charles VII, il représente une menace pour les terres du duc de Bourgogne au nord, la Normandie anglaise à l’ouest et Paris anglo-bourguignonne au sud. Pour contrôler le Beauvaisis, il place des hommes de confiance dans les villes de la région : ses frères Amadoc de Vignolles à Beaumont-sur-Oise et Pierre-Regnault de Vignolles à Clermont. À partir de Beauvais, il mène des expéditions en territoire ennemi et agrandit sa zone d’influence, prenant par exemple le château de Breteuil en décembre 1434. Contrôlant le Beauvaisis, il contrôle également le réseau routier et ses flux de marchandises : il peut ainsi gêner les relations commerciales entre Amiens et Paris. Toutefois, conscient de la complémentarité qui unit les villes et les campagnes, il fait en sorte que ses hommes n’entravent pas les échanges économiques entre Beauvais et sa région par leurs pillages. Ce faisant, il entretient de bonnes relations avec la population locale et s’assure de son soutien (Rousseau, 1969). La Hire a donc une vision claire de la géographie politique du nord du royaume de France et de l’organisation du territoire beauvaisien, parvenant à en tirer profit pour étendre l’influence française dans la région.
Ces exemples montrent que les capitaines de compagnie sont capables d’analyser et d’exploiter l’organisation de territoires à des échelles locale avec la prise d’un château ou d’une ville, régionale avec la mise en coupe réglée de villes importantes et de leurs hinterlands, supra-régionale avec l’utilisation d’un territoire comme base pour des opérations dans des territoires ennemis parfois éloignés.
C. De la présence physique à la symbolique : s’approprier un territoire
Contrôler un territoire passe par rendre visible ce contrôle aux yeux de la population. La présence physique du capitaine et de sa compagnie est le premier moyen pour les habitants de connaître l’identité du détenteur de l’autorité. La Hire à Beauvais et ses hommes dans les campagnes et les places environnantes incarnent la réaffirmation de l’autorité d’un Charles VII conquérant : dans une lettre du 31 décembre 1433, La Hire s’intitule « lieutenant du Roy nostre Sire et capitaine général deça la rivière de Seine es pais de l’Isle de France, Picardie, Beauvaisin, Laonnois et Soissonnois, et bailli de Vermandois » et, à ce titre, crée un atelier monétaire à Beauvais, prérogative royale par excellence (Rousseau, 1969, p. 407-408). Charles VII nomme ainsi de nombreux capitaines à des offices de bailli ou de sénéchal : il ne s’agit pas seulement d’assoir son autorité sur une circonscription mais surtout de la défendre face aux ennemis. Toutefois, même lorsque l’office est occupé durablement (La Hire est bailli de Vermandois de 1429 à sa mort en 1443), on constate rarement un enracinement du capitaine : toujours en campagne pour le roi, ils sont peu présents dans leur circonscription et laissent sa défense à des hommes de confiance et sa gestion à leur lieutenant.
A contrario, la présence d’un capitaine et de sa compagnie en territoire ennemi sape l’autorité du détenteur du pouvoir, qui se révèle incapable de défendre efficacement ses possessions, d’autant que cette présence est généralement accompagnée de pillages. Ceux-ci ne répondent pas uniquement à un souci de faire du butin pour s’enrichir mais, par la ponction de ressources, visent à diminuer les capacités de l’ennemi à faire la guerre et peuvent aussi avoir une dimension symbolique lorsque des objets liturgiques sont volés (Jucker, 2009). Ils sont assortis d’incendies qui marquent dans le paysage la visibilité du passage de la compagnie, sans compter les violences traumatisantes faites aux personnes. Plusieurs années après le passage des Écorcheurs qui sillonnent les territoires bourguignons entre 1435 et 1445, les habitants des régions dévastées sont en mesure de décrire et chiffrer précisément leurs pertes aux officiers du duc (Tuetey, 1874). Même si l’emprise des pillards sur les régions traversées est éphémère, elle les marque durablement, d’autant que certaines localités sont plusieurs fois attaquées entre 1435 et 1445 et gardent les traces des destructions. Une autre forme éphémère d’emprise sur un territoire est l’appatissement : le capitaine menace d’attaquer une ville si elle ne paie pas le prix de sa sécurité (le patis). C’est ce que font Blanchefort et La Hire, qui tentent de soutirer de l’argent à la ville d’Amiens à partir de leur position menaçante à Breteuil (4). Le patis n’est pas qu’un moyen de gagner de l’argent : il fait sentir aux populations que leurs autorités sont incapables d’assurer leur sécurité et que le véritable maître des lieux est le capitaine.
Enfin, les capitaines savent utiliser la dimension symbolique des lieux pour montrer leur domination. C’est le cas lors de la prise d’une ville ou d’un château : l’entrée du vainqueur et la mise en place d’une nouvelle garnison peuvent être assortis d’une mise en scène. À Bordeaux en 1451, l’armée française entre dans la ville prise aux Anglais à la manière des entrées royales : l’absence du roi est palliée par la présence des grands sceaux symbolisant le retour de son pouvoir dans la cité, tandis que les capitaines sont richement équipés et défilent en bon ordre jusqu’à la cathédrale (Chartier, t. II, p. 305-313). De même, en pillant et détruisant des églises, ils mettent à mal non seulement le cœur géographique d’une communauté mais également les valeurs qui unissent cette communauté, en particulier quand le viol des bâtiments religieux est accompagné de celui des femmes (Verreycken, 2016). Certains savent jouer de cette géographie symbolique : en 1436, Villandrando, employé par Robert Dauphin d’Auvergne qui convoite le siège épiscopal d’Albi face à Bernard de Casilhac, force la ville à lui ouvrir ses portes, entre dans la cathédrale et s’assoit sur le siège épiscopal, prenant possession de la cité au nom de son maître (Quicherat, 1879, p. 129-130).
La géographie a donc pour les capitaines de compagnie une utilité dépassant la simple étude du terrain. Une claire conscience des enjeux politiques, stratégiques, économiques et symboliques liés aux territoires leur permet d’y jouer un rôle essentiel.
III. Une géographie modifiée par les capitaines ?
Cela peut parfois aboutir à une transformation des territoires par les conquêtes, les massacres, les destructions, les reconstructions, la perturbation des échanges. Mais la question est de savoir dans quelle mesure cet impact est durable.
A. Quel impact géopolitique ?
Sous Charles VII, les capitaines de compagnie sont indubitablement les ouvriers de la reconquête du royaume de France. Le cas de La Hire le montre : nommé par le roi bailli de Vermandois en 1429, il a la charge de reconquérir cette région aux mains des Anglo-Bourguignons, ce qu’il réussit à faire ; en 1433, le roi le nomme « capitaine général deça la rivière de Seine es pais de l’Isle de France, Picardie, Beauvaisin, Laonnois et Soissonnois » et il parvient à s’implanter à Beauvais et à étendre son emprise territoriale à partir de cette ville. Par ses succès militaires, La Hire agrandit le territoire contrôlé par le roi de France et contribue à affaiblir le duc de Bourgogne. Toutefois, la succession des événements – nomination à un office territorial puis conquête de la circonscription – invite à penser que La Hire, même s’il dispose d’une grande autonomie, met en œuvre une stratégie définie par Charles VII.
Lorsque les capitaines de compagnie montrent un certain sens géopolitique, il s’agit le plus souvent d’une vision à court ou moyen terme, l’essentiel étant de défendre leurs intérêts présents. Le jeu de bascule de Perrinet Gressart montre sa grande capacité d’adaptation aux changements de situation pour conserver son capitanat de La Charité-sur-Loire. De même, les Écorcheurs s’attaquent avant tout aux territoires du duc de Bourgogne pour éviter des représailles royales : si le duc est revenu dans le giron français en 1435, il est tout de même préférable pour eux d’éviter de piller le domaine royal, d’autant que ce sont les revenus de ce dernier qui permettent de les employer.
L’activité des capitaines de compagnie a donc un impact géopolitique limité quand elle ne s’inscrit pas dans un plan plus vaste : La Hire n’est que l’ouvrier d’une reconquête dont le maître d’œuvre est Charles VII. C’est la conséquence du renforcement du pouvoir royal au xve siècle : pour tenir une position, un capitaine a besoin d’être légitimé par une autorité supérieure. Sinon, il est condamné à un jeu de bascule – à l’image de Perrinet Gressart – ou à errer de territoire en territoire – comme les Écorcheurs qui vivent sur le pays en attendant de trouver un emploi.
B. À l’échelle locale : des territoires transformés par les capitaines ?
À l’échelle locale, l’impact économique des compagnies semble souvent minime. Paray-le-Monial et sa campagne doivent ainsi subir les exactions des Écorcheurs en août et septembre 1437, décembre 1438, février 1439, mai 1440, février et septembre 1443, janvier et février 1444 (Canat, 1863, p. 459-460). Souvent, le bétail est visé : en décembre 1438, on coupe les jambes des animaux qui ne sont ni rançonnés ni emmenés mais, trois mois plus tard, le bétail est à nouveau rançonné, ce qui signifie qu’il a pu être au moins partiellement reconstitué. L’impact sur l’économie agraire est donc certainement faible et peu durable : à chaque fois que des troupes passent dans la région, elles trouvent des ressources à piller.
Il en est de même pour le commerce. Les capitaines peuvent interférer dans les flux de marchandises, que ce soit directement dans le cadre d’une guerre de prédation comme La Hire à Saint-Denis en 1434, ou indirectement, la présence d’une compagnie incitant souvent les marchands à changer d’itinéraire pour éviter une mauvaise rencontre. Toutefois, l’arrivée de plusieurs centaines d’hommes de guerre, qui ont du butin à vendre et veulent acheter des vivres et des armes, peut dynamiser les échanges commerciaux : en 1434, la ville d’Amiens s’inquiète de ce que certains habitants des faubourgs vendent des vivres « aus estrangers où il leur plest, et en porroient pourveir les annemys du roy [d’Angleterre] nostre sire » (5), c’est-à-dire aux hommes de Blanchefort stationnant à Breteuil ; en 1439, la présence des Écorcheurs de Robert de Flocques, Boniface de Valpergue et Barthélémy Barette à Saulieu, à l’ouest de Dijon, incite des marchands de Troyes à venir échanger des armes contre du bétail (Canat, 1863, p. 478-479). Ce commerce d’opportunité ne dure que le temps de la présence des capitaines et de leurs hommes dans la région, c’est-à-dire souvent pas plus de quelques semaines, et concerne généralement des marchandises de peu de valeur. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’à cette époque, nombre de régions voient passer des troupes régulièrement et cela fait peut-être les affaires de certains marchands.
Quant à l’impact démographique, il est malaisé de l’évaluer, par manque de sources précises. Il semble que les conséquences sur la mortalité soient minimes : pour reprendre l’exemple de Paray-le-Monial, qui a vu passer des milliers de pillards en une dizaine d’années, seulement trois morts sont dénombrés par les enquêteurs du duc de Bourgogne. Cela s’explique par le fait que les Écorcheurs préféraient capturer les habitants pour les rançonner. En revanche, les déplacements de populations semblent plus importants : les ruraux fuient les soudards et se mettent à l’abri des fortifications urbaines mais ce n’est que temporaire et ils regagnent leurs maisons dès que la menace est éloignée. Certains décident également de rejoindre les compagnies en espérant mettre fin aux difficultés quotidiennes par la prédation (Furon, 2016b). D’autres sont déportés : selon Thomas Basin, après la prise de Soissons par l’armée de Charles VI en 1414, des femmes sont emmenées et forcées de se prostituer dans presque toutes les villes du royaume (Basin, 1933 [1471-1472], p. 26). Cela représente des naissances non advenues qui, ajoutées aux morts dues au siège et à l’assaut, ont dû faire apparaître une classe creuse dans la démographie soissonnaise. Mais les massacres de populations entières sont rares, comme en 1472 à Nesle en Vermandois : dans ce cas, ce n’est pas une initiative des capitaines bourguignons mais un ordre du duc Charles le Téméraire qui cherche à détruire un territoire pour des raisons stratégiques (Viltart, 2009). Sur le long terme, les désertifications dues à la guerre touchent des espaces peu étendus : en Comtat Venaissin, une trentaine de petits villages ont été abandonnés temporairement ou définitivement entre 1360 et 1440 (Butaud, 2002). Mais, globalement, les épidémies de peste provoquent des baisses démographiques plus importantes que le passage d’une compagnie.
Enfin, si les destructions peuvent être nombreuses au passage d’une troupe, les (re)constructions ordonnées par un capitaine sont plus rares en raison de la forte mobilité des compagnies et de leurs maigres moyens financiers. Mais lorsqu’il s’agit de tenir une place ou une région durablement, les fortifications deviennent une préoccupation. En 1435, Poton de Xaintrailles et La Hire reconstruisent ainsi les défenses de Gerberoy, à 16 kilomètres de Beauvais. Pour cela, ils reçoivent 7000 saluts d’or du connétable de Richemont, qui leur en a donné l’ordre (Gruel, 1890, p. 108). L’argent nécessaire à ces réparations provient donc des finances royales et vient appuyer la stratégie de consolidation des positions françaises dans la région. L’initiative ne vient pas des deux capitaines, même s’ils laissent par ce travail de reconstruction une trace visible de leur présence dans le paysage beauvaisin.
L’impact territorial de l’activité des capitaines de compagnie est donc ponctuel tant géographiquement que temporellement. Usagers temporaires des territoires, ils modifient rarement en profondeur leur organisation et le rapport des populations à leur espace de vie.
Conclusion
Le rapport des capitaines de compagnie à leur espace est donc dynamique. L’espace n’est pas seulement un ensemble d’atouts et de contraintes à exploiter militairement : il « produit » le capitaine, dans le sens où celui-ci agrandit sa renommée partiellement en fonction de sa capacité à utiliser, conquérir, maîtriser et agrandir un territoire. Tous les capitaines cités ici – et bien d’autres pourraient être convoqués – ont construit leur carrière et leur réputation en faisant preuve d’une certaine intelligence géographique qui s’est développée grâce à leur grande mobilité spatiale. Celle-ci a conduit certains à devenir de véritables explorateurs et à se forger une culture géographique qui dépasse largement le cadre guerrier et relève plutôt de la curiosité intellectuelle nourrie par le goût de l’aventure.
Toutefois, ce savoir a une efficience limitée dans le temps. L’impact de leurs pratiques spatiales est très ponctuel car ils n’ont ni le pouvoir, ni les moyens financiers de transformer des territoires. L’activité des capitaines consiste essentiellement à se les approprier avec leurs ressources, ne serait-ce que le temps d’un pillage. Si l’espace produit le capitaine, celui-ci produit donc rarement seul de l’espace, n’étant souvent que l’exécutant d’une autorité supérieure qui, par son pouvoir décisionnaire, est la véritable productrice d’espace, particulièrement à l’échelle du royaume de France.
Enfin, la culture géographique des capitaines de compagnie du xve siècle étant essentiellement issue de l’observation et de l’expérience et très rarement de source livresque, cela amène à s’interroger sur la diffusion de la géographie humaniste, alors en plein développement : a-t-elle imprégné leurs esprits ? Il est difficile de l’affirmer. Peut-être faut-il envisager que la géographie des capitaines, empirique et centrée sur leur espace proche, et celle des humanistes, essentiellement livresque et ouverte sur le monde entier, existent en parallèle sans vraiment se rencontrer, sauf le temps d’une expédition lointaine ou de la consultation d’une carte.
Bibliographie
Allmand C., 1992, « Intelligence in the Hundred Years War », dans Neilson K. et McKercher B.J.C. (éd.), Go spy the Land. Military Intelligence in History, New York, Praeger, p. 31-47.
Basin T., 1933 [1471-1472], Histoire de Charles VII, éd. Samaran C., Paris, Les Belles Lettres, t. I, 309 p.
Beaulant R., 2014, « L’espionnage armagnac vu par les autorités dijonnaises durant le conflit franco-bourguignon (1419-1435) », Annales de Bourgogne, t. 86-4, p. 19-34.
Bossuat A., 1936, Perrinet Gressart et François de Surienne, agents de l'Angleterre. Contribution à l'étude des relations de l'Angleterre et de la Bourgogne avec la France sous le règne de Charles VII, Paris, Droz, 444 p.
Bourin M. et Zadora-Rio E., 2007, « Pratiques de l’espace : les apports comparés des données textuelles et archéologiques », dans Lienhart T. (dir.), Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, 37e congrès, Mulhouse, 2006, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 39-55.
Bueil J. de, 1887-1889 [1461-1466], Le Jouvencel, éd. Favre C. et Lecestre L., Paris, Renouard, 2 vol., 225 et 497 p.
Butaud G., 2002, « Villages et villageois en Comtat Venaissin en temps de guerre (milieu xive-début xve siècle) », dans Desplat C. (dir.), Les villageois face à la guerre (xive-xviiie siècle). Actes des XXIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, p. 53-64.
Canat M., 1863, Documents inédits pour servir à l’histoire de la Bourgogne, t. I, Châlons-sur-Saône, Dejussieu, 496 p.
Carolus-Barré L., 1982, « Deux “capitaines” italiens compagnons de Jeanne d’Arc, Barthélémy Barette (Baretta), Théaude de Valpergue (Valperga) », Bulletin de la Société historique de Compiègne, t. XXVIII, p. 81-118.
Chartier J., 1858, Chronique, éd. Vallet de Viriville A., Paris, Jannet, t. I et II, 271 et 346 p.
Contamine P., 1972, Guerre, État et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France 1337-1494, Paris-La Haye, Mouton, 757 p.
Contamine P., 1980, « L’écrit et l’oral en France à la fin du Moyen Âge. Note sur l’alphabétisme de l’encadrement militaire », dans Paravicini W. et Werner K.F. (dir.), Histoire comparée de l’administration (ive-xviiie siècles). Actes du xive colloque historique franco-allemand, Tours, 27 mars-1er avril 1977, Zurich, Artemis, p. 102-113.
Contamine P., 2000, « L’art de la guerre à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance : maîtrise et représentation de l’espace », dans DUCHHART Heinz et VEIT Patrice (dir.), Guerre et paix du Moyen Âge aux Temps modernes. Théories – Pratiques – Représentations, Mayence, Verlag Philipp von Zabern, p. 35-52.
Dauphant L., 2012, Le Royaume des quatre rivières. L’espace politique français (1380-1515), Seyssel, Champ Vallon, 431 p.
Fourcade S., 2015, « De l’utilité des lettres dans la carrière des armes. Guerre et culture écrite en France au xve siècle », Le Moyen Âge, t. CXXI, n°1, p. 21-40.
Furon C., 2016a, « La Hire et Poton de Xaintrailles, capitaines de Charles VII et compagnons de Jeanne d’Arc », revue en ligne Camenulae, 15.
Furon C., 2016b, « Gens de guerre en hiver : le cas des Écorcheurs durant l’hiver 1438-1439 », Questes, 34, L’hiver, p. 85-118.
Gautier Dalché P. (dir.), 2013, La Terre. Connaissance, représentations et mesure au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 710 p.
Gautier Dalché P., 2015, « Les usages militaires de la carte, des premiers projets de croisade à Machiavel », Revue historique, 673, p. 45-80.
Grévy-Pons N., 1980, « Propagande et sentiment national pendant le règne de Charles VI : l’exemple de Jean de Montreuil », Francia, 8, p. 127-145.
Gruel G., 1890, Chronique d’Arthur de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne (1393-1458), éd. Le Vavasseur A., Paris, Renouard, 314 p.
Harrouët R., 1999, « Une famille de bibliophiles au XVe siècle : les Coëtivy », Bulletin et mémoires de la Société archéologique du département d’Ille-et-Vilaine, t. CII, p. 139-199.
Journal d’un bourgeois de Paris, 1881, éd. Tuetey A., Paris, Champion, 413 p.
Jucker M., 2009, « Le butin de guerre au Moyen Âge. Aspects symboliques et économiques », Francia, 36, p. 113-133.
Keen M., 1986, « Gadifer de la Salle : A late medieval Knight », dans Harper-Bill C. et Harvey R. (éd.), The Ideals and Practice of medieval Knighthood, Woodbridge, Boydell Press, p. 74-85.
Knudson C.-A., 1928, « Une aventure d'Antoine de la Sale aux îles Lipari », Romania, 54, p. 99-109.
Lacoste Y., 1976, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, Maspero, 187 p.
La Sale A. de, 1983, Le paradis de la reine Sibylle, éd. Mora-Lebrun F., Paris, Stock, 144 p.
Le débat des hérauts d’armes de France et d’Angleterre, 1877, éd. Pannier L. et Mayer P., Paris, Firmin-Didot, 217 p.
Le livre nommé Le Canarien. Textes français de la conquête des Canaries au xve siècle, 2008, éd. Aznar E., Corbella D., Pico B., Privat M. et Tejera A., Paris, CNRS éditions, 296 p.
Le Roux de Lincy A., 1857, Chants historiques et populaires du temps de Charles VII et de Louis XI, Paris, Auguste Aubry, 208 p.
Lethenet B., 2013, « “Selon les nouvelles que vous me ferez savoir”. Essai sur le renseignement au Moyen Âge », Revue du Nord, n° 402, p. 837-857.
Lethenet B., 2014, « “Par aguets et espiements”. Espionner aux xive et xve siècles », Annales de Bourgogne, t. 86-4, p. 5-18.
Marchandisse A. et Schnerb B., « Chansons, ballades et complaintes de guerre au xve siècle : entre exaltation de l’esprit belliqueux et mémoire des événements », dans Hablot L. et Vissière L. (dir.), Les paysages sonores du Moyen Âge à la Renaissance, Rennes, PUR, p. 113-124.
Monstrelet E. de, 1860-1861, Chronique, éd. Douët d’Arcq L., Paris, Renouard, t. IV et V, 492 et 488 p.
Murphy N., 2012, « Between France, England and Burgundy : Amiens under Lancastrian Dual Monarchy, 1422-1435 », French History, 26, p. 143-163.
Naber A., 1990, « Les manuscrits d'un bibliophile bourguignon du xve siècle, Jean de Wavrin », Revue du Nord, t. 72, n° 284, p. 23-48.
Pons N., 1982, « La propagande de guerre française avant l'apparition de Jeanne d'Arc », Journal des savants, p. 191-214.
Quicherat J., 1879, Rodrigue de Villandrando, l’un des combattants pour l’indépendance française au quinzième siècle, Hachette, 356 p.
Registre des délibérations du conseil de ville de Châlons-en-Champagne (1417-1421), 2001, éd. Guilbert S., Châlons-en-Champagne, Archives municipales, 340 p.
Rousseau F., 1969, La Hire de Gascogne, Mont-de-Marsan, Lacoste, 466 p.
Stuart B., 1976 [1502], Traité sur l’Art de la Guerre, éd. Comminges É. de, La Haye, Martinus Nijhoff, 77 p.
Toureille V., 2014, Robert de Sarrebrück ou l’honneur d’un écorcheur (v. 1400-v. 1462), Rennes, PUR, 272 p.
Tuetey A., 1874, Les écorcheurs sous Charles VII. Épisodes de l’histoire militaire de la France au xve siècle d’après des documents inédits, Montbéliard, Henri Barbier, 2 vol.
Verreycken Q., 2016, « Le soldat face au sacré : la lutte contre le viol des femmes et des lieux saints dans les armées de Charles le Hardi (1465–1477), moyen de promotion d’un nouveau modèle de comportement des gens de guerre ? », dans Jalabert L. et Simiz S. (dir.) Le Soldat face au clerc. Armée et religion en Europe occidentale (xve–xixe siècle), Rennes, PUR, p. 163-178.
Viltart F., 2009, « Exploitiez la guerre par tous les moyens ! Pillages et violences dans les campagnes militaires de Charles le Téméraire (1466–1476) », Revue du Nord, vol. 380, n° 2, p. 473–490.
Notes :
(1) « L’expression de “pratique spatiale” renvoie à des formes d’utilisation de l’espace liées à un mode de vie. Conçue comme l'action d'un sujet, elle résulte de choix plus ou moins conscients, qu'on peut considérer comme sociologiquement déterminés. » (Bourin et Zadora-Rio, 2007, p. 39)
(2) Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal sous la cote 4798.
(3) BnF, fr 23997 : Pisan C. de, Livre des faiz d’armes et de chevalerie, f° 37 r°.
(4) Archives municipales (AM) Amiens, BB 4, f° 53 r° (délibérations du 4 août 1434 à propos du paiement ou non du patis à Blanchefort), 69 v°, 70 v° et 71 r° (à propos d’une lettre de La Hire lue les 14, 15 et 18 mars 1435 et enjoignant la ville de payer un patis).
(5) AM Amiens, BB 4, f° 43 r° (20 janvier 1434).
Le sanctuaire de Knock (Irlande) : observatoire de l’évolution de la valeur sacrée dans l’espace et la société | Publié le 2020-05-16 10:57:57 |
Par Marie-Hélène Chevrier (Docteur en géographie – ATER, Université de Strasbourg – Laboratoire Image, Ville, Environnement UMR 7362).
Résumé : Dans les pays ayant une longue tradition chrétienne, la sécularisation de la société s’est accélérée depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Cela se manifeste par une disparition des marqueurs religieux de l’espace et du temps publics, ainsi que par un ensemble de lois revenant sur des interdits formulés par la morale chrétienne. Le pèlerinage, cependant, et les lieux vers lesquels il se dirigent ne sont apparemment pas réellement remis en cause par cette sécularisation croissante. Au contraire, la fréquentation de certains chemins de pèlerinages (tels ceux de Saint-Jacques-de-Compostelle) et des principaux sanctuaires catholiques (Lourdes, Fatima, Guadalupe, etc.) restent stable voire connaissent un regain de fréquentation, particulièrement depuis les années 1990. Il y a là un paradoxe qui pose question quant à la place tenue par la valeur sacrée dans la société et sa spatialisation.
A travers l’étude du sanctuaire de Knock, en Irlande, cet article s’attachera à montrer que les lieux de pèlerinage, dans le monde chrétien, sont de bons observatoires des évolutions de cette valeur sacrée. Le cas de Knock est particulièrement intéressant : l’Irlande demeure aujourd’hui un des pays d’Europe les plus ancrés dans la tradition catholique mais la sécularisation de la société s’y est grandement accélérée depuis une dizaine d’années. Le sanctuaire de Knock constitue un des cœurs de l’Irlande catholique, recevant 1,6 million de visiteurs par an. Notre Dame de Knock, apparue en 1879, est progressivement devenue une figure tutélaire pour les irlandais. L’examen de la création de ce sanctuaire au XIXe siècle, dans un contexte de tension entre Irlandais et Anglais, permet de mettre en avant les grandes logiques qui président à la mise en place d’un sanctuaire et d’un pèlerinage. L’observation des pratiques des visiteurs au sein du sanctuaire et l’analyse des aménagements réalisés dans l’enceinte du lieu soulignent ensuite l’importance de l’espace : pour les visiteurs, il est empreint d’une véritable efficacité, au sens théologique du terme. Pour les promoteurs, cette efficacité doit être prise en compte dans l’aménagement. Il s’agit de permettre aux visiteurs d’accéder physiquement et sans intermédiaire au sacré, ainsi que de « mettre en scène » cette valeur si particulière attribuée à l’espace. Ces aménagements, qui, à Knock, ont la particularité d’avoir été pensés non seulement localement mais aussi au niveau régional par les autorités tant ecclésiastiques que civiles, mettent en évidence l’évolution de la valeur sacrée elle-même, qui n’est plus seulement religieuse mais se dilate jusqu’à acquérir une modalité plus laïque. Cette valeur sacrée en quelque sorte renouvelée permet au lieu de pèlerinage de s’ouvrir à d’autres visiteurs que les seuls pèlerins, faisant du sanctuaire un nouveau genre de destination touristique.
Mots-clés : Pèlerinage, Irlande, sécularisation, espace sacré, tourisme.
Abstract : In countries based on a long Christian tradition, the secularization of society had sped up since the last half of the twentieth century. This is visible through the disappearance of religious signs from public space and time, and through a set of laws reconsidering some taboos of Christian morality. Though pilgrimage and pilgrimage places are apparently not really challenged by this growing secularization. On the contrary, attendance levels of some pilgrimage routes (Santiago de Compostela for example) stay strong, even registering an increase, particularly since the 1990’s. Therefore, there is a paradox which leads to examine the part played by the sacred value in society and its spatialization.
Through the study of the Irish shrine of Knock, this paper will show that the pilgrimage places of the Christian world are good sacred value observatories, allowing to measure the evolution of this value. Knock case is particularly interesting: among European countries, Ireland is still one of the most embedded in the Catholic tradition, but the secularization of society has been greatly accelerated during the last ten years. Knock shrine, with its 1.6 million visitors a year, is one of the hearts of Catholic Ireland. Appeared in 1879, Our Lady of Knock progressively became a leading light for Irish people. The study of the creation of the shrine during the ninetieth century, in a climate of tension between Irish and English people, highlights the logic behind the foundation of a shrine and a pilgrimage. The observation of the visitors’ practices and the analysis of the planning in the shrine area underline the importance of space: for the visitors, it is imbued with a true “efficacy”. For the developers, this efficacy must be considered in the planning. It is about granting access to the sacred to the visitors, both physically and directly (without an intermediary). It is also about “staging” this sacred value assigned to space. In Knock, the planning was very specific because it had not only been thought at a local but also at a regional scale and in cooperation between ecclesiastical and public authorities. Studying this case, the paper will show the evolution of the sacred value, which is expanding itself. It is not only religious anymore, but it has acquired a secular meaning. This somehow renewed sacred value enables the pilgrimage place to open to other visitors, not only pilgrims, making the shrine a new kind of tourist attraction.
Key words : Pilgrimage, Ireland, secularization, sacred space, tourism.
Le « Lourdes irlandais », c’est ainsi qu’est généralement présenté le sanctuaire catholique de Knock dans les médias à chaque visite pontificale (Jean-Paul II en 1976 et François en 2018). Relativement méconnu en-dehors des pays anglophones, le sanctuaire marial implanté dans le petit village de Knock Mhuire (972 habitants recensés en 2016), dans le comté de Mayo (70 km au nord de Galway), est effectivement le plus important lieu de pèlerinage d’Irlande en termes de nombre de visiteurs (1,6 millions de visiteurs par an), très loin devant les deux autres sites sacrés et sanctuaires les plus renommés (cf. document 1) : Croagh Patrick (montagne de St Patrick environ 100 000 ascensions par an) et Lough Derg (monastère sanctuaire de St Patrick accueillant quelques milliers de visiteurs par an). Aux yeux des Européens, comme le rappelle L’Atlas des préjugés (Tsevtkov, 2017), l’Irlande et les Irlandais sont caractérisés par un fort attachement au catholicisme. Une vision en grand décalage avec la situation réelle d’une sécularisation initiée avec la modernisation (notamment industrielle) du pays dans les années soixante (Brennan, 2012), croissante et accélérée depuis une dizaine d’années.
D’après le recensement de 2016, 78,3% des Irlandais se déclarent catholiques, contre 84,2% en 2011 (Central Statistics Office). Cette évolution statistique s’accompagne de lois sociales de plus en plus émancipées des prescriptions de l’Eglise catholique, adoptées après consultation de la population par référendum : 62% des électeurs irlandais approuvent ainsi le mariage homosexuel en 2015, tandis qu’un référendum de mai 2018 conduit à la légalisation de l’avortement pour toutes les femmes (et non plus seulement en cas de danger pour la vie de la mère) en décembre 2018. Plus anecdotique mais non moins significatif, le Parlement irlandais a abrogé, en janvier 2018, l’interdiction pour les débits de boisson d’ouvrir le Vendredi Saint. Cependant, malgré ce détachement de plus en plus fort de la société vis-à-vis de l’Eglise catholique, le nombre de visiteurs et de pèlerins au sanctuaire de Knock et dans les principaux sanctuaires irlandais ne diminue pas (Chevrier, 2016).
Ce constat amène à s’interroger sur la signification de ces pratiques pèlerines et le rapport au sacré qu’elles traduisent : se sont-ils eux-mêmes, d’une certaine manière, sécularisés ? L’étude du sanctuaire de Knock menée ici montrera que ces grands lieux de pèlerinages, dans des sociétés qui se sécularisent, sont des observatoires privilégiés qui permettent d’apprécier l’évolution et la « dilatation » de la valeur sacrée, de sa dimension religieuse à sa dimension laïque. L’analyse de la création et du développement du sanctuaire de Knock soulignera, dans un premier temps, que ces grands lieux de pèlerinage, loin d’être des créations imposées par les hautes autorités de l’Eglise, sont généralement le fruit d’un processus initié par le peuple des croyants. Se mettent ainsi en place des pratiques spatiales bien particulières qui, oscillant entre tradition et modernité, donnent corps à une certaine « efficace », caractéristique des lieux de pèlerinage et attachée à leur valeur sacrée. Cette valeur sacrée, au cœur de la sécularisation dépasse alors les frontières du religieux et se « dilate » prenant une dimension laïque, que le cas du sanctuaire de Knock permet d’observer clairement.
Document 1 : Principaux lieux de pèlerinage irlandais, type de culte et rayonnement (M.-H. Chevrier, 2019)
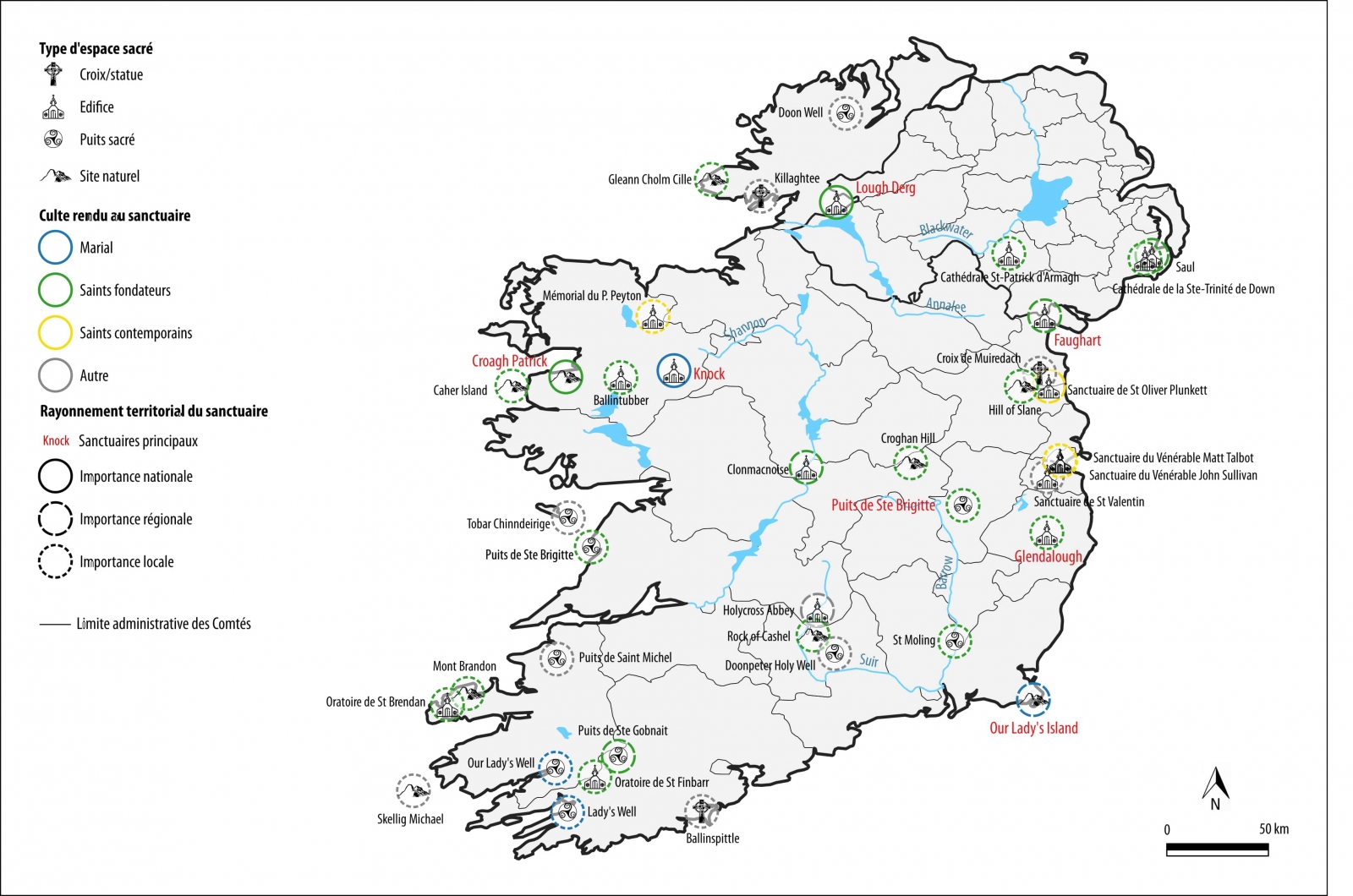
I. La construction populaire du caractère sacré du sanctuaire de Knock
Dans l’Eglise catholique, on entend par le terme sanctuaire un « espace délimité, marqué par une expérience spirituelle liée à la religion (apparition, étape de la vie d’un saint, reliques…), où s’appliquent des règles spécifiques et vers lequel convergent les visiteurs, qu’ils aient des motivations religieuses ou profanes » (Chevrier, 2016). Ils sont extrêmement nombreux, à tel point qu’il est impossible d’en donner le nombre exact. Parmi ceux-ci, le sanctuaire de Knock fait partie d’une catégorie particulière : il compte parmi les quatorze sanctuaires liés à une apparition mariale ayant été officiellement reconnue par les autorités ecclésiastiques.
A. Une apparition qui survient dans un centre névralgique de la contestation paysanne
L’acte de fondation du sanctuaire de Knock consiste dans ce que Mircea Eliade qualifie de « hiérophanie » : un processus par lequel Dieu se manifeste aux hommes, conférant un caractère sacré à l’espace (Eliade, 1965). Celle-ci se place au cœur de la série d’apparitions mariales signalées au cours du XIXe siècle et de la première moitié du XXe en Europe (rue du Bac à Paris en 1830, La Salette en 1846, Lourdes en 1858, Pontmain en 1871, Fatima en 1917 et L’Ile-Bouchard en 1947).
Le jeudi 21 août 1879, deux habitantes de Knock Mhuire (Mary McLoughlin et Mary Byrne), passant vers dix-neuf heures devant l’église paroissiale, aperçoivent des « images lumineuses » sur la façade du bâtiment, composant une sorte de tableau catéchétique (Laurentin, Sbalchiero, 2012). Au centre se trouve la Vierge Marie qui semble prier. Elle est entourée de deux hommes que les voyants identifient comme étant Saint Joseph et Saint Jean l’Evangéliste. A la droite de ce groupe de personnages se trouve un autel sur lequel est élevée une grande croix devant laquelle se tient un agneau. Autour de l’autel, des anges volent. Les deux voyantes s’empressent d’aller alerter leurs voisins qui accourent malgré la pluie battante. Ce sont aujourd’hui les 15 personnes dont les témoignages ont ensuite été recueillis officiellement pour l’enquête canonique qui restent enregistrés comme les 15 voyants « officiels » mais tous les villageois qui sont passés devant l’église pendant les deux heures qu’a duré l’apparition ont vu le tableau, ce qui est très inhabituel par rapport aux autres apparitions mariales de cette époque qui ne se sont révélées qu’à un petit nombre de personnes, généralement des enfants. A la différence de toutes les autres apparitions également, aucun message oral ni écrit n’est délivré. Pour les théologiens ayant ensuite étudié ce cas, le message est porté par la scène elle-même qui, via l’image de l’Agneau et de la croix, insiste sur l’importance de l’Eucharistie et de la pénitence. Le recteur actuel du sanctuaire souligne ainsi qu’il « se passe assez de choses sur le tableau » et qu’il « n’y a pas grand-chose de plus à dire » (Chevrier, 2016).
Cette apparition a lieu dans une campagne irlandaise rendue exsangue par la crise du mildiou ayant entraîné la grande famine (1845-1852). La propriété foncière est réorganisée au profit d’un petit nombre de landlords, la plupart du temps anglais. En 1876, 750 landlords possèdent la moitié des terres (Barjot, Mathis, 2009). Face à cette forme de spoliation de la part des Anglais anglicans et au désarroi créé par la grande famine, l’Eglise catholique fait alors office de refuge spirituel et identitaire. Les prêtres, de plus en plus nombreux, sont souvent proches des paysans les plus pauvres, fervents paroissiens. La région de Knock se trouve dans cette situation au moment des apparitions. D’après l’archidiacre Cavanagh, alors en charge de la paroisse, 200 familles de la paroisse sont sans terre et 400 petits propriétaires possèdent tout juste 3 à 5 acres d’une terre de très mauvaise qualité (Neary, 2015). Le Comté de Mayo, dont Knock fait partie, est ainsi un terreau favorable pour le développement de la Ligue agraire de Mayo, fondée en août 1879 par Michael Davitt, un des initiateurs de la réunion d’Irishtown du 20 avril 1879 qui marque le début du bras de fer avec le gouvernement britannique de William Gladstone : la Land War (1879-1882). Les petits paysans irlandais, se liguent contre les propriétaires terriens autour de trois revendications principales, les « 3F’s » : Fair rent soit des loyers raisonnables, Fixity of tenure où la garantie de ne plus être expulsés tant que le fermage est payé et Free sale, c’est-à-dire la possibilité de vendre librement son droit d’occupation du sol. C’est ainsi dans un village qui se trouve au cœur géographique et politique de la contestation irlandaise que surviennent les apparitions et que se développe rapidement le sanctuaire religieux le plus important du pays.
B. Un sanctuaire créé à l’initiative du peuple croyant
Comme ce qui s’est déjà produit à Lourdes en 1858, la nouvelle de l’événement se répand très vite dans les villages voisins. La famille Gordon dont la fille, Delia, est sourde, se rend sur le lieu de l’apparition dix jours plus tard pour y prier. Mme Gordon dépose alors, sur les oreilles de sa fille, du mortier qu’elle a prélevé sur le mur de l’église : la jeune fille recouvre instantanément l’ouïe, ce qui ne fait qu’augmenter la renommée du lieu. Mgr Cavanagh, en charge de la paroisse, se met à tenir un registre des guérisons. En 1880, 600 cas sont déjà enregistrés. Ces guérisons miraculeuses déclarées renforcent l’attrait des croyants et des curieux pour Knock. Le bouche-à-oreille joue un rôle crucial dans l’acquisition de la renommée pour un lieu de pèlerinage (Chevrier, 2016).
Devant la foule des croyants qui se presse à Knock, le processus visant à établir l’authenticité de l’apparition est lancé dès octobre 1879 par l’archevêque diocésain John MacHale qui met en place une commission composée de trois prêtres (le curé de Knock et deux prêtres des villages voisins) qui interrogent les témoins. Au terme de plusieurs séances de délibérations, ils concluent, en 1880, que les témoignages donnés concordent tous et sont « dignes de foi ». Ce n’est pas à proprement parler le caractère surnaturel de l’événement qui est reconnu mais bien la valeur des témoignages donnés. Cette conclusion prudente mais positive encourage le développement du pèlerinage. La foule n’attend pas la reconnaissance officielle ni la mise en place de lieux de cultes plus vastes ou modernes pour venir en pèlerinage. Au contraire, elle les précède. L’Eglise, elle, ne se précipite pas. Ce n’est qu’après un certain temps qui aura permis d’observer les fruits de la dévotion populaire que l’Autorité pourra se prononcer sur l’authenticité (et non la vérité, chaque croyant restant libre de croire ou non dans les apparitions) et le caractère surnaturel des faits. Dans le cas du sanctuaire de Knock, la ferveur populaire ne faiblissant pas et les guérisons avérées étant de plus en plus nombreuses, une seconde commission d’enquête est mise en place en 1935, qui entend sous serment le témoignage des voyants encore en vie et examine les guérisons miraculeuses attribuées à Notre Dame de Knock. Cette commission réitère les conclusions positives de 1880 et aboutit à l’authentification de l’apparition.
Le sanctuaire de Knock est ainsi représentatif d’une caractéristique propre aux grands sanctuaires du monde chrétien : ils sont, à quelques exceptions près, non pas des créations des institutions ecclésiastiques mais le produit d’une logique ascendante. C’est le flux constant des croyants vers un lieu qui pousse les autorités ecclésiastiques à lui attribuer le titre de sanctuaire, à reconnaître la valeur sacrée particulière de l’espace et à valider le pèlerinage.
II. Des pratiques entre tradition et modernité, liées à « l’efficace » du lieu
Le pèlerinage se caractérise par trois éléments fondateurs : « l’existence d’un lieu sacré ou considéré comme tel », « une démarche spéciale pour s’y rendre, ce qui suppose la rupture d’avec son séjour habituel, une distance à franchir et une route à parcourir » et « un certain nombre de rites à remplir et d’actes religieux, individuels ou collectifs avant, pendant, à l’arrivée et au retour de cette démarche » (Chélini, Branthomme, 1982). C’est sur ce dernier point que s’opèrent les différences entre sanctuaires.
A. Les pratiques spatiales des visiteurs : marqueurs de l’inculturation de la religion
Les sanctuaires sont, par excellence, le lieu de ce que la théologie catholique nomme « inculturation » et définit comme le « rapport adéquat entre la foi et toute personne (ou communauté) humaine en situation socioculturelle particulière » (Lacoste, 1998). Ainsi, la foi, universelle dans son contenu, et la culture, particulière à chaque peuple, au lieu d’être deux entités en rapport mais bien distinctes, doivent-elles s’enrichir mutuellement. Ce sont tous les domaines de la culture d’une société qui sont alors innervés par la religion tandis que la culture locale vient métisser les pratiques religieuses. L’inculturation se présente alors « comme une praxis d’ordre liturgique, catéchétique, pastorale, etc. comme un ensemble de démarches concrètes destinées à ce que la foi adhère à la vie » (Lacoste, 1998). C’est donc dans l’espace, le temps et les pratiques que se manifeste cette inculturation et de manière paroxystique dans les lieux de pèlerinage.
Le pèlerinage et les sanctuaires qui y sont associés relèvent de la religiosité populaire, définie comme « une expression de la foi qui bénéficie d’éléments culturels d’un milieu déterminé, en interprétant et en interpellant la sensibilité des participants de façon vive et efficace » (Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, 2003). De ce fait, les pratiques pèlerines sont marquées par des particularismes culturels très visibles.
Le pèlerinage à Knock comprend des pratiques rituelles dérivées de celles des sociétés pré-chrétiennes (cf. document 2a). L’un des usages des pèlerins irlandais est ainsi de prier le chapelet en faisant le tour de l’église des apparitions (cf.document 4), rituel de circumambulation qui se rapporte à celui déjà pratiqué par les Celtes autour des puits sacrés. Plutôt que d’abroger cette pratique traditionnelle, l’Eglise irlandaise l’a intégrée au culte chrétien en en modifiant le sens. Elle fait partie de l’imagerie populaire. Un des textes de Paul Durcan (poète irlandais contemporain) raconte ainsi comment, lorsqu’il s’est cassé la jambe étant enfant, il s’est retrouvé clopinant autour du sanctuaire de Knock sous la pluie (« Hopping round Knock Shrine in the Falling Rain, 1958 », Durcan, 1993) après que sa tante Sarah lui eut affirmé qu’il serait guéri s’il faisait quinze fois le tour de l’église des apparitions en récitant son chapelet. Se retrouve également un rite d’attouchement très similaire à ceux qui existaient dans les lieux de cultes pré-chrétiens : ceux-ci étaient généralement pourvus d’une pierre levée que les croyants touchaient pour obtenir une bénédiction.
A la suite de l’apparition sur le mur de l’église de Knock, les pèlerins sont venus toucher le mur, y frotter des objets voire essayer d’en prélever des fragments. Ce rite d’attouchement revêt une réelle importance aux yeux des pèlerins, tant et si bien que lorsque la nouvelle structure en verre a été mise en place, empêchant l’accès au mur des apparitions, un morceau du pignon a été placé à l’extérieur, pour que les pèlerins puissent toujours y poser leur main, l’embrasser où y frotter des objets (cf. document 2b). Enfin, comme dans un certain nombre de sanctuaires, des fontaines sont également à disposition des pèlerins, pour y recueillir l’eau d’une source locale (cf. document 2c). Parmi les miracles recensés, un certain nombre serait liés, d’après les croyants, à l’usage de cette eau. Cette association de propriétés surnaturelles aux sources jaillissant dans les sites sacrés rappelle, elle aussi, les croyances ancestrales liées aux puits sacrés. Cette survivance et appropriation de pratiques pré-chrétiennes dans le pèlerinage irlandais s’observe d’autant plus que l’Eglise celte primitive était plus ouverte au syncrétisme que ne l’étaient les autres Eglises européennes et a donc bien plus conservé et « baptisé » les sites sacrés anciens et les pratiques qui y étaient associées. 34% des sanctuaires de l’île seraient d’ailleurs des centres religieux pré-chrétiens, contre seulement 5% pour l’ensemble de l’Europe (Nolan, 1983).
Document 2 : Pratiques rituelles de l’espace au sanctuaire de Knock

(Cliché : M.-H. Chevrier, 17/05/2015)
Toutes ces pratiques rituelles sont des manifestations culturelles et s’accompagnent d’autres particularismes dans les manières de prier et les comportements. De ce fait, les sanctuaires sont de véritables « conservatoires ». Tandis que, dans les sites touristiques, ces particularismes sont la plupart du temps « mis en scène » à travers des reconstitutions, ils sont ici totalement vécus : ces rites religieux ne sont pas une simple reconstitution de rites traditionnels. Pour les fidèles, ils ont toujours une réelle efficacité.
B. L’incarnation du sacré dans l’espace du sanctuaire : Knock, un lieu efficace
L’Irlande a la particularité de compter bien davantage de sanctuaires directement liés à des faits topographiques et paysagers (cf. document 1) et donc fondamentalement localisés que les autres pays européens dont les sanctuaires sont d’abord construits autour d’images ou d’objets sacrés et seulement ensuite associés à un lieu. En 1983, M.L. Nolan dénombre 113 sanctuaires « actifs » en Irlande. Sur ceux-ci, 92% sont « intimement associés à des caractéristiques topographiques ou à des formations végétales » (Nolan, 1983). Dans tous ces lieux, les croyants cherchent le contact physique direct avec ce lieu ou cet objet précis, suivant des rituels particuliers.
Ces pratiques très spécifiques impliquant la relation à l’espace, adaptées au christianisme dans le cas du sanctuaire de Knock, sont à mettre en lien avec un élément primordial dans les lieux de pèlerinage : leur participation à l’efficacité liturgique. Lorsqu’un phénomène surnaturel se produit dans un lieu, ce dernier acquiert, aux yeux des croyants, un caractère saint. Le lieu saint est celui qui « ne suppose pas nécessairement la fréquentation cultuelle et est fréquenté indifféremment par le clerc et le laïc » (Levatois, 2012). Il symbolise l’alliance entre Dieu et les hommes. Ce n’est qu’une fois qu’il a été ensuite consacré par l’institution religieuse et, dans le cas de l’Eglise catholique, par la célébration de la dédicace, qu’il devient un lieu sacré, du fait de l’efficace du rituel de consécration. En théologie, l’efficace consiste dans le fait qu’une parole et un acte produisent réellement un effet et non pas uniquement symboliquement. Il est ainsi question de l’efficacité des sacrements : les paroles et les actes du prêtre sont performatifs et transforment la nature même des personnes, lieux et objets. Ainsi, lorsqu’un espace est consacré, il change de nature et devient réellement un espace sacré. A Knock, après la consécration du lieu, un autel a été construit au pied du mur de l’église des apparitions, permettant la célébration des sacrements à l’endroit exact de l’apparition, lui donnant un caractère canoniquement sacré et rendant Dieu effectivement présent (cf. document 3).
Document 3 : Installation postérieure à la consécration du lieu de l’apparition : chapelle des apparitions adossée au mur de l’église paroissiale, renfermant un autel et un ensemble statuaire
(Cliché : M.-H. Chevrier, 18/05/2015)
Du fait de cette nature sacrée, l’espace acquiert, aux yeux des croyants une efficace propre, liée à la fois à la hiérophanie, à la consécration et aux pratiques rituelles qui y sont accomplies. Pour les visiteurs, cette distinction entre lieu saint et lieu sacré n’est pas nette, les deux étant généralement amalgamés dans les perceptions et représentations des visiteurs. Pour eux, la sacralité vient du fait même de l’apparition. Ainsi, dans les lieux de pèlerinage, le sacré « ressenti » diffère du sacré « institutionnalisé » et devient plus intense, les visiteurs étant plus prompts à conférer à l’espace et à ses attributs (objets, sources, etc.) des propriétés miraculeuses : étant donné que l’espace est sacré, le fait de l’arpenter (réaliser la circumambulation) ou le toucher permettrait d’obtenir des grâces particulières.
De ce fait, plus que l’aspect historique et architectural du sanctuaire, c’est bien l’expérience vécue dans le lieu qui prime aux yeux des visiteurs. Parmi les champs lexicaux utilisés lorsqu’il leur est demandé de donner les trois mots qui caractérisent le mieux le sanctuaire, dominent celui du ressenti (« enthousiasmant », « émouvant », « réconfort ») et celui de l’atmosphère du lieu (« paisible », « calme »). Vient seulement ensuite le champ lexical du spirituel (Chevrier, 2016). Cette capacité à provoquer des émotions et des effets physiques sur les visiteurs, liée au sacré, fait partie de l’efficace des lieux de pèlerinage qui, elle-même, assure la pérennité des sanctuaires.
C. Un sanctuaire dont la configuration et la gestion sont en constante évolution
Cet attrait, jamais démenti, qu’exerce le sanctuaire de Knock, a des conséquences sur son évolution spatiale. Il doit être adapté à tous les visiteurs, à la fois en termes de capacités d’accueil et en termes humains et théologiques. Le sanctuaire de Knock partage avec tous ceux de l’Eglise catholique le fait d’être à la fois générique (organisation spatiale identique dans tout lieu de culte catholique) et exceptionnel (caractères strictement individuels liés à son histoire particulière). Il partage également avec les autres grands lieux de pèlerinage le fait d’avoir connu une évolution spatiale remarquable et constante. A Knock, un lieu de culte préexistait à l’événement qui a été à l’origine de la fondation du sanctuaire. Une difficulté, cependant, provient du fait que l’apparition a lieu à l’extérieur de l’église. C’est ce mur extérieur qui attire alors les visiteurs, non plus l’intérieur de l’église paroissiale qui devient vite trop exigüe pour accueillir tous les visiteurs. En 1940, un premier oratoire et ensemble statuaire représentant les apparitions sont inaugurés devant le pignon de l’église, en faisant le nouveau centre du sanctuaire et étendant la superficie du lieu de culte. Cette installation cultuelle est complétée en 1949 par un nouveau bâtiment dédié à l’accueil des personnes malades. Le nombre de visiteurs étant toujours en augmentation, des travaux d’agrandissement débutent à la fin des années 1960, sous l’impulsion du Père James Horan (cf. document 4). Sont ainsi créés, autour de la chapelle des apparitions, un hôtel pour les personnes malades (St Joseph’s Rest House), un chemin de croix, un musée et une nouvelle basilique dont la construction commence en 1973 et s’achève en 1976. Elle peut accueillir environ 10 000 personnes, soit autant que la Nouvelle Basilique de Guadalupe à Mexico (lieu de pèlerinage catholique le plus visité au monde), inaugurée la même année. L’aménagement de nouveaux équipements dans le périmètre du sanctuaire de Knock reprend ensuite à la fin des années 1980, avec notamment la construction d’un complexe associant la chapelle de la Réconciliation et un centre d’aide psychologique, en vis-à-vis de la chapelle des apparitions. En une centaine d’années, la petite église paroissiale s’est transformée en un grand centre cultuel rayonnant à l’échelle internationale, dont l’ensemble des infrastructures occupe deux bons tiers de la superficie du noyau villageois.
Le cas de Knock est représentatif de l’évolution que connaissent la majorité des principaux sanctuaires catholiques : ils s’agrandissent avec de nouveaux bâtiments dont l’architecture est en phase avec les canons de l’époque. Cette évolution n’est cependant pas qu’architecturale. Elle concerne également les pratiques des visiteurs, en lien avec les orientations pastorales du sanctuaire qui approfondissent le message propre au lieu. Le sanctuaire de Knock a ainsi choisi de se centrer spécifiquement sur le sacrement de la réconciliation, d’où la création d’une chapelle spécifique dans les années 1980, où des prêtres sont disponibles en permanence pour les 4000 confessions qui sont demandée en moyenne chaque semaine pendant la saison du pèlerinage (Chevrier, 2016). Afin de mettre en adéquation l’évolution des pratiques, la fréquentation toujours importante du lieu et ses orientations pastorales propres, le recteur actuel du sanctuaire a mis sur pied un important programme baptisé « Witness to Hope » (2014-2017) et articulé autour de trois piliers : un axe « renouvellement de la foi » (séminaires et retraites) ; un accent plus important mis sur la promotion du sanctuaire en Irlande et à l’étranger ; et la remise à neuf de la nouvelle basilique (Neary, 2015). Outre les professionnels intervenant pour les aspects techniques et matériels, ce sont aussi les paroissiens qui se mobilisent bénévolement à l’appel du recteur. Ils œuvrent ainsi à l’accueil des visiteurs, à la distribution du matériel promotionnel, etc. Le lieu de pèlerinage, s’il n’a pas suscité un développement urbain conséquent comme cela a été le cas à Fatima et à Lourdes, a néanmoins été le siège d’une transformation nette du village, à la fois spatiale (extension du site du sanctuaire), mais aussi économique (passage d’une économie fondée sur l’agriculture à une autre reposant sur l’accueil des visiteurs).
III. Une valeur sacrée conceptuellement étendue mais spatialement condensée, moteur de développement pour Knock
Le cas du sanctuaire de Knock montre que les lieux de pèlerinage catholiques ne sont pas figés. Leur caractère sacré leur donne, dans un contexte de sécularisation de l’espace et du temps publics, une valeur majorée : ce sont les conservatoires de cette valeur sacrée religieuse qui devient patrimoine. Mais ils demeurent également des lieux de culte actifs pour les croyants et l’exemple du programme « Witness to Hope » montre que les sanctuaires sont aussi des laboratoires permettant de travailler sur l’évolution de la valeur sacrée elle-même qui se détache progressivement du religieux.
Document 4 : Plan du sanctuaire de Knock actuel et de ses différentes infrastructures

A. « Notre Dame de Knock, Reine d’Irlande » : quand le sacré devient laïc
L’Irlande, au XIXe, occupe une place très spéciale à l’échelle mondiale : seul pays catholique de langue anglaise, elle constitue de ce fait une enclave dans l’Empire britannique. Pour beaucoup d’historiens, les communautés irlandaises expatriées auraient alors exercé, dans la seconde moitié du XIXe et au début du XXe siècle, une sorte d’impérialisme spirituel dans les pays récepteurs (Roddy, 2016). Il faut cependant bien noter l’aspect transnational qui se joue ici. Certes, les migrants irlandais apportent avec eux leur foi et leurs pratiques catholiques mais les Irlandais de l’étranger ont également une influence non-négligeable sur l’évolution du catholicisme en Irlande, par le biais de fondations, de donations et par les lettres échangées avec les parents restés au pays où s’opère, selon l’expression d’Emmet Larkin une « révolution dévotionnelle » (Larkin, 1972). Celle-ci participe à lier l’identité irlandaise au catholicisme.
L’apparition de Knock vient alors, en 1879, incarner cet attachement des Irlandais à la foi catholique et lui donner un point d’ancrage géographique. Le combat politique qui se joue dans la région de Knock à cette époque autour des questions agraires oppose Irlandais et Anglais. L’apparition de la Vierge aux Irlandais en difficulté a dès lors une coloration politique. Dans la théologie chrétienne, la Mère du Christ vient en aide aux opprimés (figure de Marie Auxiliatrice). L’apparition de Knock met donc, figurativement, Dieu du côté des Irlandais et le lieu devient alors un centre religieux à l’échelle nationale. L’analogie avec Lourdes, couramment reprise par les médias, est tout-à-fait significative. Ces grands sanctuaires (Knock, Lourdes, Fatima, Częstochowa, Guadalupe) deviennent des symboles nationaux. La Vierge Marie devient quant à elle une figure tutélaire pour les Irlandais, d’autant plus que le culte de la Vierge fait partie des pierres d’achoppements de la rupture entre protestants et catholiques et permet donc de se distinguer clairement des Anglais majoritairement anglicans et rattachés au protestantisme. Quelques années après la proclamation de l’Etat libre d’Irlande (1922), le pèlerinage à Knock prend une coloration politique. Le grand pèlerinage de 1929 est l’occasion de célébrer l’indépendance de l’Irlande par des démonstrations de patriotisme, qui culmine plus tard avec la proclamation de Notre Dame de Knock « Reine d’Irlande et Reine de la Paix » durant la seconde guerre mondiale. Ce titre devient effectif avec la cérémonie du couronnement de la statue de Notre Dame de Knock au sanctuaire, le 8 décembre 1954, autorisée par le Pape seulement un an après le couronnement de la Reine Elisabeth II en Grande-Bretagne (juin 1953) et comme en écho à celui-ci (Turner, 2009).
Notre Dame de Knock, Reine d’Irlande est aussi la figure tutélaire à laquelle se rattachent les Irlandais de l’étranger. A la cathédrale St Patrick, à New-York, l’hymne « Our Lady of Knock », composé en 1981, est traditionnellement entonné lors des festivités de la Saint Patrick. Cet hymne est également repris lors de la quasi-totalité des cérémonies de funérailles irlandaises (en Irlande et à l’étranger), marqueur de l’appartenance à la nation irlandaise (Chevrier, 2016). Le musée du sanctuaire ne se contente d’ailleurs pas de relater les apparitions et le développement du pèlerinage, il met en avant la culture irlandaise et la place que tient Knock dans la vie du pays et pour les Irlandais de l’étranger. Cet angle est de plus en plus développé par les autorités du sanctuaire qui renforcent les liens avec la communauté irlandaise aux Etats-Unis en organisant de grands pèlerinages transatlantiques (premiers vols de pèlerinage transatlantiques accueillis à Knock en 2015).
B. Un espace sacré pratiqué différemment par les pèlerins et les visiteurs séculiers
Le sanctuaire de Knock est bien un espace doublement sacré : d’un point de vue religieux mais aussi d’un point de vue laïc car il est devenu un élément de l’iconographie irlandaise (Gottmann, 1952). Preuve en est le mode de prise de connaissance du lieu par les visiteurs : une enquête réalisée en 2015 montre que 74,5% des visiteurs interrogés au sanctuaire en ont découvert l’existence via le bouche-à-oreille, proportion qui monte à 87% si l’on ne prend en compte que les visiteurs Irlandais (Chevrier, 2016). Ce bouche-à-oreille se fait au sein de la famille, de génération en génération et traduit une différence importante entre lieux de pèlerinage et lieux uniquement touristiques : alors que les lieux touristiques sont fortement dépendants du discours médiatique, les sanctuaires peuvent s’en affranchir. Leur fréquentation n’en dépend pas, elle peut simplement s’en trouver augmentée.
La volonté de l’actuel recteur du sanctuaire, clairement affichée dans les objectifs du programme « Witness to Hope » est justement d’assurer la promotion du lieu à l’étranger pour que celui-ci soit fréquenté plus largement. L’accent est mis sur les Etats-Unis, le recteur espérant toucher la jeune génération d’Américains d’ascendance irlandaise. Cette médiatisation n’est pas seulement à destination des catholiques, bien au contraire, et si elle peut se faire aussi largement, c’est en grande partie du fait de la sécularisation des sociétés qui vient renforcer l’attrait pour le sacré (qu’il soit religieux ou laïc). Avec la sécularisation, en effet, les espaces ayant connu une hiérophanie, puis ayant été « officialisés » comme sanctuaires, sont désormais saisis en tant que patrimoine et attirent de ce fait des visiteurs non-croyants. L’arrivée de ce nouveau profil de visiteurs, totalement novices concernant le culte catholique, se traduit dans l’espace par les pratiques des visiteurs d’une part, et par les moyens mis en place pour les accueillir d’autre part (module d’information, personnel et bénévoles disponibles, brochures multilingues).
Les pratiques spatiales des visiteurs varient suivant plusieurs paramètres : la durée de leur séjour dans le lieu de pèlerinage, le fait que leur visite soit individuelle ou collective, ainsi que leur appartenance ou non à l’Eglise catholique (avec des variations selon leur degré d’appartenance) qui détermine leur familiarité avec ce type de lieux. A Knock, les différences de pratiques sont très nettes. Les groupes de touristes ont une vision très limitée de l’espace du sanctuaire : arrivés en car, ils se garent sur le parking jouxtant le sanctuaire et disposent d’entre quinze et trente minutes dans le sanctuaire, n’ayant bénéficié que d’explications très rapides de leur guide. Leur pratique de l’espace est alors guidée par leur regard (cf. document 4) : ils se dirigent en premier lieu vers ce qui est le plus visible, c’est-à-dire la nouvelle basilique dont ils font rapidement le tour et dont ils pensent que c’est le cœur du sanctuaire. Certains se dirigent ensuite vers la chapelle des apparitions toute proche et beaucoup cherchent la boutique pour ramener des médailles, souvenir de leur passage rapide. Tous prennent en photo les édifices qui, à leurs yeux, sont les plus imposants (majoritairement la nouvelle basilique et la chapelle des apparitions). Les touristes venus seuls s’accordent plus de temps pour visiter le lieu (une à deux heures), dont ils ont déjà une connaissance approximative grâce aux guides qu’ils ont lu avant leur visite. Beaucoup se rendent au point d’information pour prendre un plan et demander ce qu’il faut voir. Eux aussi sont généralement d’abord attirés par la nouvelle basilique du fait de son caractère imposant, mais ils prennent ensuite le temps de parcourir l’ensemble de l’espace du sanctuaire, librement, sans chercher à suivre un itinéraire particulier. Passant, comme les groupes de touristes, à la boutique, beaucoup de ces visiteurs prennent également le temps d’allumer une bougie dans le grand brûloir jouxtant l’église paroissiale. Le café-restaurant et le musée jouissent aussi d’un certain succès auprès de ces visiteurs venus le plus souvent par intérêt culturel.
La pratique de l’espace des pèlerins (qu’ils viennent individuellement ou en groupe) est bien distincte de celle des touristes. Ils viennent, très majoritairement, pour une journée entière. Leur itinéraire n’est pas contraint et ils vaquent librement dans tout l’espace du sanctuaire. Cependant, une grande majorité d’entre eux commence par se rendre (plus ou moins brièvement) dans la chapelle des apparitions. Au cours de la journée, la plupart accomplissent les différents rituels (circumambulation autour de la chapelle, passage aux fontaines, réalisation du chemin de croix, prière du rosaire) et bénéficient des sacrements en assistant à une des nombreuses messes célébrées quotidiennement dans les différentes églises et chapelles du site et en allant se confesser. Ils ont une connaissance bien plus fine de l’ensemble des infrastructures du sanctuaire et donnent un sens théologique à leur pratique de l’espace.
Il se produit ainsi une forme de dédoublement de l’espace au sein du sanctuaire, propre aux lieux de pèlerinage patrimonialisés : celui des pèlerins et celui des visiteurs séculiers. Tout l’enjeu, pour les autorités ecclésiastiques, est de réconcilier ces deux espaces pour assurer la cohabitation des différents profils de visiteurs.
C. Un sanctuaire moteur de développement territorial et économique régional
L’arrivée de visiteurs séculiers de plus en plus nombreux dans les lieux de pèlerinage représente une réelle opportunité de développement territorial et économique, bien cernée par les autorités religieuses mais également civiles (Chevrier, 2016). Le sanctuaire de Knock est particulièrement remarquable de ce point de vue car, dès les années 1960, ce potentiel de développement a été bien saisi par les autorités locales.
Durant le demi-siècle qui a suivi l’apparition, aucun réel aménagement n’a été fait autour de l’église paroissiale de Knock. Les pèlerins affluaient mais étaient accueillis dans des conditions précaires, particulièrement difficiles pour les malades. Ce n’est qu’en 1935 que commence à s’organiser le pèlerinage, à l’initiative d’un couple de laïcs, William David et Judy Coyne qui ont été marqués par la gestion des pèlerinages et de l’hospitalité lors de leur pèlerinage à Lourdes. Ils entendent structurer le sanctuaire de Knock sur le modèle de Lourdes, avec la volonté d’en faire un moteur de développement pour la région et, malgré la réticence initiale des autorités ecclésiastiques, fondent en 1935 la Knock Shrine Society. Cette association d’hospitaliers prenant soin des personnes malades durant leur pèlerinage impulse la création d’infrastructures adaptées au sein du sanctuaire, ce qui permet une augmentation de la fréquentation du lieu. Les villageois se mobilisent également, se reconvertissant en hôteliers (système Bed & Breakfast largement dominant), restaurateurs, fleuristes, petits commerçants. Plus de 70 petites affaires locales sont ouvertes. De leur côté, les autorités civiles agissent également : elles réalisent des travaux d’élargissement des rues du villages et des routes qui y mènent et construisent un petit centre commercial et un nouveau parking (Shackley, 2006).
Conscient de l’importance symbolique prise par le sanctuaire au niveau national et international, le Père James Horan, recteur du sanctuaire à partir de 1967, veut en faire un moteur du développement économique régional. Cet intérêt porté au territoire local, et non seulement au sanctuaire, de la part des autorités ecclésiastiques est relativement unique. Non content d’avoir restauré de fond en comble le sanctuaire, le P. Horan souhaite faire du sanctuaire un atout économique pour la région. Cette partie du pays était en effet en difficulté, notamment du fait de sa mauvaise desserte par les infrastructures de transport. Le recteur du sanctuaire, très en lien avec les autorités civiles, propose donc la construction d’un aéroport à une vingtaine de kilomètres du village, arguant de l’importance du flux de pèlerins nationaux et internationaux. L’aéroport international de Knock – Irlande Ouest est inauguré en 1985, avec trois vols directs d’Aer Lingus (compagnie nationale irlandaise) pour Rome. L’aéroport est désormais le 4ème du pays, avec 750 000 passagers par an et le recteur du sanctuaire ainsi que l’archevêque de Tuam font partie de son conseil d’administration. Les autorités ecclésiastiques entretiennent des liens importants avec les autorités civiles de Knock et de la région, le religieux et le civil fonctionnant en bonne harmonie. La sécularisation n’a pas remis en cause cette entente. Au contraire, elle renforce la coopération, nécessaire pour accueillir les nouveaux visiteurs séculiers qui participent à l’économie de la région. Des événements internationaux organisés par le sanctuaire telles que les visites pontificales sont de formidables opportunités économiques pour toute l’Irlande de l’Ouest. La venue du Pape François en août 2018 a ainsi attiré 45 000 visiteurs en une seule journée mais également mis le sanctuaire sur le devant de la scène médiatique dans le monde entier, suscitant l’intérêt d’organisateurs de pèlerinages et d’opérateurs touristiques.
Conclusion
Le sanctuaire de Knock est un cas exemplaire des plus grands lieux de pèlerinage catholiques. Développé suite à une hiérophanie très particulière, il a tout de suite été reconnu comme un site sacré par la population et fréquenté pour cette raison, entraînant sa reconnaissance officielle par les autorités de l’Eglise. La valeur sacrée est mise en scène dans l’espace du sanctuaire, à travers la statuaire reproduisant l’apparition, mais aussi à travers les constructions d’édifices religieux parfois spectaculaires qui ont accompagné l’extension du pèlerinage. Cette valeur sacrée est également mise en scène par les visiteurs eux-mêmes, dans leur manière de parcourir l’espace selon certains rites. Au fil des années, Knock a intégré l’iconographie irlandaise, au point que la valeur sacrée n’est plus seulement religieuse mais a en outre une composante laïque. Knock est un des symboles de l’Irlande, ce qui permet au sanctuaire de s’intégrer dans le contexte de sécularisation de la société. Il devient, comme les autres grands lieux de pèlerinage, un conservatoire du sacré, d’autant plus valorisé que ce sacré s’efface de l’espace public. Il est aussi un conservatoire de l’identité irlandaise. En tant que tel, il est alors patrimonialisé et attire désormais des visiteurs non-croyants, qui se singularisent par leurs pratiques spatiales au sein du sanctuaire. Les lieux de pèlerinage tels que Knock deviennent ainsi des observatoires de la sécularisation de la société.
Bibliographie
Barjot D. (dir.), Mathis C.-F. (dir.), 2009, Le monde britannique (1815-1931), Paris, Sedes, 363 p.
Brennan P. (dir.), 2012, La sécularisation en Irlande, Caen, Presses universitaires de Caen, 274 p.
Chélini J. (dir.), Branthomme H. (dir.), 1982, Les chemins de Dieu : histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours, Paris, Hachette, 493 p.
Chevrier M.-H., 2016, Pratiques et valeurs spatiales, pèlerines et touristiques. Grands et petits lieux de pèlerinage aujourd’hui, Thèse de doctorat en géographie, Université Lumière Lyon 2, 469 p.
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, 2003, Directoire sur la piété populaire et la liturgie. Principes et orientations, Paris, Bayard éditions – Fleurus-Marne – Les éditions du cerf, 252 p.
Durcan P., 1993, A Snail in My Prime. New and Selected Poems, Londres, Harvill/Harper Collins Publishers, 271 p.
Eliade M., 1965, Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, 187 p.
Gottmann J., 1952, La politique des Etats et leur géographie, Paris, Armand Colin, 228 p.
Lacoste J.-Y., 1998, Dictionnaire critique de théologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. Quadrige, 1587 p.
Larkin E., 1972, « The Devotional Revolution in Ireland, 1850-75 », The American Historical Review, vol.77, n°3, p.625-652.
Laurentin R. (dir.), Sbalchiero P., 2012, Dictionnaire des « apparitions » de la Vierge Marie, Paris, Fayard, 1432 p.
Levatois M., 2012, L’espace du sacré. Géographie intérieure du culte catholique, Paris, Editions de l’Homme Nouveau, 148 p.
Neary T., 2015, Milestones of Knock. Celebrating 80 years of Knock Shrine Society and its service to the shrine, the pilgrims and the sick, Knock, Knock Shrine Society.
Nolan M. L., 1983, « Irish Pilgrimage: The Different Tradition », Annals of the Association of American Geographers, vol. 73, n°3, p.421-438.
Roddy S., 2016, « Mass Migration’s Impact on Irish Catholicism: An Historical View » dans Pasura D., Bivand Erdal M. (ed.), Migration, Transnationalism and Catholicism. Global Perspectives, Londres, Palgrave Macmillan, 366 p.
Shackley, M., 2006, « Empty bottles at sacred sites. Religions retailing at Ireland’s national shrine » dans Timothy D.J., Olsen D.H., Tourism, Religion and Spiritual Journeys, Londres, Routledge, p.94-100.
Tsvetkov Y., 2017, Atlas mondial des préjugés (NE), Paris, Les Arènes, 112 p.
Turner E., 2009, « Legitimization or suppression? The effect of Mary’s appearances at Knock, Ireland » dans Hermkens A.-K., Jansen W., Notermans C. (ed.), Moved by Mary. The Power of the Pilgrimage in the Modern World, Farnham, Ashgate Publishing Limited, p.201-214.
Penser la géologie dans la géographie militaire française (1871-1914) | Publié le 2019-05-29 17:58:02 |
Par Philippe Boulanger (Professeur à Sorbonne Université Lettres (1)
Résumé : La géographie constitue un savoir stratégique, opérationnel et tactique qui est longtemps resté empirique. Elle tend à se construire plus précisément à partir du XIXesiècle en Europe, notamment en s’appuyant sur la géologie. En France, la géographie militaire forme un véritable courant de pensée après la défaite face à la Prusse en 1870, dont l’intérêt est de se préparer à la prochaine guerre face à l’Allemagne. Ses théoriciens tendent à concevoir des méthodes scientifiques et des finalités qui doivent la rendre opérationnelle. La géologie est ainsi considérée comme l’approche fondamentale, mais pas unique, de la manière de penser le territoire à des fins militaires jusqu’à la Grande Guerre. Des théories élaborées sont diffusées dans de multiples études comme enseignées dans les écoles militaires. Comment le primat de la géologie s’est-il imposé dans la géographie militaire française jusqu’en 1914 ?
Mots-clés : Géologie, Géographie militaire, Géologie, Grande Guerre, Epistémologie
Abstract: Geography is strategic, operational and tactical knowledge that has long been empirical. It tends to be built more precisely from the 19th century in Europe, in particular by relying on geology. In France, military geography formed a real stream of thought after the defeat of Prussia in 1870, whose interest was to prepare for the next war against Germany. His theorists tend to design scientific methods and purposes that should make it operational. Geology is thus seen as the fundamental, but not unique, approach to thinking about the territory for military purposes until the Great War. Developed theories are disseminated in multiple studies as taught in military schools. How did the primacy of geology prevail in French military geography until 1914?
Keywords: Geology, Military geography, Epistemology, Great War, France
Introduction
La géologie est un domaine de pensée essentiel dans la géographie française à la fin du XIXesiècle et au début du XXesiècle. La culture militaire n’échappe pas à cette situation. L’étude de l’agencement des roches et des structures les affectant est une approche fondamentale, voire originelle, des débuts de la géographie militaire française. En effet, à partir des années 1870, la géographie militaire française s’impose comme un mouvement de pensée jusqu’aux années 1930, non sans retard par rapport à d’autres pays comme l’Espagne ou l’Allemagne. L’expression qui est diffusée par le professeur Théophile Lavallée à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr à partir de 1832, entre dans les dictionnaires militaires à la fin du siècle. Par exemple, le Nouveau dictionnaire militairepublié en 1892 la définit comme l’étude de la géographie d’un point de vue militaire en comprenant les mathématiques, les statistiques, la géographie politique et économique ainsi que la géographie physique (Anonyme, 1892). Il définit aussi la géologie révélant sa prépondérance pour l’activité militaire : « La géologie est l’étude de la terre à ses différents âges. Elle s’occupe de la forme et de la disposition des masses minérales qui constituent l’écorce solide du globe terrestre. Cette étude peut être très utile au général, à l’officier d’état-major et au topographe, parce qu’elle peut servir de base à des opérations de guerre, à des combinaisons stratégiques, à des plans de batailles, etc. » (Ibid.). Au cours de cette période de reconnaissance et de développement de la discipline géographique dans la culture militaire (écoles militaires, doctrine, études stratégiques), la géologie est une colonne vertébrale de tout raisonnement à des fins militaires. Elle propose, somme toute, une méthode scientifique bien commode et permet d’élaborer des hypothèses liées à la manœuvre de manière solide. En fait, l’un des paradoxes est que son succès contient les germes de sa remise en cause durant la Grande Guerre et de sa mutation au début des années 1920. Les théories déterministes se sont révélées inutiles dans la guerre de position à l’automne 1914, de sorte que la place de la géologie est repensée au profit de la géographie humaine. Comment la géologie s’impose comme un mode de raisonnement scientifique dans la géographie militaire française ? Trois aspects sont abordés : la géologie à l’origine de la géographie militaire française, penser la géographie militaire par la géologie, les limites du raisonnement fondé sur la géologie.
I. La géologie à l’origine de la géographie militaire
A. Une approche essentielle dans le développement des écoles latines et germaniques
Comme l’a montré Hervé Coutau-Bégarie dans le Traité de stratégie, la géographie militaire est une approche de la géographie à des fins stratégiques qui naît au début du XIXesiècle (Coutau-Bégarie, 1999). En tant que mouvement de pensée, différentes écoles se développent en Europe à partir des années 1810 et 1820. La raison est liée à la volonté de s’opposer aux armées napoléoniennes considérées comme des occupants que ce soit en Prusse, en Espagne ou dans les États de la péninsule italienne. L’analyse géographique devient ainsi un des moyens de contourner la puissance française en apportant un savoir stratégique et une connaissance du terrain. Les théoriciens de la stratégie qui ne sont pas géographes ont bien compris toute son importance pour les États-majors. Karl Von Clausewitz (1780-1831), acteur de la réorganisation de l’armée prussienne après la bataille d’Iéna de 1806, est nommé directeur de l’Académie de guerre de Berlin (1818-1830) où il valorise l’enseignement de la géographie. Son ouvrage De la guerre(1816-1831) accorde une place théorique mais importante aux territoires et à l’espace (montagnes, cours d’eau, etc.). Le stratégiste d’origine suisse Jomini (1779-1869), après avoir servi à l’Etat-major de Ney en 1805 puis du Tsar en 1813, rédige un Traité de grande tactique(1805) puis le Précis de l’art de la guerre(1837) qui accorde un chapitre à la prépondérance de la géographie militaire et de la statistique. À cette époque, ces deux auteurs témoignent d’un mouvement qui s’inscrit plus largement en faveur de la géographie militaire et conduit par des officiers qui présentent un raisonnement lié à l’espace.
Cette dynamique en faveur de la géographie militaire donne naissance à des écoles de pensée, d’abord dans les pays latins comme le royaume d’Espagne et dans les États italiens, puis dans les États germaniques comme la Prusse. Tous les écrits publiés dans les années 1810 à 1830 s’appuient, d’abord, sur la géographie physique, plus précisément sur la géologie. En Espagne, par exemple, le général Juan Sanchez-Cisneros, dans Elementos de geographica fisica aplicada à la cienca de la guerra(1819), présente la manière d’exploiter la géologie pour la défense du territoire. Dans la péninsule italienne, la géographie militaire se développe pour la même raison tout en contribuant à la question de l’unité italienne. Dans les territoires germaniques, la Prusse devient une autre « Terre d’élection ». Le Terrainlehredevient une science reconnue tandis qu’une section de cartographie est créée auprès de l’Etat-major dès 1816.
La Militar Geographieparticipe elle-aussi à réfléchir aux moyens défensifs du territoire, à la construction territoriale de l’unité allemande et à la Mitteleuropa. Entre autres exemples, le Maréchal Von Roon, dans Principes de géographie (1834) et dans Géographie militaire de l’Europe (1837), suit le même principe : envisager la prochaine guerre offensive et défensive à partir de la géologie et de la géographie physique. Dans l’Empire austro-hongrois, un Institut de géographie militaire est créé à Vienne tandis que plusieurs officiers enseignent et publient des traités de géographie militaire. Le colonel Von Rutdorffer élabore une Géographie militaire de l’Europe(1847) selon une approche descriptive et encyclopédique des connaissances de la Terre fondée sur la géologie, l’orographie et l’hydrographie. Dans l’Empire russe, en Roumanie, en Suisse, et au sein d’autres États européens à l’exception de la France et du Royaume-Uni, des mouvements de pensée contribuent à des productions scientifiques élaborées de manière inédite.
B. Une approche encore marginale en France avant 1870
Aux lendemains du Traité de Vienne de 1815, l’armée française est réorganisée de sorte qu’elle ne puisse plus être un obstacle à la stabilité du continent européen. Cette situation explique en grande partie le retard de la géographie militaire française jusqu’aux années 1870. Pourtant, l’expression de géographie militaire est déjà formulée dans le projet de la Convention d’une Agence des cartes au Dépôt de la guerre, en juin 1794, qui ne voit jamais le jour. Elle est reprise en 1832 par Théophile Lavallée dans ses cours à partir de 1832, puis son manuel intitulé Géographie physique, historique et militaire (Lavallée, 1832). Cet ouvrage connaît sept éditions jusqu’à sa mort en 1869 puis trois autres dans les années 1870. Professeur de géographie et de statistique à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, il est le premier véritable théoricien français de la géographie militaire. Son approche demeure académique en abordant une partie théorique sur les aspects physiques de la Terre et une partie régionale descriptive des bassins fluviaux dont l’étude s’achève par des considérations stratégiques.
La géologie apparaît centrale dans sa méthodologie en privilégiant, selon la conception académique de la géographie, la géographie physique selon les théories du XVIIIesiècle. Le découpage régional s’appuie sur les bassins fluviaux qui permettent de comprendre les modes d’appropriation et d’organisation de l’espace par les sociétés. Théophile Lavallée conçoit même une méthode de géographie militaire en sept temps : la géographie physique, l’histoire des territoires, les bassins fluviaux, les côtes et les ports militaires, les sous-ensembles des bassins fluviaux, les frontières terrestres et le tableau stratégique (militaire). Toute l’originalité de cette méthode consiste à exposer le lien entre la géologie, et la géographie physique de manière générale, avec des considérations stratégiques inspirées des guerres napoléoniennes. Jusqu’aux années 1870, il apparaît le seul en France à s’y consacrer pleinement, révélant ainsi l’absence de réel courant de pensée mais aussi des retards structurels et culturels dans l’armée française qui éclatent au grand jour lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871.
C. Une géographie militaire reconnue comme un savoir stratégique
Au milieu du XIXesiècle, force est de constater que la géographie militaire est reconnue comme un savoir stratégique dans les pays latins et germaniques. Dans les académies militaires et dans les services géographiques militaires, elle est valorisée comme un pilier de la formation des officiers et de l’activité militaire. Cette reconnaissance révèle ainsi une prise de conscience de son utilité sur le plan institutionnel mais aussi une conception structurée. Son originalité porte justement sur cet aspect par rapport aux siècles antérieurs. Elle se structure en une méthode d’emploi et tente de proposer des hypothèses de réflexion à des fins militaires et politiques. Dans le développement de ces écoles de pensée de géographie militaire, la géologie constitue justement l’approche la plus scientifique qui est constamment recherchée. L’incidence de la nature des roches sur l’emploi des hommes et du matériel, sur la manœuvre et les axes de passage apparaît comme une finalité de la discipline.
En revanche, la géographie militaire française demeure trop peu développée pour être efficace en 1870. Si les bases académiques sont posées par Théophile Lavallée, elle demeure encore très marginale et peu inscrite encore dans la culture militaire. Les déficiences face à l’armée prussienne à l’été 1870 sont nombreuses en la matière. Que ce soit l’approvisionnement en cartes d’état-major du territoire français ou le niveau de connaissances des officiers, la géographie ne forme pas une priorité de l’art de la guerre. Aux lendemains de cette défaite en 1871, l’armée française en mesure toute l’importance.
Les établissements d’enseignement militaire sont alors restructurés. La discipline géographique est rendue obligatoire tandis que le niveau des connaissances exigées aux concours est élevé. Enfin, la création du Service géographique de l’armée en 1887, dont la vocation est d’abord de produire des cartes topographiques, contribue aussi au développement d’une réflexion sur l’usage du facteur géographique pour les armées. Il en résulte la naissance d’une école française de géographie militaire qui conduit à penser la discipline d’abord par la géographie physique.
II- Penser la géographie militaire par la géologie
A. Une diversité de théories
Ce mouvement de pensée de géographie militaire française est à la recherche d’une reconnaissance scientifique par l’élaboration d’une méthode d’analyse. Selon la tradition académique française, la géographie est d’abord physique. Il n’apparaît donc pas étonnant que les théories qui s’imposent jusqu’à la Grande Guerre s’appuient sur la géologie, l’hydrographie et la climatologie. En fait, seule la méthode par la géologie et l’hydrographie s’inscrit dans la durée et donne lieu à une diversité de théories.
La première est celle des Joints d’assises terrestres du colonel du génie Joseph Napoléon Fervel. Elle est exposée, d’abord, dans plusieurs articles du Spectateur militaireen 1870, intitulés « Études de géographie stratégique du Nord-Ouest de l’Europe », puis reprise dans l’ouvrage Études stratégiques du théatre de guerre entre Paris et Berlinen 1873 (Fervel, 1873). La méthode est inspirée de celle suivie par l’État-major allemand en s’appuyant sur la géologie et les régions naturelles et en écartant la théorie des bassins fluviaux (2). Elle doit permettre d’identifier les espaces prévisibles de la prochaine guerre contre l’armée allemande. Les « joints d’assises terrestres » sont « les lieux les plus habituels des grandes batailles comme des grandes cités » (Fervel, 1870). Ils recouvrent étroitement « les bassins générateurs », caractérisés par leur unité géologique et ethnologique, et se juxtaposent aux « cases »des échiquiers de guerre. Ils peuvent se manifester, au-delà de leur dimension de lieu d’échanges historiques et de carrefour des communications, comme des lieux de rencontre culturelle. Fervel emploie l’expression de « barrières ethnologiques » pour désigner ces espaces de frontières culturelles, susceptibles d’apparaître comme des lieux d’affrontements armés entre deux peuples. Nombreux sont les exemples mis en évidence.
La région en amont de Magdebourg constitue l’un des champs de bataille prévisible de la prochaine guerre. En particulier, la plaine de Leipzig, « vers l’inévitable plaine de rassemblement qu’on a surnommée le carrefour des nations », est envisagée comme la base la plus rationnelle pour l’attaque du haut Elbe et de Berlin. Le Rhin, autre exemple significatif, sera l’enjeu et le théâtre d’un nouveau conflit, avant de devenir une fois encore une frontière naturelle. En somme, les opérations stratégiques sont soumises, de tout temps, aux« joints d’assises terrestres ». Cette approche, explique-t-il, justifie seule l’analyse des éléments physiques. La géographie militaire doit suivre des critères plus généraux, c’est-à-dire, « les contours des masses de même nature, les joints d’assises de la construction générale ». Elle s’appuie désormais sur les sillons des terrains, la géologie, la disposition des reliefs (l’orographie) et l’hydrographie.
La deuxième théorie est celle de la« géogénie » du commandant du génie Olivier Barré établie à la fin du XIXesiècle. Sa conception est, en réalité, classique et reformule l’idée que la géologie est à la base de la géographie militaire qu’il enseigne à l’Ecole d’application du génie et de l’artillerie. Elle est diffusée entre 1897 et 1899 dans ses cours imprimés en sept fascicules qui portent sur l’Europe, la France et les colonies françaises : l’histoire morphogénique de l’Europe centrale, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l’Autriche-Hongrie, l’Italie du Nord et l’Allemagne, les colonies d’Afrique et l’Asie (Barré, 1897-1899). Elle est synthétisée dans la Géographie militaire etles nouvelles méthodes géographiques, Introduction à l’étude de l’Europe centrale et La France du Nord-Est, édité chez Berger-Levrault en 1899(Barré, 1899a). Toute son œuvre tend à asseoir la géographie physique dans la géographie militaire et à lui accorder une place prépondérante. Elle se veut scientifique par l’étude de bases solides que l’auteur situe dans la nature du sol.« La méthode géomorphogénique est la méthode nécessaire de l’enseignement de la géographie physique. Mais celle-ci est la base obligée de toute étude géographique spécialisée et en particulier de la géographie militaire » (Barré, 1899b, p. 78).
Cette méthode s’articule à partir de trois éléments distincts en rapport avec la géologie. Le premier est relatif à« l’architecture générale » de l’espace, c’est-à-dire qu’il s’intéresse d’abord aux éléments physiques homogènes du milieu. Cette étape doit permettre de décrire les grands ensembles et procéder à des subdivisions régionales. Le second renvoie à« la nature des matériaux », à la composition des roches et à leur incidence sur la conduite de la guerre. Le dernier porte sur« la sculpture du sol », accidents du terrain et obstacles naturels qui se présentent à une armée en mouvement. Ces trois éléments fixent les fondements de la géogénie, laquelle est complétée par d’autres caractères, liés aux voies de communication et aux positions défensives, qui restent cependant secondaires par rapport au déterminisme imposé par le milieu. L’étude du sol constitue l’essentiel de l’analyse d’un espace en géographie militaire, car la géographie se comprend avant tout par la géologie. Barré vient à regretter que les géographes français aient négligé les travaux des géologues, comme ceux de Elie de Beaumont. Selon lui, la configuration du sol établit les conditions de la marche des armées dans une région déterminée, mais son approche doit rester suffisamment synthétique pour aborder les phénomènes de masse et les mouvements de guerre. Lorsqu’il aborde la division des ensembles géologiques dans la France du Nord-Est, il distingue trois unités géographiques, « la Terre rhénane, la dépression de la Saône, la Région parisienne orientale ».
Chacune d’entre elles constitue un théâtre d’opérations militaires bien distinctes. La première se compose d’une partie de la Terre rhénane et comprend les montagnes des Vosges et les plaines d’Alsace et du Palatinat rhénan, la Lorraine. La deuxième est composée de la haute vallée de la Saône, exposée directement à une invasion de l’armée allemande. Le troisième s’étend à toute la partie orientale de la région parisienne, de la Loire à Longwy. Ce théâtre d’opération présente la caractéristique de voir converger toutes les voies de communication provenant des deux premiers. Le principe de cette division régionale réside dans la distinction d’unités naturelles homogènes dont les périphéries sont des lieux de contact et de confrontation. Dans ces espaces en marge se situent les anciens et futurs champs de bataille selon l’avancée plus ou moins prononcée de l’adversaire. La démonstration stratégique consiste donc à comprendre d’abord ces unités naturelles dans leurs aspects géologiques et topographiques, puis à en déduire des hypothèses stratégiques allant jusqu’à proposer des aménagements de fortifications ou des plans d’opérations.
La troisième théorie est issue d’un auteur renommé parmi les géographes militaires puisqu’il s’agit de l’un des fondateurs de l’école française de géographie militaire. Gustave-Léon Niox (1840-1921), après une carrière brillante dans l’infanterie, est nommé professeur de géographie militaire dans la nouvelle Ecole supérieure de guerre en 1876. Il conserve ce poste jusqu’en 1895 après avoir été promu colonel en 1888 et officier général en 1893. Réputé pour son charisme et son talent oratoire, il forme ainsi plusieurs générations d’officiers français destinés à occuper des postes élevés au sein des États-majors. Il publie, surtout, ses cours de géographie militaire qui sont autant une encyclopédie en la matière : 7 ouvrages parus et réédités régulièrement entre 1876 et 1895. Le premier volume portant sur les Notions de géologie, de climatologie et d’ethnographieest édité en 1876 et réédité en 1878 et en 1880, puis sous le titre de La Franceen 1882 jusqu’à 1893 (4e édition) (Niox, 1876 ; 1882). Jusqu’en 1882, sa conception théorique de la géographie militaire est exposée dans ce premier volume. Elle s’appuie sur le même principe que l’étude de la géologie doit être le préalable à toute analyse de l’espace, idée qu’il modifie à partir des années 1880 pour accorder un raisonnement plus important à la géographie humaine. Selon Niox, la géologie détermine non seulement les conditions de développement d’une civilisation, mais aussi sa force militaire et sa capacité de s’imposer comme une grande puissance. Il admet que les opérations stratégiques sont commandées par les formes du relief, qui dépendent à leur tour de la composition géologique.
Ainsi, deux conditions principales fixeraient les hommes à s’établir dans une région et participeraient au développement d’un potentiel militaire. D’abord les richesses minéralogiques influencent « la manière d’être, de vivre, de travailler ». La « vitalité d’un pays, dont le développement est si intimement lié à sa prospérité agricole ou commerciale, dépend aussi en grande partie de la nature du sol » (Niox, 1878, p. 4). Il en déduit que la géologie intéresse la marche des armées. Sur un sol granitique, l’engagement des troupes reste possible par tout type de temps, contrairement au sol argileux qui se détrempe sous la pluie, rendant les routes impraticables, ou provoque une poussière pénétrante sous la sécheresse. La seconde condition s’explique par la fertilité des terroirs qui dépend de la constitution géologique des terrains et assure un potentiel de développement d’une société. Les « détails minéralogiques » constituent donc, selon lui, le premier critère d’analyse des nations. « La géologie vient en aide à l’histoire, permet des inductions utiles au militaire comme à l’homme politique et à l’administration » (op. cit., p. 5). Pour justifier cette théorie, Niox fait référence à la monarchie austro-hongroise divisée en deux grands États, différents par leurs mœurs, leur culture, leurs origines ethniques. Une ligne de démarcation s’appuyant sur des critères géologiques les sépare. Ainsi, en Hongrie, se situent les terrains composés de dépôts alluvionnaires occupés par les héritiers des envahisseurs magyares venant de l’Orient, de l’autre des terrains de soulèvement habités par des peuples de race allemande poussés par les invasions vers les contrées alpines considérées comme des refuges défensifs favorables. Ainsi, à l’origine de la géographie militaire, se découvre inévitablement le déterminisme de la géologie. « L’étude de la géologie d’un pays sera une initiative indispensable pour quiconque se propose d’en connaître les conditions morales, économiques, stratégiques ».
Pour Niox comme pour Fervel et Barré, l’apport de la géologie à la géographie militaire doit constituer une base de réflexion scientifique. En 1878, par exemple, Niox reconnaît que les méthodes empiriques employées en géographie doivent être remplacées par une « méthode scientifique sérieuse », c’est-à-dire par l’étude des roches car « l’ossature du sol, ses muscles, ses nerfs, sa vie pour ainsi dire, ses transformations qu’il faut comprendre et expliquer, et tout dans la nature ayant pour raison d’être une cause antérieure, c’est cette cause antérieure qu’il faut sans cesse remonter » (op. cit.,pp. XI-XII).
B. Une conception de la géographie militaire fondée sur la géologie
Ces trois théories traduisent, en réalité, un contexte de pensée qui atteste de la prépondérance de la géographie physique. Elles influencent toutes bien d’autres auteurs en géographie militaire jusqu’à la Grande Guerre. Leur portée est donc considérable pour plusieurs générations d’officiers et suscitent des débats entre eux. Elles présentent aussi le point commun de procéder à l’étude de la géologie pour comprendre le terrain. Or le terrain est la condition première de la conduite de la manœuvre. Le terrain commande l’action comme l’écrivent nombre de théoriciens de la stratégie ou de la tactique au XXe siècle. Certains font aussi référence à « la tyrannie du terrain ». Comment est ainsi envisagée la relation entre la géologie liée au terrain et l’art militaire ?
Tout d’abord, un premier niveau de réflexion se rencontre dans des considérations générales à travers l’ensemble des études. Le terrain est lié à la tactique, puis à des considérations stratégiques selon l’échelle géographique envisagée. Il importe de savoir pour le militaire la nature des sols (imperméables ou perméables), l’organisation du relief (axes des vallées et des sols), la composition de la végétation (l’obstacle formé par la forêt dont la nature dépend en partie des couches géologiques), la climatologie (vent, température). Ensuite, l’étude de la géologie conduit à analyser le terrain selon sa valeur défensive. Les accidents du sol peuvent offrir des avantages pour arrêter une avance ennemie, pour élaborer une fortification de campagne par exemple. Enfin, cette étude conduit à comprendre comment les couches géologiques déterminent l’occupation humaine et l’activité économique. Celles-ci influencent, pensent les géographes militaires, la densité de population, les capacités de production agricole, les ressources industrielles et commerciales. Ces trois niveaux de réflexion sont récurrents et révèlent une pensée déterministe.
À un autre niveau de réflexion, les composants géologiques constituent un des trois piliers de la géographie militaire avec la topographie et le climat. Ils exercent une influence dans la guerre de mouvement et de positions. Les sols sont ainsi classés selon leurs propriétés et leurs valeurs militaires s’ils sont meubles, sablonneux ou lourds. La nature des roches définit un cadre d’intervention plus ou moins facilité. La structure des sols conditionne les formes d’interventions militaires. La résistance et la perméabilité des roches qui varient selon les régions conduisent à des conditions d’action préétablies. Des sols peu résistants et perméables sont favorables au stationnement des troupes et au creusement de tranchées et d’abris. Les inondations dans les cantonnements souterrains ou à la surface se font rares sinon inexistantes. Les infections transmises par l’eau stagnante apparaissent aussi plus rares.
La géologie informe ainsi sur les conditions extérieures au combat, celles que les combattants rencontrent avant, pendant et après la bataille. Elle renseigne encore sur les matériaux disponibles pour l’organisation des défenses. Les roches sont généralement nécessaires et utilisées pour la construction de bâtiments et d’abris. Elles constituent une véritable ressource à exploiter à condition de disposer de personnel instruit et compétent. Enfin, elle permet d’envisager les conditions d’emploi du matériel, des systèmes d’armes et des hommes. Tout l’intérêt de la géographie militaire porte sur la maîtrise de la connaissance du terrain pour le militaire durant cette période. Parallèlement, il apparaît une autre dimension du raisonnement géographique. La géologie sert aussi à mieux préparer et conduire la guerre de mouvement.
C. La naissance de la « géologie militaire » pour la guerre de mouvement
Alors que la guerre de position et la fortification de campagne ne sont guère des principes dominants de la pensée militaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXesiècle, la guerre de mouvement est considérée par l’Etat-major général comme inévitable et la seule doctrine possible. Il apparaît donc cohérent que les géographes militaires s’intéressent à l’usage des couches géologiques pour comprendre les voies d’invasion, à l’influence des sols pour la mobilité et le transport. Les considérations apportées à des fins tactiques ou stratégiques apparaissent donc primordiales pour connaître les possibilités de mouvements sur les axes d’invasions, d’emploi des armes et des hommes sur de grands espaces. Il en résulte l’émergence de l’expression de « géologie militaire » dans plusieurs ouvrages à la fin du XIXesiècle, notamment ceux de Charles Clerc qui semble avoir été l’inventeur de cette expression en France. Charles Clerc défend cette conception de la géographie militaire dans Géologie militaire, les Alpes françaises(1882) et dans Géologie militaire, le Jura(1888) (Clerc, 1882 ; 1888).
Pour les géographes militaires, comme Laurent Pichat dans Géographie militaire du bassin du Rhin (1876), la géologie militaire joue un rôle important dans la guerre de mouvement (Pichat, 1876). Les roches déterminent des possibilités de déplacement élémentaires et conduisent les armées à faire face à des difficultés d’équipement plus ou moins importantes selon les cas. Il est ainsi considéré des modesde raisonnement préétablis. Sur les roches granitiques, la mobilité reste satisfaisante en toute saison et ne se heurte à aucune difficulté majeure. Sur les roches calcaires, les chemins deviennent plus difficiles, par la présence de la poussière sur le matériel et les hommes en été, par les pluies qui les rendent glissants. Sur les sols de craie pure ou légèrement marneux, peu de difficultés sont rencontrées. Il est reconnu que les pays crayeux facilitent les déplacements de masse et la coordination de tous les éléments qui composent les armées modernes comme le Vermandois et la vallée de l’Oise. Sur les sols argileux et marneux, les conditions de mobilité se durcissent lorsque la pluie ouvre de larges chenaux boueux. Les armées sont alors ralenties sinon alourdies par la boue. Cette catégorisation des roches par rapport à la mobilité fait partie de la conception de la géographie militaire jusqu’aux années 1930. Elle apparaît essentielle même dans la guerre de position durant la Grande Guerre alors qu’elle était envisagée pour la guerre de mouvement.
Dans Les conditions géographiques de la Grande Guerre, thèse de doctorat soutenue en Sorbonne en 1923, le géographe militaire Robert Villate s’en inspire et l’illustre de nombreux exemples tout en apportant des possibilités d’aménagement (Villate, 1925). Il considère que sur les sols argileux en temps de pluie il faut soit sortir de la zone comprenant ces sols déshérités, soit apporter suffisamment de matériaux pour ne plus en dépendre. Dans tous les cas, des sols marneux et argileux sont sources d’épuisement pour les soldats. En décembre 1914, le 21ecorps d’armée lance une offensive sur l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette au Nord d’Arras. Il échoue en raison de la nature du sol, argileux et imperméable. Les soldats peinent à sortir de la tranchée, glissent sur le sol et s’exposent ainsi maladroitement aux tirs de l’ennemi protégé.
Enfin, la conception de la géologie à des fins militaires présente aussi son intérêt pour l’emploi des armes, essentiellement l’infanterie, la cavalerie et l’artillerie avant 1914. Selon ces armes, la nature des roches n’exerce pas autant d’influence. Si les dispositions déjà citées sont considérées pour l’infanterie, la nature des sols occupe une place essentielle pour l’artillerie. Dans les roches meubles et imperméables, les obus s’enfoncent sans éclater et les tirs d’artillerie perdent une partie de leur efficacité. Dans le sol humide, les pièces d’artillerie se désappointent, réclamant un replacement systématique, réduisant de fait la cadence des tirs. Ces situations se rencontrent durant la Grande Guerre. L’artillerie française, dans la Woëvre en avril 1915, se heurte ainsi à ce problème. Les soldats français, lancés à l’attaque de la première ligne allemande, découvrent des réseaux de fils de barbelés et une défense restée intacte (Ibid., p. 27). Pour y faire face, de nouveaux procédés sont généralisés par la suite sur le front. Sur les sols argileux, des types d’obus sont conçus pour éclater au niveau du sol tandis que les armées apprennent à classer les types de terrains selon leurs propriétés naturelles et militaires. Cette catégorisation des couches géologiques est même approfondie à des fins tactiques par le 2èBureau de la VèArmée française pendant la guerre 1914-1918. Comme le montre le tableau 1, celui-ci identifie les qualités des roches avec l’emploi des armes témoignant d’une continuité des réflexions d’avant-guerre en tenant compte des expériences des offensives successives dans la région de Reims.
Document 1 : L’influence des roches géologiques sur l’emploi des armes. Source : 2è Bureau de la Vème Armée française pendant la guerre 1914-1918 (cité dans Villate, 1925, p. 29).
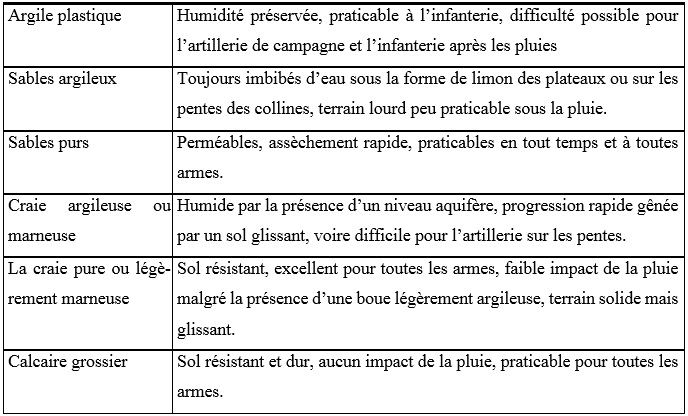
En somme, la géographie militaire française entre 1871 et 1914 se pense par la géologie. Force est de constater qu’elle est, d’abord, envisagée dans le cadre d’une géographie terrestre. La géographie maritime et littorale apparaît marginale tandis que la géographie militaire aérienne n’apparaît qu’à partir de l’Entre-deux-guerres. Ensuite, l’apport de la géologie dans le raisonnement militaire se conçoit à partir de l’idée de mouvement. Il est pris en compte pour l’aménagement du terrain surtout à partir de la Grande Guerre dont la première instruction doctrinale ne date que de 1917. Ce qui importe, avant 1914, est de connaître les possibilités de déplacement des armées sur des axes d’invasion et des théâtres de guerre déjà identifiés. Enfin, la réflexion géographique militaire est centrée sur le continent européen et pour un milieu tempéré ou méditerranéen. Il apparaît peu de connaissances ou d’intérêts stratégiques pour les autres continents. Il est vrai, aussi, que cette conception de la géographie militaire, dépassée à l’entrée en guerre en septembre 1914, présente plusieurs limites.
III- Les limites d’une géologie militaire opérationnelle
A. Une conception déterministe de la géographie
L’école française de géographie militaire est l’une des plus brillantes en Europe, par la diversité des études régionales comme par le nombre d’auteurs (près d’une centaine). Mais elle présente une conception déterministe de la géographie alors que la géographie universitaire s’en détache justement à partir de la fin du XIXe siècle. Jusqu’en 1914, la théorie des joints d’assises terrestres, dont l’expression ne connaît pas de succès après son invention par Fervel, est reprise par bien d’autres auteurs. Le principe a le mérite d’être simple et clair. Tous les éléments d’une société (la population, les ressources, etc.) sont imprimés dans le sol. L’histoire des nations s’explique par la nature du sol et la similitude des terrains constitue la véritable unité de la géographie. Le joint d’assise terrestre se caractérise alors comme le lieu de rencontre de deux types de terrain, donc de deux peuples opposés qui se sont affirmés à la surface de roches homogènes. Cet espace de rencontre est avant tout un espace de heurt, de rivalité et de confrontation. Les guerres, explique son auteur, le colonel Fervel, se déroulent à l’emplacement de ces lieux de transition et peuvent être prévues en conséquence.
Cette théorie des joints d’assises terrestres inspire plusieurs travaux avec des variantes selon les cas. Braeckman et Ducarne, dans Géographie militaire de l’Allemagne, de la Hollande, de la France et de la Belgique (1878), débutent leurs analyses régionales par la géologie et en déduisent, ensuite, les particularités. Chaque unité géologique forme alors un théâtre de guerre qui est ensuite étudié dans ses aspects militaires, comme les fortifications. Le successeur de Théophile Lavallée à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, Bureau, dans la Géographie physique, historique et militaire(1882), considère que la géographie militaire se définit comme l’étude du sol appliquée à l’art de la guerre. Son analyse conduit à comprendre les lignes de fracture, les accidents topographiques qui ont déterminé l’histoire des États. Les grandes vallées apparaissent comme des zones de contact évidentes entre deux joints d’assises terrestres. Lorsqu’il évoque la géographie militaire de la « région française »,il met en évidence les bassins fluviaux comme des entités naturelles homogènes et des lieux de contact entre peuples. Il considère, par exemple, que le bassin du Rhin supérieur, entre le Pô, le Danube et le Rhin moyen, constitue le centre des trois grands théâtres de guerre de l’Europe occidentale. Il fait de la Suisse une « position stratégique des plus remarquables, éminemment favorable à l’offensive, à cause des débouchés qu’elle procure dans chacun de ces bassins » (op. cit., p. 132).
Le bassin du Rhin supérieur s’ouvre vers la vallée du Danube par la ligne Bâle-Schaffouse, vers le Tyrol par Feldkirch, vers le coeur de l’Italie septentrionale par le Splugen ou le Saint-Gothard. Quant aux frontières du Nord-Nord-Est, les limites ne s’alignent pas sur celles des unités physiques, d’où la succession de guerres entre les États depuis le XVIIesiècle. Toutes les démonstrations stratégiques de Bureau s’appuient sur la théorie des lieux de contact, des joints d’assises terrestres, de la correspondance entre les grandes unités naturelles et notamment fluviales.
Toute la conception de la géographie militaire renvoie ainsi au primat de la géologie, c’est-à-dire à l’idée que la composition des roches joue un effet déterminant dans la conduite des opérations. La question que pose l’ensemble des géographes militaires dans leurs travaux respectifs est celle de l’adaptation de la troupe au milieu naturel. Les raisonnements préconçus font partie des connaissances géographiques générales dont doivent disposer les officiers. La finalité de la géographie militaire réside donc dans la préparation de ces éventualités contraignant la conduite des opérations, soit par l’étude des cartes géologiques, soit par l’apprentissage du terrain. Charles Clerc accorde ainsi une place essentielle à la géologie dans ses deux études sur les Alpes et le Jura. Il s’annonce d’ailleurs le fondateur d’une méthode nouvelle qu’il nomme la « géologie militaire »et qui tend à valoriser l’étude des roches et du relief à des fins militaires. Dans les Alpes françaises, études de géologie militaire (1882), il développe plusieurs théories de la défense des Alpes contre l’Allemagne et l’Italie après avoir traité de l’origine et la formation des Alpes (orogénique, configuration, hydrologie, climatologie), la géologie des régions de Savoie, Alpes valdôtaines, Dauphiné et Alpes vaudoises. La géologie militaire se veut d’abord générale et largement inspirée de la géologie pratiquée alors par les membres de la Société de géographie dont il est membre. Le fait militaire n’intervient finalement que sous la forme de conclusion. Dans Le Jura, études de géologie militaire(1888), il privilégie, à partir de la géologie surtout l’étude des axes de passages et les éventuels mouvements d’un adversaire italien.
Cette méthode reposant sur la géologie présente toutefois des limites. D’abord, la complexité relative de la géologie rebute des auteurs comme des lecteurs potentiels, limitant ainsi le foisonnement intellectuel de la fin du siècle. La géologie apparaît être le gage d’une géographie sélective et de qualité. En outre, cette méthode fixe un cadre de réflexion rigide, laissant peu de place à de nouvelles hypothèses. Les théâtres de guerre se rencontrent toujours aux mêmes lieux, certaines régions apparaissent toujours difficilement praticables comme le souligne, en 1892, le Nouveau dictionnaire militaire : « La géologie indique les joints des assises qui composent chaque élément de la surface terrestre, et, par suite, les crêtes ou accidents de terrain susceptibles de constituer de bonnes lignes de défense. Ces joints correspondent à des accidents de terrain ayant une grande valeur au point de vue tactique et stratégique ; aussi l’histoire militaire permet de constater que les grandes batailles se sont livrées très souvent des localités situées aux joints d’assises terrestres. On peut donc dire que si ce n’est pas la géologie elle-même qui influe sur les combinaisons de la guerre, elle n’intervient pourtant indirectement par le relief, par le modelé de la croûte terrestre qu’elle implique. A ce point de vue, elle est le complément nécessaire de la géographie militaire. Un simple coup d’œil jeté sur une bonne carte géologique fera immédiatement connaître les points importants des lignes naturelles de défense ».
B. Une ouverture limitée vers la géographie universitaire
Une autre limite se distingue dans l’élaboration d’une géographie militaire qui se veut opérationnelle et concrète pour le militaire. Celle-ci présente aussi, d’après les sources disponibles, un certain repli sur elle-même, fort éloigné des mutations de la géographie universitaire. Les progrès de la géographie vidalienne ne sont pas connus avant la Grande Guerre. Sous l’impulsion de Paul Vidal de la Blache (1845-1918), de nouvelles conceptions se développent, mettant en valeur le rapport entre l’homme et le milieu, les données de la récente géographie humaine où les concepts de régions naturelles, de genres de vie, de civilisation industrielle et de circulation sont approfondis (3). Le « possibilisme » qui suppose que les conditions physiques de l’espace, qui influencent les sociétés dans leur manière de s’organiser, peuvent aussi être modelées par celles-ci, s’impose au tournant du siècle à la Sorbonne et dans les enseignements de la géographie française dans les facultés. Il tend à remplacer le déterminisme géographique et crée une mutation importante en termes de méthodologie et de raisonnement.
Or celle-ci ne semble pas avoir été connue des géographes militaires à cette époque. Les documentations consultées par les géographes militaires, outre les cartes géologiques et topographiques, s’appuient surtout sur les travaux des géographes allemands du XIXe siècle, les guides de voyage, parfois la Géographie universelle d’Elisée Reclus ou les ouvrages de Levasseur, professeur de géographie économique et de statistiques au Collège de France à partir de 1868. Les géographes militaires ont peu accès aux récents travaux de recherche de l’école vidalienne ou aux numéros de la Revue de géographiede la Société de géographie de Paris (laquelle comprend des officiers de l’armée coloniale mais très peu d’officiers métropolitains), le Bulletin de géographie historique et descriptive ou la nouvelle revue des Annales de géographie créée en 1891. Enfin, ils demeurent attachés à la théorie des bassins fluviaux d’Elie de Beaumont ou de Philippe Buache datant du XVIIIesiècle. Celle-ci apporte un cadre commode sur le plan scientifique pour lequel il est peu envisagé de transformation.
Parallèlement, les géographes militaires, tous officiers de carrière en poste dans des sites militaires à Paris comme en province, n’ont guère le temps ou les moyens de fréquenter les cours de géographie à l’Université. Ils sont presque tous des professeurs de géographie dans des écoles militaires, dont l’instruction s’est effectuée souvent avant la guerre de 1870-1871, autrement dit à une époque où la géographie française est encore largement influencée par la géographie physique et historique. A l’exception de Charles Clerc, qui est membre de la Société de géographie et non professeur, tous ne côtoient pas le milieu universitaire, qui ne comprend d’ailleurs qu’un faible nombre de professeurs en France. La géographie militaire se veut avant tout une géographie appliquée et moins un exercice intellectuel destiné à l’obtention d’un diplôme. Il faut attendre la création de la Commission de géographie au sein du Service de géographie de l’armée, en octobre 1914, pour que les géographes universitaires et les géographes militaires travaillent ensemble sur des notices régionales en Europe intéressant les armées françaises.
Il en résulte un désintérêt pour la géographie universitaire qui apparaît trop moderne, peu de relations avec la communauté des géographes académiques et une Ecole française de géographie militaire isolée qui ne se renouvelle pas à la suite des nouvelles formes de conflits qui apparaissent en Asie orientale ou dans les Balkans au début du XXesiècle. A la veille de la Grande Guerre, les théories de géographie militaire se révèlent inopérantes et ont perdu de leur rayonnement par rapport à la fin du XIXesiècle.
C. Une conception de la géologie réservée au milieu militaire
La géographie militaire française avant 1914 présente cette particularité d’être destinée au seul milieu militaire. Sa diffusion est destinée à un public averti et sensibilisé à des questions stratégiques en vue de préparer la prochaine guerre contre l’Allemagne. En quête de reconnaissance au sein de l’institution militaire, elle s’impose comme un outil pragmatique et concret et articule ses démonstrations à partir de problématiques stratégiques et tactiques. Dans La France par rapport à l’Allemagne(1884), l’auteur anonyme, probablement le colonel Rémy, a conscience de s’adresser à des lecteurs d’abord militaires.« Le travail que nous présentons ici, particulièrement au public militaire, a un objet spécial et restreint qu’il importe de bien définir. C’est une étude, au point de vue stratégique, du territoire de la France par rapport à l’Allemagne (...) » (Anonyme, 1884, p. V). Certains officiers issus des écoles militaires poursuivent cette réflexion et l’enseignent à leur tour devant une nouvelle génération d’élèves-officiers. Bureau, ancien élève de l’Ecole militaire de Saint-Cyr, succède à Théophile Lavallée à la fin des années 1860. Cette diffusion se veut donc réservée aux élites militaires. Elle ne concerne pas un public large, contrairement à la géographie universitaire qui connaît un plus grand rayonnement au sein de la société française.
Les théories précitées, reposant sur l’usage de la géologie à des fins militaires, limitent par leur complexité sa diffusion au-delà de la communauté militaire. Elles exposent la finalité appliquée de la géographie militaire. Celle-ci ne se veut pas uniquement un exercice purement intellectuel mais une discipline concrète, répondant à un besoin d’ordre tactique et stratégique. L’ouvrage de Luzeux sur Le Morvan, étude physique, historique et militaire, publié vraisemblablement dans les années 1880, tend à faire comprendre le rôle stratégique que pourrait jouer le Morvan en cas de guerre. Cette région serait alors une vaste place militaire, une zone de refuge pour effectuer une contre-offensive. Cet essai de géographie militaire répond au besoin de valoriser une région stratégique sous-estimée et revêt un caractère avant tout pratique qui n’intéresse qu’un public de lecteurs avertis.Il témoigne également d’une conception plus problématisée et moins encyclopédique de la discipline qui n’en demeure pas moins réservée à la communauté militaire et éloignée des enjeux de la géographie universitaire.
Pour ces différentes raisons, la géographie militaire renforcée des théories dites scientifiques s’appuyant sur la géologie se limite à un public restreint qui ne parvient déjà plus à convaincre les officiers d’Etat-major à la veille de la guerre. La modernisation des systèmes d’armes, comme l’artillerie ou l’apparition de l’usage de l’avion pour la reconnaissance, ne peut être prise en compte et suscite un autre intérêt au détriment de la discipline géographique. Si la carte d’Etat-major demeure un outil permanent des officiers, la théorie des Joints d’assises terrestres semble avoir été oubliée en raison de sa nature déterministe au sein du milieu militaire.
Entre 1871 et 1914, l’essor de la géographie militaire française est étroitement lié à une conception traditionnelle de la géographie, reposant essentiellement sur sa dimension physique. Cet essor s’inspire de modèles européens, principalement latins et germaniques, qui avaient conçus, au début du XIXe siècle, une discipline géographique opérationnelle contre l’armée napoléonienne, puis comme un savoir stratégique pour tout officier. La défaite française face à la Prusse en 1870-1871 suscite de profondes mutations en faveur de son développement dans les décennies suivantes, dans le cadre de la reconstruction de l’appareil militaire. Une véritable école de pensée française émerge et valorise le raisonnement géographique à des fins militaires.
Or ce raisonnement s’appuie en grande partie sur la géographie physique et sur la géologie que le géographe militaire Charles Clerc invite à renommer, en 1882, par l’expression de Géologie militaire. Si les théories géographiques militaires entretiennent surtout une forme de déterminisme, il n’en demeure pas moins qu’elles ont suscité un certain engouement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elles participent à créer un mouvement de pensée qui connaît son âge d’or durant cette période. A l’entrée en guerre en 1914, elles apparaissent inopérantes sur un plan stratégique. Mais l’usage de la géologie à des fins militaires demeure de premier intérêt dans la guerre de position. La réflexion géographique militaire s’engage alors dans une autre phase de son développement. Tout en conservant un intérêt pour la géographie physique dans son ensemble, elle intègre davantage la géographie humaine à des fins militaires.
Notes
(1) Professeur des universités en géographie à Sorbonne Université. Il est l’auteur, entre autres, de La France devant la conscription1914-1922 (Economica, 2001), La géographie militaire française 1871-1939, (Economica, 2002), Géographie militaire(Ellipses, coll. Carrefour, 2006), Géographie militaire et géostratégie, enjeux et crises du monde contemporain(2015, 2eéd.).
(2) Il en appelle à renoncer à la méthode des bassins hydrographiques, encore suivie dans la géographie militaire de Lavallée. Ces bassins fluviaux ne représentent que des « rayures accidentelles », des « gouttières errantes », une « énumération d’accidents sans suite » qui désespèrent la mémoire.
(3) De 1895 à 1905, Vidal de la Blache, professeur successivement à l’école normale supérieure, aux universités de Nancy et de la Sorbonne à Paris, pose les bases d’une nouvelle géographie qui s’organise en une école de pensée. Il crée lesAnnales de géographieen 1896, encadre de nombreuses thèses, assurant ainsi la pérennité de sa pensée. À partir de 1905, l’école de géographie française est définitivement établie et reconnue dans le monde entier, grâce aux travaux des disciples de Blache, notamment de ceux de Raoul Blanchard, Jules Sion, Camille Vallaux, Jean Bruhnes, Emmanuel de Martonne, Albert Demangeon. Il est à noter que les géographes universitaires ne s’intéressent pas, par ailleurs, à la géographie militaire qui n’est jamais citée.
Bibliographie
Anonyme, 1884, La France par rapport à l’Allemagne, étude de géographie militaire, Bruxelles, Marquardt, 375 p.
Anonyme, 1892, Nouveau dictionnaire militaire par un comité d’officiers de toutes armes, Paris, Baudoin, 854 p.
Barré O., 1897-1899, Cours de géographie, croquis de géographie, Fontainebleau, Ecole d’application.
Barré O., 1899a, La géographie militaire et les nouvelles méthodes géographiques, Introduction à l’Etude de l’Europe centrale et la France du Nord-Est, Paris, Berger-Levrault, 80 et 122 p.
Barré O., 1899b, Cours de géographie, croquis de géographie, Introduction à l’Etude de l’Europe centrale, Paris, Berger Levrault, p. 78.
Clerc C., 1882, Les Alpes françaises, études de géologie militaire, Paris, Lib. Berger-Levrault, 224 p.
Clerc C., 1888, Le Jura, études de géologie militaire, Paris, Berger-Levrault, 215 p.
Coutau-Bégarie H., 1999 (2e éd.), Traité de stratégie, Paris, Economica, 1005 p.
Fervel, Colonel, 1870, « Etudes de géographie stratégique sur le Nord-Ouest de l’Europe », Le spectateur militaire, p. 21.
Fervel, Colonel, 1873 (2e éd.), « Etudes de géographie stratégique », Le Spectateur militaire, juin 1870, pp. 312-332, juillet-septembre 1870, pp. 5-27,
Fervel, Colonel, 1873, Etudes stratégiques sur le théâtre de guerre entre Paris et Berlin, Paris, Dumaine, 152 p.
Lavallée Th., 1832, 1836, 1853 (4e éd.), Géographie physique, historique et militaire, Metz, Roussel Jeune, 612 p.
Niox G.-L., 1876 (1ère éd.), Notions de géologie, de climatologie et d’ethnographie, Paris, Dumaine, 1876, 1878, 1880, 191 p.
Niox G.-L., 1882 (1ère éd.), La France, Paris, Baudoin et Delagrave, 1882 à 1893, 4eme édition, 440 p.
Niox, Commandant, 1878, Géographie militaire, Introduction, Paris, Dumaine, p. 4.
Pichat L., 1876, Géographie militaire du bassin du Rhin, Paris, Delagrave, 304 p.
Villate R., 1925, Les conditions géographiques de la guerre, étude de géographie militaire sur le front français de 1914 à 1918, Paris, Payot, 325 p.